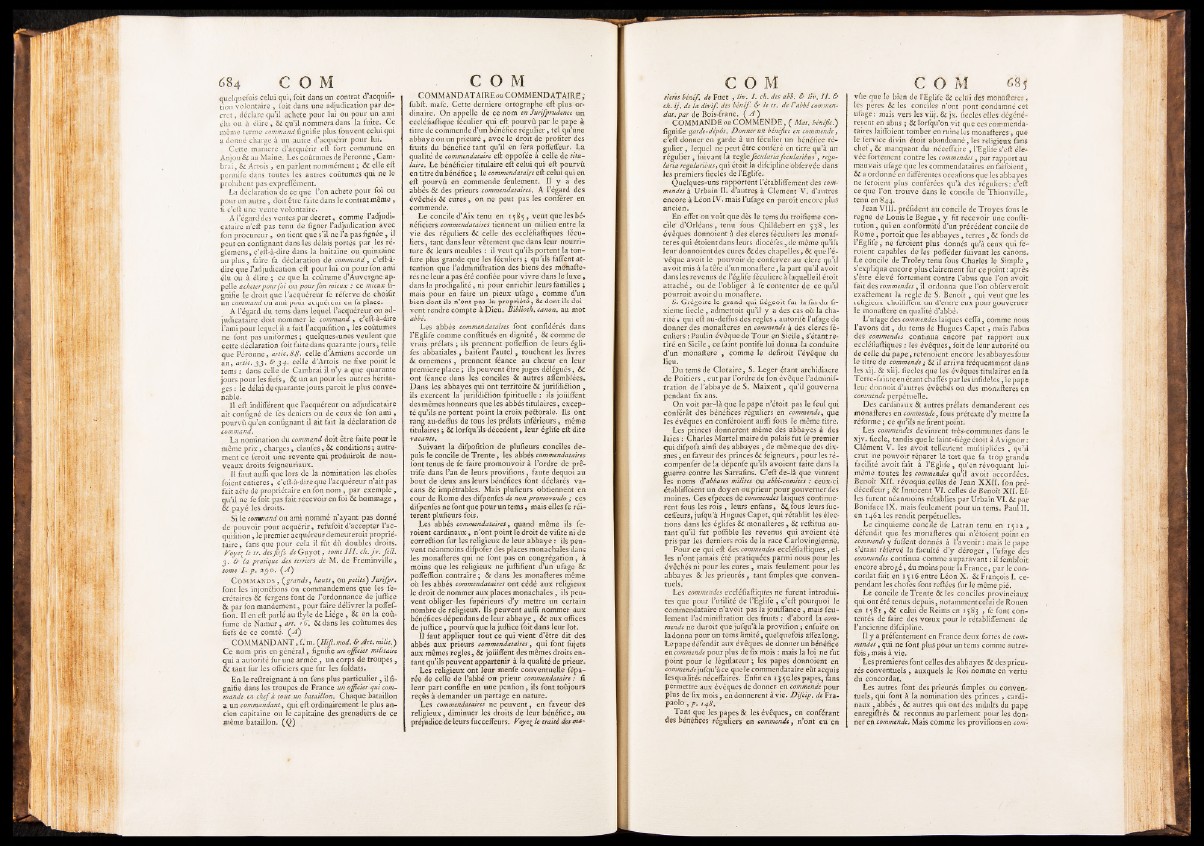
quelquefois celui qui, foit dans un contrat d’acquifi-
tion volontaire , foit dans une adjudication par decret
, déclare qu’il acheté pour lui ou pour un ami
élu ou à élire, & qu’il nommera dans la fuite. Ce
même terme command lignifie plus Couvent celui qui
a donné charge à un autre d’acquérir pour lui.
Cette maniéré d’acquérir eft fort commune en
Anjou & au Maine, Les coutumes de Peronne, Cambrai
, & Artois , en parlent nommément ; &: elle eft
permife dans toutes les autres coûtumés qui ne le
prohibent pas expreffément.
La déclaration de ce que l’on acheté pour foi ou
pour un autre, doit être faite dans le contrat même,
ii c’eft une vente volontaire. 1 .
A l’égard des ventes par decret, comme ^’adjudicataire
n’eft pas tenu de ligner l’adjudication avec
fon procureur, on tient que s’il ne l’a pas lignée , il
peut en çonlignant dans les délais portés par les re-
glemens, c ’eft-à-dire dans la huitaine ou quinzaine
au plus, faire fa déclaration de command, c’eft-à-
dire que l’adjudication eft pour lui ou pour fon ami
élu ou à élire ; ce que la coutume d’Auvergne appelle
acheter pour foi ou pour fon mieux : ce mieux lignifie
le droit que l ’acquéreur fe réferve de choifir
un command ou ami pour acquéreur en fa place.
A l’égard du tems dans lequel l’acquéreur ou adjudicataire
doit nommer le command , c’eft-à-dire
l’ami pour lequel il a fait l’acquifition, les coutumes
ne font pas uniformes ; quelques-unes veulent que
cette déclaration foit faite dans quarante jours, telle
que Péronne, artic. 88. celle d’Amiens accorde un
an, artic. j j . & 34. celle d’Artois ne fixe point le
tems : dans celle de Cambrai il n’y a que quarante
jours pour les fiefs, & un an pour les autres héritages
: le délai de quarante jours paroît le plus convenable.
Il eft indifférent que l’acquéreur ou adjudicataire
ait configné de fes deniers ou de ceux de fon ami,
pourvu qu’en confignant il ait fait la déclaration de
command.
La nomination du command doit être faite pour le
même prix, charges, çlaufes, & conditions ; autrement
ce feroit une revente qui produiroit de nouveaux
droits feigneuriaux.
Il faut auffi que lors de la nomination les chofes
foient entières, c’eft-à-dire que l’acquéreur n’ait pas
fait a&e de propriétaire en fon nom , par exemple ,
qu’il ne fe foit pas fait recevoir en foi & hommage ,
Sc payé les droits.
Si le command ou ami nommé n’ayant pas donné
de pouvoir pour acquérir, refufoit d’accepter l’acquifition
, le premier acquéreur demeureroit propriétaire
, fans que pour cela il fût dû doubles droits.
Voye{ le tr. desfiefs de G uyo t, tome I I I . ch. jv . fecl.
3 . & la pratique des terriers de M. de Freminville,
tome I . p. 2.90. (A~)
CoMMANDS , ( grands, hauts, ou petits) Jurifpr.
font les injonéïions ou commandemens que les fe-
crétaires & fergens font de l’ordonnance de juftice
& par fon mandement, pour faire délivrer la poffef-
fion. Il en eft parlé au ftyle de Liège , & en la coûr
fume de Namur, art. 16'. & dans les coûtumés des
fiefs de ce comté. (A )
COMMANDANT, f.'m. (Hifi. mod. & Art. milit.')
C e nom pris en général, lignifie un officier militaire
qui a autorité fur une armée , un corps de troupes ,
& tant fur les officiers que fur les foldats.
En le reftreignant à un fens plus particulier, il lignifie
dans les troupes de France un officier qui commande
en chef à tout un bataillon. Chaque bataillon
a un commandant, qui eft ordinairement le plus ancien
capitaine ou le capitaine des grenadiers de ce
même bataillon. (Q)
COMMANDATAIREoa COMMEND ATAIRE
fubft. mafe. Cette derniere ortographe eft plus ordinaire.
On appelle de ce nom en Jurifprudence un
eccléfiaftique féculier qui eft pourvû par le pape à
titre de commende d’un bénéfice régulier, tel qu’une
abbaye ou un prieuré , avec le droit de profiter des
fruits du bénéfice tant qu’il en fera poffelfeur. La
qualité de commendataire eft oppofée à celle de titulaire.
Le bénéficier titulaire eft celui qui eft pourvû
en titre du bénéfice ; le commendataire eft celui qui en
eft pourvû en commende feulement. Il y a des
abbés & des prieurs commendataires. A l’égard des
évêchés & cures, on ne peut pas les conférer en
commende.
Le concile d’Aix tenu en 1585, veut que les bénéficiers
commendataires tiennent un milieu entre la
vie des réguliers & celle des eccléfiaftiques fécu-
liers, tant dans leur vêtement que dans leur nourriture
& leurs meubles : il veut qu’ils portent la ton-
fure plus grande que les féculiers ; qu’ils faffent attention
que l’adminiftration des biens des m<$hafte-
rés ne leur a pas été confiée pour v ivre dans le luxe ,
dans la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ;
mais pour en faire un pieux ufage, comme d’un
bien dont ils n’ont pas la propriété, & dont ils doivent
rendre compte à Dieu. Biblioth. canon, au mot
abbé.
Les abbés commendataires font confidérés dans
l’Eglife comme conftitués en dignité, & comme de
vrais ■ prélats ; ils prennent poffeflion de leurs égli-
fes abbatiales , baifent l’au te l, touchent les livres
& ornemens, prennent féance au choeur en leur
première place ; ils peuvent être juges délégués, &
ont féance dans les conciles & autres affemblées.
Dans les abbayes qui ont territoire & jurifdiâion ,
ils exercent la jurifdiftion fpirituelle : ils joiiiffent
des mêmes honneurs que les abbés titulaires, excepté
qu’ils ne portent point la croix pe&orale. Ils ont
rang au-deffus de tous les prélats inférieurs, même
titulaires ; & lorfqu’ils décèdent, leur églife eft dite
vacante.
Suivant la difpofition de plufieurs conciles depuis
le concile de Trente, les abbés commendataires
font tenus de fe faire promouvoir à l’ordre de prê-
trife dans l’an de leurs provifions, faute dequoi au
bout de deux ans leurs bénéfices font déclarés va-
cans & impétrables. Mais plufieurs obtiennent en
cour de Rome des difpenfes de non promovendo ; ces
difpenfes ne font que pour un tems, mais elles fe réitèrent
plufieurs fois.
Les abbés commendataires, quand même ils fe-
roient cardinaux, n’ont point le droit de vifite ni de
correftion fur les religieux de leur abbaye : ils peuvent
néanmoins difpofer des places monachales dans
les monafteres qui ne font pas en congrégation, à
moins que les religieux ne juftifient d’un ufage &
poffeflion contraire ; & dans les monafteres même
où les abbés commendataires ont cédé aux religieux
le droit de nommer aux places monachales, ils peuvent
obligerv les fupérieurs d’y mettre un certain
nombre de religieux. Us peuvent aufli nommer aux
bénéfices dépendans de leur abbaye, & aux offices
de juftice, pourvû que la juftice foit dans leur lot.
Il faut appliquer tout ce qui vient d’être dit des.
abbés aux prieurs commendataires, qui font fujets
aux mêmes réglés, & joiiiffent des mêmes droits entant
qu’ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.
Les religieux ont leur menfe conventuelle fépa-
rée de celle de l’abbé ou prieur commendataire : fi
leur part confifte en une penfion, ils font.toûjours
reçus à demander un partage en nature.
Les commendataires ne peuvent, en faveur des
religieux, diminuer les droits de leur bénéfice, au
préjudice de leurs fucceffeurs. Vyye^ le traité des matitres
èénéf. de Fiiet , liv. I. ch. des abb. & Uv. II. &
ch. ij. de la divifi dés bénèf. & le tr. de l'abbé commen-
dat.par de Bois-franc. ( A )
COMMANDE ou COMMENDE, ( Mat. bènèfic.)
fignifie garde-dépôt. Donner un bénéfice en commende,
c’eft donner en garde à un feculier un bénéfice régulier
, lequel ne peut être conféré en titre qu’à un
régulier, luivant la réglé feculariafecularibus , regu-
laria regularibus, qui étoit la difeipline obfervée dans
les premiers fiecles de l’Eglife.
Quelques-uns rapportent l’établiffement des corti-
mendes à Urbain II. d’autres à Clement V. d’autres
encore à Léon IV. mais l’ufage en paroît encore plus
ancien.
En effet on voit que dès le tems du troifieme concile
d’Orléans, tenu fous Çhildeberr en 5 3 8 , les
évêques donnoient à des clercs féculiers les monafteres
qui étoientdans leurs diocèfes., de même qu’ils
leur donnoient des cures &des chapelles, & que l’évêque
avoit le pouvoir de conferver au clerc qu’il
avoit mis à la tête d’un monaftere, la part qu’il avoit
dans les revenus de l’églife féculiere à laquelle il étoit
attaché, ou de l’obliger à fe contenter de ce qu’il
pourroit avoir du monaftere.
S. Grégoire le grand qui fiégeoit fur la fin du fi-
xieme fiecle , admettoit qu’il y a des cas où la charité
» qui eft au-deffus des réglés, autorife l’ufage de
donner des monafteres en commende à des clercs féculiers
: Paulin évêque de Tour en S icile, s’étantre-
tiré en Sicile, ce feint pontife lui donna la conduite
d’un monaftere , comme le defiroit l’évêque du
lieu.
Du tems de Clotaire, S. Leger étant archidiacre
de Poitiers , eut par l’ordre de fon évêque l’adminif-
tration de l ’abbaye de S. Maixent, qu’il gouverna
pendant fix ans.
On voit par-là que le pape n’étoit pas le feul qui
conférât des bénéfices réguliers en commende, que
les évêques en conféroient aufli fous le même titre.
Les princes donnèrent même des abbayes à des
laïcs : Charles Martel maire du palais fut le premier
qui difpofa ainfi des abbayes , de même que des dix-
mes, en faveur dès princes & feigneurs, pour les ré-
compenfer de la dépenfe qu’ils a voient faite dans la
guerre contre les Sarrafins. C ’eft de-là que vinrent
les noms à'abbates milites ou abbi-comites : ceux-ci
établiffoient un doyen ou prieur pour gouverner des
moines. Ces efpeces de commendes laïques continuèrent
fous les rois , leurs enfans, lous leurs fucceffeurs,
jufqu’à Hugues Capet, qui rétablit les élections
dans les églifes & monafteres , & reftitua autant
qù’il fut poflible les revenus qui avoient été
pris par les derniers rois de la race Carlovingienné.
Pour ce qui eft des commendes eccléfiaftiques, elles
n’ont jamais été pratiquées parmi nous pour les
évêchés ni pour les cures, mais feulement pour les
abbayes & les prieurés, tant Amples que conventuels.
Les commendes eccléfiaftiques ne furent introduites
que pour l’utilité de l’Eglife , c’eft pourquoi le
commendataire n’avoit pas la jouiffance , mais feulement
l’adminiftration des fruits : d’abord la commende
ne duroit que jufqu’à la provifion ; enfuite on
la donna pour un tems limité, quelquefois affezlong.
Le pape défendit aux évêques de donner un bénéfice
en commende pour plus de fix mois : mais la loi ne fut
point pour le légiflateur ; les papes donnoient en
commende jufqu’à ce que le commendataire eût acquis
les qualités néceffaires. Enfin en 13 foies papes, fans
permettre aux évêques de donner en commende pour
plus de fix mois, en donnèrent à vie. Difcip. de Fra-
paolo ,/>. 148.
Tant que les papes & les évêques, en conférant
des bénéfices réguliers en commende, n’ont eu en
vue que le bien de l’Eglife & celui des riiOhâfteres ,
les peres & les conciles n’ont pont condamné cet
ufage : mais vers les viij. & jx. fiecles elles dégénérèrent
en abus ; & lorfqu’on vit que ces commendataires
laiffoient tomber en ruine les monafteres, que
le fervice divin étoit abandonné, les religieux fans
ch ef, & manquant du néceffaire , l’Egliie s’eft éle-
vee fortement contre les commendes, par rapport au
mauvais ufage que les commendataires en faifoient,
& a ordonné en différentes occafions que les abbayes
ne feroient plus conférées qu’à des réguliers: c’efi:
ce que l’on trouve dans le concile de Thionville,
tenu en 844.
Jean VIII. préfident dit concile de Troyës fous le
régné de Louis le Begue, y fit recevoir une confti-
tution, qui en conformité d’un précédent concile de
Rome j portoit que les abbayes , terres, & fonds de
1 E glife,- ne feroient plus donnés qu’à ceux qui feroient
capables de les pofféder fuivant les canons*
Le Concile de Troley tenu fous Charles le Simple ,
s’expliqua encore plus clairement fitr ce point: après
s’être elevé fortement contre l’abus que l’on avoit
fait des commendes, il ordonna que l’on obferveroît
exactement la réglé de S. Benoit, qüi veut que les
religieux choififfent un d’entre eux pour gouverner
le monaftere en qualité d’abbé*
L’ufege des commendes laïques cefla, comme nous
l’avons d it , du tems de Hugues C a p e t , mais l’abus
des commendes continua encore par rapport aux
eccléfiaftiques : les évêques , foit de leur autorité ou
de celle du pape, retenoient encore les abbayes fous
le titre de commende ; & if arriva fréquemment dans
les xij. & xiij* fiecles que les évêques titulaires en la
Terre-fainte en étant châffés par les infidèles, le pape
leur donnoit d’autres évêchés ou des monafteres en
commende perpétuelle.
Des cardinaux & autres prélats demandèrent ces
monafteres en commende, fous prétexte d’y mettre la
réforme ; ce qu’ils rie firent point.
Les commendes dèvinrèrit très-commtiries dans le
xj v. fiecle, tandis que le faint-fiége étoit à Avignon :
Clément V. les avoit tellement multipliées , qu’il
crut ne pouvoir réparer lé tort que fa trop grande
facilité avoit fait à l’Eglife , qu’en révoquant luî-
même. toutes les commendes qu’il avoit accordées.
Benoît XII. révoqua, celles de Jean XXII. fonpré-
déceffeur ; & Innocent VI. celles de Benoît XII. Elles
furent néanmoins rétablies par Urbain VI. & par
Boniface IX. mais feulement pour un tems. Paul II.
en 146 z les rendit perpétuelles.
Le cinquième coneilë de Latran tenu en 1 5 1 2 ,
défendit que les monafteres qui n’étoient point en
commende y fuffent donnés à l’avenir: mais le pape
s’étant réfervé la faculté d’y déroger, l’ufege des
commendes continua comme auparavant : il fembloit
encore abrogé, du moins pour la France, par le concordat
fait en 1516 entre Léon X . & François I. cependant
les choies font reftées fur le même pié.
Le concile de Trente & lès conciles provinciaux
qui ont été tenus depuis, notamment celui de Rouen
en 15 8 1 , & celui de Reims en 1583 , fe font contentes
de faire des voeux pour le rétabliffement de
l’ancienne difeipline.
Il y a préfentement en France deux fortes de commendes
, qui ne font plus pour un tems comme autrefois
*.mais â vie.
Les premières font celles des abbayes & des prieurés
conventuels, auxquels le Roi nomme ën vertu
du concordat.
Lès autres font des prieurés fimples ou conventuels,
qui font à la nomination des princes , cardi-*
naux , abbés, & autres qui ont des induits du pape
enregiftrés & reconnus au parlement pour les donner
en commendci Mais comme les provifions en com*