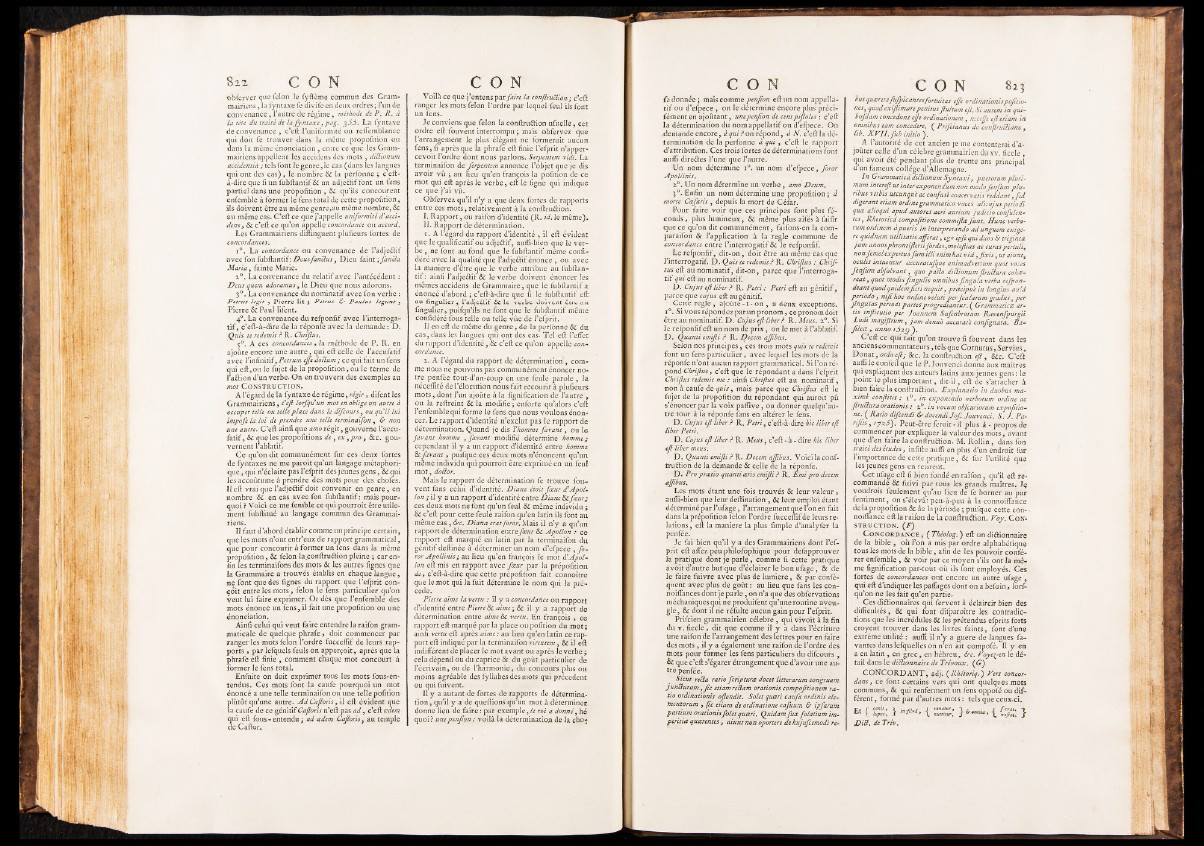
obfervef q u e félon le fyftème commun des Grammairiens
, la fyntaxe fe divife en deux ordres ; l’un de
convenance, l’autre de régime, méthode de P. R. à
la tête du traité de la fyntaxe, pag. jS à . La fyntaxe
de convenance , c’eft l ’uniformité ou reifemblance
qui doit fe trouver dans la même propofition ou
dans la même énonciation , entre ce .que les Grammairiens
appellent les accidens des mots -, diclionum
accidentia ; tels font le genre, le cas (dans les langues
qui ont des cas) , le nombre 6c la perfonne ; c’eft-
à-dire que fi un fubftantif & un adje&if font un fens
partiel dans une propofition , & qu’ils concourent
enfemble à former le fens total de cette propofition,
ils doivent être au même genre,au même nombre, &
au même cas. C ’eft ce que j’appelle uniformité d'accidens
3 & c’eft ce qu’on appelle concordance ou accord.
Les Grammairiens diftinguent plufieurs fortes de
concordances,
i° . La concordance ou convenance de l’adjeâif
avec fon fubftantif: Deusfanclus, Dieu faint ; fancla
Maria, fainte Marie.
2°. La convenance du relatif avec l’antécédent :
Deus quem adoramus, le Dieu que nous adorons.
3°. La convenance du nominatif avec fon verbe :
Petrus le g i t , -Pierre lit ; Petrus & Paulus legunt ,
Pierre & Paul lifent.
4°. La convenance du refponfif avec l’interrogat
if , c’eft-à-dire de la réponfe avec la demande : D.
(fuis te rede mit? R. Chriflus.
5°. A ces concordances, la méthode de P. R. en
ajoute encore une autre, qui eft celle de l’accufatif
avec l’infinitif, Petrum ejfe doclum; ce qui fait un fens
qui eft,ou le fujet de la propofition, ou le terme de
l’aâion d’un verbe. On en trouvera des exemples au
mot C o n s tr u c t io n .
A l’égard de la fyntaxe de régime, régir , difent les
Grammairiens, défi lorfqiüun mot en oblige un autre à
occuper telle ou telle place dans le difeours, ou qu'il lui
impofe la loi de prendre une telle terminaifon , & non
une autre. C ’eft ainfi que amo régit, gouverne l’accufatif,
&c que les propofitions de, ex 9 pro , &c. gouvernent
l’ablatif.
Ce qu’on dit communément fur ces deux fortes
de fyntaxes ne me paroît qu’un langage métaphorique
, qui n’éclaire pas l’efprit des jeunes gens, & qui
les accoutume à prendre des mots pour des chofes.
Il eft vrai que l’adje&if doit convenir en genre, en
nombre & en cas avec fon fubftantif : mais pourquoi
} V oici ce me femble ce qui pourroit être utilement
fubftitué au langage commun des Grammairiens.
Il faut d’abord établir comme un principe certain,
que les mots n’ont entr’eux de rapport grammatical,
que pour concourir à former un fens dans la même
propofition, & félon la.conftru&ion pleine ; car enfin
les terminaifons des mots & les autres lignes que
la Grammaire a trouvés établis en chaque langue,
ne font que des lignes du rapport que l’efprit conçoit
entre les mots, félon le fens particulier qu’on
veut lui faire exprimer. Or dès que l’enfemble des
mots énonce un fens, il fait une propofition ou une
énonciation.
Ainfi celui qui veut faire entendre la raifon grammaticale
de quelque phrafe , doit commencer par
ranger les mots félon l’ordre fucceflif de leurs rapports
, par lefquels feuls on apperçoit, après que la
phrafe eft finie , comment chaque mot concourt à
former le fens total.
Enfuite on doit exprimer tous les mots fous-en-
tendus. Ces mots font la caufe pourquoi un mot
énoncé a une telle terminaifon ou une telle pofition
plutôt qu’une autre. AdCafloris, il eft évident que
la caufe de ce génitif Cafloris n’eft pas ad, c’eft oedem
qui eft fous - entendu ; ad oedem Cafloris y au temple
de Caftor,
Voilà ce que j’entens par faire la conflruction ; c’eft
ranger les mots félon l ’ordre par lequel feul ils font
un fens.
Je conviens que félon la conftru&ion ufuelle, cet
ordre eft fouvent interrompu ; mais obfervez que
l’arrangement le plus élégant ne formeroit aucun
fens, fi après que la phrafe eft finie l’efprit n’apper-
cevoit l’ordre dont nous parlons. Serpentent vidi. La
terminaifon de ferpentem annonce l’objet que je dis
avoir vu ; au lieu qu’en françois la pofition de ce
mot qui eft après le verbe, eft le ligne qui indique
ce que j’ai vu.
Obfervez qu’il n’y a que deux fortes de rapports
entre ces mots, relativement à laconftruftion.
I. Rapport, ou raifon d’identité (R. id. le même).
II. Rapport de détermination.
i . A l’égard du rapport d’identité , il eft évident
que le qualificatif ou adje&if, aufii-bien que le verbe
, ne font au fond que le fubftantif même confi-
déré avec la qualité que l’adjeûif énonce , ou avec
la maniéré d’être que le verbe attribue au fubftantif:
ainfi l’adje&if & le verbe doivent énoncer les
mêmes accidens de Grammaire, que le fubftantif a
énoncé d’abord ; c’eft-à-dire que fi le fubftantif eft
au fingulier, l’adjeûif & le verbe doivent être au
fingulier, puifqu’ils ne font que'le fubftantif même
confidéré fous telle ou telle vue de l’efprit.
Il en eft de même du genre, de la perfonne & du
cas, dans les langues qui ont des cas. Tel eft l’effet
du rapport d’identité c’eft ce qu’on appelle concordance.
z. A l’égard du rapport de détermination, comme
nous ne pouvons pas communément énoncer notre
penfée tout-d’un-coup en une feule parole , la
néceflité de l’élocution nous fait recourir à plufieurs
mots, dont l’un ajoute à la fignification de l’autre ,
ou la reftreint & la modifie ; enforte qu’alors c’eft:
l’enfemble qui forme le fens que nous voulons énoncer.
Le rapport d’identité n’exclut pas le rapport de
détermination. Quand je dis Yhomme favant, ou le
J avant homme , favant modifié détermine homme;
cependant il y a un rapport d’identité entre homme
favant , puifque ces deux mots n’énoncent qu’un
même individu qui pourroit être exprimé en un feul
mot, doclor.
Mais le rapport de détermination fe trouve fou-
vent fans celui d’identité. Diane étoit foeur d?Apollon
; il y a un rapport d’identité entre Diane & foeur;
ces deux mots ne font qu’un feul & même individu ;
& c’eft pour cette feule raifon qu’en latin ils font au
même c a s , &c. Diana erat foror. Mais il n’y a qu’un
rapport de détermination entre foeur & Apollon : ce
rapport eft marqué en latin par la terminaifon du
génitif deftinée à déterminer un nom d’efpece , fo ror
Apollinis; au lieu qu’en françois le mot 8Apollon
eft mis en rapport avec foeur par la prépofition
de, c’eft-à-dire que cette prépofition fait connoître
que le mot qui la fuit détermine le nom qui la précédé.
Pierre aime la vertu : il y a concordance ou rapport
d’identité entre Pierre & aime ; & il y a rapport de
détermination entre aime & vertu. En françois , ce
rapport eft marqué parla place ou pofition du mot;
ainfi vertu eft après aime : au lieu qu’en latin ce rapport
eft indique par la terminaifon virtutem, & il eft
indifférent de placer le mot avant ou après le verbe ;
cela dépend ou du caprice & du goût particulier de
l’écrivain, ou de l’harmonie, du concours plus ou
moins agréable des fyllabes des mots qui précèdent
ou qui fuivent.
Il y a autant de fortes de rapports de détermination,
qu’il y a de queftions qu’un mot à déterminer
donne lieu de faire: par exemple,le roi a donné, hé
quoi ? une penflon : voilà la détermination de la chofe
donnée ; mais comme penflon eft un nom appella-
tif ou d’efpece , on le détermine encore plus préci-’
fément en ajoutant, une penflon de cent pifloles : c’eft
la détermination du nom appellatif ou d’efpece. On
»demande encore, à qui ? on répond, à N. c’eft la détermination
de la perfonne à q u i, c’eft le rapport
d’attribution. Ces trois fortes de déterminations font
auffi direâes l’une que l ’autre.
Un nom détermine i°. un nom d’efpece, foror
Apollinis.
2°. Un nom détermine un v erbe, amo Deum.
3°. Enfin un nom détermine une propofition; à.
morte Coefaris , depuis la mort de Célar.
Pour faire voir que ces principes font plus féconds
, plus lumineux, & même plus aifés à faifir
que ce qu’on dit communément, faifons-en la com-
paraifon & l’application à la réglé commune de
concordance entre l’interrogatif & le refponfif.
Le refponfif, dit-on, doit être au même cas que
l’interrogatif. D . (fuis te redemit? R. Chriflus : Çhrif-
tus eft au nominatif, dit-on, parce que l’interrogatif
qui eft au nominatif.
D. Cujus efl liber ? R. Pétri : Pétri eft au génitif,
parce que cujus eft au génitif.
- Cette réglé , ajou te-t-on , a deux exceptions. •
i°. Si vous répondez par(un pronom, ce pronom doit
être au nominatif. D. Cujus efl liber ? R. Meus. 2°. Si
le refponfif eft un nom de prix, on le met à l’ablatif.
D . Quanti emifti ? R. Decem afflbus.
Selon nos principes, ces trois mots quis te redemit
font un fens particulier, avec lequel les mots de la
réponfe n’ont aucun rapport grammatical. Si l’on répond
Chriflus, c’eft que le répondant a dans l’efprit
Chriflus redemit me : ainfi Chriflus eft au nominatif,
non à caufe de quis, mais parce que Chriflus éft le
fujet de la propofition du répondant qui auroit pu
s’énoncer par la voix p aflive, ou donner quelqu’aù-
tre tour à fa réponfe fans en altérer le fens.
D. Cujus èfl liber ? R. Pétri, c’eft-à-dire hic liber efl
liber Pétri.
D. Cujus efl liber ? R. Meus, c’eft - à - dire hic liber
efl liber meus.
D . Quanti emifli ? R. Decem afflbus. Voici la conf-
truftion de la demande & celle de la réponfe.
D. Pro proetio quanti ans emifli? R. Emi pro decem
afflbus.
Les mots étant une fois trouvés & leur valeur,
auffi-bien que leur deftination , & leur emploi étant
déterminé par l’ufage, l’arrangement que l’on en fait
dans la prépofition félon l’ordre fucceflif de leurs relations
, eft la maniéré la plus fimple d’analyfer la
penfée.
Je fai bien qu’il y a des Grammairiens dont l’efprit
eft allez peu pmlofophique pour defapprouver
la pratique dont je parlé, comme fi cette pratique
àvôit d’autre but que d’éclairer le bon ufage, & de
le faire fuivre avec plus de lumière, & par confé-
quent avec plus de goût : au lieu que fans les con-
noiffances dont je parle, on n’a que des obfervations
méchaniques qui ne produifent qu’une routine aveugle
, & dont il rie réfulte aucun gain pour l’efprit.
Prifcien grammairien célébré , qui vivoit à la fin
dit v . fiecle, dit que comme il y a dans l’écriture
Une raifon de l’arrangement des lettres pour en faire
des mots , il y a également une raifon de l’ordre des
mots pour former les fens particuliers du difeours ,
& que c’eft s’égarer étrangement que d’avoir une autre
penfée.
Sicut recla ratio feripturoe docet litterarum congruam
Juncluram , fle etiam reclam orationis compofltionem ratio
ordinationis oflendit. Solet quoeri cattfa ordinis ele-
mentorum , fie etiam de ordinatione cafuurn & ipfarum
partium orationisfolet quoeri. Quidam fuoe folatiumim-
peritioe quoerentes , aiuntnon oportere dehujujcemodi rebus
quoererefufpicam es fortuit as effe ordinationispofitio-
nés, quod exiflimare penitus ftultum efl. Si autem in qui-
bufdam çoncedunt efje ordinationem , necefle efl etiam in
omnibus eam concedere. ( Prifcianus de conflruclione ,
lib. X P I I .fu b initio ) . 1
f l l’autorité de cet ancien je me contenterai d’ajouter
celle d’un célébré grammairien du xv. fiecle ,
qui avoit été pendant plus de trente ans principal
d’un fameux college d’Allemagne.
In Grammaticâ diclionum Syntaxi} puerorum pluri-
mum interefl ut inter exponendum non modo fenfum plu-
ribus verbis utcunque ac confusè coacervatis reddant 3fed
digérant etiam ordine grammatico. voces alicujus periodi
quoe alioqui apud autores acri durium judicio confulen-
tes y Rhetoricd compofitione commifloe funt. Uunc verbo•
rum ordinem apueris in interpretando ad unguem exige-
re quidnam utilitatis afferat, ego ipfe qui duos & triginta
jam annosphrontiflerii for des, moleflias ac curas pertuli,
non femel expertus fum illi enim hac via , flx is , ut aiunti
oculis intuentur accuratufque ànimadvertum quot voces
fenfum abfolvant, quo paclo diclionum flruclura cohoe-
reat, quot modis flngulis omnibus flngula verba refpon-
deant quod quidem fieri nequit, proecipuï in longius aulâ
periodo , nifl hoc ordine veluti per Jcalarum gradus, per
fingulas periodi partes progrediantur. ( Grammaticoe ar-
tis inflitutio per Joannem Sufenbrotum Ravenfpurgii
Ludi magiflrum, jam denub accurate conflgnata. B a-
fileoe , anno iflzc) ).
C eft ce qui fait qu’on trouve fi fouvent dans les
anciens commentateurs, tels que Cornutus, Servius,
Donat, ordo efl; &c. la conftruftion efl , & c . C ’eft
aufli le confeil que le P. Jouvenci donne aux maîtres
qui expliquent des auteurs latins aux-jeunes gens: le
point le plus important, dit-il, eft de s’attacher à
bien faire la eonftruftion. Explanatio in duobus maxime
conflitit ; i° . in exponendo verborum ordine ac
flruclura orationis c 2°. in vocum obfcuriorum expofitio-
ne. ( Ratio difeendi & docendi Jof. Jouvenci. S. J. Pa-
riflis y ty zSj. Peut-être fëroit-il plus à - propos de
commencer par expliquer la valeur des mots, avant
que d’en faire la conftruéHon. M. Rollin , dans fon
traite des études, infifte aufli en plus d’un endroit fur
1 importance de cette pratique, & fur l’utilité que
les jeunes gens en retirent.
Cet ufage eft fi bien fondé en raifon, qu’il eft recommandé
& fuivi par tous les grands maîtres. Je
voudrois feulement qu’au lieu de fe borner au pur
fentiment, on s’élevât peu-à-peu à la connoiffance
de la propofition & de la période ; puifque cette con--
noiflîance eft la raifon de la conftruftion. Voy. C ons
tr u c t io n . (F )
C o n co r d an c e , ( Théolog. ) eft un diéfionnaire
de la bible , oit l’on a mis par ordre alphabétique
tous les mots de la bible, afin de les pouvoir conférer
enfemble , & voir par ce moyen s’ils ont la même
fignification par-tout oix ils font employés. Ces
fortes de concordances ont encore un autre ufage ,
qui eft d’indiquer les paffages dont on a befoin, lorsqu’on
ne les lait qu’en partie.
Ces di&ionnaires qui fervent à éclaircir bien des
difficultés, & qui font difparoître les contradictions
que les incrédules & les prétendus efprits forts
croyent trouver dans les livres faints , font d’une
extrême utilité : auffi il n’y a guère de langues fa-
vantes dans lefquelles on n’en ait compofé. Il y en
a en latin , en grec, en hébreu, &c. Poye^-en le détail
dans le dictionnaire de Trévoux. (G)
CO NCO RD AN T , adj. ( Rhétoriq. ) Per s concor-
dans, ce font certains Vers qui ont quelques mots
communs, & qui renferment un fens oppofé ou différent
, formé par d’autres mots : tels que ceux-ci.
Et } * — . { Ü3S . >
Di cl, de Trév.