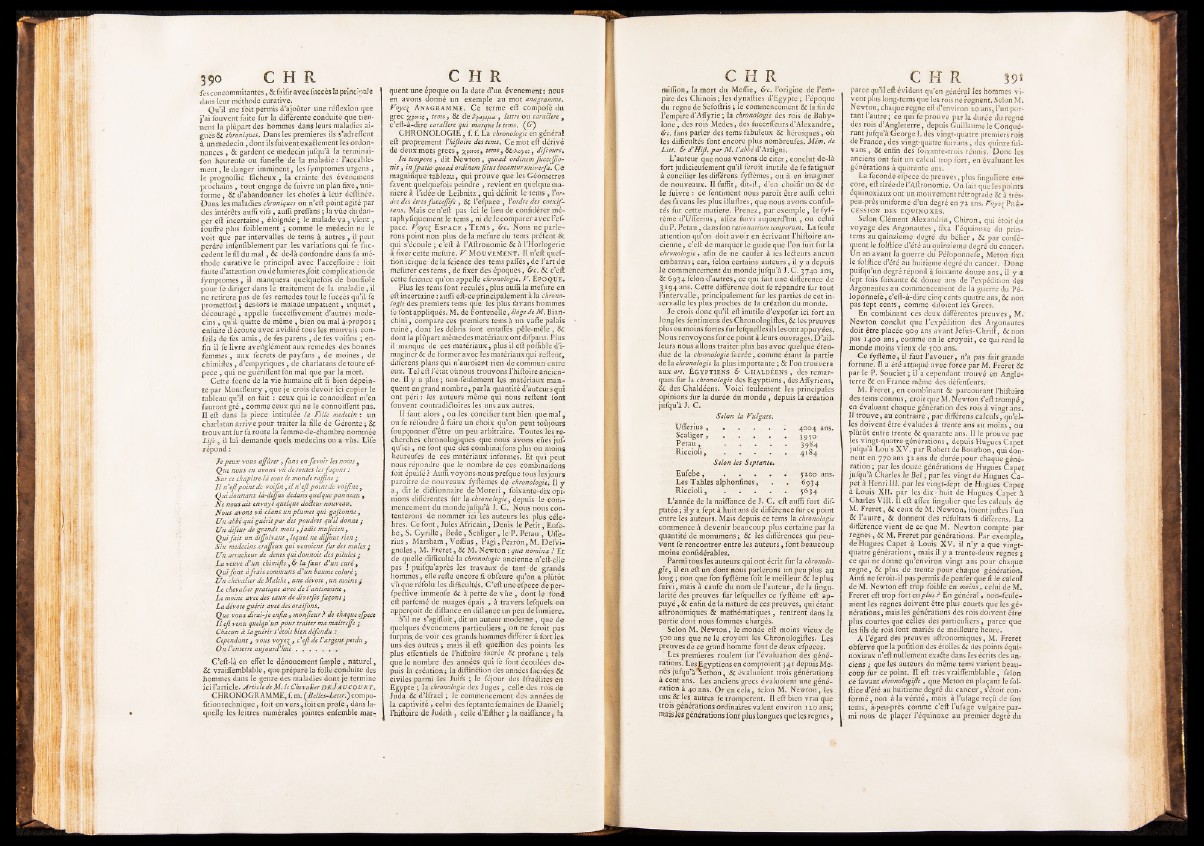
fesconcommitantes, &faifiravecfuccès la principale
•dans leur méthode curative.
Qu’il me foit permis d’ajouter line réflexion que
j’ai fouvent faite fur la différente conduite que tiennent
la plupart des hommes dans leurs maladies aigues
6c chroniques. Dans les premières ils s’adreffent
A un médecin, dont ils fuivent exaâement les ordonnances
, & gardent ce médecin jufqu’à la terminaison
heureul'e ou funefte de la maladie : l’accablement
, le danger imminent, les fymptomes urgens,
le prognoftic fâcheux , la crainte des évenemens
prochains , tout engage de fuivre un plan fixe, uniforme
, 6c d’abandonner les chofes à leur deftinée.
Dans les maladies chroniques on n’eft point agité par
des intérêts aufli vifs , aufli preffans ; la vue du danger
eft incertaine, éloignée ; le malade v a , v ien t,
louffre plus foiblement ; comme le médecin ne le
voit que par intervalles de tëms à autres , il peut
perdre infenfiblement par les variations qui fe Succèdent
le fil du mal, 6c de-là confondre dans fa méthode
curative le principal avec l’accefloire : foit
faute d’attention ou de lumières,foit complication de
fymptomes, il manquera quelquefois de bouflole
pour fe diriger dans le traitement de la maladie, il
ne retirera pas de fes remedes tout le fuccès qu’il fe
promettoit ; dès-lors le malade impatient, inquiet,
découragé , appelle fucceffivement d’autres médecins
, qu’il quitte de même , bien ou mal à-propos ;
enfuite il écoute avec avidité tous les mauvais con-
feils de fes amis, de fes parens, de fes voifins ; enfin
il fe livre aveüglément aux remedes des bonnes
femmes, aux fecrets de payfans , de moines, de
chimiftes , d’empyriques , de charlatans de toute ef-
p e c e , qui ne guériffent fon mai que par la mort.
Cette fcene de la vie humaine eft fi bien dépeinte
par Montfleury , que je crois devoir ici copier le
tableau qu’il en fait : ceux qui le connoiffent m’en
fauront gré , comme ceux qui ne le connoiffent pas.
Il eft dans la piece intitulée la Fille médecin : un
charlatan arrive pour traiter la fille de Géronte ; 6c
trouvant fur fa route la femme-de-chambre nommée
Life , il lui demande quels médecins on a vus. Life
répond :
Je peux vous affùrer, fans en favoir les noms ,
Que nous en avons vu de toutes les façons ;■
Sur ce chapitre-là tout le monde raffine j
I l n e f point de Voifin, il n eft point de voijîne,
Qui donnant là-deffius dedans quelque panneau ,
Ne nous ait envoyé quelque docteur nouveau.
Nous avons vû. céans un plumet qui gafconne ,
Un abbé qui guérit par des poudres qu'il donne ;
Un difeur de grands mots , jadis mufcien ,
Qui fait un diffolvant, lequel ne dijfout rien ;
Six médecins craffieux qui venoient fur des mules ;
Un arracheur de dents qui donnoit des pilules ;
La veuve d'un chimifie ,& la futur d'un curé ,
Qui font à frais communs d'un baume coloré ;
Un chevalier de Malthe, une dévote, un moine ç
Le chevalier pratique avec de l'antimoine ,
Le moine avec des eaux de diverfes façons ;
La dévote guérit avec des oraifons.
Que vous dirai-je enfin » monjieur? de chaque efpece
IL eft venu quelqu'un pour traiter ma maîtreffe ;
Chacun à laguérir s'étoit bien défendu :
Cependant» vous voye^ ycêjt de l'argent perdu ,
On l'enterre aujourd'hui.................. .
C ’eft-là en effet le dénouement fimple , naturel,
& vraiffemblable, que.prépar’e la folle conduite des
hommes dans le genre des maladies dont je termine
ici l’article. ArticledeM. le Chevalier d e J AU co u r t .
CHRONOGRAMME, f. m. {Belles-Lettré) compo-
fitiontechnique, foit en vers, loit en p rofe, dans laquelle
les lettres numérales jointes enfemble marquent
une époque ou la date d’un événement : flous
en avons donné un exemple au mot anagramme.
Voye^ An a g r am m e . Ce terme eft compofé du
grec xpov°t > tems , & de S'pap/xa , lettre ou caractère p
c’eft-à-dire caractère qui marque le tems. {G)
CHRONOLOGIE, f. f. La chronologie en général
eft proprement Yhiftoire des tems. Ce mot eft dérivé
de deux mots grecs, xpovoc, tems, , difcours.
In tempore , dit Newton, quoad ordinem fucceffio-
nis , in fpatio quoad ordinem fitus locantur univerfa. Cô
magnifique tableau, qui prouve que les Géomètres
favent quelquefois peindre , revient en quelque maniéré
à l’idée de Leibnitz, qui définit le tems , Vordre
des êtres fucceffifs , 6c l’efpace , Yordre des coexif-
tans. Mais ce n’eft pas ici le lieu de confidérer mé-
taphyfiquement le tems, ni dé le comparer avec l’efi
pace. Voye^ Espace >Tem s , &c. Nous ne parlerons
point non plus de la mefure du tems prêtent &
qui s’écoule ; c ’eft à l’Aftronomie & à l’Horlogerie
à fixer cette mefure. V. Mo u v em en t . Il n’eft question
ici que de la fcience des tems paffés, de l’art de
mëfurer ces tems, de fixer des époques, &c. 6c c’eft
cette fcience qu’on appelle chronologie. V. Époque.
Plus les tems font reculés, plus aufli la mefure en
eft incertaine : aufli eft-ce principalement à la chronologie
des premiers tems que les plus farans hommes
fe font appliqués. M. de Fontenelle, éloge de M. Bian-
chini, compare ces premiers tems à un vafte palais
ruiné, dont les débris font entafles pêle-mêle , 6c
dont la plûpart même des matériaux ont difparu. Plus
il manque de ces matériaux, plus il eft poflible d’imaginer
& de former avec les matériaux qui retient,
diftèrens plans qui n’auro'ieot rien de commun entre
eux. Tel eft l’état où nous trouvons l’hiftoire ancienne.
Il y a plus ; non-feulement les matériaux manquent
en grand nombre, parla quantité d’auteurs qui
ont péri : les auteurs même qui nous retient font
fouvent coutradiéloires les uns aux autres.
Il faut alors , ou les concilier tant bien que mal,
oufe réfoudre à faire un choix qu’on peut toujours
foupçonner d’être un peu arbitraire. Toutes les recherches
chronologiques que nous avons eues juf*
qu’i c i , ne font que des combinaifons plus ou moins
heureufes de ces matériaux informes. Et qui peut
nous répondre que le nombre de ces combinaifons
foit épuifé ? Aufli voyons-nous prefque tous les jours
paroître de nouveaux fyftèmes de chronologie. Il y
a , dit le diélionnaire deMoreri, foixante-dix opinions
différentes fitr la chronologie, depuis le commencement
du monde jufqu’à J. G. Nous nous contenterons
de nommer ici les auteurs les plus célébrés.
Ce font, Jules Africain, Denis le P etit, Eufe-
be, S. Cyrille, Bede, Scaliger, le P. Petau , Ufle-
rius, Marsham, Voflxus, Pagi, Pezrôn, M. Defvi-
gnoles, M. Freret, & M. Newton : quct nomina ! Et
de quelle difficulté la chronologie ancienne n’eft-elle
pas ! puifqu’après les travaux de tant de grands
hommes, elle relie encore fi obfcure qu’on a plûtot
vu que réfolu les difficultés. C ’eft une efpece de per-
fpeâive immenfe 6c à perte de vue , dont le fond
eft parfemé de nuages épais , à travers lefquels on
apperçoit de diftance en diftance un peu de lumière.
S’il ne s’agilfoit, dit un auteur moderne , que de
quelques évenemens particuliers , on ne feroit pas
lurpris. de voir ces grands hommes différer fi fort les
uns des autres ; mais il eft queftion des points les
plus effentiels de l’hiftoire facrée 6c profane ; tels
que le nombre des années qui fe font écoulées depuis
la création; la diftinâion des années facrées 6c
civiles parmi les Juifs ; le féjour des Ifraélites en
Egypte ; la chronologie des Juges , celle des rois de
Juda 6c d’Ifrael ; le commencement des années de
la captivité , celui des feptantefemaines de Daniel ;
l’hiftoire de Judith, celle d’Efther ; la naiflance, la
miflion, la mort du Meflie, &c. l’origine de l’empire
des Chinois ; les dynafties d’Egypte ; l’époque
du régné de Sefoftris ; le commencement 6c la fin de
l’empire d’Aflyrie ; la chronologie des rois de Baby-
lone, des rois Medesy des fucceffeurs d’Alexandre,
&c. fans parler des tems fabuleux 6c héroïques, où
les difficultés font encore plus nombreufes. Mém. de
Litt. & d'HiJt. par M. l'abbé d’Artigni.
L’auteur que nous venons de citer, conclut de-là
fort judicieulement qu’il feroit inutile de fe fatiguer
à concilier les différens fyftèmes, ou à en imaginer
de nouveaux. Il fuffit, dit-il, d’en choifir un 6c de
le fuivre : ce fentiment nous paroît être aufli celui
des fa vans les plus illuftres, que nous avons conful-
tés fur cette matière. Prenez, par exemple, le fy f-
tème d’Uflerius, aflez fuivi aujourd’h u i, ou celui
du P. Petau, dans fon rationariurn temporum. La feule
attention qu’on doit avoir en écrivant l’hiftoire ancienne
, c’eft de marquer le guide que l’on fuit fur la
chronologie, afin de ne eaufer à les letteurs aucun
embarras ; car, félon certains auteurs, il y a depuis
le commencement du monde jufqu’à J. C. 3740 ans,
& 6934 félon d’autres, ce qui fait une différence de
3194 ans. Cette différence doit fe répandre fur tout
l’intervalle, principalement fur les parties de cet intervalle
les plus proches de la création du monde.
Je crois donc qu’il eft inutile d’expofer ici fort au
long les fentimens des Chronologiftes, 6c les preuves
plus ou moins fortes fur lefquelles ils les ont appuyées.
Nous renvoyons fur ce point à leurs ouvrages. D ’ailleurs
nous allons traiter plus bas avec quelque étendue
de la chronologie facrée , comme étant la partie
de la chronologie la plus importante ; & l’on trouvera
aux art. Ég ypt iens & C haldéens , des remarques
fur la chronologie des Egyptiens, des Aflyriens,
6c des Chaldéens. Voici feulement les principales
opinions fur la durée du monde, depuis la création
jufqu’à J. C.
Selon la Vulgate.
Uflerius , , 4004 ans.
Scaliger, . . . . . 3950
Petau , ................................. 3984
Riccioli............................................ 4184
Selon les Septante.
Eufebe, . . . . - * 5200 ans.
Les Tables alphonfines, ■ 6934
Ric cioli, ................................. 0 3 4
L’année de la naiflance de J. C . eft aufli fort dif-
piitée ; il y a fept à huit ans de différence fur ce point
entre les auteurs. Mais depuis ce tems la chronologie
commence à devenir beaucoup plus certaine par la
quantité de monumens ; 6c les différences qui peuvent
fe rencontrer entre les auteurs, font beaucoup
moins confidérables.
Parmi tous les auteurs qui ont écrit fur la chronologie
, il en eft un dont nous parlerons un peu plus au
long ; non que fon fyftème foit le meilleur 6c le plus
fûivi, mais à caufe du nom de l’auteur, de la Angularité
des preuves fur lefquelles ce fyftème eft appuyé
, & enfin de la nature de ces preuves, qui étant
aftronomiques & mathématiques , rentrent dans la
partie dont nous fommes chargés.
Selon M. Newton, le monde eft moins vieux de
5O0 ans que ne le croyent les Chronologiftes. Les
preuves de ce grand homme font de deux efpeces.
Les premières roulent fut dévaluation des générations.
LesEgyptiens en comptoient 341 depuis Menés
jufqu’à bethon, 6c évaliioient trois générations
à cent ans. Les anciens grecs évaluOient une génération
à 40 ans. Or en cela,, félon M. Newton, les
uns & les autres fe trompèrent. Il eft bien vrai que
trois générations ordinaires valent environ 1 20 ans;
mais les générations font plus longues que les régnés,
parce qu’il eft évident qu’en général les hommes v ivent
plus long-tems que les rois ne régnent. Selon M.
Newton, chaque régné eft d’environ 20 ans, l’un portant
l’autre ; ce qui fe prouve par la durée du régné
des rois d’Angleterre, depuis Guillaume le Conquérant
jufqu’à George I. des vingt-quatre premiers rois
de France, des vingt-quatre fuivans, des quinze fui*
vans , 6c enfin des foixante-trois réunis. Dortc les
anciens ont fait un calcul trop fort, en évaluant les
générations à quarante ans.
La fécondé efpece de preuves, plus fingulieré en*
core, eft tirée de l’Aftronomie. On fait que les points
équinoxiaux ont un mouvement rétrograde 6c à très*
peu-près uniforme d’un degré en 72 ans. Foyer Précession
DES EQUINOXES.
Selon Clément Alexandrin, Chiron, qui étoit du
voyage des Argonautes , fixa l’équinoxe du prin-
tems au quinzième degré du bélier , 6c par confé-
quent le folftice d’été au quinzième degré du cancer.
Un an avant la guerre du Péloponnefe, Meton fixa
le folftice d’été au huitième degré du cancer. Donc
puifqu’un degré répond à foixante-douze ans , il y a
fept fois foixante 6c douze ans de l’expédition des
Argonautes au commencement de la guerre du Péloponnefe
, e’eft-à-dire cinq cents quatre ans, 6c non
pas fept cents, comme difoient les Grecs.
En combinant ces deux différentes preuves, M*
Newton conclut que l ’expédition des Argonautes
doit être placée 909 ans avant Jefus-Chrift, & non
pas 1400 ans, comme on le croyoit, cê qui rend le
monde moins vieux de 560 ans.
Ce fyftème, il faut l’avouer, n’a pas faitgrandé
fortune. II a été attaqué avec force par M. Fretet 6c
par le P. Souciet ; il a cependant trouvé en Angleterre
6c en France même des défenfeuts.
M* Freret, en combinant & parcourant Phiftoire
des tems connus, croit que M. Newton s’eft trompé j
en évaluant chaque génération des rois à vingt ans.
Il trouve, au contraire , par différens calculs, qu’elles
doivent être évaluées à trente ans ait moins, ou
plutôt entre trente & quarante ans. Il le prouve par
les vingt-quatre générations, depuis Hugues Capet
jufqu’à Louis X V . par Robert de Bourbon, qui donnent
en 770 ans 32 ans de durée pour chaque génération
; par les douze générations de Hugues Capet
jufqu’à Charles le Bel ; par les vingt de Hugues Capet
à Henri III. par les vingt-fept de Hugues Capet
à Louis XII. par les dix - huit de Hugues Capet à
Charles VIII. Il eft aflez fingulier que les calculs de
M. Freret, 6c ceux de M. Newton, foient juftes l’un
& l’autre, & donnent des réfultats fi différens. La
différence vient de ce que M. Newton compte par
régnés, & M. Freret par générations. Par exemple,
de Hugues Capet à Louis X V . il n’y a que vingt-
quatre générations, mais il y a trente-deux régnés ;
ce qui ne donne qu’environ vingt ans pour chaque
régné, 6c plus de trente pour chaque génération.
Ainfi ne feroit-il pas permis de peflfer que û le calcul
de M. Newton eft trop foible en moins, celui de M.
Freret eft trop fort en plus ? En général, non-feulement
les régnés doivent être plus courts que les générations,
mais les générations des rois doivent être
plus courtes que celles des particuliers , parce que
les fils de rois font mariés de meilleure heure.
A l’égard des preuves aftronomiques, M. Freret
obferve que la pofition’ des étoiles & des points équinoxiaux
n’eft nullement exaôe dans les écrits des anciens
; qtie les aüteürs du même tems varient beaucoup
fiir ce point. Il eft très-vraiffemblable , félon
ce favant chronologifle , que Meton en plaçant le folftice
d’été au huitième degré du cancer, s’étoit conformé
, non à la v érité, mais à l’ufage reçu de fon
tenrs, à-peu-près comme c’eft l’ufage vulgaire parmi
nous de plaçer l’équinçxe au premier degré du