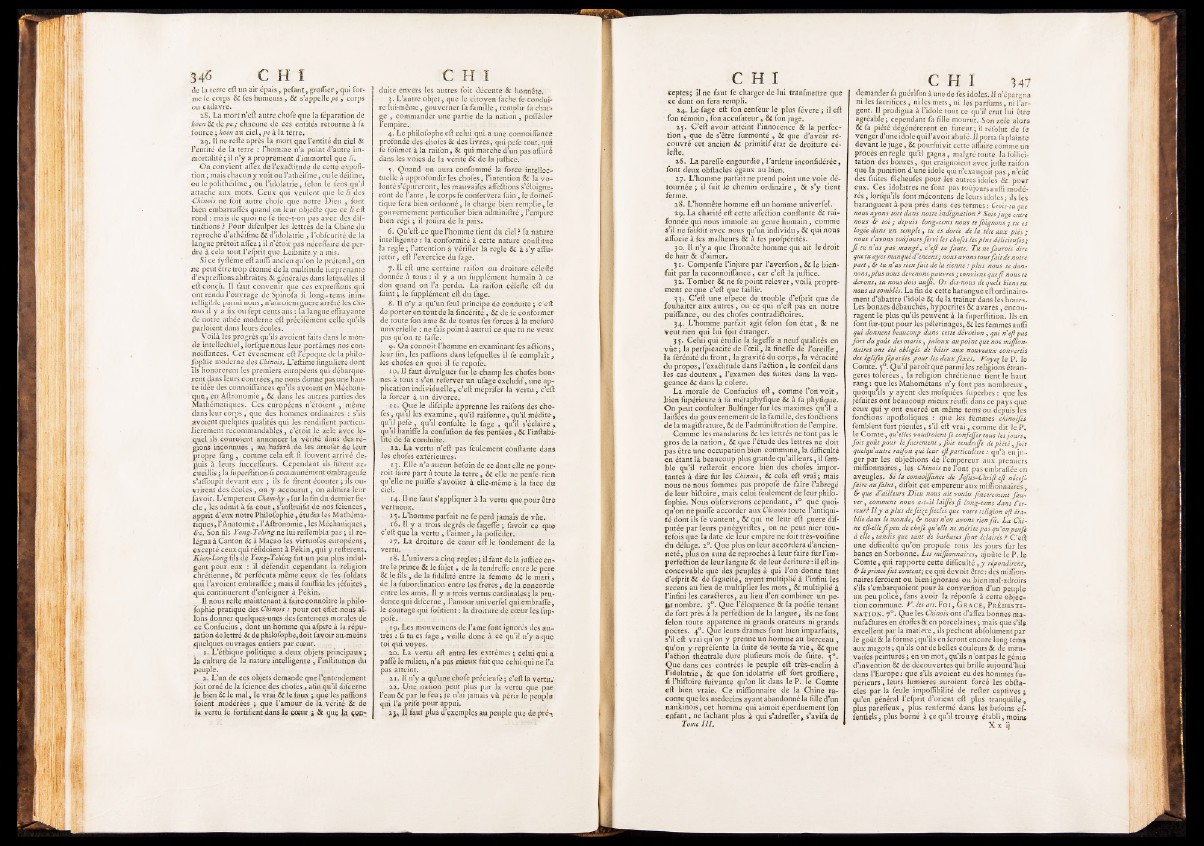
g£ € H I
de la terre eft un air épais, pefant, groffier, -qui'forme
Ie corps & fes humeurs, & s’appellepe , corps
ou cadavre.
28. La mort n’ell autre chofe que la réparation de
hoen & de pe.; chacune de ces entités retourne à fa
fource y hoen au ciel ,pe à la terre.
'29. Il ne refte après la mort que l’entité du ciel &
l’entité de la terre : l’homme n’a point d’autre immortalité
; il n’y a proprement d’immortel que li.
On convient affez de l’exaÛitude de cette expofi-
tion ; mais chacun y voit ou l’athéifme, ou le déilme,
ou le polithéifme, ou l’idolâtrie, félon le fens qu’il
attache aux mots. Ceux qui veulent que le li des
Chinois ne foit autre chofe que notre Dieu , font
bien embarralfés quand on leur objeéte que ce li eft
rond : mais de quoi ne fe tire-t-on pas avec des dif-
tinélions ? Pour difculper les lettrés de la Chine du
reproche d’athéifme & d’idolâtrie , l ’obfcurité de la
langue prêtoit alfez ; il n’étoit pas néceffaire de perdre
à cela tout l’efprit que Leibnitz y a mis.
Si ce fyftème eft auffi ancien qu’on le prétend, on
ne peut être trop étonné de la multitude furprenante
d’exprelîions abftraites & générales dans lefquelles il
eft conçu. Il faut convenir que ces expreffions qui
ont rendu l’ouvrage de Spinofa fi long-tems inintelligible
parmi nous, n’auroient guere arrêté les Chinois
il y a fix ou fept cents ans : la langue.effrayante
de notre athée moderne eft précifément celle qu’ils
parloient dans leurs écoles.
Voilà les progrès qu’ils avoient faits dans le monde
intellectuel, lorfque nous leur portâmes nos con-
rioiffances. Cet événement eft l’époque de la philp-
fophie moderne des Chinois. L ’eftime finguliere dont
Ils honorèrent les premiers européens qui débarquèrent
dans leurs contrées , ne nous donne pas une haute
ideè des connoiffa'nces qu’ ils avoient en Mé.chani-
quq, en- Aftronomie , •& dans les autres parties des
Mathématiques. Ces européens n’étôient , même
dans leur corps, que des hommes ordinaires : s’ils
avoient quelques qualités qui les rendiffent particulièrement
recommandables, c’étoit le zele avec lequel
ils çouroient annoncer la vérité dans des régions
inconnues , aurhafard de les arrofer-de leur
propre fang, comme cela eft fi fou vent .arrivé de--
puis à ,leurs fuccefféurs. Cependant ils .firent accueillis
; là fuperftition fi communément ombrageufe
s’affoupit devant eux ; ils fe firent écouter ; ils ouvrirent
des écoles , on y accourut, on admira leur
/avoir. L’empereur Cham-hy, fur la fin du dernier fie-
c le , les admit à fa cour, s’inftruifit de nos fciences,
apprit d’eux notre Philofophie, étudia les Mathématiques
, l’Anatomie, l’Aftronomie, les Méchaniques,
&c. Son fils Yong-Tching ne lui reffembla pas ; il relégua
à Canton & à Macao les virtuofes européens,
excepté ceux qui réfidoient à Pékin, qui y refterent.
Kien-Long fils de Yong-Tchingfut un peu plus indulgent
pour eux : il défendit cependant la religion
chrétienne, & perfécuta même, ceux de fes foldats
qui l’a voient embraffée ; mais il fouffrit-.les jéfuites,
qui continuèrent d’enfeigner à Pékin. ;
Il nous refte maintenant à faire connoître la philofophie
pratique des Chinois : pour cet. effet , nous allons
donner quelquesrunes des fentenees morales de
ce Confucius , dont un homme qui afpiféà la réputation
de lettré & de philofophe,doit fayoir au-moins
quelques ouvrages entiers par coeur. :
1. L’éthique politique a deux objets : principaux ;
Ja culture de la nature intelligente , l’inftitution du
peuple.
.. 2, L’un de ces objets demande que l’entendement
/oit orné de la fcience des chofes, afin qu’il difcerne
le bien & le m al, le vrai & le faux ; que les pallions
/oient modérées ; que l’amour de la vérité & de
la vertu fe fortifient dans le coeur „ & que la çoa-
C H I
dnite envers les autres foit décente & honnête.
3. L’autre objet, que le citoyen fâche fe condui»
re lui-même, gouverner fa famille, remplir fa charge
, commander une partie de la nation, pofféder
l’empire.
4. Le philofophe eft celui qui a une connoiffancô
profonde des chofes & des livres, qui pefe tout, qui
fe foûmet à la raifon, & qui marche d’un pas affuré
.dans les voies de la vérité & de la juftice.
5. Quand on aura confommé la force intellectuelle
à approfondir les chofes, l’intention & la vo lonté
s’épureront, les mauvaifes affeétions S’éloigneront
de l’ame, le corps fe conferVera fain, le domef-
tique fera bien ordonné, la charge bien remplie, le
gouvernement particulier bien adminiftré, l’empire
bien régi ; il jouira de la paix.
6. Qu’eft-ce que l’homme tient du ciel? la nature
intelligente : la conformité à cette nature conftitue
la réglé ; l’attention à vérifier la réglé & à s’y affu-
jettir, eft l’exercice du fagé.
7. Il eft une certaine raifon ou droiture céleftè
donnée à tous : il y a un fupplément humain à ce
don quand on l’a perdu. La raifon célefte eft du
faint ; le fupplément eft du fage.
8. Il n’y a qu’un feul principe de conduite ; c ’eft
de porter en tout de la fincérite, & de fe conformer
de toute fon ame & de toutes fes forces à la mefurô
uni ver le lie : ne fais point à autrui ce que tu ne veux:
pas qu’on te faffe.
9. On connoît l’homme en examinant fes avions,
leur fin, les pallions dans lefquelles il fe complaît,
les chofes en quoi il fe repofe.
10. Il faut divulguer fur le champ les chofes bonnes
à tous : s’en referver un ufage exclufif, une application
individuelle, c’eft méprifer la vertu, c’eft:
la forcer à un divorce.
i i> Que le difciple àpprenrie les raifons des chofes
j qu’il les examine, qu’il raifonne, qu’il médite ,
qu’il p e fe , qu’il confulte le fage , qu’il, s’éclaire ,
qu’il baniffe la confufion de fes penfées , & l’inftabi-
lité de fa conduite.
i2. La vertu n’eft pas feulement confiante dans
les chofes extérieures.
j 3 ■ Elle n’a aucun befoin de ce dont elle ne pour-
roit faire part à toute la terre, & elle ne penfe rieil
qu’elle ne puiffe s’avoiier à elle-même à la face du
ciel. /
14. Il ne faut s’appliquer à la vertu que pour être
vertueux.
15. L’homme parfait ne fe perd jamais de vue.
, 16. Il y a trois degrés de fageffe ; favoir ce que
c’eft que la v ertu , l’aimer, la pofféder..
17. La droiture de coeur eft le fondement de la
vertu.
18. L ’univers a cinq réglés ; il faut de là juftice entre
le prince & le fiijet, de la tendreffe entre le pere
& le fils, de la fidélité entre la femme & le mari,
de Ja fubordination entre les freres, de la concorde
entre les amis. Il y a trois vertus cardinales ; la prudence
qui difcerne,, l’amour univerfel qui embraffe,
le courage qui foûtient : la droiture de coeur les fup-
pofe. :
19. Les mouveinens de l’ame font ignorés des au-
'tres : fi tu es fage , veille donc à ce qu’il n’y a que
toi qui voyes.
. 20. La vertu eft entré les extrêmes ; celui qui a
paffé le milieu, n’a pas mieux fait que celui qui ne l’a
pas atteint.
21. Il n’y a qu’une chofe précieufe; c’eft la vertu.’
22. Une nation peut plus par la vertu que par
l’eau & par le feu ; je n’ai jamais vû périr le peupla
qui l’a prife pour appui.
2.3, U faut plus d’çxemples au peuple que de pré-.
C H I
ceptes; il ne faut fe charger de lui trânfmettre que
ce dont on fera rempli.
24. Le fage eft fon cenfeur le plus févere ; il eft
fon témoin, fon accufateur, &i fon juge.
2 f. C ’eft avoir atteint l’innocence & la perfection
, que de s’être furmonté , & que d’avoir recouvré
cet ancien & primitif état de droiture célefte.
26. La pareffe engourdie, l ’ardeur inconfidérée,
font deux obftacies égaux au bien.
27. L’homme parfait ne prend point une voie détournée
; il fuit le chemin ordinaire, & s’y tient
ferme.
28. L’honnête homme eft un homme univerfel.
29. La charité eft cette affeCtion confiante & rai-
fonnée qui nous immole au genre humain, comme
s’il ne faifoit avec nous qu’un individu, & qui nous
affocie à fes malheurs & à fes profpérités.
30. Il n’y a que l’honnête homme qui ait le droit
de haïr & d’aimer.
31. Compenfe l’injure par l’averfion, & le bienfait
par la reconnoiffance, car c’eft la juftice.
32. Tomber & ne fe point relever, voilà proprement
ce que c’eft que faillir.
33. C ’eft une eîpece de trouble d’efprit que de
fouhaiter aux autres, ou ce qui n’eft pas en notre
puiffance, ou des chofes contradictoires.
34. L ’homme parfait agit félon fon é ta t, & ne
veut rien qui lui fgit étranger.
3 ç. Celui qui étudie la fageffe a neuf qualités en
vûe ; la perfpicacité de l’oe il, la fineffe de l’oreille,
la férénité du front, la gravité du corps, la véracité
du propos, l’exaflitude dans l’aCtion, le confeil dans
les cas douteux, l’examen des fuites dans la vengeance
& dans 1# colere.
La morale de Confucius e f t , comme l’on v o it ,
bien fupérieure à fa métaphyfique & à fa phyfique.
On peut confulter Bulfinger fur les maximes qu’il a
laiffées du gouvernement de la famille, des fondions
de la magiftrature, & de l’adminiftration de l’empire. !
Comme les mandarins & les lettrés ne font pas le
gros de la nation, & que l’étude des lettres ne doit
pas être une occupation bien commune, la difficulté
en étant là beaucoup plus grande qu’ailleurs, il fem-
ble qu’il refteroit encore bien des chofes importantes
à dire fur les Chinois, & cela eft vrai ; mais
nous ne nous fommes pas propofé de faire l’abregé
de leur hiftoire, mais celui feulement de leur philofophie.
Nous obferverons cependant, i° que quoiqu’on
ne puiffe accorder aux Chinois toute l’antiquité
dont ils fe vantent, & qui ne leur eft guere dif-
putée par leurs panégyriftes, on ne peut nier toutefois
que la date de leur empire ne foit très-voifine
du déluge. 20. Que plus on leur accordera d’ancienneté,
plus on aura de reproches à leur faire fur l’im-
perfeftion de leur langue & de leur écriture : il eft inconcevable
que des peuples à qui l’on donne tant
d’efprit & de fagacité, ayent multiplié à l’infini les
accens au lieu de multiplier les mots, Sc multiplié à
l ’infini les câra&eres, au lieu d’en combiner un petit
nombre. 30. Que l’éloquence & la poéfie tenant
de fort près à la perfe&ion de la langue, ils ne font
. félon toute apparence ni grands orateurs ni grands
poètes. 40. Que leurs drames font bien imparfaits,
s’il eft vrai qu’on y prenne un homme au berceau ,
qu’on y repréfente la fuite de toute fa v ie , & que
l’a&ion théâtrale dure plufieurs mois de fuite. ç°.
Que dans ces contrées le peuple eft très-enclin à
l’idolâtrie, & que fon idolâtrie eft* fort groffiere,
fi l’hiftoiré fuivante qu’on lit dans le P. le Comte
eft bien vraie. Ce millionnaire de la Chine raconte
que les médecins ayant abandonné la fille d’un
nankinois, cet homme qui aimoit éperduement fon
enfant, ne fachant plus à qui s’adreffer, s’avifa de
Tome III.
C H I U7
demander la guérifon à Une de fes idoles, il n*êpargna
ni les facrifices, ni les mets, ni les parfums, ni l’argent.
Il prodigua à l’idole tout ce qu’il crut lui être
agréable ; cependant fa fille mourut. Son zele alors
& fa piété dégénérèrent en fureur ; il réfolut de fe
venger d’une idole qui l’a voit abufé. Il porta fa plainte
devant le juge, & pourfuivit cette affaire comme ua
procès en réglé qu’il gagna, malgré toute la follici-
tation des bonzes, qui craignoient avec jufte raifon
que la punition d’une idole qui n’exauçoit pas, n’eût
des fuites fâcheufes pouf les autres idoles & pour
eux. Ces idolâtres ne font pas toujours auffi modérés
, lorfqu’ils font mécontens de leurs idoles ; ils les
haranguent à-peuprès dans ces termes: Crois-tu que
nous ayons tort dans notre indignation ? Sois juge entre
nous & toi ; depuis Long-tems nous te /oignons ; tu es
logée dans un temple , tu es dorée de la tête aux piés ;
nous t'avons toujours fervi les chofes les plus délicieufes;
f i tu nas pas mangé, c'efi ta faute. Tu ne faurois dire
que tu ayes manqué d'encens; nous avons tout fait de notre
part, & tu n'as rien fait de la tienne : plus nous te donnons,
plus nous devenons pauvres j conviens que f i nous te
devons, tu nous dois aujji. Or dis-nous de quels biens tu
nous as comblés. La fin de cette harangue eft ordinairement
d’abattre l’idole & de la traîner dans les boues.
Les bonzes débauchés, hypocrites & avares , encouragent
le plus qu’ils peuvent à la fuperftition. Ils en
font fur-tout pour les pèlerinages, & lés femmes auffi
qui donnent beaucoup dans cette dévotion , qui n'efi pas
fort du goût des maris, jaloux au point que nos mifjion-
tiaires orit été obligés de bâtir aux nouveaux convertis
des èglifes féparéts pour les deux fexes. Voyez le P. 1®
Comte. 50. Qu’il paroît que parmi les religions étrangères
tolérées, la religion chrétienne tient le haut
rang : que les Mahométans n’y font pas nombreux ,
quoiqu’ils y ayent des mofquées fuperbes : que les
jéfuites ont beaucoup mieux réuffi dans ce pays que
ceux qui y ont exercé en même tems ou depuis fes
fondions apoftoliques : que les femmes chinoifes
femblent fort pieufes, s’il eft v ra i, comme dit le P.
le Comte, qu'elles voudroient fe confejjer tous les jours,
foit goût pour le facrement, foie tendreffe de piété, foit
quelqiüautre raifon qui leur efiparticulière : qu’à en juger
par les obje&ions de l’empereiir aux premièrs
millionnaires, les Chinois ne l’ont pas embraffée en
aveugles. Si la connoiffance de Jefus-Chrifi efi nécej-
faire aufalut, difoit cet empereur aux miffionnairés,
& que d'ailleurs Dieu nous ait voy.lu fincerement fau-
ver, comment nous a-t-il laijfés f i long-tems dans T erreur
é I l y a plus de feiçc ficelés que votre religion eft établie
dans le monde, & nous rien avons rien fû. La Chine
cjl-elle f i peu de chofe quelle ne mérite pas qu'on penfe
à elle , tandis que tant de barbares font éclairés ? C ’eft
une difficulté qu’on propofe tous les jours fur les
bancs en Sorbonne. Les miffionnairés, ajoute le P. le
Comte, qui rapporte cette difficulté , y répondirent,
& le prince fut content; ce qui devoit être : des mîffion-
naires feroient ou bien ignorans ou bien mal-adrôits
s’ils s’embarquoient pour la converfion d’un peuple
un peu policé, fans avoir la réponfe à cette objection
commune. V. les art. F o i, G r â c e , Préde st in
a t io n . 70. Que les Chinois ont d’affez bonnes manufactures
en étoffes & en porcelaines ; mais que s’ils
excellent par la matière, ils pechent abfolument par
le goût & la forme ; qu’ils en feront encore long-tems
aux magots ; qu’ils ont de belles couleurs & de màu-
vaifes peintures ; en un mot, qu’ils n’ont pas le génie
d’invention & de découvertes qui brille aujourd’hui
dans l’Europe : que s’ils avoient eu des hommes fu-
périeurs, leurs lumières auroient forcé les obftacies
par la feule impoffibilité de refter captives ;
qu’en général l’efprit d’orient eft plus tranquille,
plus pareffeux, plus renfermé dans les befoins ef-
fentiels, plus borné à çe qu’il trouve établi, moins
X x ij