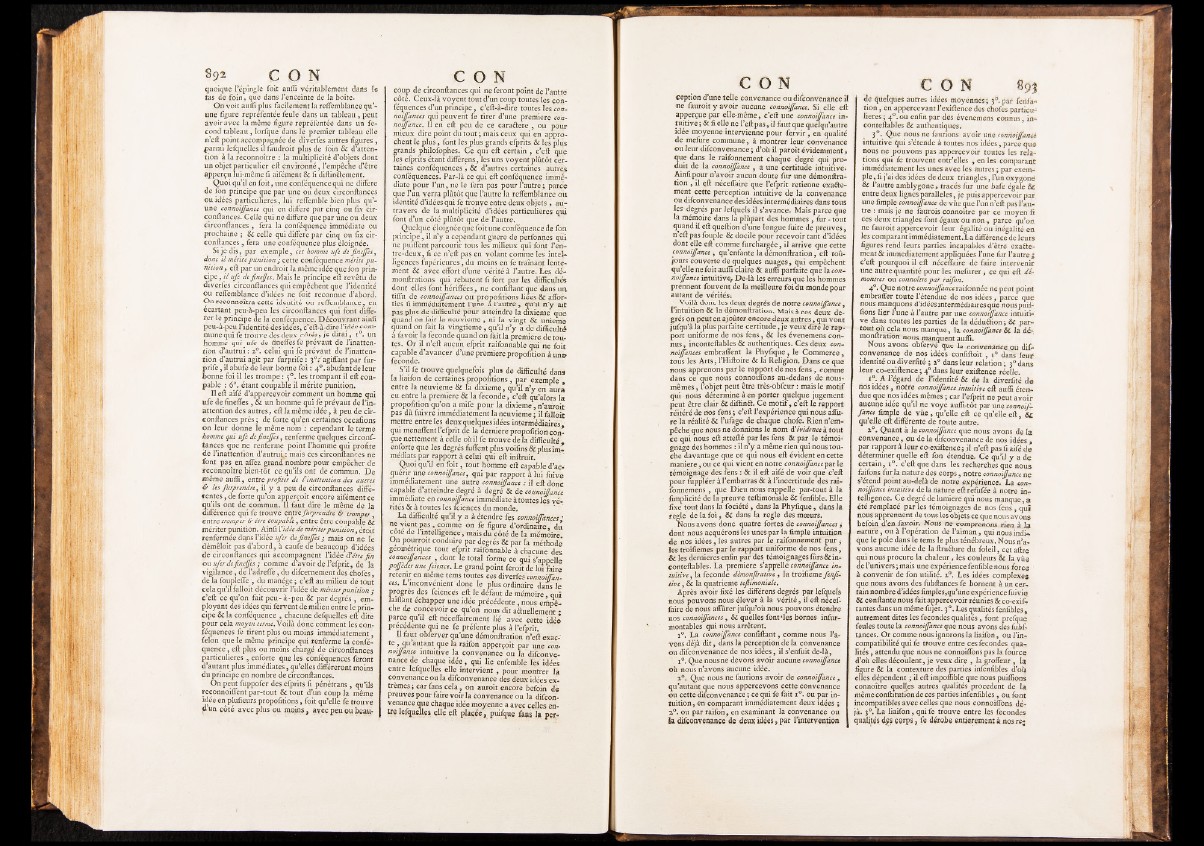
quoique l’épingle foit aufli véritablement dans le
tas de foin, que dans l’enceinte de la boîte.
On voit aufli plus facilement la reflemblance qu’une
figure repréfentée feule dans un tableau, peut
avoir avec la même figure repréfentée dans un fécond
tableau, lorfque dans lê premier tableau elle
n’eft point accompagnée de diverfes autres figures,
.parmi lefquelles il faudroit plus de foin & d’attention
à la reconnoître : la multiplicité d’objets dont
un objet particulier efl environné, l’empêche d’être
apperçu îui-même fi aifément & fi diftinâement.
Quoi qu’il en foit, une conféquence qui ne différé
de fon principe que par une ou deux circonftançes
ou idées particulières, lui relTejnble bien plus qu’une
connoiffance qui en différé par cinq ou fix circonftances.
Celle qui ne différé que par une ou deux
circonftances , fera la conféquence immédiate ou
prochaine ; & celle qui différé par cinq ou fix circonftances
, fera une conféquence plus éloignée.
Si je dis, par exemple, cet homme ufe de finejfes,
donc il mérite punition ; cette conféquence mérite punition
, eft par un endroit la même idée que fon principe
, il ufe definejjes. Mais le principe eft revêtu de
diverfes circonftances qui empêchent que l’identité
ou reflemblance d’idées ne foit reconnue d’abord.
On reconnoîtra cette identité ou reflemblance, en
écartant peu-à-peu les circonftances qui font différer
le principe de la conféquence. Découvrant ainfi
peu-à-peu.l’identité des idées, c’ eft-à-dire l’idée commune
qui fe trouve des deux cAtés, je dirai, i°. un
homme q u i u fe d e finefles fe prévaut de l’inattention
d’autrui : z°. celui qui fe prévaut de l’inattention
d’autrui agit par furprile : 30/agiflant par fur-
prife, il abufe de leur bonne foi : 40. abufantdeleur
bonne foi il les trompe : 50. les trompant il eft coupable
: 6°. étant coupable il mérite punition.
Il eft aifé d’appercevoir comment un homme qui
ufe de finefles , & un homme qui fe prévaut de l’inattention
des autres, eft la même idée, à peu de circonftances
près ; de forte qu’en certaines occafions
on leur donne le même nom : cependant le terme
homme qui ufe de finejfes, renferme quelques circonftances
que ne renferme point l’homme qui profite
de l’inattention d’autruL: mais ces circonftances ne
font pas en allez grand nombre pour empêcher dé
reconnoître bien-tôt ce qu’ils ont de commun. De
même aufli, entre profiter de Vinattention des autres
& les furprendre, il y a peu de circonftances différentes
, de forte qu’on apperçoit encore aifément ce
qu’ils ont de commun. Il faut dire le même de la
différence qui fe trouve entre furprendre & tromper
entre tromper & être coupable, entre être coupable &
mériter punition. Ainfi Vidée de mériter punition, étoit
renfermée dans l’idée ufer de finejfes ; mais on ne le
démêloit pas d’abord, à caufe de beaucoup d’idées
de circonftances qui accompagnent l’idée dé être fin
bu ufer de finejfes ; comme d’avoir de l’elprit, de la
vigilance, de l’adrefle, du difeernement des chofes,
de la fouplefle , du manège ; c’eft au milieu de tout
cela qu’il falloit découvrir l’idée de mériter punition ;
c ’eft ce qu’on fait peu-à-peu & par degrés , employant
des idées qui fervent de milieu entre le principe
& la conféquence , chacune defquelles eft dite
pour cela moyen terme. Voilà donc comment les con-
féquences fe tirent plus ou moins immédiatement,
félon que le même principe qui renferme la confé- -
quence, eft plus ou moins chargé de circonftances i particulières , enforte que les cbnféquences feront
d’autant plus immédiates, qu’elles différeront moins
du principe en nombre de circonftances.
On peut fuppofer des efprits fi pénétrans, qu’ils
reconnoiffent par-tout & tout d’un coup la même
idée en plufieurs propofitions, foit qu’elle fe trouve
^’un côté avec plus ou moins, avec peu ou beaucoup
de circonftances qui ne feront point de l’autre
côté. Ceux-là voyent tout d’un coup toutes les conféquences
d’un principe, c ’eft-à-dire toutes les con-
noijfances qui peuvent fe tirer d’une première connoiffance.
Il en eft peu de ce cara&ere , ou pour
mieux dire point du tout ; mais ceux qui en approchent
le plus, font les plus grands efprits & les plus
grands philosophes. Ce qui eft certain , c’eft que
les efprits étant différens, les uns voyent plutôt certaines
conféquences , & d’autres certaines autres
conféquences. Par-là ce qui eft conféquence immédiate
pour l’un, ne le fera pas pour l’autre; parce
que l’un verra plutôt que l’autre la reflemblance ou
identité d’idées qui fe trouve entre deux objets , au-
travers de la multiplicité d’idées particulières qui
font d’un côté plutôt que de l’autre.
Quelque éloignée que foit une conféquence de fon
principe, il n’y a cependant guere de perfonpes qui
ne puiffent parcourir tous les milieux qui font l’entre
deux, fi ce n’eft pas en volant comme les intelligences
Supérieures, du moins en fe traînai# lentement
& avec effort d’une vérité à l’autre. Les dé-
monftrations qui rebutent fi fort par les difficultés
dont elles font hériflees, ne confiftant que dans un
tiffu de connoijfances ou propofitions liées & affor-
ties fi immédiatement l’une jgj l’autre , qu’il n’y ait
pas plus de difficulté pour atteindre la dixième que
quand on fait la neuvième , ni la vingt & unième
quand on fait la vingtième, qu’il n’y a de difficulté
à favôir la fécondé quand on lait la première de toutes.
Or il n’eft aucun efprit raifonnable qui ne foit
capable d’avancer d’une première propofition à un*
fécondé.
S’il fe trouve quelquefois plus de difficulté dans
la liaifon de certaines propofitions, par exemple ,
entre la neuvième & la dixième, qu’il n’y en aura
eu entre la première & la fécondé, c’eft qu’alors la
propofition qu’on a mife pour la dixième, n’aüfoit
pas dû fuivre immédiatement la neuvième ; il falloit
mettre entre les deux quelques idées intermédiaires,
qui menaflent l’efprit de la derniere propofition conçue
nettement à celle où il fe trouve delà difficulté
enforte que les degrés fuflent plus voifins 8ç plus immédiats
par rapport à celui qui eft inftruit.
Quoi qu’il en fo it , tout homme eft capable d’acquérir
une connoiffance, qui par rapport à lui fuive
immédiatement une autre connoijjance : il eft donc
capable d’atteindre degré à degré & de cotinoifjance
immédiate en connoijjance immédiate à toutes les vérités
& à toutes les fciences du monde.
La difficulté qu’il y a à étendre fes connoijfances}
ne vient p a s, comme on fe figure d’ordinaire, du
cote de l’intelligence, mais du côté de la mémoire,
ü n pourrait conduire par degrés & par la méthode
géométrique tout efprit raifonnable à chacune des
connoijfances , dont le total forme ce qui s’appelle
pojfeder une fcience. Le grand point ferait de lui faire
retenir en même tems toutes ces diverfes connoijfances.
L ’inconvénient donc le plus ordinaire dans le
progrès des fciences eft le défaut de mémoire, qui
laiflant échapper une idée précédente, nous empêche
de concevoir ce qu’on nous dit aauellement ;
parce qu’il eft néceflairement lié avec cette idée
précédente qui ne fe préfente plus à l’efprit.
Il faut oblerver qu’une démonftration n’eft exac-
te , qu’autant que la raifon apperçoit par une con-
noijfancç intuitive la convenance ou la difeonve-
nance de chaque id ée, qui lie enfemble les idées
entre lefquelles elle intervient , pour montrer la
convenance ou la difconvenance des deux idées extrêmes
; car fans cela, on aurait encore befoin de
preuves pour faire voir la convenance ou la difconvenance
que chaque idée moyenne a avec celles entre
lefquelles elle eft placée, puifque faos la per-
Ception d’une telle convenance ou difconvenance il
ne fauroit y avoir aucune connoiffance. Si elle eft
apperçue par elle-même, c’eft une connoiffance intuitive
; & fi elle ne l’eft pas, il faut que quelqu’autre
idée moyenne intervienne pour fervir , en qualité
de mefure commune, à montrer leur convenance
ou leur difconvenance ; d’où il paraît évidemment *
que dans le raifonnement chaque degré qui produit
de la connoiffance , a une certitude intuitive*
Ainfi pour n’avoir aucun doute fur une démonftration
, il eft neceflaire que l’efprit retienne exactement
cette perception intuitive de la convenance
ou difconvenance des idées intermédiaires dans tous
les'Ndegres par lefquels il s’avance. Mais parce que
la mémoire dans la plupart des hommes , fur - tout
quand il eft queftion d’une longue fuite de preuves j
n’eft pas fouple & docile pour recevoir tant d’idées
dont elle eft comme furchargée, il arrive que cette
connoiffance * qu’enfante la démonftratidn, eft toujours
couverte de quelques nuages, qui empêchent
qu’elle ne foit aufli claire & aufli parfaite que la connoiffance
intuitive,,, De-là les erreurs que les hommes
prennent fou vent de la meilleure foi du monde pour
autant de vérités;
Voilà donc les deux degrés de notre connoiffance,
l’intuition & la démonftration, Mais à ces deux degrés
on peut en ajouter encore deux autres, qui vont
jufqu’à la plus parfaite certitude, je veux dire le rapport
uniforme de nos fens, & les évenemens connus
, inconteftables & authentiques; Ces deux connoijfances
embrafient la Phyfique, le Commerce,
tous les Arts ; l’Hiftoire & la Religion. Dans ce que
nous apprenons par le rapport de nos fens, comme
dans ce que nous connoiflons au-dedans de nous-
mêmes , l’objet peut être très-obfcur : mais le motif
qui nous détermine à en porter quelque jugement
peut être clair &diftintt. Ce motif, c ’eft le rapport
réitéré de rios fens ; c’eft l’expérience qui nous allure
la réalité & l’ufage de chaque chofe. Rien n’empêche
que nous ne donnions le nom d£ évidence à tout
ce qui nous eft attefté par les fens & par le témoi- j
gnàgë des hommes : il n’ÿ à même rien qui nous touche
davantage que ce qui nous eft évident en cette
maniéré, ou ce qui vient en notre connoiffance par le
témoignage des fens : & il eft aifé de voir que c’eft
pour fuppléer à l’embarras & à l’incertitude des rai-
fonnemens , que Dieu nous rappelle par-tout à la
fimplicité de la preuve teftimoniale & fenfible. Elle
fixe tout dans la foeiété, dans la Phyfique, dans la
réglé de la foi * & dans la réglé des moeurs.
Nous avons donc quatre fortes de connoifjances j
dont nous acquérons les unes par la ûmple intuition
de nos idées, les autres par le raifonnement pur ,
les troifiemes par le rapport uniforme de nos fens,
& les dernieres enfin par des témoignages fûrs& inconteftables.
La première s’appelle connoiffance intuitive
, la fécondé démonjlrative , la troifieme fenfii-
iive, & la quatrième teftimoniale.
Après avoir fixé les différens degrés par lefquels
nous pouvons nous élever à la vérité, il eft necef-
faire de nous affûrer jufqu’où nous pouvons étendre
nos connoijfances, & quelles font‘les bornes infur-
montables qui nous arrêtent.
i°. La connoiffance confiftant, comme nous Pavons
déjà dit, dans la perception de la convenance
bu difconvenance de nos idées, il s’enfuit de-là,
i°. Que nous ne devons avoir aucune connoiffance
où nous n’avons aucune idée.
z°. Que nous ne faurions avoir de connoiffance,
qu’autant que nous appercevons cette convenance
ou cette difconvenance ; ce qui fe fait i° . ou par intuition,
en comparant immédiatement deux idées ;
i ° . ou par raifon, en examinant la convenance ou
la difconvenance de deux; idées, par l’intervention
de quelques autres idées moyennes; 3®. par fenfa-
tion, en appercevant l’exiftence des chofes particulières
; 40. ou enfin par des évenemens connus, inconteftables
& authentiques.
i 3°. Que nous ne faurions avoir une connoiffance
intuitive qui s’étende à toutes nos idées, parce que
nous ne pouvons pas appercevoir toutes les relations
qui fe trouvent entr’elles , en les comparant
immédiatement les unes avec lés autres ; par exemple,
fi j’ai des idées de deux triangles, l’un oxygond
& l’autre amblygone, tracés fur une bafe égale &
entre deux lignes parallèles, je puis appercevoir par
une fimple connoiffance de vûe que l’un n’eft pas l’autre
: mais je rte faUrois connoître par ce moyen fi
ces deux triangles font égaux ou non , parce qu’on
ne fauroit appercevoir leur égalité ou inégalité en
les comparant immédiatement. La différence de leurs
figures rend leurs parties incapables d’être exafte-
ment & immédiatement appliquées l’une fur l’autre %
c’eft pourquoi il eft néceflaire de faire intervenir
une autre quantité pour les mefurer , ce qui eft dér
montrer ou connoître par raifon.
40. Que notre connoiffance raifonnée ne peut point
embrafler toute l’étendue de nos idées, parce que
nous manquons d’idées intermédiaires que nouspuifi
fions lier l’une à l’autre par une connoiffance intuiti-;
v e dans toutes les parties de la dédu&ion ; & par*
tout où cela nous manque, la connoiffance ÔC la démonftration
nous manquent aufli.
Nous avons obfervé que la convenance ou difconvenance
de nos idées confiftoit , i° dans leur1
identité ou diverfité ; z ° dans leur relation ; 30 dans
leur co-exiftence ; 40 dans leur exiftence réelle.
i° . A l’égard de l’identité & de la diverfité de
fios idees , notre connoiffance intuitive eft aufli étendue
que nos idees mêmes ; car l’efprit ne peut avoir
aucune idée qu’il ne voye aufli-tôt par une connoifr
fiance fimple de v û e , qu’elle eft ce qu’elle eft, &
qu’elle eft différente de toute autre.
x°. Quant à la connoiffance que nous avons de la
convenance, ou de la difconvenance de nos idées %
par rapport à leur co-exiftence ; il n’eft pas fi aifé de
déterminer quelle eft fon étendue. C e qu’il y a de
certain, i° . c’eft que dans les recherches que nous
faifons fur la nature des corps, notre connoijjance ne
s’étend point au-delà de notre expérience. La qon-
noiffance intuitive de la nature eftreftifée à notre intelligence.
Ce degré de lumière qui nous manque, a
été remplacé par les témoignages de nos fens , qui
nous apprennent de tous les objets ce que nous avons
befoin d’en favoir. Nous ne comprenons tien à la
nature, ou à l’opération de l’aiman , qui nous indique
le pôle dans le tems le plus ténébreux. Nous n’avons
aucune idée de la ftru&ure du foleil, cet aftré
qui nous procure la chaleur, les couleurs & la vue
de l’univers ; mais une expérience fenfible nous force
à convenir de fon utilité. z°. Les idées complexes
que nous avons des fubftances fe bornent à un certain
nombre d’idées Amples,qu’une expérience fui vie
& confiante nous fait appercevoir réunies & co-exif?
tantes dans un même fujet. 30. Les qualités fenfibles ,
autrement dites les fécondés qualités, font prefque
feules toute la connoiffance que nous avons des fubftances.
Or comme nous ignorons la liaifon, ou l’incompatibilité
qui fe trouve entre ces fécondés qualités
, attendu que nous ne connoiflons pas la fource
d’où elles découlent, je veux dire , la groffeur , la
figure & la contexture des parties infenfibles d’où
elles dépendent ; il eft impoflîble que nous puiflions
connoître quelles autres qualités procèdent de la
même conftitutionde ces parties infenfibles, ou font
incompatibles avec celles que nous connoiflons déjà.
30. La liaifon, qui fe trouve entre les fécondés
qualités d£S corps, fe dérobe entièrement à nos re