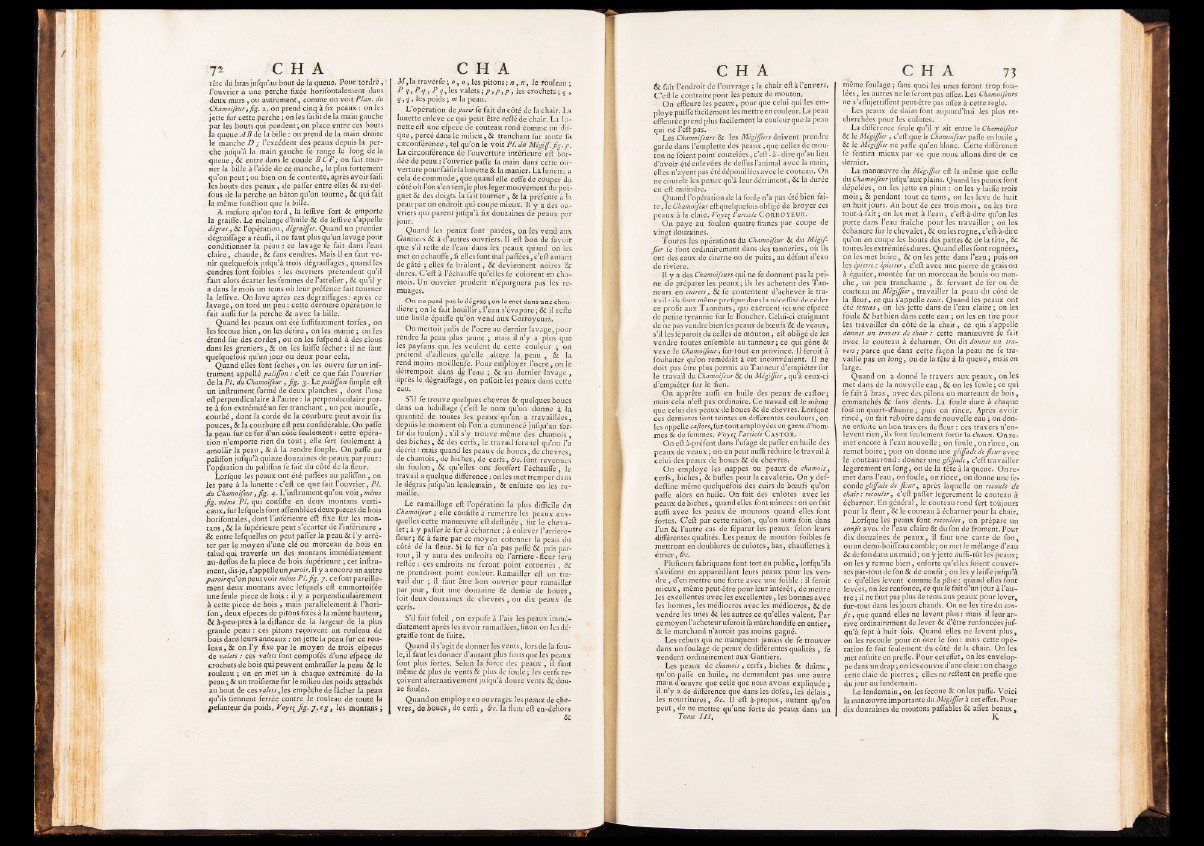
tête clti bras jufqu’au-bout de la queue. Pour tofdrê ,
l ’ouvrier a une perche fixée horifontalement dans
deux murs, ou autrement, comme on voit Plan, du
(Chamoifeur , fig. z . on prend cinq à fix peaux : on les
jette fur cette perche ; on les faifit de la main gauche
par les bouts qui pendent; on place entre ces bouts
la queue A B de la bille : on prend de la main droite
le manche D ; l’excédent des peaux depuis la perche
jufqù’à la main gauche fe range le long de la
queue, & entre dans le coude B C F ; on fait tourner
la bille à l’aide de ce manche, le plus fortement
qu’on peut ; ou bien on fe contente, après avoir faifi
les bouts des peaux, de paffer entre elles & au-def-
fous de la perche un bâton qu’on tourne, 6c qui fait
la même fonflion que la bille.
A mefure qu’on tord, la leflive fort & emporte
la graiffe. Le mélange d’huile 6c de leflive s’appelle
dégras, 6c l’opération, dégraiffer. Quand un premier
•dégraiffage a réufli, il ne faut plus qu’un lavage pour
conditionner la péau : ce lavage fe fait dans l’eau
claire, chaude, 6c fans cendres. Mais il en faut venir
quelquefois jufqu’à trois dégraiflages, quand les
cendres iont foibles : les ouvriers prétendent qu’il
faut alors écarter les femmes de l’attelier, 6c qu’il y
a dans le mois un tems oit leur préfence fait tourner
la leflive. On lave après ces dégraiflages : après ce
lavage, on tord un peu : cette derniere opération fe
fait aufli fur la perche 6c avec la bille.
Quand les peaux ont été fuflifamment torfes, on
les fecoue bien, on les détire, on les manie ; on les
ctend fur des cordes, ou on les fufpend à des clous
dans les greniers, & on les laiffe fecher : il ne faut
quelquefois qu’un jour ou deux pour cela.
Quand elles font feches, on les ouvre fur un inf-
trument appellé paliffon : c’eft ce que fait l’ouvrier
de la PL. du Chamoifeur, fig. 3. Le paliffon fimple eft
un infiniment formé de deux planches , dont l’une
eflperpendiculaire à l’autre : la perpendiculaire porte
à fon extrémité un fer tranchant, un peu moufle,
courbé, dont la corde de la courbure peut avoir fix
pouces, & la courbure eft peu confidérable. On paffe
la peau fur ce fer d’un côté feulement : cette opération
n’emporte rien du tout ; elle fert feulement à
amollir la peau, & à la rendre fouple. On paffe au
paliffon jufqu’à quinze douzaines de peaux par jour :
[’opération du paliffon fe fait du côte de la fleur.
Lorfque les peaux ont été paflees au paliffon, on
les pare à la lunette : c’eft ce que fait l’ouvrier, PL
du Chamoifeur , fig. 4. L’inftrument qu’on vo it, même
fig. même PL qui confifte en deux montans verticaux,
fur lefquels font affemblées deux pièces de bois
horifontales, dont l’inférieure eft fixe fur les montans
, & la fupérieure peut s’écarter de l’inférieure ,
& entre lefquelles on peut paffer la peau & l ’y arrêter
par le moyen d’une clé ou morceau de bois en
talud qui traverfe un des montans immédiatement
au-deffus de la piece de bois fupérieure ; cet inftru-
anent, dis-je, s’appelle unparoir. Il y a encore un autre
/wo/rqu’on peut voir même PL fig. y. ce font pareillement
deux montans avec lefquels eft emmortoifée
une feule piece de bois : il y a perpendiculairement
à cette piece de bois , mais parallèlement à l’hori-
fon , deux efpeces de pitons fixés à la même hauteur,
& à-peu-près à la diftance de la largeur de la plus
grande peau : ces pitons reçoivent un rouleau de
bois dans leurs anneaux : on jette la peau fur ce rouleau
, & on l’y fixe par le moyen de trois efpeces
de valets : ces valets font compofés d’une efpece de
crochets de bois qui peuvent embraffer la peau 6c le
rouleau ; on en met un à chaque extrémité de la
peau ; & un troifieme fur le milieu des poids attachés
au bout de c es valets 9les empêche de lâcher la peau
qu’ils tiennent ferrie contre le rouleau de toute la
£>efanteur du poids, Voye^ fig, y , c g t les montans ;
M , là travérfe ; o , o , les pitons le rouleau ;
B q, P q , P q t les valets ip > p ,p> les crochets ; q ,
q y q > les poids ; m la peau.'
L ’opération de parer fe fait du côté de la chair. La
lunette enleve ce qui peut être relié de.chair. La lunette
eft une efpece de couteau rond- comme lin dil-
que, percé dans le milieu, & tranchant fur toute fa
circonférence, tel qu’on le voit PL du Mégiff. fig. p.
La circonférence de l ’ouverture intérieure eft bordée
de peau : l’ouvrier paffe fa main dans cette, ouverture
pour faifir la lunette & la manier. Là limette a
cela de commode, que quand elle ceffe de couper du
côté oh l’on s’en fert *le plus, léger mouvement du poignet
6c des doigts la fait tourner , & la préfertte à la
peau par un endroit qui coupe mieux. Il y a des ouvriers
qui-parent jüfqu’à fix douzaines de peaux par
jour.
Quand-lès peaux font parées, on les vend: aux
Gantiers 6c à d’autres ouvriers. Il eft bon de favoir
que s’il relie de l’eau dans les peaux quand on les
met en échauftè, fi elles font mal paflees, c’èft autant
de gâté ;; elles fe brûlent, & deviennent noires 6c
dures. G’eft à l’échauffe qu’elles fe colorent en chamois.
Un ouvrier prudent n’épargnera pas les re-
muages. •
On ne perd pas le dégras ; on le met dans une chaudière
; on le fait bouillir ; l’eau s’évapore ; 6c il relie
une huile épaiffe qu’on vend.aux Corrôyeurs,
On mëttoit jadis de l’ocre au dernier lavage,.pour
rendre la peau plus jaune ; mais il n’y a plus que
les payfans qui les veulent de cette couleur ; on
prétend d’ailleurs^.qu’elle /altéré, la,.peau , & la
rend moins môëlleufe. Pour, employer l’ocre, on le
d.étrempoit dans d f l’eau 6c au dernier lavage ,
après le;dégraiffage, on paflbitrles peaux dans cette
eau.
S’il fe trouve quelques chèvres & quelques boucs
dans un habillage (c’eft le nom qu’on donne à la
quantité, de toutes les peaux'qu’on a travaillées,
depuis le moment où l’o n a commencé jufqu’au for-
tir du foulon) ; s’il s’y trouve même des chamois ,
des biches, 6c des cerfs, le travail fera tel qu’on l’a
décrit : mais quand les peaux de boucs ; de chevres,
de chamois, de biches, de cerfs, &c. font revenues
du foulon, 6c qu’elles ont fouffert l’échauffe, le
travail a quelque différence : on les met tremper dans
le dégras jufqu’au lendemain, & enfuite on les ra-
maille.
Le ramaillage eft l’opération la plus difficile du
Chamoifeur ; elle confifte à remettre lés peaux auxquelles
cette manoeuvre eft deftinée, fur le chevalet
; à y paffer le fer à écharrier ; à enlever l’arriere-
fleur ; 6c à faire par ce moyen cotonner la peau du
côté de la fleur. Si le fer n’a pas paffé & pris partout
, il y aura des endroits où l’arriéré - fleur fera
reliée : ces endroits ne feront point cotonnés , 6c
ne prendront point couleur. Ramailler eft un travail
dur ; il faut être bon ouvrier pour ramailler
par jou r, foit une douzaine 6c demie de boucs,
foit deux douzaines de chevrès , ou dix peaux de
cerfs.
S’il fait fôleil, on expofe à l’air les peaux immédiatement
après les avoir ramaillées, finon on les dé-
graiffe tout de fuite.
Quand il s’agit de donner les vents, lors de la foule,
il faut les donner d’autant plus forts que les peaux
font plus fortes. Selon la force des peaux , il faut
même 6c plus de vents & plus de foule; les cerfs reçoivent
alternativement jufqu’à douze vents 6c douze
foules..
Quand on employé en ouvrages les peaux de chèvres,
de boucs, de cerfs, &c. la fleur eft en-dehors
6c
& fait'l’endroit de l’ouvrage ; la chair eft à l’enVers.
C ’eft le contraire pour les peaux de mouton.
- Qn effleure les peaux, pour que celui qui1 les employé
puiffe facilement les mettre en couleur. La peau
effleurée prend plus facilement la couleur que la peau
qui n e l’eftpas. : ; • :
Les Chamoifeurs 6c les Mégiffiersàoivent prendre
garde dans l’emplette dés peaux, que celles de mouton
ne foient point coutelées, c’eft - à - dire qu’au lieu
d’avoir été enlevées de deffus l’animal avec la main,
elles n’ayertt pas été dépouillées avec le couteau. On
ne couteie les peaux qu’à leur détriment, 6c la durée
en eft moindre.
Quand l’opération de la foule n’a pas- été biert faite
feChamoifeur eft quelquefois obligé de broyer ces
peaux à la claie. Voye^l'article C o r r o y eu r .
On paye au foulon quatre francs par coupe de
vingt douzaines,
• Toutes les opérations du 'Chamoifeur 6c du Mégif-
fier fe font ordinairement dans des tanneries, où ils
ont dès eaux de citerne ou de puits, au défaut d’eau
de riviere.
• II. y a des Chamoifeurs qui ne fe donnent pas la peine
.de préparer les peaux; ils les achètent des Tanneurs
en cuirets, 6c fe contentent d’achever le travail
: ils font même prefque dans la néceflïté de céder
ce profit aux Tanneurs, qui exercent ici une efpece
de petite tyrannie fur le Boucher, Celui-ci craignant
de ne pas vendre bien fes peaux de boeufs 6c de veaux,
s’il les féparoit de celles de mouton, eft obligé de les
vendre toutes enfemble au tanneur ; ce qui gêne &
vexe le Chamoifeur, fur-tout en province. Il lèroit à
fouhaiter qu’on remédiât à cet inconvénient. Il ne
doit pas être plus permis au Tanneur d’empiéter fur
le travail du Chamoifeur 6c du Mégiffier 3 qu’à ceux-ci
d’empiéter fur le lien.
On apprête aufli en huile des peaux de caftor ;
mais cela n’ell pas ordinaire. Ce travail eft le même
que celui des peaux de boucs & de chevres. Lorfque
ces dernieres font teintes en différentes couleurs, on
les appelle cafiors, fur-tout employées en gants d’hommes
& de femmes. Voye^ C article C a s to r .
On eft à-préfent dans l’ufage de paffer en huile des
peaux de veaux ; on en peut aufli réduire le travail à
celui des peaux de boucs 6c de chevres.
On employé les nappes ou peaux dé chamois,
cerfs, biches, & bulles pour la cavalerie. On y def-
deftine même quelquefois des cuirs de boeufs qu’on
paffe alors en huile. On fait des culotes avec les
peaux de biches, quand elles font minces : on en fait
aufli avec les peaux de moutons quand elles font
fortes. C ’eft par cette raifon, qu’on aura foin dans
l ’un & l’autre cas de féparer les peaux félon leurs
différentes qualités. Les peaux de mouton foibles fe
mettront en doublures de culotes, bas, chauffettes à
étrier, &c.
Plufieurs fabriquans font tort au public, lorfqu’ils
s’avifent en appareillant leurs peaux pour les vendre
, d’en mettre une forte avec une foible : il feroit
mieux, même peut-être pour leur intérêt, de mettre
les excellentes avec les excellentes, les bonnes avec
les bonnes, les médiocres avec les médiocres, 6c de
vendre les unes 6c les autres ce qu’elles valent. Par
ce moyen l’acheteur uferoit fa màrchandife en entier,
& le qiarchand n’auroit pas moins gagné.
Les rebuts qui ne manquent jamais de fe trouver
dans un foulage de peaux de différentes qualités , fe
vendent ordinairement aux Gantiers.
Les peaux de chamois, cerfs, biches & daims ,
qu’on paffe en huile, ne demandent pas une autre
main-d’oeuvre que celle que nous avons: expliquée ;
il n’y a de différence que dans les dofes, les délais ,
les nourritures, &c. Il eft à-propos, autant qu’on
peut, de ne mettre qu’une forte de peaux dans un
Tome I I I .
même foulage ; fans quoi les unes feront trop foulées
, les autres ne le feront pas affez. Les Chamoifeurs
ne s ’affujettiffent peut-être pas affez à cette regle.
i Les peaux de daim font aujourd’hui les plus recherchées
pour les culotes,
La différence feule qu?il y ait entre le Chamoifeur
6c le Mégiffier, c’eft que le Chamoifeur paffe en huile ,
6c le Mégiffier ne paffe qu’en blanc. Cette différence
fe fentira mieux par ce que nous allons dire de ce
dernier.
La manoeuvre du Mégiffier eft la même que celle
du Chamoifeur jufqu’aux plains. Quand les peaux font
dépelées, on les jette en plain : on les y laiffe trois
mois; & pendant tout ce tems, pn les leve de huit
en huit jours. Au bout de ces trois mois, on les tire
tout-à-fait ; on les met à Peau, c’eft-à-dire qu’on les
porte dans l’eau fraîche pour lés travailler ; on les
échancre furie chevalet, 6c on les rogne, c’eft-à-dire
qu’on en coupe les bouts des pattes 6c de la tête, 6c
toutes les extrémités dures. Quand elles font rognées,
on les met boire, 6c on les jette dans l’eau ; puis on
les épierre : épierrer, c’eft avec une pierre de graisou
à éguifer, montée fur un morceau de bouis ou manche
, un peu tranchante , & fervant de fer ou de
couteau au Mégiffier, travailler la peau du côté de
la fleur, ce qui s’appelle tenir. Quand les peaux ont
été tenues, on les jette dans de l’eau claire ; on les
foule 6c bat bien dans cette eau ; on les en tire pour
fes travailler du côté de la chair, ce qui s’appelle
donner un travers de chair : cette manoeuvre le fait
avec le couteau à écharner. On dit donner un travers;
parce que dans cette façon la peau ne fe travaille
pas en long, ou de la tête à la queue, mais en
large.
Quand on a donné le travers aux peaux , on les
met dans de la nouvelle eau, 6c on les foule ; ce qui
fe fait à bras, avec des pilons ou marteaux de bois ,
emmàrtchés & farts dents. La foule dure à chaque
fois un quart-d’heure ; puis on rince. Après avoir
rincé, on fait reboire dans de nouvelle eau ; On doft-
ne enfuite un bon travers de fleur : ces travers n’en-
levent fien, ils font feulement fortir la chaux. Onre-
metencôre à l’eau nouvelle; on foulé, On rince, on
remet boire; puis on donne une gliffadt de fleur avec
le coütêau rond : donner une gliffàde, c’eft travailler
legerement en long, ou de la tête à la queue. On remet
dans l’eau, on foule, on rince, on donne une fécondé
gliffàde de fleur, après laquelle on recoule de
chair: recouler, c’eft paffer legerement le couteau à
écharner. En général, le couteau rond fert toûjours
pour la fleur, 6c le couteau à écharner pour la chair.
Lorfque les peaux font recoulées, on prépare un
confit avec de l’eau claire 6c du fon de froment. Pour
dix douzaines de peaux, il faut Une carte de fon,
ou un demi-boiffeau comble; on met le mélange d’eau
6c de fon dans unmuid ; on ÿ jette àufli-tôt les peaux;
on les y remue bien, enforte qu’elles foient couvertes
par-tout de fon & de confit ; on les y laiffe jufqu’à
ce qu’elles lèvent comme la pâte : quand elles font
levéès, on les renfonce* ce qui fe fait d’un jour à l’autre
; il ne faut pas plus de tems aux peaux pour lever,
fur-tout dans les jours chauds. On ne les tire du confit
, que quand elles ne lèvent plus : mais il leur arrive
ordinairement de lever 6c d’être renfoncées jufqu’à
fept à huit fois. Quand elles ne lèvent plus,
on les recoule pour en ôter le fon : mais cette opération
fe fait feulement du côté de la chair. On les
met enfuite en preffe. Pour cet effet, on les enveloppe
dans un drap ; on les couvre d’une claie : on charge
cette claie de pierres ; elles ne relient en preffe que
du jour au lendemain.
Le lendemain, on les fecoue & on les paffe. Voici
la manoeuvre importante du Mégiffier à cet effet. Pour
dix douzaines de moutons paffables 6c affez beaux ,
K