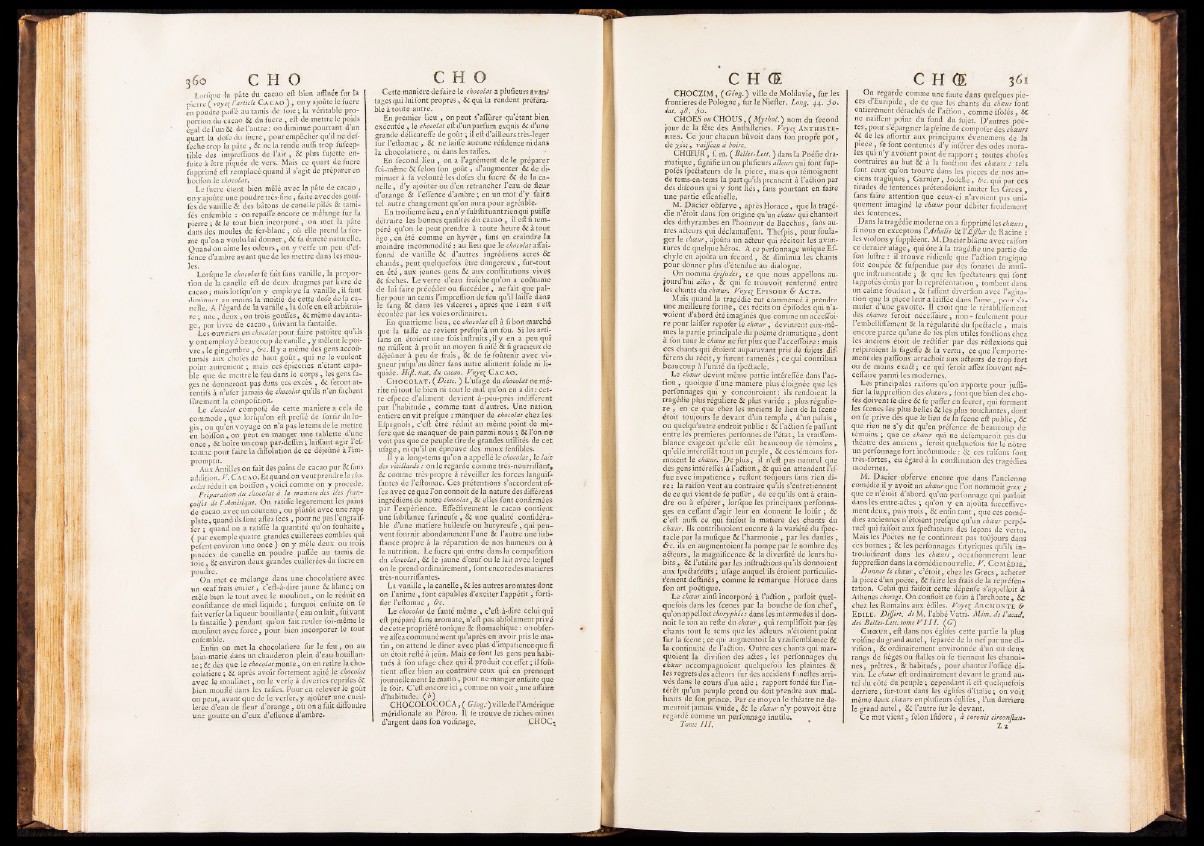
Lorfque 4a pâte du cacao eft bien affinée fur la
pierre ( voye{ C article C a c a o , ) , o n y ajoute le lucre
en poudre pafl'é au tamis de foie ; la véritable proportion
du cacao 8c du fucre , eft de mettre le poids
égal de l’un 8c de l’autre : on diminue pourtant d’un
quart la dofe du lucre, pour empêcher qu’il ne def-
feche trop la pâte , & ne la rende aufli trop fufeep-
tible des impreflions de l’a i r , 8c.plus fujette en-
fuite à être piquée de vers. Mais ce quart de fucre
fupprimé eft remplacé quand il s’a_git de préparer en
boiffon le chocolat.
Le fucre étant bien mêlé avec la pâte de cacao ,
on y ajoute une poudre très-fine, faite avec des gouf-
fes de vanille & des bâtons de-caneUe pilés & tami-
fés enfemble : -on repaffe encore ce mélange fur la
pierre ; & le tout bien incorporé , on met la pâte
dans des moules de fer-blanc , où elle prend là forme
qu’on a voulu lui donner-, & fa dureté naturelle.
Quand on-aime les odeurs, on y verfe un peu d’efi-
fence d’ambre avant que de les mettre dans lesmou-
les. •
Lorfque le chocolat fe fait fans vanille, la proportion
de la canelle eft de deux dragmes par livre de
cacao ; mais lorfqu’on y employé la vanille, il faut
diminuer au moins la'moitié de cette dofe de la ça-
nelle. A l’égard de la vanille, la dofe en eft arbitraire
; une ,-deux , ou trois goufles, Si même davantag
e , par livre de cacao , luivant la fantaifie.
Les-ouvriers en chocolat pour faire patoître qu’ils
y ont employé beaucoup de vanille , y mêlent le poivre
, le gingembre , &c. Il y a même des gens accoutumés
aux chofes de haut goût, qui ne le veulent
.point autrement ; mais ces épiceries n’etant capable
que de mettre le feu dans le corps, les gens fa-
ges ne donneront pas dans ces excès , 8c feront attentifs
à n’ufer jamais de chocolat qu’ils n’en fâchent
Virement la com p o fit io n .
Le chocolat compofé de cette maniéré a cela de
commode, que lorfqu’on eft preffé de for tir du logis
, ou qu’en voyage on n’a pas letems de le mettre
en boiffon , on peut en manger une tablette d’une
once, 8t boire un coup par-deffus ; laiffant agir l’ef-
tomac pour faire la diffolution de ce déjeûné à l’impromptu.
Aux Antilles on fait des pains de cacao pur & fans
addition. V. C a c a o . Et q u an d o n v e u t p ren d r e le cho-
colat réduit en boiffon, voici comme on y procédé.
Préparation du chocolat à la manière des îles fran-
çoifes de ? Amérique. On ratifie legerement les pains
de cacao avec un couteau, ou plûtôt avec une râpe
plate, quand ils font allez fecs , pour ne pas l’engraif-
fer ; quand on a ratifie la quantité qu’on fouhaite,
( par exemple quatre grandes cuillerées combles qui
pelent environ une once ) on y mêle deux ou trois
pincées de canelle en poudre paffée au tamis de
l'oie, & environ deux grandes cuillerées du fucre en
poudre.
On met ce mélange dans une chocolatière avec
un oeuf frais entier, c’eft-à-dire jaune & blanc ; on
mêle bien le tout avec le moulinet, on le réduit en
confiftance de miel liquide ; furquoi enfuite on fe
fait verfer la liqueur bouillante ( eau ou lait, fuivant
la fantaifie ) pendant qu’on fait rouler foi-même le
moulinet avec force, pour bien incorporer le tout
enfemble.
Enfin on met la chocolatière fur le fe u , ou au
bain-marie dans un chauderon plein d’eau bouillante
; & des que le chocolat monte, on en retire la chocolatière
; 8c après avoir fortement agité le chocolat
avec le moulinet, on le verfe à diverfes reprifes 8c
bien moufle dans les taffes. Pour en relever le goût
on peut, avant que de le verfer, y ajouter une cueil-
le ré e d’eau de fleur d’orange , où on a fait diffoudre
une goutte ou d’eux d’effence d’ambre.
Cette maniéré défaire le chocolat a plusieurs a van*
tages qui lui font propres, 8e qui la rendent préférable
à toute autre.
En premier lieu , on peut s’affurer qu’étant bien
exécutée , le chocolat eftd’un parfum exquis 8c d’une
grande délicateffe de goût ; il eft d’ailleurs très-leger
fur l’eftomac , & ne laifîe aucune réfidence ni dans
la chocolatière , ni dans les taffes.
En fécond lieu , on a l’agrément de le préparer
foi-même 8c félon fon goût , d’augmenter 8c de diminuer
à fa volonté les dofes du fucre 8c de la canelle,
d’y ajoûter ou d’en retrancher l’eau de fleur
d’orange 8t l’effence d’ambre ; en un mot d’y faire
tel autre changement qu’on aura pour agréable.
En troifieme lieu, en n’y fubftituantrien qui puiffe
détruire les bonnes qualités du cacao , il eft fi tempéré
qu’on le peut prendre à toute heure 8c à tout
âge , en été comme en h y v e r , fans en craindre la
moindre incommodité : au lieu que le chocolat affai-
fonné de vanille 8c d’autres ingrédiens acres 8C
chauds, peut quelquefois être dangereux , fur-tout
en é té , aux jeunes gens 8c aux conftitutions vive»
8c feches. Le verre d’eau fraîche qu’on a coûtume»
de lui faire précéder ou fuccéder , ne fait qiie pallier
pour un tems l’imprefîion de feu qu’il laiffe dans
le fang 8c dans les yifeeres, après que l’eau s’effc
écoulée par les voies ordinaires.
En quatrième lieu, ce chocolat eft à fi bon marche
que la taffe ne revient prefqu’à un fou. Si les arti-
lans en étoient une foisinftruits , i l y en a peu qui
ne miffent à profit un moyen fi aifé 8c fi gracieux dé
déjeûner à peu de frais, 8c de fe foûtenir avec , v igueur
jufqu’au dîner fans autre aliment folide ni liquide.
Hift.nat,. du cacao. Voye%_ C a c a o .
C h o c o l a t . ( Diete. ) L’ufage du chocolat ne mérite
ni tout le bien ni tout le mal qu’on en a dit : cette
efpece d’aliment devient à-peu-près indifférent
par l’hâ^ïtude , comme tant d’autres. Une nation
entière en vit prefque : manquer de chocolat chez les-
Efpagnols, c’eft être réduit au même point de mi-
fere que de manquer de pain parmi nous ; 8c l’on ne?
voit pas que ce peuple tire de grandes utilités de cet
ufage, ni qu’il en éprouvé des maux fenfibles.
Il y a long-tems qu’on a appellé le chocolat, le laie
des vieillards : on le regarde comme très-nourriffanf,
8c comme très-propre à réveiller les forces languif-
fantes de l’eftomac. Ces prétentions s’accordent a£
fez avec ce que l’on connoît de la nature des différens
ingrédiens de notre chocolat, 8c elles font confirmées
par l’expérience. Effe&ivemertt le cacao contient'
une fubftance farineufe , 8c une qualité confidéra-
ble d’une matière huileufe ou butyreufe , qui peuvent
fournir abondamment l’une 8c l’autre une fubftance
propre à la réparation de nos humeurs ou à
la nutrition. Le fucre qui entre dans la compofition
du chocolat y 8c le jaune d’oeuf ou le lait avec lequel
on le prend ordinairement, font encore des matières
très-nourriffantes.
La vanille, la canelle, 8c les autres aromates dont
on l’anime , font capables d’exciter l’appétit, fortifier
l’eftomac , &c.
Le chocolat de fanté même , c’ eft-à-dire Celui qui
eft préparé fans aromate, n’eft pas abfolumept privé
de cette propriété tonique 8c ftomachique: ohobfer-
ve affez communément qu’après en avoir pris le matin
, on attend le dîner avec plus d’impatience que fi
on étoit refté à jeûn. Mais ce font les gens peu habitués
à fon ufage chez qui il produit cet effet ; il foû-
tient allez bien au contraire ceux qui en prennent
journellement le matin, pour ne manger enfuite que
le foir. C ’eft encore i c i, comme on v o it , une affaire
d’habitude. (£)
CH OCO LO COCA , ( Géog.'") ville de l’Amérique
méridionale au Pérou. Il fe trouve de riches mines
d’argent dans fon Yoifinage, CHOC;
CHOCZIM, ( Géog. ) ville de Moldavie, fur les
frontières de Pologne, fur le Niefter. Long. '44.
iat. 48. 3o.
CHOES ou CHOUS, ( Mythoi. ) nom du fécond
jour de la fête des Anthifteries. Voyez Anth ist é-
ries. Ce jour chacun bûvoit dans Ion propre pôt,
de x°°c > vaijfeau à boire.
CHOEUR, f. m. ( Belles-Lett. ) dans la Poéfie dramatique
, fignifie un ou plufieurs acteurs qui font fup-
pofés fpeûateurs de la pièce, mais qui témoignent
de tems-en-tems la part qu’ils prennent à l’aâion par
des difeours qui y font liés, fans pourtant en faire
une partie effentielle.
M. Dacier obferve, après Horace, que la tragédie
n’étôit dans fon origine qu’un choeur qui chantoit
des dithyrambes en l’honneur de Bacchus, fans autres.
afteurs qui déclamaffent. Thefpis, pour foula-'
ger le choeur y ajoûta un a fleur qui récitôit les âvân-
tures de quelque héros. A ce perfonnage unique Ef-
chyle en ajoûta un fécond, 8c diminua les' chants
pour donner plus d’étendue au dialogue.
On nomma épijodesy ce que nous appelions aujourd’hui
actes, 8c qui fe trouvoit renfermé entre
les chants du choeur. Voye£ Episode & A c t e .
Mais_ quand la tragédie eut commencé à prendre
une meilleure forme, ces récits ou épifodes qui n’a-
▼ oient d’abord été imaginés que comme un acceffoi-
re pour laiffer repofer le choeur, devinrent eux-mêmes
la partie principale du poème dramatique, dont
à' fon tour le choeur ne fut plus que l’acceffoire : mais
ces chants qui étoient auparavant pris de fujets différens
du ré c it ,y furent ramenés ; ce qui contribua
Beaucoup à l’unité du fpeftacle.
Le choeur devint même partie intéreffée dans l’ action
, quoique d’une maniéré plus éloignée qiie lés
perfonnages qui y cbncOiiroient : ils rendoient la
tragédie plus régulière 8c plus variée ; plus régulière
, en ce que chez les anciens le lieu de la feene
étoit toujours le devant d’un temple , d’un palais,
ou qiielqu’autre endroit public : 8t l’aâion fe paffant
entre les premières perfonnes de l’état, la vraiffem-
blance exigeoit qu’elle eût beaucoup de témoins,
qu’elle intéreffât tout un peuple, 8c ces témoins for-
moient le choeur. De p lus, il n’eft pas naturel que
des gens intéreffés à l’aflion, 8c qui en attendent l’if-
fueavec impatience, relient toûjours fans rien dire
: la raifon veut au contraire qu’ils s’entretiennent
de ce qui vient de fe paffer, de ce qu’ils ont à craindre
ou à efpérer, lorfque les principaux perfonnages
en ceffant d’agir leur en donnent le loifir ; 8c
C’eft aufli ce qui faifoit la matière des chants du
choeur. Ils côntribuoient encore à la variété du fpec-
tacle par la mufique 8c l’harmonie , par les danfes ,
&c. ils en augmentoient la pompe par le nombre des
a fleurs, la magnificence 8c la diverfité dé leurs habits
, 8c l ’utilité par les inftruflions qu’ils donnoient
aux fpefiateürs ; ufage auquel ils étoient particulie-
Vément deftiriés, comme lé remarque Horace dans
fon art poétique.
Le choeur ainfi incorporé à l’aâ io n , parloit quelquefois
dans les fçenes par la bouche de fon ch ef,
qu’on appelloit choryphée: dans les intermèdes il don-
jioit le ton au refte du choeur , qui rempliffoit par fes
chants tout le tems que les’afteurs n’étoient point
fur la feene ; ce qui augmentoit la vraiffemblance &
la continuité de l’aôion. Outre ces chants qui mar-
quoient la divifion des a â e s , les perfonnages du
choeur accompagnoient quelquefois les plaintes 8c
les regrets des adteurs fur des accidens funeftes arrivés
dans le cours d’un afte ; rapport fondé fur l’intérêt
qu’un peuple prend ou doit prendre aux malheurs
de fon prince. Par ce moyén le théâtre ne de-
meuroit jamais vuide, & 1 £ choeur n’y pouvoit être
regardé comme un perfonnage inutile.
Tome LU.
On regarde comme urfe faute dans quelques pièces
d’Euripide, de ce que les chants du choeur font
entièrement détachés de l’action, comme ifolés , 8t
lie naiffent point du fond du fujet. D ’autres poètes,
pour s’épargner la peine de compofer des choeur*
8ç. de les aflortir aux principaux évenemens de la
piece, fe font contentés d’y inférer des odes morales
qui n’y avoient point de rapport ; toutes chofes
contraires au but & à la fonction des choeurs : tels
fpnt ceux qu’on trouve dans les pièces de nos anciens
tragiques., Garnier , Jodelle, &c. qui par ces
tirades de fentences prétendoient imiter les Grecs
fans faire attention que ceux-ci n’avoient pas uniquement
imaginé le choeur pour débiter froidement
des fentences..
Dans la tragédie moderne on a fupprimé les choeurs ,
fi nous en exceptons YAtkalie 8c YEJihcr de Racine
les violons y fuppléent. M. Dacier blâme avec raifon
ce dernier ufage, qui ôte à la tragédie une partie de
fon luftre : il trouve ridicule que l’aélion tragique
foit coupée 8c fufpendue par des fonates de mufique
inftrumentale ; 8c que les fpeftateurs qui font
luppofés émûs par la repréfentation, tombent dans
un calme fôudain , 8c.faffent diverfion avec l’agita-’
tion que la piece leur a laiffée dans l’ame , pour s’a-
muler d’une gavotte. Il croit que le rétabliffement
dés choeurs feroit néceffaire, non-feulement pour
l’embelliffernent 8c la régularité du fpe&acle , mais
encore parce qu’une de les plus utiles fondions chez
les anciens étoit de reélifier par des réflexions qui
re/piroiçnt la fageffe 8c la vertu, ce que l’emportement
des paflîons arrachoit aux aéleurs de trop fort
ou de moins exaél ; ce qui feroit affez fouvent néceffaire
parmi les modernes.
Les principales raifons qu’on apporte pour jufti-
fier la iuppreflion des choeurs, font que bien des chofes
doivent fe dire 8c fe paffer en fecret, qui forment
les fcèries les plus belles 8c les plus touchantes, dont
on fé prive dès que le lieu de la feene eft public, Ôc
que rien ne s’y dit qu’en préfence de beaucoup de
témoins ; que ce choeur qui ne defemparoit pas du
théatrè des anciens , feroit quelquefois fur le nôtre
un perfonnage fort incômmode : 8c ces raifons font
très-fortes, eu égard à la conftitution des tragédies
modernes.
M. Dacier obferve encore que dans l’ancienne
comédie il y avoit un choeur que l’on nommoit grex ;
qüe ce n’etoit d’abord qu’un perfonnage qui parloit
dans les entre-aftes ; qu’on y en ajoûta fucceflive-
ment deux, puis trois, 8c enfin tant, que ces comédies
anciennes n’étoient prefque qu’un choeur perpétuel
qui faifoit aux fpeôateurs des leçons de vertu.
Mais les Poètes ne fe continrent pas toûjours dans
ces bornes ; 8c les perfonnages fatyriques qu’ils in-
troduifirent dans les choeurs, occafionnerent leur
fuppreffion dans la comédie nouvelle. V. C omédie.'
Donner le choeur y c’étoit, chez les Grecs, acheter
la piece d’un poète, 8c faire les frais de la repréfentation.
Celui qui faifoit cette dépenfe s’appellpit à
Athènes chorege. On.confioit ce foin à l’archonte, &c
chez les Romains aux édiles. Voye^ A r ch o n te &
Edile. Dijfert. de M. l’abbé Vatri. Mém. dé Tacad,
des Belles-Lett. tome V I I I . (G ) *
C hoeur , eft dans nos églifes cette partie la plus
voifine du grand autel, feparée de la nef par une divifion
, 8c ordinairement environnée d’un ou deux
rangs de fiéges ou ftalles où fe tiennent les chanoines
, prêtres, & habitués, pour chanter l’office divin.
Le choeur eft ordinairement devant le grand autel
du côté du peuple ; cependant il eft quelquefois
derrière, fur-tout dans les églifes d’Italie ; on voit
même deux choeurs en plufieurs églifes , l’un derrière
le grand autel, 8c l’autre fur le devant.
Ce mot vient, félon Ifidore, à coronis circonjlan