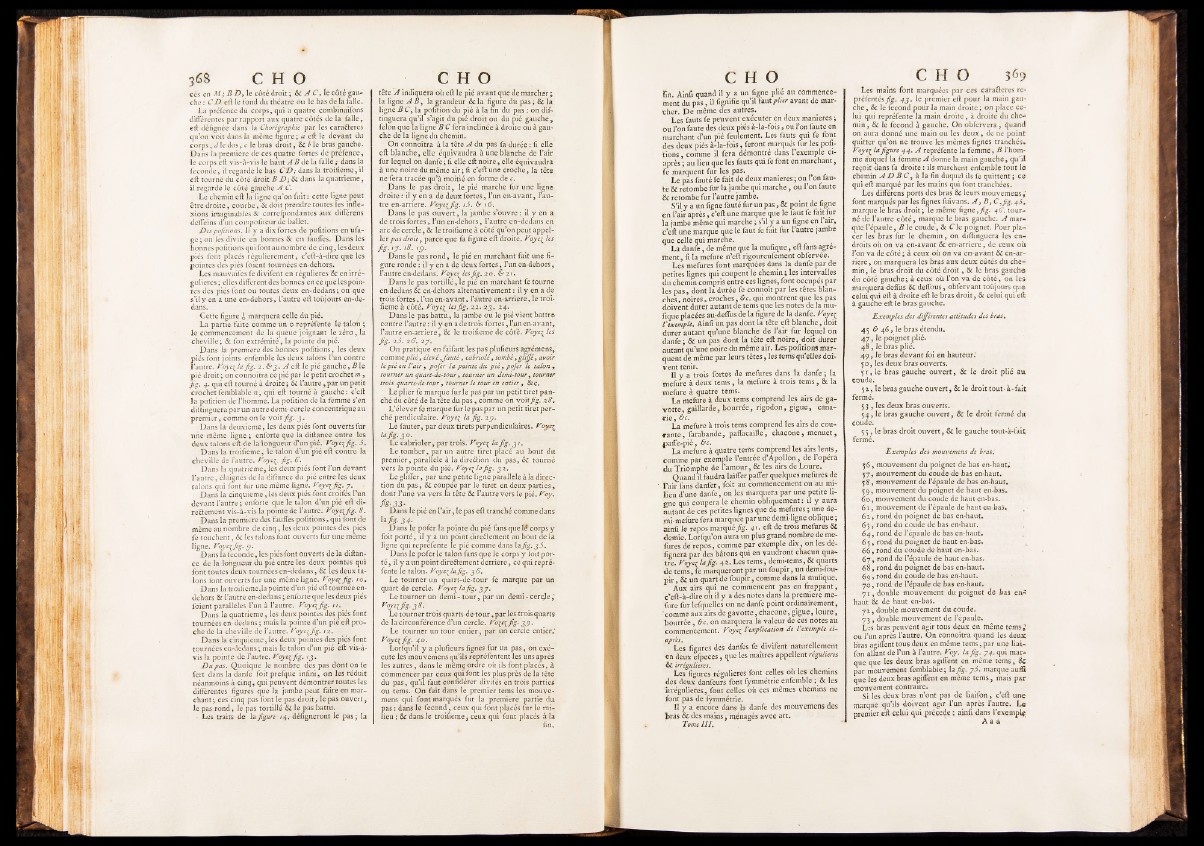
H ’
eés en M; B ï ) , le cô.té droit ; & A C , le côté gauche
: C D eû le fond du théâtre ou le bas de la falle.
La préfencedu corps, qui a quatre combinaifons
differentes par rapport aux quatre côtés de la falle,
elf délignée dans la Chorégraphie par les carafteres
qu’on voit dans la même figure ; a eft le devant du
corps , d le dos, c le bras droit, & b le bras gauche.
Dans la première de ces quatre fortes de préfence,
le corps eft vis-à-vis le haut A B de la falle ; dans la
fécondé, il regarde le bas C D ; dans la troifieme, il
eft tourné du côté droit B D ; & dans la quatrième,
il regarde le côté gauche A C.
Le chemin eft la ligne qu’on fuit : cette ligne peut
être d roite, courbe, & doit prendre toutes les inflexions
imaginables & correfpondantes aux différens
deffeins d’un conipofiteur de ballet.
Des pojitions. Il y a dix fortes de pofitions en ufa-
pe ; on les divife en bonnes & en fauffes. Dans les
bonnes pofitions qui font au nombre de cinq, les deux
piés font placés régulièrement, c’eft-à-dire que les
pointes des piés foient tournées en-dehors.
Les mauvaifes fedivifent en régulières & en irrégulières
; elles different des bonnes en ce que les pointes
des piés font ou toutes deux en-dedans ; ou que
s’il y en a une en-dehors, l’autre eft toujours en-dedans.
Cette figure ^ marquera celle du pié.
La partie faite comme un o repréfente le talon ;
le commencement de la queue joignant le zéro, la
cheville ; & fon extrémité, la pointe du pié.
Dans la première des bonnes pofitions, les deux
piés font joints enfemble les deux talons l’un contre
l ’autre. Foye^ la fig. z . & j . A eft le pié gauche, B le
pié droit ; on connoîtra ce pié par le petit crochet m ,
fig. 4. qui eft tourné à droite ; & l’autre, par un petit
crochet femblable n , qui eft tourné à gauche : c’eft
la pofition de l’homme. La pofition de la femme s’en
diftinguera'par un autre demi- cercle concentrique au
premier, comme on le voit fig. 3.
Dans la deuxieme, les deux piés font ouverts fur
une même ligne ; enforte que la diftance entre les
deux talons eft de la longueur d’un pié. Fyye^fig. 5.
Dans la troifieme, le talon d’un pié eft contre la
cheville de l’autre. Foye^. fig. 6.
Dans la quatrième, les deux piés font l’un devant
l’autre, éloignés de la diftance du pié entre les deux
talons qui font fur une même ligne» Foye^fig. y. •
Dans la cinquième, les deux piés font croifés l’un
devant l’autre ; enforte que le talon d’un pié eft directement
vis-à-vis la pointe de l’autre. Foye[ fig. 8.
Dans la première des fauffes pofitions, qui font de
même au nombre de cinq, les deux pointes des piés
fe touchent, & les talons font ouverts fur une même
ligne. Foye^fig. c,.
Dans la fécondé, les piés font ouverts de la diftance
de la lohgueur du pié entre les deux pointes qui
font toutes deux tournées en-dedans, & les deux talons
font ouverts fur une même ligne. Foye^fig. 10.
Dans la troifieme,la pointe d’un pié eft tournée en-
dehors & l’autre en-dedans ; enforte que les deux piés
foient parallèles l’un à l’autre. Foy e^ fig. 11.
Dans la quatrième, les deux pointes des piés font
tournées en- dedans ; mais la pointe d’un pié eft proche
de la cheville de l’autre. Foye^fig. i z . - -
Dans la cinquième, les deux pointes des piés font
tournées en-dedans ; mais le talon d’un pié èft vis-à-
vis la pointe de l’autre. Foye^ fig. 13.
D u pas. Quoique le nombre des pas dont on le
fert dans la danfe foit prefque infini, on les réduit
néanmoins à cinq, qui peuvent démontrer toutes les
différentes figures que la jambe peut faire en marchant;
ces'cinq pas font le pas droit, le pas ouvert,
le pas rond, le pas tortillé & le pas battu.
• Les traits de la figure 14, défigneront le pas ; la
tête A indiquera oit eft le pié avant que de marcher;
la ligne A 2?, la grandeur & la figure dit pas ; & la
ligne B C , la pofition du pié à la fin du pas : on dif-
tinguera qu’il s’agit du pié droit ou du pié gauche ,
félon que la ligne B C fera inclinée à droite ou à gauche
de la ligne du chemin.
On connoîtra à la tête A du pas fa durée : fi elle
eft blanche, elle équivaudra à une blanche de l’air
fur lequel on danfe ; fi elle eft noire, elle équivaudra
à,une noire du même air; fi c’eft une croche, la tête
ne fera tracée qu’à moitié en forme de c.
Dans le pas droit, le pié marche fur une ligne
droite : il y en a de deux fortes, l’un en-avant, l’autre
en-arriere. Foyer fig. i5. & 16 .
Dans le pas ouvert, la jambe s’ouvre : il y en a
de trois fortes , l’un en-dehors, l’autre en-dedans en
arc de cercle, & le troifieme à côté qu’on peut appei-
ler pas droit, parce que fa figure eft droite. Foye£ les
fig.1y .18. ic,. . ^
Dans le pas rond, le pié en marchant fait une figure
ronde : il y en a de deux fortes, l’un en-dehors,
l’autre en-dedans. Foyer les fig. zo . & z i'.
Dans le pas tortillé, le pié en marchant fe tourne
en-dedans & en-dehors alternativement : il y en a de
trois fortes, l’un en-avant, l’autre en-arriere, le trôi-
fieme à côté. Foye^ les fig. z z . 23. 24. ‘
Dans le pas battu, la jambe ou le pié vient battre
contre l’autre : il y en a de trois fortes, l’un en-avant,
l’autre en-arriere, & le troifieme de côté. Foye^ les
fig. zS. zG. zy. ■
On pratique en faifant les pas plufieurs agrémens,"
comme plié, élevé,fauté , cabriolé , tombé , glijfié, avoir
■ le pié en l ’air, pofer la pointe du pié t pofer le talon ,
tourner un quart- de-tour, tourner un demi-tour, tourner
trois quarts-de-tour , tourner le tour in entier, &c.
Le plier fe marque fur le pas par un petit tiret pan-
ché du côté de la tête du pas, comme on voitfig. z8.
L’élever fe marque fur le pas par un petit tiret perché
pendiculaire. Foye%_ la fig. 2.51.
Le fauter, par deux tirets perpendiculaires. Voye£
l * f ig - 3 °- .
Le cabrioler, par trois. Fjyeç la fig. 3 1 .'
Le tomber, par un autre tiret placé au bout du
premier, parallèle à la direction du pas, & tourné
vers la pointe du pié. Foye^ la fig. j z .
Le gliffer, par une petite ligne parallèle à la direction
du pas, & coupée par le tiret en deux parties ,
dont l’une va vers la tête & l’autre vers le pié. Foy.
fig-33-
Dans le pié en l’air, le pas eft tranché comme dans
1*fig-34- . ■ . .. ; . . /
Dans le pofer la pointe du pié fans que II corps y
foit porté, il y a un point directement au bout de la
ligne qui repréfente le pié comme dans la fig. 3 5.
Dans le pofer le talon fans que le corps y foit porté
, il y a un point directement derrière, ce qui repréfente
le talon. Foye^ la fig. 3 G.
Le tourner un quart-de-tour fe marque par un
quart de cercle. Foyeç la fig. $y.
Le tourner un demi-tour, par un demi-cerqle,’
Fcyeifig-38. ... t .
Le tourner trois quarts-de-tour, par les trois quarts
de la circonférence d’un cercle. Fo^e^ fig. 3$.
Le tourner un tour entier, par un cercle entier.’
Foye{ fig. 40. , • ■ »
Lorlqu’il y a plufieurs figues fur un pas, on exécute
les mouvemens qu’ils repréfentent les uns après
les autres, dans le mêmq ordre où ils font placés, à
commencer par ceux qui font les plus près de la tête
du pas, qu’il faut confidérer divilés en trois parties
ou tems. On fait dans le premier tems les mouvemens
qui font marqués fur la première partie du
pas : dans le fécond, ceux qui font placés lur le milieu
; & dans le troifieme, ceux qui font placés à la
fin. Ainfi quaftd il y; a un ligne plié au eommence-
ïnent du pas, il lignifie qu’il faut plur avant de mar-
icher. De même des autres.
Les fauts fe peuvent exécuter en deux maniérés ;
ou l’on faute des deux prés à-la-fois, oü l’on faute en
marchant d’un pié feulement. Les fauts qui fe font
des deux piés à-la-fois, feront marqués fur les pofitions,
comme il fera démontré dans l’exemple ci-
après ; au lieu que les fauts qui le font en marchant,
fe marquent fur les pas.
Le pas fauté fe fait de deux maniérés ; ou 1 on faute
& retombe fur la jambe qui marche, ou l’on faute
& retombe fur l’autre jambe.
S’il y a un ligne fauté fur un pas, & point de ligne
en l’air après, c ’eft une marque que le faut fe fait fur
la jambe même qui marche ; s’il y a un ligne en 1 air,
c’eft une marque que le faut fe fait fur l’autre jambe
que celle qui marche. ,
La danfe, de même que la mufique, eft fans agrément,
fi la mefure n’eft rigoureufement obfervée.
Lès mefurès font marquées dans la danfe par de
petites lignes qui coupent le chemin ; les intervalles
du chemin compris entre ces lignes, font occupés par
les pas, dont la durée fe connoît par les têtes blanches,
noires , croches, &c. qui montrent que les pas
doivent durer autant de tems que les notes de la mufique
placées au-deffus de la figure de la danfe. Fiyei
Vexemple. Ainfi un pas dont la tête eft blanche, doit
durer autant qu’une blanche de l’air fur lequel on
danfe * & un pas dont la tête eft noire, doit durer
autant qu’une noire du même air. Les pofitions marquent
de même par leurs têtes, les tems qu’elles doivent
tenir.
Il y a trois fortes de mefures dans la danfe ; la
tnefure à deux tems, la mefure à trois tems, & la
mefure à quatre tems. .
La mefure à deux tems comprend les airs de gavotte,
gaillarde, bourrée, rigodon, gigue, cana-
* ie , , . . » .
La mefure à trois tems comprend les airs de couran
te, farabande, paffacaille, chacone, menuet,
paffe-pië, &c.
La mefure à quatre tems comprend les airs lents,
comme par exemple l’entrée d’Apollon, de l’opérâ
du Triomphe de l’amour, & les airs de Loure.
Quand il faudra laiffer paffer quelques mefures de
J’air fans danfer, foit au commencement ou au milieu
d’une danfe, on les marquera par une petite ligne
qui Coupera le chemin obliquement : il y aura
autant de ces petites lignes que de mefures ; une de-
mi-mefure fera marquée par une demi-ligne oblique ;
ainfi le repos m arqué^. 4'- eft de trois mefures &
demie. Lorfqu’ôn aura un plus grand nombre de mefures
dé repos, comme par exemple dix, oh les dé-
fignerâ par des bâtons qui en vaudront chacun qua*-
tre. Foyei la fig. 4Z. Les tems, demkems, & quarts
de tems, fe marqueront par un foupir, un demi-fou-
p ir , & un quart de foupir, comme dans là mufique.
Aux airs qui ne commencent pas en frappant,
c’eft-à-dire ou il y a des notes dans la première mefure
fur lefquelles on ne danfe point ordinairement,
comme aux airs de gavotte, chacone, gigue, loure,
bourrée, &c. on marquera la valeur de ces notes au
commencement. Foye[ l'explication de l'exemple ci-
Après.
Les figures des danfes fe divifent naturellement
en fieux efpeces, que les maîtres appellent réguliers.
& irrégulières.
Les figures régulières font celles oh les chemins
des deux danfeurs font fymmétrie enfemble ; & les
irrégulières, font celles oh ces mêmes chemins ne
font pas de fymmétrie.
Il y a encore dans la danfe des mouvemens des
jbras Ôc des mains f ménagés avec art.
Tome I I I .
Les mains font marquées par ces cara&efes re-
préfentés fig. 4 3 . le premier eft pour la main gauche
, & le fécond pour la main droite ; on place celui
qui repréfente la main droite, à droite du chemin
, & le fécond à gauche. On obfervera, quand
on aura donné une main ou les deux, de ne point
quitter qu’on ne trouve les mêmes lignes tranchés*
Foye{ la figure 44. A repréfente la femme, B l’homme
a'uquel la femme A donne la main gauche, qu’il
reçoit dans fa droite : ils marchent enfemble tout le
chemin A D B C , à la fin duquel ils fe quittent ; ce
qui eft marqué par les mains qui font tranchées.
Les différens ports des bras & leurs mouvemens,’
font marqués par les lignes fuivans. A , B , C,fig. 45.
marque le bras droit; le même ligne,fig. 46'. tourné
de l’autre cô té, marque le bras gauche. A marque
l’épaule 9 B le coude, & C le poignet. Pour placer
les bfas fur le Chemin, on diftinguera les endroits
oh on va en-avant & en-arriere, de ceux oîi
l’on va de côté ; à ceux oh on va en-avant & en-arriere
, on marquera les bras aux deux côtés du chemin,
le bras droit du côté droit, & le bras gauche
du côté gauche ; à ceux oh l’on va de côté, on les
marquera deffus & deffous, obfervant toujours que
celui qui eft à droite eft le bras d roit, & celui qui eft
à gauche eft le bras gauche.
Exemples des differentes attitudes des bras.
45 & 46 , le bras étendu.
4 7 , le poignet plié.
48, le bras plié.
4 9 , le bras devant foi en hauteur.'
50, les deux bras ouverts.
5 1 , le bras gauche ouvert, & le droit plié ôu
Coude.
51 , le bras gauche ouvert, & le droit tout- à-fait
fermé.
5 3 , les deux bras ouverts.
54, le bras gauche ouvert, & le droit fermé du
coude.
5 5, le bras droit ouvert, & le gauche tout-à'-faiî
fermé.
Exemples des mouvemens de bras.
Ç6-, mouvement du poignet de bas en-haut»
Ç7, mouvement du coude de bas emhaut.
58, mouvement de l’épaule de bas en-haut.
^9, mouvement du poignet de haut en-bas.
60, mouvement du coude de haut en-bas.
6 1 , mouvement de l’épaule de haut en-bas, ^
6 2, rond du poignet de bas endiaut.
63, rond du coude de bas ernhaut.
64, rond de l’épaule de bas en-haut.
6 5 , fond du poignet de haut en-bas.
6 6 , rond du coude de haut en-bas.
6 7 , rond de l’épaule de haut en-bas.
é8 , rond du poignet de bas en-haut.
6o -, rond du coude de bas en-haut.
70, rond de l’épaule de bas en-haut.
7 1 , double mouvement du poignet de baà en-5
haut & de haut en-bas.
72 , double mouvement du coude.
7 3 , double mouvement de l’épaule.
Les bras peuvent agir tous deux en même tems^
ou l’un après l’autre. On connoîtra quand les deux
bras agiffent tous deux en même tems, par une liai—
fon allant de l’un à l’autre» Foy. la fig. y 4. qui marque
que les deux bras agiffent en même tems, &
par mouvement femblable ; la fig. yS. marque aufli
que les deux bras agiffent en même tems, mais par
mouvement contraire.
Si les deux bras n’ont pas de liaifon, c’eft une
marque qu’ils doivent agir l’un après l’autre. Le
premier eft celui qui précédé : ainfi dans l’exemple
A a a