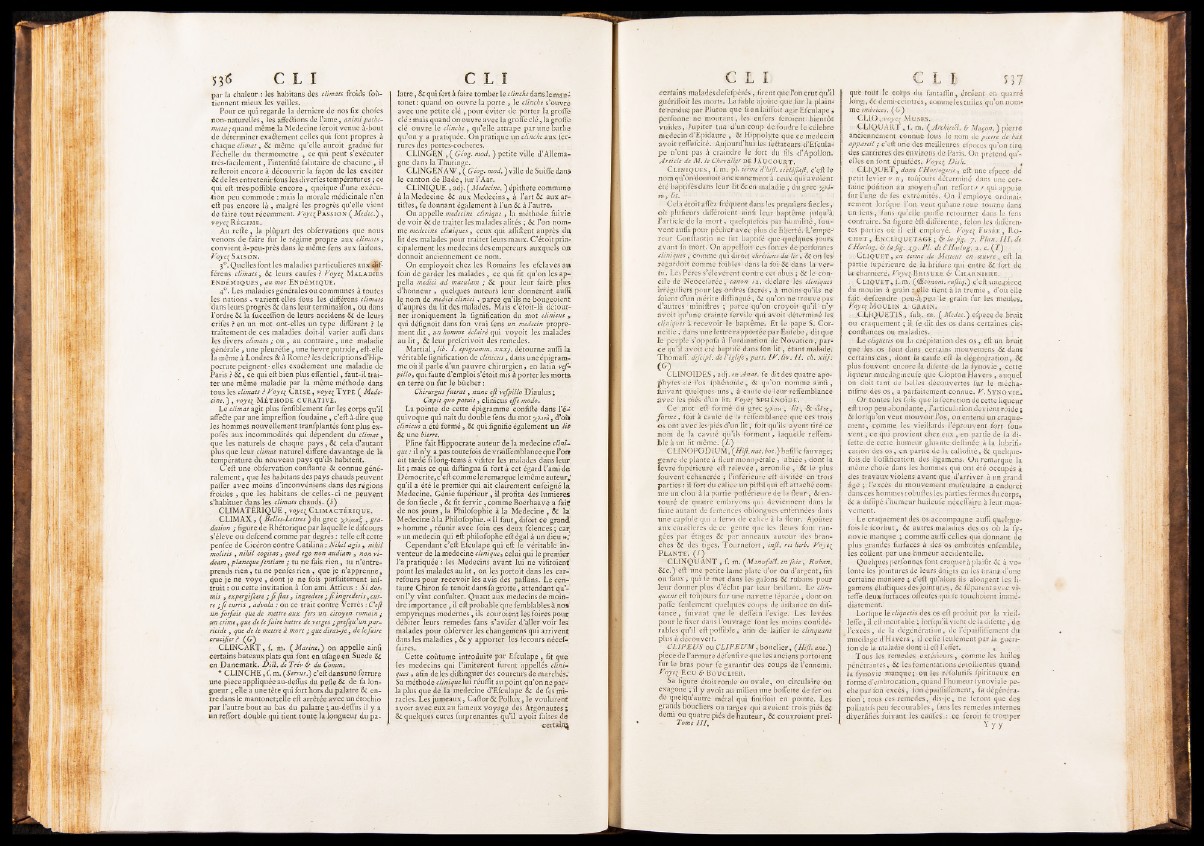
par la chaleur : les habitans des cllmàts froids foû-
tiennent mieux les veilles.. •
Pour ce qui regarde la derniere de nos fix chofes
non-naturelles, les affe&ions de l’ame, animi pathe-
m a ta ; quand même la Medecine feroit venue à-bout
de^déterminer exactement celles qui font propres à
chaque c lim a t , 8c même qu’elle auroit gradué fur
l ’échelle: du thermomètre , ce qui peut s’exécuter
très-facilement, l’intenlité falutaire de chacune , il
refteroit encore à découvrir la façon de les exciter
8c de les entretenir fous les diverfes températures ; ce
qui eft très-poffible encore , quoique d’une exécution
peu commode : mais la morale médicinale n’en
eft pas encore là , malgré les progrès qu’elle vient
de faire tout récemment. Voye^Passion ( Medec. ) ,
voye^ R ÉG IM E .
Au refte, la plûpart des obfervations que nous
venons de faire fur Je régime propre aux climats,
convient à-peu-près dans le même fens aux faifons.
Voyt{ Saison.
30. Quelles font les maladies particulières aimdif-
férens climats, 8c leurs caufes ? Voye^ Maladies
EN D ÉMIQ UES, au mot END ÉMIQ UE.
40. Les maladies générales ou communes à toutes
les nations , varient-elles fous les différens climats
‘dans leurs progrès 8c dans leur terminaifon, ou dans
l’ordre 8c la fucceflïon de leurs accidens 8c de leurs
crifes ? en un mot ont-elles un type différent ? le
traitement de ces maladies doit-il varier auffi dans
les divers climats ; ou , au contraire, une maladie
générale, une pleurélie, une fievre putride, eft-elle
la même à Londres & à Rome? les del'criptions d’Hippocrate
peignent-elles exaâement une maladie de
Paris ?-&, ce qui eft bien plus effentiel, faut-il traiter
une même maladie par la même méthode dans
tous les climats ? Voye^ Crise , voye^ Type ( Mede-
cine.) , voyez MÉTHODE CURATIVE.
Le climat agit plus fenliblement fur les corps qu’il
affefte par une impreffion foudaine, c’eft-à-dire que
les hommes nouvellement tranfplantés font plus ex-
pofés aux incommodités qui dépendent du climat,
que les naturels de chaque pa ys, 8c cela d’autant
plus que leur climat naturel différé davantage de la
température du nouveau pays qu’ils habitent.
C ’eft une obfervation confiante & connue généralement
, que les habitans des pays chauds peuvent
paffer avec moins d’inconvéniens dans des régions
froides , que les habitans de celles-ci ne peuvent
s’habituer dans les climats chauds. (b')
CLIMATÉRIQUE, voye{ Climactérique.
CLIMAX, ( Belles-Lettres ) du grec » gra~
dation ; figure de Rhétorique par laquelle le difcours
s’élève pu defcend comme par degrés : telle eft cette
penfée de Cicéron contre Catilina .* Nikil agis, nihil
moliris , nihil cogitas , quod ego non audiam , nonvi-
deam, planeque fentiam ; tu ne fais rien, tu n’entreprends
rien, tu ne penfes rien, que je n’apprenne,
que je ne voye , dont je ne fois parfaitement' inf-
truit : ou cette invitation à fon ami Atticus : Si dormis
, expergifcere y Ji fias , ingredere ; J î ingrederis, cur-
re ;Ji curris , advola : ou ce trait contre Verrès : C'efi
un forfait que de mettre aux fers un citoyen romain y
un crime, que de le faire battre de verges ; prefqu'un parricide
, que de le mettre a mort y que dirai-je, de le faire
crucifier ? (6 )
CLINCART, f. m. ( Marine.) on appelle ainfi
certains bateaux plats qui font en ufageen Suede 8c
en Danemark. JDicl. de Trév & du Comm.
* CLINCHE ,-f. m. (Serrur.) c’eft dansune ferrure
une piece appliquée au-deffus du pelle & de fa longueur
; elle a une tête qui fort hors du palatre & entre
dans le mantonet;elle eft arrêtée avec un étochio
par l ’autre bout au bas du palace ; au-deffus il y a
un reffort double qui tient toute la longueur du palatre,
& qui fert à faire tomber le clinche dans le matir
tonet: quand on ouvre la porte , le clinche s’ouvre
avec une petite clé , pour éviter de porter la groffe
clé : mais quand on ouvre avec la groffe clc, la groffe
clé ouvre le clinche , qu’elle attrape par une barbe
qu’on y a pratiquée. On pratique un clinche aux ferrures
des portes-cocheres.
CLINGEN , ( Géog. mod. ) petite ville d’Allemagne
dans la Thuringe.
CLINGENAW, ( Géog. mod. ) ville de Suiffe dans
le canton de Bade, fur l’Aar.
CLINIQUE , adj. ( Medecine. ) épithete commune
à la Medecine 8c aux Médecins, à l’art & aux ar-
tiftes, fe donnant également à l’un 8c à l’autre.
On appelle medecine clinique , la méthode fuivie
de voir & d e traiter les malades alités ; 8c l’on nomme
médecins cliniques, ceux qui affilient auprès dm
lit des malades pour traiter leurs maux. C ’étoit principalement
les médecins des empereurs auxquels o#
donnoit anciennement ce nom.
On employoit chez les Romains les efclaves a\t
foin de garder les malades, ce qui fit qu’on les appel
la medici ad matulam ; 8c pour leur faire. plus
d’honneur, quelques auteurs leur donnèrent auffi
le nom de medici clinici, parce qu’ils ne bougeoient
d’auprès du lit des malades. Mais c’étoit-là détourner
ironiquement la lignification du mot clinicus ,
qui défignoit dans fon vrai fens un médecin proprement
d it , un homme éclairé qui voyoit les malades
au l i t , & leur préferivoit des remedes.
Martial, lib. I . epigramm. x x x j. détourne auffi la
véritable lignification de clinicus , dans une épigram-
me où il parle d’un pauvre chirurgien, en latin vef-
pillo, qui faute d’emploi s’étoit mis à porteries morts
en terre ou fur le bûcher :
Chirurgus fuerat, nunc efivefpillo D iaulus;
Ccepit quo potuit, clinicus effe modo.
La pointe de cette épigramme confifte dans l’équivoque
qui naît du double fens du mot , d’oùi
clinicus a été formé, 8c qui lignifie également un lit
8c une bierre.
Pline fait Hippocrate auteur de la medecine clinique
: il n’y a pas toutefois de vraiffemblance que l’or*
ait tardé li long-tems à viliter les malades dans leur,
lit ; mais ce qui diftingua fi fort a cet égard l’ami de
Démocrite,c’eft comme le remarque le même auteur,*
qu’il a été le premier qui ait clairement enfeigrié la
Medecine. Génie fupérieur , il profita des lumières
de fon fiecle , & fit fervir , comme Boérhaave a faiC
de nos jours, la Philofophie à la Medecine , 8c la
Medecine à la Philofophie. « Il faut, difoit ce grand'
»homme , réunir avec foin ces deux fciences; car,
» un médecin qui eft philofophe eft égal à un dieu
Cependant c’eft Efculape qui eft le véritable inventeur
de la medecine clinique, celui qui le premier
l’a pratiquée : les Médecins avant lui ne vifitoient
point les malades au li t , on les portoit dans les carrefours
pour recevoir les avis des paffans. Le centaure
Chiron fe tenoit dans fa grotte, attendant qu’on
l’y vînt confulter. Quant aux médecins de moindre
importance, il eft probable que femblablesà nos
empyriques modernes, ils couroiènt les foires pour
débiter leurs remedes fans s’avifer d’aller voir les
malades pour obferver les changemens qui arrivent
dans les maladies , 8c y apporter les fecours nécef-
faires.
Cette coutume introduite par Efculape , fit que
les médecins qui l’imiterent furent appelles cliniques
, afin de les diftinguer des coureurs de marchés.*
Sa méthode clinique lui réuffit au point qu’on ne parla
plus que de la médecine d’Efculape <x de fes miracles.
Les jumeaux, Caftor&Poilux, le voulurent
avoir avec eux au fameux voyage des Argonautes ;
8c quelques cures furprenantes qu’il avoit faites de
certain^
certains maladesdefefpérés,,firent qûed’on crut qu’il
guériffoit les morts. La fable ajoute que fur:la plaint
te rendu'e par Plufon que ft ©n laiffoit agir Efculape ÿ
personne ne mourant, .les. enfers feroienitj .bientôt
vuides , Jupiter tua d’un, coup defoudre le célébré
médecin d’Epidaure , & Hippolyte que ce médecin
avoit reffufeité. - Aujourd’hui: les lêftateurs;d’Efçula-i
pe n’ont pas à craindre le fort du fils d’Apollon.
Article de M. le Chev'qlter DÉ JÂtTCOURT.
C l i n i q u e s ? f. m. pl. terme d’hijl. etcléfiafl, c’eft le
noih qû’oriÿonnoît anciennement à ceux qui avôiént
été bapfifésdans leur lit-êcen maladie ; dû grec
vii y lit. ■
Gela étoït affez fréqiient dans les premiers fieeles,-
où plufieùrs différoient ainfi leur baptême julqu’à,
rarticle de la mort, quelquefois pa'r^humilité, 'fou-
vent auffi: pour pécher avec plus de liberté-.-L’empê.J
reur Conftantin ne fut baptifé que-quelques jours,
avant fa mort. On àppellbit” fees lôrtès' de perfonnes
cliniques •comme qui dirôit chrétiens dit- lit , '& oh les1
règâfdbit comme foibles'dànS'Ia fof&dâh's là vertu.
LesPerbs s'élevèrent contre cet abus ; & lé concile
clé Nëocëfafée•, canori 12. déclare lés cliniques
irréguliers pour les ordres facrés, à moins qu’ ils ne
foient d’ùn mérité diftingiié, & qu’on ne-trouve pas'
d’autres ■ miniftres ; parce qu’on crôyok qu’il*n’y
avoit qu’une crainte fervilë qui avoit déterminé les:
cliniques a recevoir -le- baptême. Et le-pape S. Corneille
, dans une lettrera pportée par Énfebe , dit que
le peuplé s’oppofa à l’ordination de Nova-tien-, parce
qu’il avoit été baptifé dans fon li t , étant malade*
Thomaff. difcipl. de L'églife , part. LF. liv. II. ch. xiiji
{G )
CLINOIDES ,ad j. en Anat. fe dit des quatre apo-
phylèS'i(lë: Po’s fphërioïde, -& qu’on nomme àirffi ,
îùivarit quelques-uns, à-caüfe de:leur-reffemblance
avec l’es prés d’un lits Foyè{ SPHÉNOÏDE’.- .
Ce mot eft- formé du grec , lit1, •8i-ttS'oçt
forme, fôif à caufe de'là reffemblanceique ces trois
o s Ont avec lespiés d’un lit1, foit qu’ils ayent tiré-ce
nom de la cavité qu’ils forment, laquelle reffem-
ble à un lit même. (Lj-*1 ■ "
CLINOPGD1UM, (Hîfi. nat. bot.') bafilic fauvage;
genre de plante à fleur monopétale, abiée -, dont la
levre fiipérieure eft relevée , arrondie , & le plus
fouvent échancrée ; l’inférieure eft divitée- en trois
parties : il fort du calice un piftil qui eft attaché comme
un clou à la partie poftérieure de la fleur, & entouré
de quatre embryons qui deviennent dans la
fuite autant de femences ôblongues enfermées-'dans
une capfulè qui a fervi de ealicè à la fleur. Ajoutez
aux càrafteres de ce genre que les fleurs font rangées
par étages & par anneaux autour des branches
& des figes. Tournefort, injl. rei Herb. Voye£
P l a n t e , ( / )
CLINQUANT, f. m. ( Manufacl. enfoie, Ruban.
&:c.) eft une petite lame plate d’or ou d’argent, fin
ou faux, qui fe met dans les galons & rubans pour
leur donner plus1 d’éclat par leur brillant. Le clinquant
eû toujours fur une navette féparée, dont on
paffe feulement quelques coups de diftatke en distance
, füivant que le deffein l’exige. Les levées
pour le fixer dans l’ouvrage' font les. moins confidé-
rables qu’il eft poffible, afin de laiffer le clinquant
plus à découvert.
CLIP EUS ou CLIP E U M, bouclier, (Hifl. anc.)
piece de l’armure défenfive que les anciens portoient
fur le bras pour'fe garantir des coups de l’ennemi.
Voye^ E cu & B o u c l i e r .
Sa figuré étoitronde ou ovale, ou circulaire ou
exagone ; il y avoit au milieu une boffette de fer ou
de quelqu’autre métal qui finiffoit en pointe. Les
grands boucliers ou targes qui avoient- trois pies &
demi ou quatre piés de hauteur, 8c couvroient pref-
Tome IIP,
qufe tout le cotps du fantaffin , étoienf en quarré
long, 8c demi-ceintrés j comme les tuiles qu’on nom^
me imbrices. (G) . ,
C L IO y.voye^ MUSES.
■ CLIQUA R T , !.. m. (.Afchitecl. & Maçon. ) pierre
anciennement connue fbus le nom de pierre de bas
appareil ; c’eft une des meilleures efpeces qu’on tire
des càmeres dés environs de Paris. On prétend quelles
en font épuilées. Voye^ Dish. .
, CLIQUET., detns V'Horlogerie, eft une efpece dé
petit levier v u , toujours déterminé dans une certaine:
pofition au niôyeh d’un reffortrr / qui appuie
fur l ’une de fes extrémités.; On l’employe ordinairement
lorfque l’on v.eut qu’une rouç tourne dans
un fens ^ fans qu’elle puiffe retourner dans le fens
contraire..Sa figure éft différente, félon les différentes
parties où il eft employé. Voye^ Fusée , Ro-
c h e t , E n c l i q u e t a g e ; & la fig. y. Plan. II I . de
ÇHorloge 6f.la.fig.^ ^ „P l. de VHorlog. 2. c. (T)
•-.•..•CLIQUET.,.*«, tcrme-.de Metteur en,oeuvre., eft la
partie fiipérieure. de Ja,brifure qui entre 8c fort de
ïa-cbamieré. VoytçB r i s u r e .6* C h a r n i è r e .
., C l iQUET,.f.>m. (CfiLconom. rufti-qÇ);g*eft une«piecq
du moulin à grain : elle tient à la tremie , d’où elle
fait' fdefic€ndr,e,-peula-peu-‘le grain: fur les meules.
^Cqy«£>MouiiiN À g r a i n .
. .CLIQUETIS, fubt. m. f Medec.) efpece de bruit
ou craquement ; il fe dit des os dans certaines cir-
c.onft-ances ou maladies^ ;
; Le cliquetis ou la crépitation des o s , eft un bruit
que les..os font dans certains mpuvemens & dans
certains.càs, dont la caufe eft la dégénération , 8c
plus, fouvent encore la çlifette de la fÿnovie j cette
liqueur mucllà.gineufç que Clopton Havers , auquel
on doit tant de belles découvertes fur le mécha-
nifme.dçs o s, a pârfaitentent connue. V. S y n o v i e *.
Or toutes les fois que lafecrétion de cette liqueur
eft trop peujabonclante, l’articulation devient roide ;
&Jorfqû’on veut mouvoir l’os?, on entend un craquement,
comme. les vieillards Réprouvent fort fou-
yent ; c e qui provient chez eux , en partie de la di-
fette.de cette.humeur gluante deftinée à la lubrifi-
cajion des os,:en partie de la callofité, 8c quelque-
fois,de l’offification des ligamens. On remarque la
même choie dans les hommes qui ont été occupés à
des travaux violens avant- qtie. d’arriver à un grand
âgé ; l’excès du mouvement mufculaire a endurci
dans ces hommes robuftes les parties fermes du corps,
8c a diffipél’humeiir huileufe néceffaire.à leur mouvement.
' , - •
Le craquement des os aceompagne auffi quelqjie-
fois lé lcorbut, 8c autres,maladies des os où la fy-
novie manque ;. comme auffi-celles qui .dbnnant de
plus grandes furfaeës à des os emboîtés enfemble,
les collent par une humeur aécidenteUe.
Quelques perjonnes. font craquer à plaifir 8c à volonté
Les jointures de leurs .doigts en les tiranï d’une
certaine maniéré ; c’éft qii’alors ils alongent les li-
gamens élaftiquqs des jointures, 8c féparentavec vî-
teffe deux furfaces oflëulçs qui le touchoient immédiatement.:
Lorfque lé cliquetis des os eft produit par la vieil-
leffe, il eft incurable ; lorfqu’ii vient de la difette, de
l’excès, de la dégénérationde l’épaiffiffement du
mucilage d’Havèrs , il celle feulement par la guéri-
fon de la maladie dont il eft l’effet. ,
Tous les remedes extérieurs-, comme les huiles
pénétrantes, 8c les fomentations émollientes quand
la fynovie manque; où les réfolutifs /piritueux en
forme d’embrocation, quand l’Humeur fynoviale péché
par ion excès, fon épaiffilîèment, la dégénéra-
tion ; tous ces remedes, dis-je j ne feront que des
palliatifs peu fecourables, fans les remedes internes
diverfifîés fuiyant les caûfes„: ce feroit fe tromper
Y y y