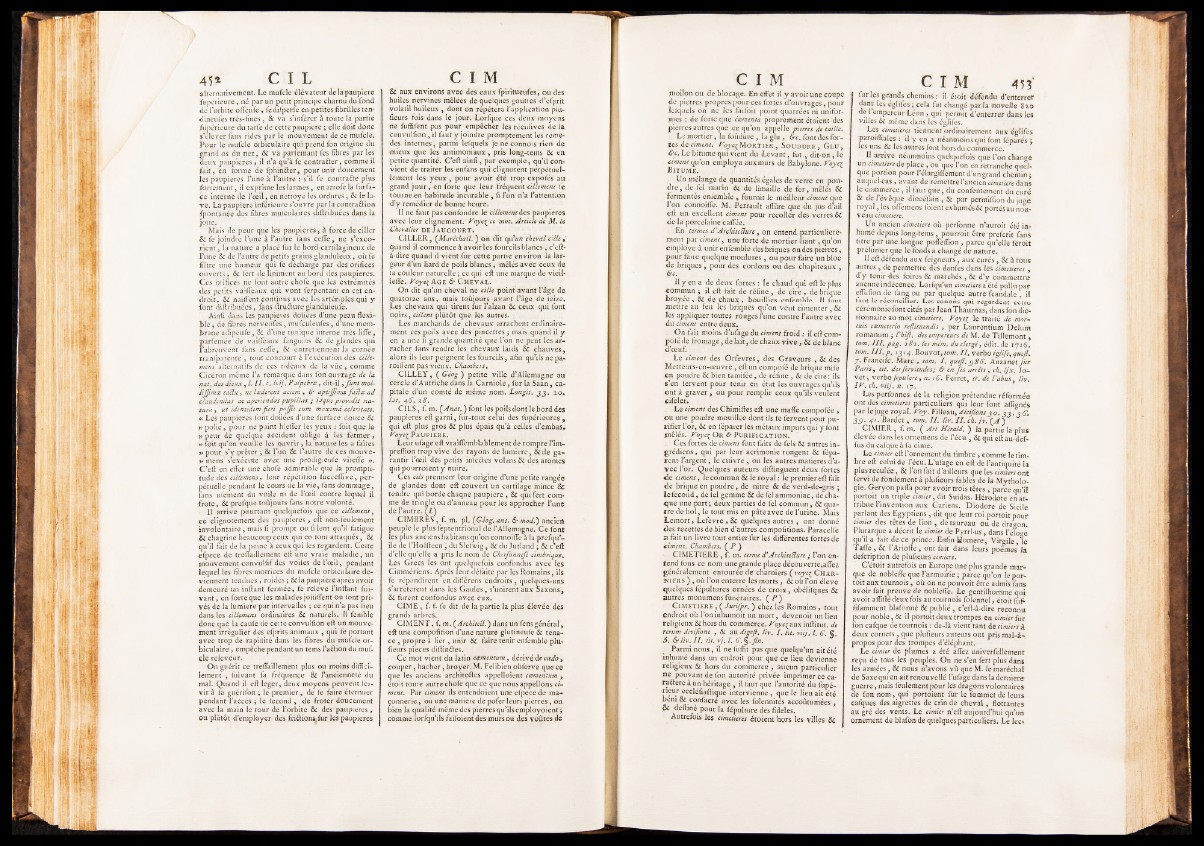
alternativement. Le mufcle élévateur de la paupière
fupérieure, né par un petit principe charnu du fond
de l’orbite offeufe , fedifperl’e en petites fibrilles tcn-
■ dineufes .très-fines , & va s’ inférer à toute la partie
fupérieure du tarie de cette paupière.; elle doit donc
s’élever fans rides par le mouvement dè ce mufcle.
Pour le mufcle orbiculaire qui prend fon origine du
grand ps du nez, & va parfemant fes fibres par les
deux paupières , il n’a qu’à fe contracter, comme il
fait, en forme de fphintter, pour unir doucement
les paupières l’une à l’autre : s’il fe ,contracte plu?
fortement, il exprime les larmes, en arrofe la furfa-
ce interne de l’oe il, en nettoye les ordures, & le lave.
Lâ paupière inférieure s’ouvre par la contraction
ipontanée des fibres mul'culaires d.iftribuées dans la
joue.
Mais de peur que le? paupières, à fQrce de ciller
& fe joindre l’une à l’autre fans c e lle , ne s’exçor
rient, la nature a placé fur le bord cartilagineux de
l ’une & de l’autre de petits grains glanduleux, où fe
filtre une humeur qui fe décharge par des orifices
ouverts, & fert de Uniment au bord des paupières.
Ces orifices ne font au,tre chofe que les extrémités
des petits ydi.ffcaux qui vont ferpentant en cet endroit,
& naifient continus avec les artérioles qui y
font clift ril?uées, fans (truCture glanduleuiè.
Ainfi dans les paupières douées d’une peau flexible
, de fibres nefveiïfes, mufeuleufes, d’une membrane
adipeufe, Sc d’une tunique interne très-lifTe,
parfemée de vaifïeaux fanguins 6c de glandes qui
l’abreuvent fans ce fie, .& entretiennent la .cornée
îranfpa.rente , tout concourt à l'exécution des cille-
'mens alternatifs de ces rideaux de la v u e , comme
Cicéron même l’a remarqué dans fon ouyrage de la
nat.'des dieux, l. ll.c .J v ij. Palpebroe, dit-il tfitntmol-
lijjîmce taclu , ne loedereni aciem , & aptijjîmce faclce ad
claudendas ac aperiendas pupillas j idque provid'tt na-
tura , ut identidem fieri pojjit cum maximâ celeritate.
« Les paupières font douées d’une furface d.ç?u.ce 6c
polie, pour ne point bleffer les yeux : foit que la
»peur dé quelque accident oblige à les fermer,
» foit qu’on veuille lès ouvrir, la nature les a faites
»pour s’y prêter ; & l’un 6c l’autre de ces mouve-
» mens s’exécute avec line prodigieufe vîteffe ».
C ’eft en effet une chofe admirable que la promptitude
des cillçmens, leur répétition fucceffive, perpétuelle
pendant le cours de la vie, fans dommage,
fans ufeYnent du voile ni de l’oeil contre lequel il
frote, & prefque toujours fans notre volonté.
Il arrive pourtant quelquefois que ce cillement,
c e clignotement des paupières , eft non-feulement
involontaire, mais fi prompt ou fi lent qu’il fatigue
& chagrine beaucoup ceux qui en font attaqués, &
qu’il fait de la peine à ceux qui les regardent. Cette
efpece de treffaillement eft une vraie maladie, un
mouvement convulfif des voiles de l’oe il, pendant
lequel les fibres motrices du mufcle orbiculaire deviennent
tendues , roides ; & la paupière a près avoir
demeuré un inftant fermée, fe releve l’inftant fui-
v an t , en forte que les malades joiiiffent ou font privés
de la lumière par intervalles ; ce qui n’a pas lieu
dans les cillement ordinaires 6c naturels. Il femble
donc que la caufe de cette convulfion eft un mouvement
irrégulier des efprits animaux , qui fe portant
avec trop de rapidité dans les fibres du mufcle orbiculaire
, empêche pendant un tems l’attion du mufcle
releveur.
On guérit ce treffaillement plus ou moins difficilement
, fuivant fa fréquence & l’ancienneté du
mal. Quand il eft leger, deux moyens peuvent fer-
vir à là guérifon ; le premier, de le faire éternuer
pendant l’accès ; le lecond , de froter doucement
avec la main le tour de l’orbite & des paupières,
ou plutôt d’employer des frittions,fur les paupières
& aux environs avec des eaux fpiritueufes, ou des
huiles nervines mêlées de quelques gouttes d’efprit
volatil huileux , dont on repétera l’application plufieurs
fois dans le jour. Lorfque ces deux* moyens
ne fuffifent pas pour empêcher les récidives de la
convulfion, il faut y joindre promptement les reme-
des internes, parmi lefquëls je ne connois rien de
mieux que les antimoniaux, pris long-tems 6c en
petite quantité. C’eft ainfi, par exemple, qu’il convient
de traiter les enfans qui clignotent perpétuellement
les y e u x , pour avoir été trop expofés au
grand jo u r , en forte que leur fréquent cillement fe
tourne en habitude incurable , fi l’on n’a Fattention
-d’y remédier de bonn;e héujre.
Il ne faut pas confondre le cillement des paupières
avec leur clignement. Foyè^ce mot. -Article de M. le
Chevalier DEJaucourt.
CILLER, ( Maréchall. ) on dit qu9un cheval cille r
quand il commence à avoir les fourcils blancs, c’eft-
tKlire quand il vient fur cette partie environ la largeur
d’un liard de poils blancs , mêlés avec eèux de
la couleur naturelle ; ce qui eft une marque de vieil-
leffe. Voye{ Age & C heval.
On dit qu’un cheval ne cille point avant l’âge dè
quatorze ans, mais toujours avant l’âge de iéize.
Les chevaux qui tirent fur l’alzan 6c ceux qui font
npirs, cillent plutôt que les autres.
Les marchands de chevaux arrachent ordinairement
ces poils avec des pincettes ; mais quand il y
en a une fi grande quantité que l’on ne peut les arracher
fans rendre les chevaux laids &: chauves,
alors ils leur peignent les fourcils, afin qu’ils ne pa-
r.oiffent pas vieux. Chambers.
C IL LE Y , ( Géog ) petite ville d’Allemagne au
cercle d’Autriche dans la Carniole, fur la Saàn, capitale
d’un comté de même nom. Longit. 3 3 . z o •
lut. q.G. z 8 .
CILS, f. m. ('Anat. ) font les poils dont le bord des
paupières eft garni, fur-tout celui d.es fupérieures.,
qui eft plus gros & plus épais qu’à celles d’embas»
Foye^ PAUPIERE.
Leur ufage eft vraiffemblablement de rompre l’im-
preffion trop v ive des rayons de lumière, & de garantir
l’oeil des petits inlettes volans 6c des atomes
qui-pourroienty nuire.
Ces cils prennent leur origine d’une petite rangée
de glandes dont eft couvert un cartilage mince 6c
tendre qui borde chaque paupière , & qui fert comme
de tringle ou d’anneau pour les approcher l’une
de l’autre. (£)
CIMBRES, f. m. pi. (Géog, anc. & mod.) anciejï
peuple le plus feptentrional de l’Allemagne. Ce font
les plus ancienshabitansqu’on connoiffe à la prefqu’-
île de i’Holfteen \ du S lelVig, & du Jutland ; & c’efl:
d’elle qu’elle a pris le nom de Cherfonnefe citnbrique.
Les Grecs les ont quelquefois confondus avec les
Cimmériens. Après leur défaite par les Romains, ils
fe répandirent en différens endroits , quelques-uns
s’arrêtèrent dans les Gaules, s’unirent aux Saxons,
6c furent confondus avec eux.
CIME, f. f. fe dit de la partie la plus élevée des
grands arbres.
CIMENT, f. m. (Architecte dans un fensgénéral,
eft une compofition d’une nature glutineufe & tenace
, propre à lier , unir & faire tenir enfemble plu-
fieurs pièces diftinftes.
Ce mot vient du latin eqsmentum, dérivé de coedo ,
couper, hacher, broyer. M. Felibien obferve que ce
que les anciens arehiteôes appelloient camentum ,
etoit toute autre chofe que ce que nous appelions ciment.
Par ciment ils entèndoient une efpece de maçonnerie
, ou une maniéré de pofer leurs pierres, ou
bien la qualité même des pierres qu’ils employoient ;
comme lorfqu’ils failoient des murs ou des voûtes de
moilon ou de blocage. En effet il y avoit une coupe
çle.pi erres propres.pour ces fortes d’ouvrages-, pour
lelquels on ne les faifoit point quarrées ni uniformes
: de forte que camenta proprement étoient des
pierres autres que ce qu’on appelle pierres de taille.
Le mortier, la foûdure , la glu , &c. font desfor-
t ç s de ciment. Voye^M o r t i e r , S o u d u r e , G l u ,
&c. Le bitume qui vient du Levant, fu t , dit-on, ;le
.ciment qu’on employa aux murs de Babyloné. V-oye^
BlTUMtE.
Un mélange de quantités égales de verre en poudre
, de fel marin & de limaille de f e r , mêlés &
fermentes enfemble -, fournit le meilleur ciment que
l ’on connoiffe. M. Perrault affûre que du jus d’ail
eft un excellent ciment pour recoller des verres &
de la porcelaine caffée.
En termes d'Architecture , on entend particulièrement
par ciment, une forte de mortier lian t, qu’on
employé à unir eniemble desbriques ou des pierres,
pour faire quelque moulures , ou pour faire un bloc
de briques , pour des cordons ou des chapiteaux ,
Il y en a de deux fortes : le chaud qui eft le plus
commun ; il eft fait de rëfine , de cire , de brique
broyée , & de chaux , bouillies enfemble. Il faut
mettre au feu les briques qu’on veut cimenter , &
les appliquer toutes rouges l’une contre l’autre avec
du ciment entre deux.
. On fait moins d’ufage du ciment froid : il efteom-
pofé de fromage, de lait, de chaux v ive , & de blanc
d’oeuf.
Le ciment des Orfèvres, des Graveurs , & des
Metteurs-en-oeuvre , eft un compqfé de brique mife
en poudre 6c bien tamifée, de refine , & de cire : ils
s’en fervent pour tenir en état les ouvrages qu’ils
ont à graver, ou pour remplir ceux qu’ils veulent
cifeler.
Le ciment des Chimiftes eft une maffe compofée , \
ou une poudre mouillée dont ils fe fervent pour pu- '
rifier l’or, & en féparer les métaux impurs qui y font
mêlés. Foye^ Or & Pu r if ic a t io n .
. Ces fortes de cimens font faits de fols & autres in- ■
grédiens, qui par leur acrimonie rongent & fépa- '
rent l’argent, le cuivre , ou les autres matières d’av
e c l ’or. Quelques auteurs diftinguent deux fortes
de ciment, le commun & le royal ; le premier eft fait ;
de brique en poudre, de nitre & de verd-de-gris |
le fécond, de fel gemme & de fel ammoniac, de cha-
ique une part ; deux parties de fel commun, & quatre
de b ol, le tout mis en pâte avec de l’urine. Mais
Lemort, Lefevre, & quelques autres , ont donné
des recettes de bien d’autres compofitions. Paracelfè
a fait un livre tout entier fur les différentes fortes de
ciment. Charrtbers. ( P )
CIMETIERE , 1’. m. terme d'Architecture ; l’on entend
fous ce nom une grande place décou verte,affez
généralement entourée de charniers ( voye^ C h a rniers
) , oii L’on enterre les morts, & où l’on éleve
quelques fépultures ornées de croix, obélifques &
autres monumens funéraires. ( P )
C imetiere , ( Jurifpr. ) chez les Romains , tout
endroit où l ’oninhumoit un mort, devenoit un lieu
religieux & hors du commerce. Voye^ aux inftitut. de
rerum divifione , & au digejt. liv. I . tit. viij. I. G. §.
6. & liv. I I . tit. vj, l. S. ^.fin.
Parmi nous, il ne fuffit pas que quelqu’un ait été
inhumé dans un endroit pour que ce lieu devienne
religieux & hors du commerce , aucun particulier
ne pouvant de fon autorité privée imprimer ce ca-
rattere à un héritage , il faut que l’autorité du fupé-
rieur eccléfiaftique intervienne , que le lieu ait été
«^nj^a-C<?n^acr® avec les folennités accoutumées,
’ Pour ta fépulture des fideles.
Autrefois les cimetières étoient hors les villes 6c
furies grands chemins : il étoit défendu d’enterret*
dans les eglifes ; cela fut changé par la novelle 8 io
! d e ! empereur Léon , qui permit d’enterrer dans les
villes & même dans les églifes.
Les cimetières tiennent ordinairement aux églifes
paroiffiales : il y en a néanmoins qui font féparés \
•les uns & les autres font hors du commerce.
Il arrive neanmoins quelquefois que l’on changé
un cimetieredz place, ou que l’on eu retranche quelque
portion pour l ’élargiffement d’un grand chemin %
auquelc-as , avant de remettre l’ancien cimetiere dans
le commerce, il faut que -, <lu oonfentement du curé
& de l’évêque 'diocéfain , & par permiffion <lu jugé
ro y al, les offemens foient exhumés & portés au nouveau
cimetiere.
Un ancien citnetiere où përfonne n’auroit été inhumé
depuis long-tems , pOiirroit être preferit fans
titre par une longue poffeflîon , parce qu’elle feroit
prefumer que lëîônds a changé de nature.
Il eft défendu aux feigneurs, aux curés, & à tous
autres , dé permettre des danfes dans lès cimetières ,
d’y tenir des foires & marchés , & d’y commettre
aucuneindécence. Lorfqu’un cimetiere a été poilu pat
effufion de fang ou par quelque autre fcandale , il
faut le réconcilier. Les canons qui regardent cette
cérémonie font cités par Jean Thaurnas, dans fon die*
tronnaire au mot cimetitre. Voyeç le traité de mor±
tuis cterneterio rejlitüeiidis , pêr Laurentium Deluift
romanum •; l ’hift-* des empereurs de M. dè Tiilemont -,
tom. I II, pag. z8z. les tnéîh. du clergé, édit, de 1716-.
t°m. I I I . p. ./j 74. Bouvot, tom. II. verbo églife,, quejl-.
y. Franoifc. Marc, tôm. I . quejl. c)86, Auzanêt Jur
Paris-, tit. des Jervitudes; & en fes arrêts , ch. tj'x. Jo-
v e t , verbo fepulcre, n. t€. Fèrret, tr. de l'àbu'st liv-.
1V. ch. viij. n, iy.
Les perfonnes dè la religion prétendue réformée
Ont des cimetières particuliers qui leur font affignés
par le juge royal. Voy. Fi Beau, décidons j o . j j . 3 G.
5 5 . 41. Bardet, tom. I I . liv. IL ch. jv. (A )
CIMIER , L m. ( Art Hérald. ) la partie la plus
élevée dans les ornemens de l’écû , & qui eft au-def-
fus du cafque à fà cime.
Le cimier eft l’ornement du timbre, comme le timbre
eft celui de l’écu. L’ufagè en ëft dé l’antiquité la
plus reculée, & 1 On fait d ailleurs que les cimiers ont
fervi de fondement à plufieurs fables de la Mythologie.
Geryon pâffa pour avoir trôis têtes -, parce qu’il
portôit un triple cimier, dit Sùidâs. Hérodote en attribue
l’invention aux Cariëns. Diodore de Sicile
parlant des Egyptiens , dit que leur roi pottoit pouf
cimier des têtes de lion , de taureau ou de dragom
Plutarque a décrit le cimier de PyfHms, dans Ielogé
qu’il a fait de ce prince. Enfin Homère , Virgile, le
Taflè , & l’A riofte, Ont fait dans leurs poèmes la
deferiptibn de plufieurs cimiers.
C’étoit autrefois en Europe une plus grande marque
de nobleflè que l’armoirie ; parce qu’on le por-
toit aux tournois, où on ne pouvoir être admis farts
avoir fait preuve de nobleffe. Le gentilhomme qui
avoit affifté deux fois au tournois folennel, étoit fufi
fifamment blafonné & publié, c ’eft-à-dire reconnu
pour noble, & il portoit deux trompes en cimier fur
fon cafque de tournois : de-là vient tant de cimiers à
deux cornets , que plufieurs auteurs ont pris mal-à-
propos pour des trompes d’éléphant.
Le cimier de plumes a été affez üniverfellement
reçu de tous les peuples. On rte s’en fert plus dans
les armées, & nous n’avons vû que M. le maréchal
de Saxe qui en ait renouvelle l’ufage dans la derniere
guerre, mais feulement pour les dragons volontaires
ae fon nom, qui portoient fur le fommet de leurs
cafques des aigrettes de crin de ch e v al, flottantes
au gré des vents. Le cimier n’eft aujourd’hui qu’un
ornement de blafon de quelques particuliers. Le lec-: