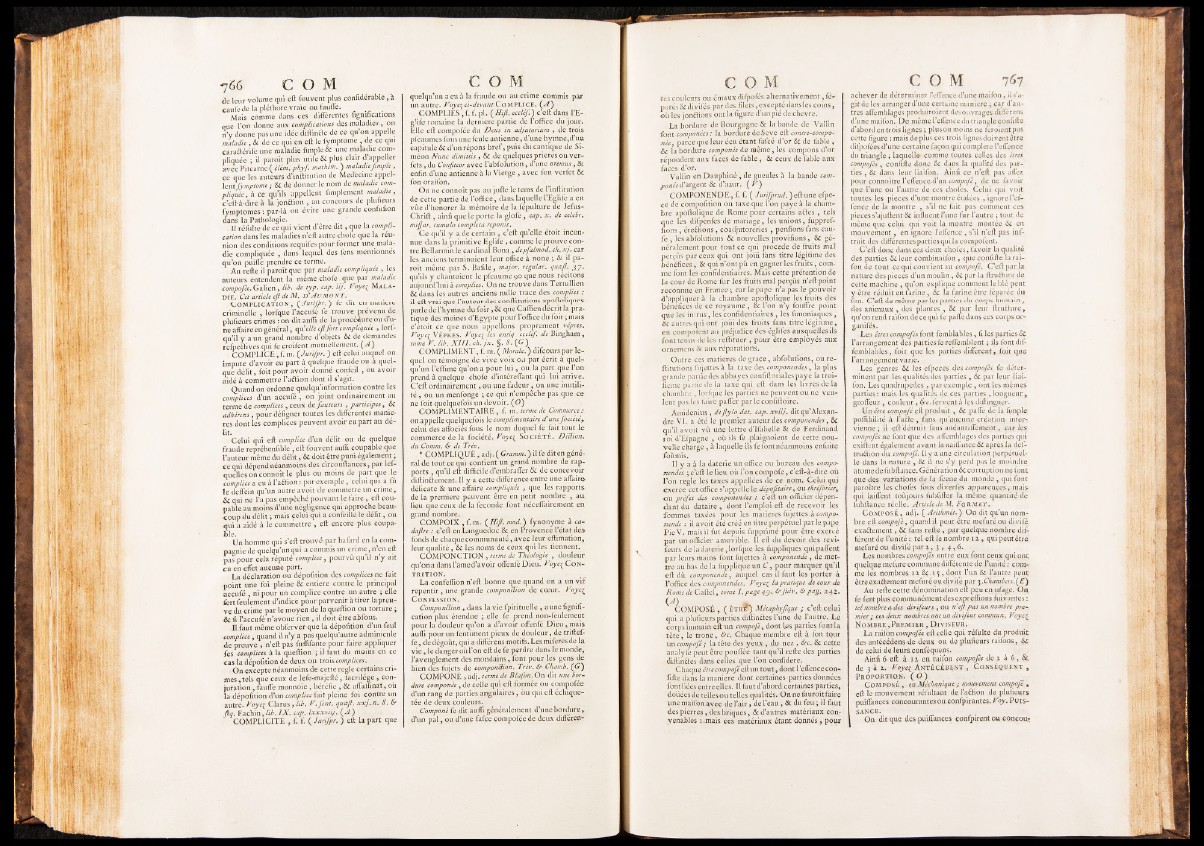
de leur volume qui eft Couvent plus confidéràble, à
caufe de la pléthore vraie ou fauffe.
Mais comme dans ces différentes lignifications
que l’on donne aux complications des maladies, on
n’y donne pas une idée diftinéte de ce qu on appelle
maladie, & de ce qui en eft le fymptome , de ce qui
caraétérife une maladie (impie 6c une maladie compliquée
; il paroît plus utile 6c plus clair d appeller
avec Pitcarne ( èlèm. phyf. matkém. ) maladie/impie ,
ce que les auteurs d’inftitution de Medécine appellent
fymptome ; 6c de donner le nom de maladie compliquée,
à ce qu’ils appellent limplement maladie,
c ’eft-à-dire à la jon&ion , au concours de plufieurs
fymptomes : par-là on évite une grande confufion
clans la Pathologie. '
Il réfulte de ce qui vient d’etre d i t , que la complication
dans les maladies n’eft autre choie que la réunion
des conditions requifes pour former une maladie
compliquée , dans lequel des fens mentionnes
qu’on puiffe prendre ce terme. . , ,
Au refte il paroît que par maladie compliquée , les
auteurs entendent la même chofe que par maladie
compofèe. Galien , lib. de typ. cap. iij. Voye^ M A LA DIE.
Cet article eJldeM. d 'A u M O N T .
C omplication, ( Jurifpr. ) fe dit en matière
criminelle , lorfque l’ accufé fe trouve prévenu de
plufieurs crimes : on dit aufli de la procédure ou d Urne
affaire en général, qu'elle eft fort compliquée , lorf-
qu’il y a un grand nombre d’objets 6c de demandes
refpeétives qui fe croifent mutuellement. ( A j
COMPLICE, f. m. ( Jurifpr. ) eft celui auquel on
impute d’avoir eu part à quelque fraude ou à quelque
délit, (bit pour avoir donné confeil , ôu avoir
aidé à commettre l’aûion dont il s’agit.
Quand on ordonne quelqu’information contre les
complices d’un accufé , on joint ordinairement au
terme de complices , ceux de fauteurs , participes, 6c
adhérens, pour défigner toutes les différentes manières
dont les complices peuvent avoir eu part au délit.
Celui qui eft complice d’un délit ou de quelque
fraude repréhenlible , eft fouvent aufli coupable que
l’auteur même du délit, 6c doit être puni également ;
ce qui dépend néanmoins des circonftances, par lesquelles
on connoît le plus ou moins de part que le
complice a eu à l’aftion : par exemple, celui qui a fû
le deffein qu’un autre a voit de commette un crime,
& qui ne l’a pas empêché pouvant le faire, eft coupable
au moins d’une négligence qui approche beaucoup
du délit ; mais celui qui a confeillé le délit, ou
qui a aidé à le commettre , eft encore plus coupable
.U
n homme qui s’eft trouvé par hafard en la compagnie
de quelqu’un qui a commis un crime, n’en eft
pas pour cela réputé complice, pourvu qu’il n’y ait
eu en effet aucune part.
La déclaration ou dépofition des complices ne fait
point une foi pleine 6c entière contre le principal
accufé , ni pour un complice contre un autre ; elle
fert feulement d’indice pour parvenir à tirer la preuve
du crime par le moyen de la queftion ou torture ;
& li l’accufé n’avoue rien , il doit être abfous.
Il faut même obferver que la dépofition d’un feul
complice, quand il n’y a pas quelqu’autre admimcule
de preuve , n’eft pas fuffifante pour faire appliquer
fes complices à la queftion ; il faut du moins en ce
cas la dépofition de deux ou trois complices.
On excepte néanmoins de cette réglé certains crimes
,tels que ceux de lefe-majefté, lacrilége , conjuration
, fauffe monnoie , hérefie , 6c aflaflinat, ou
la dépofition d’un complice fait pleine foi contre un
autre. Foye{ Clarus , lib. V . ftnt. qucejl. x x j.n . 8. 6*
ftq. Fachin, lib. IX . cap. Ixxxviij. (JA )
COMPLICITÉ , f. f. ( Jurifpr. ) eft la part que
quelqu’un a eu à la fraude ou au crime commis pàJf
un autre. Voye^ci-devant COMPLICE. (A") ■
COMPLIES , f . f. pl. ( Hifi. eccléf.) c’eft dans l’E-
glife romaine la derniere partie de l’office du jour»
Elle eft compofèe du Deus in adjutorium , de trois
pfeaumes fous une feule antienne, d’une hymne,d’un
capitule & d’un répons bref, puis du cantique de Si-
méon N une dimittis , 6c de quelques prières ou ver-
fets, du Confiteor avec l’abfolution, d’une oremus, &
enfin d’une antienne à la Vierge , avec Ion verfet 6c
fon oraifon.
On ne connoît pas au jufte le tems de l’inftitution
de cette partie de l’office, dans laquelle l’Eglife.a ert
vue d’honorer la mémoire de la lépulture de Jefus-
Chrift , ainfi que le porte la glofe, cap. x . de celebr.
mijjar. turnulo compléta reponit.
Ce qu’il y a de certain , c’eft qu’elle étoit inconnue
dans la primitive E glife, comme le prouve contre
Bellarmin le cardinal Bona , depfalmod. ch. xj. car
les anciens terminoient leur office à none ; & il paroît
même par S. B a file , major, regular. qucejl. 3 7 .
qu’ils y chantoient le pfeaume 90 que nous recitons
aujourd’hui à compiles. On ne trouve dans Tertullien
6c dans les autres anciens nulle trace des compiles :
il eft vrai que l’auteur des.conftitutions apoftoliques
parle de l’hymne du foir , 6c que Caflien décrit la pratique
des moines d’Egypte pouf l’office du foir ; mais
c’étoit ce que nous appelions proprement vêpres.
Poye{ VÊPRES. Voye{ les antiq. ecclefi de Bingham ,
tome V. lib. X IU . ch.jx. $ .8 . (G )
COMPLIMENT, f. m. ( Morale. ) difeours par lequel,
on témoigne de vive voix ou par écrit à quelqu’un
l’eftime qu’on a pour lu i, ou la part que l’on
prend à quelque chofe d’intéreflant qui liii arrive.
C ’eft ordinairement, ou une fadeur , ou une inutilité
, ou un menfonge ; ce qui n’empêche pas que ce
ne foit quelquefois un devoir. (O)
COMPLIMENTAIRE, f. m. terme de Commerce:
on appelle quelquefois le complimentaire d’une J'ociété,
celui des aflocies fous le nom duquel fe fait tout le
commerce de la fociété. Voye£ So c ié t é . Diction,
du Comm. & de Trev.
* COMPLIQUÉ, adj. ( Gramm. j il fe dit en général
de tout ce qui contient un grand nombre de rapports
, qu’il eft difficile d’embrafler 6c de concevoir
diftinéement. Il y a cette différence entre une affaire
délicate & une affaire compliquée , que les rapports
de la première peuvent être en petit nombre ., au
lieu que ceux de la fécondé font nécefîairement en
grand nombre.
COMPOIX , f. m. ( Hifi. mod.j fynonyme à ca-
daftre : c’eft en Languedoc 6c en Provence l’état des
fonds de chaque communauté, avec leur eftimation,
leur qualité, 6c les noms de ceux qui les tiennent.
COMPONCTION , terme de Théologie , douleur
qu’on a dans l’amed’avoir offenfé Dieu. Voye^ C ont
r it io n .
La confeflion n’eft bonne que quand on a un v if
repentir , une grande componction de coeur. V>ye^
C onfession.
Componction, dans la vie fpirituelle , a une fignifî-
cation plus étendue ; elle fe prend non-feulement
pour la douleur qu’on a d’avoir offenfé D ieu , mais
aufli pour un fentiment pieux de douleur, de triftefi
fe , de dégoût, qui a différens motifs. Les miferes de la
v ie , le danger où l’on eft de fe perdre dans le monde,
l’aveuglement des mondains, font pour les gens de
bien des fujets de componction. Trév. & Chamb. (G j
COMPONÉ , adj. terme de Blafon. On dit une bordure
componée, de celle qui eft formée ou compofèe
d’un rang de parties angulaires, ou qui eft é t iq u e tée
de deux couleurs.
Componé fe dit aufli généralement d’une bordure ,
d’un pa l, ou d’une fafee compofèe de deux différentes
couleurs ou émaux difpofés alternativement, fe-
parés&divifés par des filets ,excepté dans les coins,
où les jonctions ont la figure d’un pié de chevre.
La bordure de Bourgogne & la bande de Vallin
font componées: la bordure deSeve eft contre-composée
parce que leur écu étant fafcé d’or 6c de fable ,
& la bordure componée de même, les compons d’or
répondent aux faces de fable, & ceux de fable aux
faces d’or.
Vallin en Dauphiné , de gueules à la bande componée
d’argent 6c d’azur. ( P")
COMPONENDE, f. f. ( Jurifprud. ) eft une efpe-
ce de cômpofition ou taxe que l’on paye à la chambre
apoftolique de Rome pour certains aétes , tels
que les difpenfes de mariage, les unions, fuppref-
fions , éreétions, coadjutoreries , penfions fans caufe
, les abfolutions 6c nouvelles provifions, 6c généralement
pour tout ce qui procédé de fruits mal
perçus par ceux qui ont joiii fans titre légitime des
bénéfices, & qui n’ont pû en gagner les fruits, comme
font les confidentiaires. Mais cette prétention de
la cour de Rome fur les fruits mal perçus n’eft point
reconnue en France ; car le pape n’a pas le pouvoir
d’appliquer à la chambre apoftolique les fruits des
bénéfices de ce royaume , 6c l’on n’y fouffre point
que les intrus, les confidentiaires , les fimoniaques ,
& autres qui ont' joiii des fruits fans titre légitime,
en compofent an préjudice des églifes auxquelles ils
font tenus de les reftituer , pour être employés aux
ornemens & aux réparations.
Outre ces matières de grâce, abfolutions, oure-
ftitutions fujettes à la taxe des componendes, la plus
grande partie des abbayes confiftoriales paye la troi-
lieme partie de la taxe qui eft dans les livres de la
chambre , lorfque les parties ne peuvent ou ne veulent
pas les faire paffer parleconfiftoire.
Amidenius , defiylo dat. cap. xviij. dit qu’Alexandre
VI. a été le premier auteur des componendes, 6c
qu’il avoit vu une lettre d’Ifabelle & de Ferdinand
roi d’Efpagne , où ils fe -plaignoient de cette nouvelle
charge , à laquelle ils fe (ont néanmoins enfuite
foûmis.
Il y a à la daterie un office ou bureau des compon.
endes ; c’eft le lieu où l’on compofe, c’eft-à-dire où
l’on réglé les taxes appellées de ce nom. Celui qui
exerce cet office s’appelle le dèpojitaire, ou thrèforier,
ou préfet des componendes : c’eft un officier dépendant
du dataire , dont l’emploi eft de recevoir les
fommes taxées pour les matières fujettes à compor
nende : il avoit été créé en titre perpétuel parle pape
PieV. mais il fut depuis fupprimé pour être exercé
par un officier amovible. Il eft du devoir de.s revi-
feurs de la daterie, lorfque les fuppüques qui paffent
par leurs mains font fujettes à compontnde , de mettre
au bas de la fupplique un C , pour marquer qu’il
eft dû componende, auquel cas il faut les. porter à
l’office des componendes. Voye{ la pratique de coup de
Rome de C aftel, tome I.page 45. & fuiv. & pag. 242.
A)C
OMPOSÉ , ( ÊTRE*) Métaphyfique ; c’eft celui
qui a plufieurs parties diftin&es l’une de l’autre. Le.
corps humain eft un compofédont les parties, font la
tê te , le tronc, &c. Chaque membre eft à fon tpur
un compofé; la tête des yeux , du nez , &c. & cette
analyfe peut être pouffée tant qu’il refte des parties
diftindles dans celles que l’on confidere.
Chaque être compofé eft un tout, dont l ’effence con-
fifte dans la maniéré dont certaines parties données
font liées entre elles. Il faut d’abord certaines parties,
douées de telles ou telles qualités. On ne fauroit faire
une maifon avec de l’air, de l’eau, & du feu ; il faut
des pierres, des briques, & d’autres matériaux convenables
:.mais çes matériaux étant donnés, pour
achever de déterminer l’effence dùine maifon, il s’agit
de les arranger d’une certaine maniéré ; car d’autres
affemblages produiroient des ouvrages différens
d’une maifon. De même l’eflence du triangle confifte
d’abord entrois lignes ; plus ou moins ne feroientpas
cette figure : mais de plus ces trois lignes doivent être
difpofées d’une certaine façon qui complété l’effence
du triangle ; laquelle comme toutes celles des êtres
com pofés, confifte donc & dans la qualité des parties
, & dans leur liaifon. Ainfi ce n’eft pas affez
pour connoître l’effeoçe.d’un compofé, de ne fa voir
que l’une ou l’autre de ces chofes. Celui qui voit
toutes les pièces d’une montre étalées , ignore l’effence
de la montre , s’il ne fait pas comment ces
pièces s’ajyftent & influent l’une fur l’autre ; tout cle
même que çelui qui voit la montre montée & en
mouvement, en ignore Teffence , s’il n’eft pas inf-
truit des différentes parties qui la compofent.
C ’eft donc dans ces deux choies, favoir la qualité
des parties êi leur combina ifon, que confifte la rai-
fon de tout ce qui convient au compofé. C’eft par la
nature des pièces d’un moulin, ôc par la ftrufture de
cette machine , qu’on explique comment le blé peut
y être réduit en farine, ôc la farine être féparée du
fon. C’eft de même parles parties du corps humain ,
des animaux , des plantes , & par leur ftrudfure,
qu’on rend raifon de ce qui fe paffe dans ces corps or-
ganifés.
Les êtres compofés font femblables, fi les parties oc
l’arrangement des parties fe reffemblent ; ils fontdif-
femblables, foit que les parties different, foit que
l’arrangement varie.
Les genres & les efpeces des compofés fe, déterminent
par les qualités des parties , 6c par leur liaifon.
Les quadrupèdes , par exemple , ont les mêmes
parties : mais les qualités de ces, parties , longueur ,
groffeur , couleur, Çrc. fervent; à les diftinguer.
Un être compofé eft produit , & paffe de la fi m pie
poflibilité, à l’aéie , fans, qu’aucune création intervienne
; il eft'détruit fans anéantiffement, car les
compofés ne font que des affemblages des parties qui
exiftent également avant la naiffance & après la deC-
truftion du compofé. Il y a une circulation perpétuelle
d%ans la nature., 6c il ne s’y perd pas. le moindre
atome de fubftance. Génération 6c corruption ne font
que des. variations de la feene du monde , qui font
paroître les chofeS fous diverfes apparences, mais
qui laiffent toûjours fubfifter la même quantité de
lubftançe réelle. A r tic le de, M , F q r m e y .
C omposé , adj. ( Aritkmét.') On dit qu’un nombre
eft compofé, quand il. peut être m<?furé au di vifé
exactement, 6c fans refte , par quelque nombre différent
de l’unité : tel eft le nombre 1 a , qui peut être
mefu.ré ou diyifé p a ra , 3 , 4 , 6.
Les nombres compofés entre eux font ceux qui ont
quelque mefure commune différente de l’unité : comme
les nombres. 1 z 6ç 15 , dont l’un 6c l’autre peut
être exactement mefurç ou di vifé par 3. Chambers. (£ )
Au refte cette dénomination eft peu en ufage. On
fe fert plus, communément des expreflions fuivantes :
! tel nombre a des diyifeurs , ou n'eft pas un nombre pre*
[ mier ; ces d eu x nombres on t un diyifeur commun. Koyez
N o m b r e »Pr e m i e r , D i v i s e u r .
La raifon compofèe eft celle qui réfulte du produit
des antécédens de deux ou de plufieurs raifons, 6c
de celui de leurs conféquens.
Ainfi 6 eft à 1 a en raifon compofèe de a à 6 , &
de 3 à Z. Foyei AntÉQÉPÇNT J C onséquent ,
Proportion. ( O )
COMPOSÉ , en M èchanique. ; mouvement compofé ,
eft le mouvement réfutant; de l’aftion de plufieurs
puiffances concourantes ou çonfpirantes. V o y . Puissance.
On dit que des puiffances confpirent ou conçou