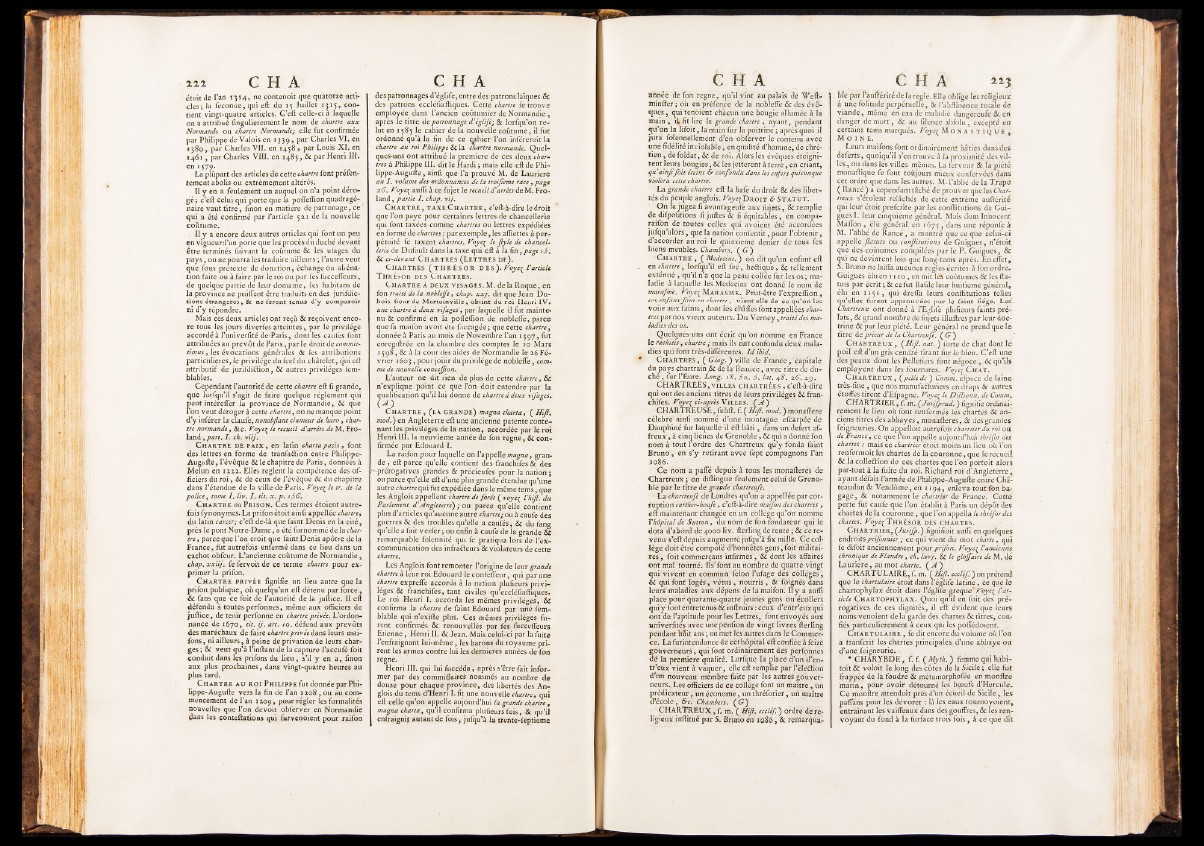
étoit de l’an 1314» ne contenoit que quatorze articles;
la fécondé, qui eft du 15 Juillet 1315» contient
vingt-quatre articles. G’eft celle-ci à laquelle
on a attribue fmguiierement le nom de chartrc aux
Normands ou chartrc Normande; elle fut confirmée
par Philippe de Valois en 1339, par Charles V I. en
1380, par Charles VII. en 1458 > par Louis XI. en
14 6 1 , par Charles VIII. en 1485, & par Henri III.
en 1579. #
La piûpart des articles de cette chartrc font prefen-
tement abolis ou extrêmement altérés.
Il y en a feulement un auquel on n’a point dérogé
; c’eft celui qui porte que la poffeffion quadragénaire
vaut titre, finon en matière de patronage, ce
qui a été confirmé par l’article 511 de la nouvelle
coûtume.
, Il y a encore deux autres articles qui font un peu
en vigueurrl’un porte que les procès du duché devant
être terminés fuivant la coûtume 8c les ufages du
p a y s , on ne pourra les traduire ailleurs ; l’autre veut
que fous prétexte de donation, échange ou aliénation
faite ou à faire par le roi ou par fes fucceffeurs,
de quelque partie de leur domaine, les habitans de
la province ne puiffent être traduits en des jurifdic-
tions étrangères, & ne feront tenus d’y comparoir
ni d’y répondre.
Mais ces deux articles ont reçu & reçoivent encore
tous les jours diverfes atteintes, par le privilège
accordé à l’univerfité de-Paris, dont les caufes font
attribuées au prévôt de Paris, par le droit de commit-
timus t les évocations générales & les attributions
particulières, le privilège du feel du châtelet, qui eft
attributif de juril'diûion, 8c autres privilèges iem-
blables.
Cependant l’autorité de cette chartrc eft fi grande,
que lorfqu’il s’agit de faire quelque réglement qui
peut intéreffer la province de Normandie, & que
l’on veut déroger à cette chartrc, on ne manque point
d’y inférer la claufe, nonobjiant clameur de haro, char-
tre normande, &c. Foyer le recueil d'arrêts de M. Fro-
land, part. 1. ch. viij.
C hartre de p a ix , en latin charta pacis , font
des lettres en forme de tranfaftion entre Philippe-
Augufte, l’évêque & le chapitre de Paris, données à
Melun en 1222. Elles règlent la compétence des officiers
du ro i, & de ceux de l’évêque & du chapitre
dans l’étendue de la ville de Paris. Foyeç le tr. de la
police y tome I . liv. I . tit. x . p. iS6~.
C hartre ou Priso n . Ces termes étoient autrefois
fy nonymes. La prifon étoit ainfi appellée chartre y
du latin carccr; c’eft de-là que faint Denis en la cité,
près le pont Notre-Dame, a été furnommé de la chartre
y parce que l’on croit que faint Denis apôtre de la
France, fut autrefois enfermé dans ce lieu dans un
cachot obfcur. L’ancienne coûtume de Normandie,
chap. xxiij. fe fervoit de ce terme chartre pour exprimer
la prifon.
C hartre privée lignifie un lieu autre que la
prifon publique, oit quelqu’un eft détenu par force,
8c fans que ce foit de l’autorité de la juftice. Il eft
défendu à toutes perfonnes, même aux officiers de
juftice, de tenir perfonne en chartre privée. L’ordonnance
de 1670, tit. ij. art. 10. défend aux prévôts
des maréchaux de faire chartre privée dans leurs mai-
fons, ni ailleurs, à peine de privation de leurs charges
; 8c veut qu’à l’inftant de la capture l’accufé foit
conduit dans les prifons du lieu , s’il y en a , finon
aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au
plus tard.
C hartr e a u r o i Philippe fut donnée par Philippe
Augufte vers la fin de l’an 1208, ou au commencement
de l’an 1209, pour régler les formalités
nouvelles que l’on devoit obferver en Normandie
dans les conteftations qui furvenoient pour raifon
despatroiinages d’églife, entre des patrons laïques &
des patrons eccléfiaftiques. Cette chartre fe trouve
employée dans l’ancien coûtumier de Normandie,
après le titre de patronnait d'èglife; & lorfqu’on relut
en 1585 le cahier de la nouvelle coûtume, il fut
ordonné qu’à la fin de ce cahier l’on inféreroit la
chartre au roi Philippe 8c la chartre normande. Quelques
uns ont attribué la première de ces deux char*
très à Philippe III. dit le Hardi ; mais elle eft de Philippe
Augufte, ainfi que l’a prouvé M. de Lauriere
au I . volume des ordonnances de la troijieme race, page
-x6. Foye^ aufli à c,e fujet le recueil d'arrêts de M. Fro-
land, partie I. chap. vij.
C hartre , t a x e C hartre , c’eft-à-dire le droit
que l’on paye pour certaines lettres de chancellerie
qui font taxées comme Chartres ou lettres expédiées
en forme de Chartres : par exemple, les aflïettes à perpétuité
fe taxent Chartres. Foye[ le Jlyle de chancellerie
de Dufault dans la taxe qui eft à la fin y page
8c ci-devant C hartres (LETTRES DE).
C hartres ( t h r é s o r d e s ) . Foye^ l'article
T hrésor des C hartres.
C hartre à deux v isa g e s . M. de la Roque, en
fon traité de la nobleffe, chap. xx j. dit que Jean Dubois
fieur de Martainville, obtint du roi Henri IV.
une chartre à deux vifages, par laquelle il fut maintenu
& confirmé en, la poffeffion de nobleffe, parce
que fa maifôn avoir été faccagée; que cette chartre^
donnée à Paris au mois de Novembre l’an 1597, fut
enregiftrée en la chambre des comptes le 10 Mars
1598, &c à la cour des aides de Normandie le 26 Février
1603, pour joiiir du privilège de nobleffe, comme
de nouvelle concefjion.
L’auteur ne dit rien de plus de cette chartre, &
n’explique point ce que l’on doit entendre par la
qualification qu’il lui donne de chartre à deux vifages
C h a r t r e , ( la grande) magna charta, ( Hifi.
mod.) en Angleterre eft une ancienne patente contenant
les privilèges de la nation, accordée par le roi
Henri III. la neuvième année de fon régné, 8c confirmée
par Edouard I.
La raifon pour laquelle on l’appelle magna, grand
e , eft parce qu’elle contient des franchifes & des
"prérogatives grandes & précieufes pour la nation ;
ou parce qu’elle eft d’une plus grande étendue qu’une
autre chartre qui fut expédiée dans le même tems, que
les Anglois appellent chartre de forêt ( voye{ l'hifi. du
Parlement d'Angleterre) ; ou parce qu’elle contient
plus d’articles qu’aucune autre chartre; ou à caufe des
guerres & des troubles qu’elle a caufés, 8c du fang
qu’elle a fait verfer; ou enfin à caufe de la grande &
remarquable folennité qui fe pratiqua lors de l’excommunication
des infrââeurs & violateurs de cette
chartre.
Les Anglois font remonter l’origine de leur grande
chartre à leur roi Edouard le confeffeur, qui par une
chartre expreffe accorda à la nation plufieurs privilèges
& franchifes, tant civiles qu’eccléfiaftiques.
Le roi Henri I. accorda les mêmes privilèges, 8c
confirma la chartre de faint Edouard par une fem-
blable qui n’exifte plus. Ces mêmes privilèges furent
confirmés 8c renouvellés par fes fucceffeurs
Etienne, Henri II. 8c Jean. Mais celui-ci par la fuite
l’enfraignant lui-même, les barons du royaume prirent
les armes contre lui les dernieres années de fon
régné.
Henri III. qui lui fuccéda, après s’être fait informer
par des commiffaires nommés au nombre de
douze pour chaque province, des libertés des Anglois
du tems d’Henri I. fit une nouvelle chartre, qui
eft celle qu’on appelle aujourd’hui la grande chartre ,
magna charta, qu’il confirma plufieurs fois, & qu’il
enfraignit autant de fois, jufqu’à la trente-feptieme
aïinéè de fon régné, qu’il vint au palais dé Weft-
minfter ; où en préfence de la nobleffe & des évêques
, qui tenaient chacun une bougie allumée à la
main , il fit lire la grande chartre , ayant, pendant
qu’on la lifoit, la main fur la poitrine ; après quoi il
jura folennellement d’en obferver le contenu avec
unë fidélité inviolable, en qualité d’homme,' de chrétien,
defoldat, 8c de roi. Alors les évêques éteignirent
leurs bougies, & les j'étterent à terre, en criant,
qu' ainfifoit éteint & confondu dans les enfers quiconque
violera cette chartre.
La grande chartre éft la bafe du droit & des libertés
du peuple anglois. FoyefDRoiT & St a t u t .
On la jugea fi avantàgeufe aux fujèts, & remplie
de difpofitions fijuftes & fi équitables , en compa-
raifon de toutes celles qui avoie'nt été accordées
jufqu’alors, que la nation Cônfentit, pour l’obtenir,
d’accorder au roi le quinzième denier de tous fes
biens meubles. Chambers. ( G )
C hartre , ( Medecine.') ôn dit qu’un enfant eft
en chartre, lorfqu’il eft fe c , hé&ique, 8c tellement
exténué , qu’il n’a que la peau collée fur les os maladie
à laquelle les Médecins ont donné le nom de
marajm’è. Foye{ Marasm e. Peut-être l’éxpreffion,
ces etifans font en chartre, vient-elle de ce qu’on les
voiie aux laints, dont les châffes fontappeileés' char->
très par nos. vieux auteurs. D u Verney, traité des ma->
ladies des os.
Quelques-uns ont écrit qu’on nomme èn France
le rachitis, chartre; mais ils ont confondu deux maladies
qui font très-différentes. Id ibid.
C hartres , ( Géog. ) ville de France, capitale
du pays çhartrain .& de la Beauce, avec titre de duché
, fur l’Eure. Long} f8 iS o . 5. lat. 48. x6. xc)..
CHARTRÈES,villes ch a r t r é e s , c’éft-à-dire
qui ont des anciens titres de leurs privilèges 8c franchifes.
Foyeç ci-après V illes. ( -d )
CHARTREUSE, fubft. f. ( Hifi. mod. ) moriâftere
célébré ainfi nommé d’une Inontagrie efcarpëe de
Dauphiné fur laquelle il éft b â t i, dans un defert affreux
, à cinq lieues de Grenoble, 8t qui a donné fon
nom à tout l’ordre des ChartfeUx qu’y fonda faint
Bruno, en s’ÿ retirant avec fept compagnons l’âil
.1086.
Ce nom a paffé depuis à tous les monàftèfés de
Chartreux; on diftingue feulement celui de Grenoble
par le titre' de gràûde chartreufe.
La chùritéufe de Londres qu’on à appellée par corruption
carther-houfe, c’eft-à-dire ma'ifon des chantes,
eft maintenant changée en un collège qu4on nomme
Xhôpital de Sutton, du nôni de fort fondateur qui lë
dota d’abôrd de 4000 liv. ftérling dé renté ; 8c ce revenu
s’eft depuis augmenté jufqu’à fix mille. Ce.collège
doit être compofé d’honnêtes gens,fpit militaires
, foit commerçans infirmes, 8c dont lés affaires
Ont mal tourné. Ils*font au nombre de quatre-vingt
qui Vivent eh commun félon l’ufage des Collèges,
8c qui font logés, Vêtus, nourris, & foignés dans
leurs maladies aüx dépéris de la maifon. Il y à âuffi
place pour quarante-quatre jeunes gens ou écOliëfS
qui y font entretenus 8c inftruifs : Ceux d’ëfiff’éUx qui
ont de l’aptitude pour les Lettrés, font envoyés aux
univerfites avec unepërtfion de vingt livrés ftérling
pendant llûit ans ; on met iés autres dans le Commerce.
La furintehdance de Cët hôpital eft confiée,à fèizë
gouverneurs, qui font ordinairement des perfôrinës
dé la première qualité. Lorfqiië la place a’un d’en-
tr’eüx vient à Vaquer, elle eft remplie par l’éleffion
d un nouveau membre faite par les autres gouverneurs.
Les officiers de ce collège font un m aure, un
prédicateur, un économe, un thréforier, un maître
d’école, &c. Chdmbers. CG')
CHARTREUX, f. m. ( Hiftr eccléf. ) ordre de religieux
inftitué par S. Bruno ên 1086, & remarquable
par l’âuftérité de la regle. Elle oblige les religieux
à une folitude perpétuelle, & l’abftinence totale de
Viande, meme en cas de maladie dangereufe & en
danger de mort, 8c au filence abfolu, excepté en
certains tems marqués. Foye{ M o n a s t i q u e ,
M o i n e .
Leurs maifons font ordinairement bâties dans des
deferts, quoiqu’il s’en trouve à la proximité des villes,
ou dans les villes mêmes. La ferveur & la piété
monaftique fe font toûjours mieux confervées dans
cet ordre que dans les autres. M. l’abbé de la Trapë
( Ràricé) a cependant tâché de prouver que les Ciar-
tteux s’étoiént relâchés de cette extrême auftérité
qui leur étoit préferite par les conftitutions de Gui-
gués I. leur cinquième général. Mais dom Innocent
Maffon , élû général en 1675, ^ans une réponfe à
M. l’abbé de Rancé, a moritré que ce que cëlui-cî
appelle flatuts ou confiitutions de Guigues, n’étoit
que des coûrumes compilées par le P. Guigues, &
qui ne devinrent lois que long-tems après. En effet,
S. Bruno ne laiffa aucunes réglés écrites à fon ordre.
Guigiies élu en i 1 10 , en mit les coûtumes & les fta-
tuts par écrit ; & ce fut Bafile leur huitième général,
élu en î 1 5 1 , qui dreffa leurs conftitutions telles
qu’elles furent approuvées par le faint fiége. Les
Chartreux ont donné à l’Eglife plufieurs faints prélats,
& grand nombre dé fujets illuftres par leur doctrine
& par leur piété. Leur général ne prend que le
titre dé prieur de la Chartreufe. ( G Y
C h a rtr eux , (Aß/?, nat. ) forte de chat dont le
poil eft d’iin gris cendré tirant fur le bleu, C ’eft une
des peaux dont les Pelletiers font négoce , & qu’ils
employent dans les fourrures. Foyeç C h a t .
C h a r t r e u x , ( pelle de ) Comm. efpece de laine
très-fine , que nos manufacturiers en draps & autres
étoffés tirent d’Efpagne. Foye[ le Diclionn. de Comm.
CHARTRIER, f. m. ( Jurifprud. ) lignifie ordinairement
le lieu où font renfermés lés chartes 8c anciens
titres des abbayes, monafteres, & des grandes
fêigileüriës. On appelloit autrefois charnier du roi ou
de France, ce que l’on appelle'aujourd’hui thréfor des
chartes : mais ce charnier étoit moins un lieu où l’on
reüfermoit les chartes de la couronne, que le recueil
8c la collection de ces chartes que l’on portoit alors
par-tout à la fuite du roi. Richard roi d’Angleterre ,
ayant défait l’armée de Philippe-Augufte entre Châ-
teaudiiri & Veridôriie, en 1194, enleva tout fon ba-
gagë, & notamment le charnier de France. Cette
pertë fut caufe que l’on établit à Paris un dépôt des
chartes de la couronne, quë l’on appella Le thréfor des
chartes. Foye^ THRÉSOR DES CHARTES.
C ha rtr ier, (Jurifp.') fignifioit auffi en quelques
endroitsprifonnier ; ce qui vient du mot charte, qui
fe difoit anciennement pour prifon. Foye[ l'ancienne
chronique de-Flandre , ch.lxvj. 8C le glôjfaire de M. de
Lauriere, au mot charte. ( A )
CHARTULAIRE, f. m. f Hifi. eccléf ) on prétend
que le chartulaire étoit dans l’églife latine, ce que lé
chartôphylax étoit dans l’églife greque*"/>’ôye£ C article
Ç h a r to ph y l ax . Quoi qu’il en foit des prérogatives
de ces dignités, il eft évident que leurs
noms venoiént delà garde des chartes & titres, con-
fiés particulièrement à ceux qui les poffédoient.
C ha r tu la ir e , fe dit encore du volume où l’on
a trànfcrit les chârtes principales, d’une abbaye pu
d’une/eigneurie. ■
* ,CHARYBDE, f. f. ( Myth..) femme qui habitent
8c voloit le long des côtes de la Sicile ; elle fut
frappée de là foudre & métamorphofée en monftre
marin, pour avoir détourné les bçeufs d’Hercule.
Ce'monftre àttendoit près d’un écueil de Sicile, les
paffâris pour les dévorer : là les eaux tournoyoient,
entraînant les vaiffeaux dans des gouffres, & les renvoyant
du fond à la furface trois fois, à ce que dit