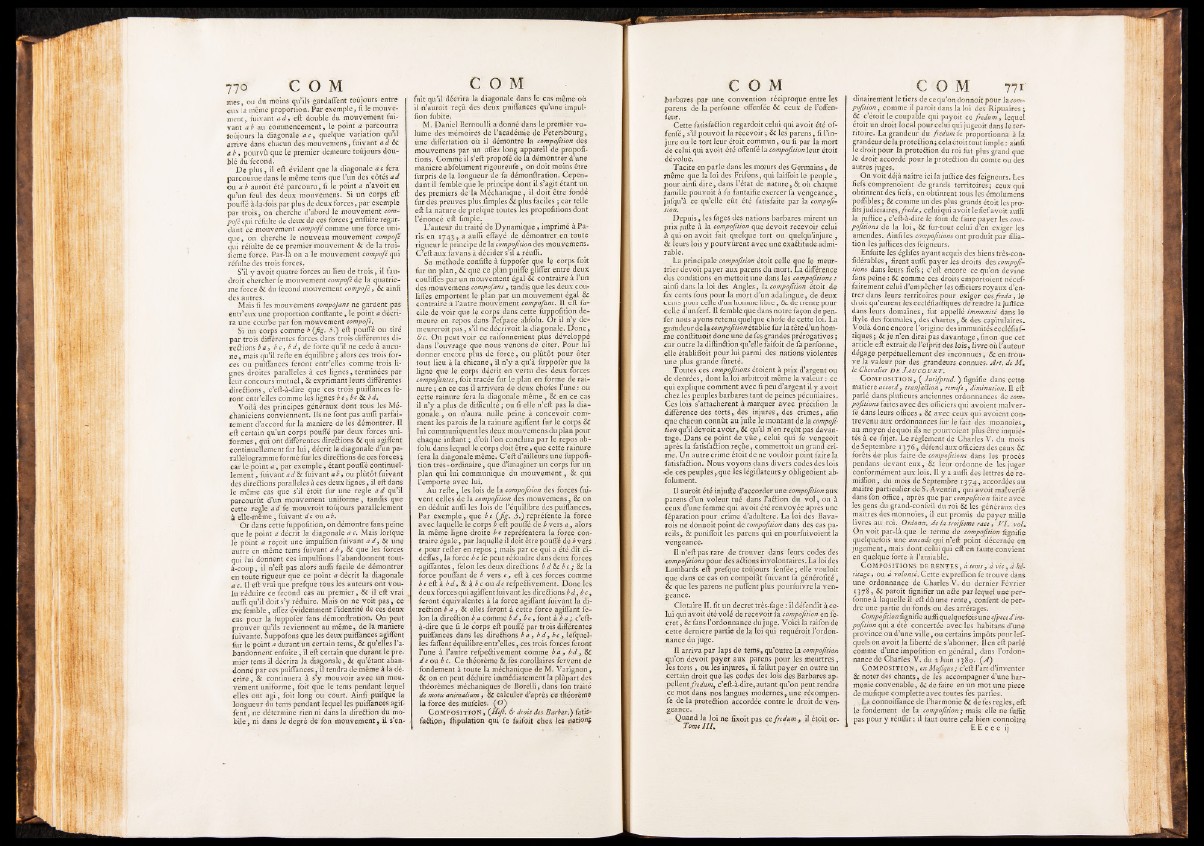
mes, ou du moins qu’ils gardaffent toujours entre
«ux la même proportion. Par exemple, fi le mouvement,
fuivant a d , eft double du mouvement fui-
vant a b au commencement, le point a parcourra
toujours la diagonale a c , quelque variation qu’il
arrive dans chacun des mouvemens, fuivant ad &
à b , pourvù que le premier demeure toûjours doublé
du fécond.
De plus, il eft évident que la diagonale ac fera
parcourue dans le même tems que l’un des côtes ad
ou a b auroit été parcouru, fi le point a n’avoit eu
qu’un foui des deux mouvemens. Si un corps eft
pouffé à-la-fois par plus de deux forces, par exemple
par trois, on cherche d’abord le mouvement com-
pofé qui réfulte de deux de ces forces ; enfuite regardant
ce mouvement compofé comme une force unique,
on cherche le nouveau mouvement compofi
qui réfulte de ce premier mouvement & de la troisième
force. Par-là on a le mouvement compofi qui
réfulte des trois forces.
S’il y avoit quatre forces au lieu de trois, il fau-
droit chercher le mouvement compofi de la quatrième
force 8c du fécond mouvement compofi, & ainfi
des autres.
Mais fi les mouvemens compofans ne gardent pas
m m une Proporti0n confiante, le point a décrira
une courbe par fon mouvement compofi.
Si Un corps comme b (fig. 5.) eft pouffé ou tiré
par trois différentes forces dans trois différentes di-
reôions b a , b c, bd , de forte qu’il ne cede à aucune
, mais qu’il refte en équilibre ; alors ces trois forces
ou puiffances feront entr’elles comme trois lignes
droites parallèles à ces lignes, terminées par
leur concours mutuel, & exprimant leurs différentes
direttions, c’eft-à-dire que ces trois puiffances feront
entr’elles comme les lignes b e , bc 8e. bd.
Voilà des principes généraux dont tous les Mé-
chaniciens conviennent. Ils ne font pas auffi parfaitement
d’accord fur la maniéré de les démontrer. Il
eft certain qu’un corps pouffé par deux forces uniformes
, qui ont différentes direôions 8c qui agiffent
continuellement fur lui, décrit la diagonale d’un parallélogramme
formé fur les direôions de ces forces ;
car le point a , par exemple, étant pouffé continuellement
, fuivant ad & fuivant ab, ou plutôt fuivant
des direâions parallèles à ces deux lignes, il eft dans
le même cas que s’il étoit fur une réglé a d qu’il
parcourût d’un mouvement uniforme, tandis que
cette re»le ad fe mouvroit toujours parallèlement
à elle-même, fuivant de ou ab.
Or dans cette fuppofition, on démontre fans peine
que le point a décrit la diagonale a c. Mais lorfque
le point a reçoit une impulfion fuivant a d , & une
autre en même tems fuivant a b , & que les forces
qui lui donnent ces impulfions l ’abandonnent tout-
à-coup , il n’eft pas alors- auffi facile de démontrer
en toute rigueur que ce point a décrit la diagonale
a c. Il eff vrai que prefque tous les auteurs ont voulu
réduire ce fécond cas au premier, 8c il eft vrai
auffi qu’il doit s’y réduire. Mais on ne voit pas, ce
me femble, affez évidemment l’identité de ces deux
cas pour la fuppofer fans démonftration. On peut
prouver qu’ils reviennent au même, de la maniéré
fuivante. Suppofons que les deux puiffances agiffent
fur le point a durant un certain tems, 8c qu’elles l ’abandonnent
enfuite, il eft certain que durant le premier
tems il décrira la diagonale, & qu’étant abandonné
par ces puiffances, il tendra de même à la décrire
, & continuera à s’y mouvoir avec un mouvement
uniforme, foit que le tems pendant lequel
elles ont ag i, foit long ou court. Ainfi puifque la
longueur du tems pendant lequel les puiffances agiffent
, ne détermine rien ni dans la direction du mobile
, ni dans le degré de fon mouvement, il s’enfuit
qu’il décrira la diagonale dans le cas même-où
il n’aurôit reçu des deux puiffances qu’une impulfion
fubite.
M. Daniel Bernoulli a donné dans le premier volume
des mémoires de l’académie de Petersbourg,
une differtation oit il démontre la compofition des
mouvemens par un affez long appareil de propofi-
tiorls. Comme il s’eft propofé de là démontrer d’une
maniéré abfolument rigourëufe, on doit moins être
furpris de la longueur de fa démonftration. Cependant
il femblê que le principe dont il s’agit étant un
des premiers de la Méchanique, il doit être fondé
fur dés preuves plus fini pies 8c plus faciles ; car telle
eft la nature de prefque toutes les propofitions dont
l’énoncé eft fimple.
L’auteur du traité de Dynamique, imprimé à Paris
en 1743 , a auffi effayé de démontrer en toute
rigueur le principe de la compofition des mouvemens.
C ’eftaux fa vans à décider s’il a réuffi.
Sa méthode confifte à fuppofer que le corps foit
fur un plan, 8c que Ce plan puiffe gliffer entre deux
couliffes par un mouvement égal 8c contraire à l’un
des mouvemens compofans ,, tandis que les deux cour
liftés emportent le plan par un mouvement égal 8c
contraire à l’autre mouvement compofant. Il eft facile
de voir que le corps dans cette fuppofition demeure
en repos dans l’efpace abfolu. Or il n’y demeurerait
pas, s’il ne décrivoit la diagonale. Donc,
&c. On peut voir ce raifonnement plus développé
dans l’ouvrage que nous venons de citer. Pour lui
donner encore plus de forcé, ou plutôt pour ôter
tout lieu à la chicane, il n’y a qu’à fuppofer que la
ligne que le corps décrit en vertu des deux forces
compofantes, foit tracée fur le plan en forme de rainure
; en ce cas il arrivera de deux chofes l’une : ou
cette rainure fera la diagonale même, & en ce cas
il n’y a plus de difficulté ; ou fi elle n’eft pas la diagonale
, on n’aura nulle peine à concevoir comment
les parois de la rainure agiffent fur le corps 8c
lui communiquent les deux mouvemens du plan pour
chaque inftant ; d’où l’on conclura par le repos abfolu
dans lequel le corps doit ê tre, que cette rainure
fera la diagonale même. C ’eft d’ailleurs une fuppofition
très - ordinaire, que d’imaginer un corps fur un
plan qui lui communique du mouvement, & qui
l’emporte avec lui.
Au refte, les lois de la compofition des forces fui-
vent celles de la compofition des mouvemens, & on
en déduit auffi les lois de l’équilibre des puiffances.
Par exemple, que b e {Jig. 6.) repréfente la force
avec laquelle le corps b eft pouffé de b vers a ,, alor-s
la même ligne droite b c repréfentera la force contraire
égale, par laquelle il doit être pouffé de b vers
e pour refter en repos ; mais par ce qui a été dit ci-
deffus, la force b e fe peut réfoudre dans deux forces
agiffantes, félon les deux direélions bd8l.be ; & la
force pouffant de b vers e , eft à ces forces comme
be eft à b d , & à bc ou de refpe&ivement. Donc.les
deux forces qui agiffent fuivant les directions b d ,b c ,
feront équivalentes à la force agiffant fuivant la direction
b a , & elles feront à cette force agiffant félon
la direction b a comme b d , b c , font à b a; c’eft-
à-dire que fi le corps eft pouffé par trois différentes
puiffances dans les directions b a , b d , b c , lesquelles
faffent équilibre entr’elles, ces trois forces feront
l’une à l’autre refpeCtivement comme b a , b d , Sc
de ou b c. Ce théorème &,fes corollaires fervent de
fondement à toute la méchanique de M. Varignon,
& on en peut déduire immédiatement la plûpart des
théorèmes méchaniques de Borélli, dans fon traité
de motu animalium, 8c calculer d’après ce théorème
la force des mufcles. (O )
C om po s it io n , W M Ê & droit des Bar bar.') fatis-
faCtipn, ftipulation qui fe faifoit chez les nation^
barbares par une. convention réciproque entre les
parens de la perfonne offenfée 8c ceux de l’offen-
i’eur.
Cette fatisfaCtion regardoit celui qui avoit été of-
fenfé, s’il pouvoit la recevoir ; 8c les parens, fi l’injure
ou le tort leur étoit commun, ou fi par la mort
de celui qui avoit été offenfé la compofition leur étoit
dévolue.
Tacite en parle dans les moeurs des Germains, de
même que la loi des Frifons, qui laiffoit le peuple,
pour ainfi dire, dans l’état de nature, & où chaque
famille pouvoit à fa fantaifie exercer fa vengeance,
jufqu’à ce qu’elle eut été fatisfaite par la compofition.
.
Depuis, les fages des nations barbares mirent un
prix jufte à la compofition que devoit recevoir celui
à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu’injure ,
& leurs lois y pourvurent avec une exactitude admirable.
La principale compofition étoit celle que le meurtrier
devoit payer aux parens du mort. La différence
des conditions en mettoit une dans les comportions :
ainfi dans la loi des Angles, la compofition étoit de
fix cents fous pour la mort d’un adalingue, de deux
cents pour celle d’un homme libre, & de trente pour
celle d’unferf. Il femble que dans notre façon de pen-
fer nous ayons retenu quelque chofe de cette loi. La
grandeur de la compofition établie fur la tête d’un homme
conftituoit donc une defes grandes prérogatives ;
car outre la diftinCtion qu’elle faifoit de fa perfonne,
.elle établiffoit pour lui parmi des nations violentes
une plus grande fûreté.
Toutes ces composions étoient à prix d’argent ou
de denrées, dont la loi arbitroit même la valeur : ce
qui explique comment avec fi peu d’argent il y avoit
chez les peuples barbares tant de peines pécuniaires.
Ces lois s’attachèrent à marquer avec précifion la
différence des torts, des injures, des crimes, afin
que chacun connût au jufte le montant de la compofition
o j ’ù devoit avoir, 8c qu’il n’en reçût pas davantage.
Dans ce point de vû e , celui qui fe vengeoit
après la fatisfaCtion reçûe, commettoit un grand crime.
Un autre crime étoit de ne vouloir point faire la
fatisfaCtion. Nous voyons dans divers codes des lois
»de ces peuples, que les légiflateurs y obligeoient absolument.
. Il auroit été injufte d’accorder une compofition aux
parens d’un voleur tué dans l’aCtion du v o l, ou à
ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après une
féparation pour crime d’adultere. La loi des Bavarois
ne donnoit point de compofition dans des cas pareils,
& puniffoit les parens qui en pourfuivoient la
vengeance.
Il n’eft pas rare .de trouver dans leurs codes des
comportions pour des a étions involontaires. La loi des
Lombards eft prefque toûjours fenfée; elle vouloit
que dans ce cas on compofât fuivant fa générofité,
8c que les parens ne puffent plus pourfuivre la vengeance.
Clotaire II. fit un decret très-fage : il défendit à celui
qui avoit été volé de recevoir m compofition en fe-
cret, 8c fans l’ordonnance du juge. Voici la raifon de
cette derniere partie de la loi qui requérait l’ordonnance
du juge.
Il arriva par laps de tems, qu’outre la compofition
qu’on devoit payer aux parens pour les meurtres,
les forts , ou les injures, il fallut payer en outre un
.certain droit que les codes des lois des Barbares appellent
fredum, c’eft-à-dire, autant qu’on peut rendre
ce mot dans nos langues modernes, une récompen-
fe de la protection accordée contre le droit de vengeance.
Quand la loi ne fixoit pas ce fredum , il étoit or-
Tome I IL
dinairemènt le tiers de ce qu’on donnoit pour la corn*
pofition, comme il paraît dans la loi des Ripuaires ;
& c’étoit le coupable qui payoit ce fredum, lequel
étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire.
La grandeur du fredum fe proportionna à la
grandeur delà protection; cela étoit tout fimple : ainfi
le droit pour la protection du roi fut plus grand que
le droit accordé pour la protection du comte ou des
autres juges.
On voit déjà naître ici la juftice des feigneurs. Les
fiefs comprenoient de grands territoires ; ceux qui
obtinrent des fiefs, en obtinrent tous les émolumens
poffibles ; 8c comme un des plus grands étoit les profits
j u d i c i a i r e s , , celui qui avoit le fief avoit auffi
la juftice, c’eft-à-dire le foin de faire payer les com-
pofîtions de la lo i, 8c fur-tout celui d’en exiger les
amendes. Ainfi les compofitions ont produit par filiation
les juftices des feigneurs.
Enfuite les églifes ayant acquis des biens très-con-
fidérables, firent auffi payer les droits des compofitions
dans leurs fiefs ; c’en; encore ce qu’on devine
fans peine : 8c comme ces droits emportoient nécef-
fairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer
dans leurs territoires pour exiger ces freda, le
droit qu’eurent les eccléfiaftiques de rendre la juftice
dans leurs domaines , fut appellé immunité dans le
ftyle des formules, des chartes, & des capitulaires.
Voilà donc encore l ’origine des immunités eccléfiaftiques
; & je n’en dirai pas davantage, finon que cet
article eft extrait de I’elprit des lois, livre où l’auteur
dégage perpétuellement des inconnues, & en trouve
la valeur par des grandeurs connues. Art. de M*
le Chevalier D E J AU COU R T .
C omposition, ( Jurifprud. ) fignifie dans cette
matière accord, tranfaclion, remife , diminution. Il eft
parlé dans plufieurs anciennes ordonnances de compofitions
faites avec des officiers qui avoient malver-
fé dans leurs offices, 8c avec ceux qui avoient contrevenu
aux ordonnances fur le fait des monnoies,
au moyen de quoi ils ne pourraient plus être inquiétés
à ce fujet. Le réglement de Charles V. du mois
de Septembre 1376, défend aux officiers des eaux 8c
forêts de plus faire de compofitions dans les procès
pendans devant eux, 8c leur ordonne de les juger
conformément aux lois. Il y a auffi des lettres de re-
miffion, du mois de Septembre 1374, accordéesau
maître particulier de S. Aventin, qui avoit malverfé
dans fon office, après que par compofition faite avec
les gens du grand-confeil du roi 8c les généraux des
maîtres des monnoies, il eut promis de payer mille
livres au roi. Ordonn. de la troifieme race, VI. vol*
On voit par-là que Me terme de compofition fignifie
quelquefois une amende qui n’eft point décernée en
jugement, mais dont celui qui eft en faute convient
en quelque forte à l’amiable.
C ompositions de rentes , à tems, a vie, à héritage
, ou d volonté. Cette expreffion fe trouve dans
une ordonnance de Charles V. du dernier Février
1378, 8c paraît lignifier un aCte par lequel une per-
fpnne à laquelle il eft dû une rente, confient de perdre
une partie du fonds ou des arrérages.
Compofition fignifie auffi quelquefois une efpece <£im-
pofition qui a été concertée avec les habitans d’une
province ou d’une ville , ou certains impôts pour lef-
quels on avoit la liberté de s’abonner. lien eft parlé
comme d’une impofition en général, dans l’ordonnance
de Charles V. du zJuin 1380. (A)
Composition, enMufique; c’eft l’art d’inventer
& noter des chants, de les accompagner d’une harmonie
convenable, 8c de faire en un mot une piece
de mufique complette avec toutes fes parties.
. . La connoiffance de l’harmonie 8c de fes réglés, eft
le fondement de la compofition; mais elle ne fuffit
pas pour y réuffir : il faut outre cela bien connoître
E E e e e ij