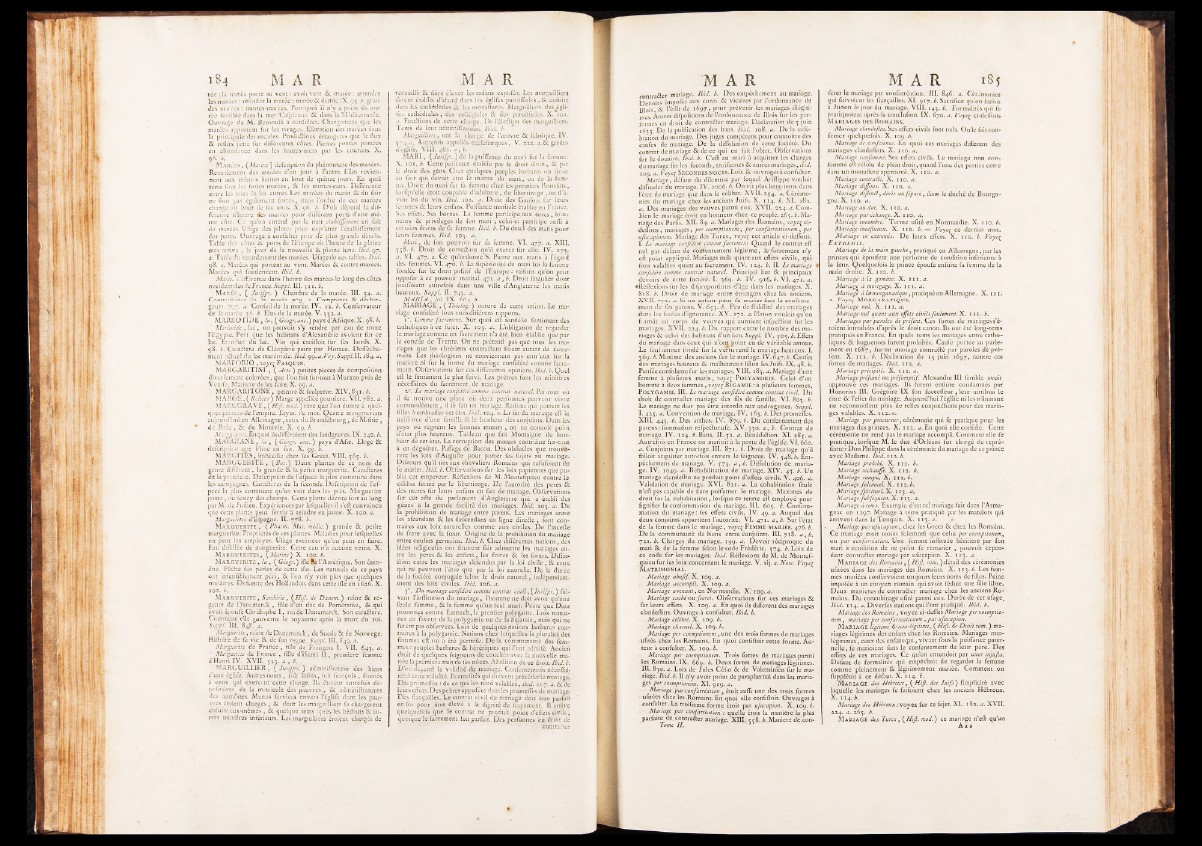
iT- r r
i I !■
f ■ > !
! ,
Î > '
iS rU -
9(.,
A R M A R A R A R 185
CC pone au vent ; a^ oi^vcm &. nviRo : at'cnclre
icioiiler la mavee ; m:uA' cl'-ini'. v b. gtaii-
• mortes-inaieci. Poin-quoi il 11V a ]'('inc iIl mala
incr X.'ariil:;i.io ^ dans l.i MAuten-anec.
e M. ik'MioiilU a conl'ultef, (diangemcns <j’.;c k'S
t nt fill- Ics rivngvS. Elevation clcs niaivcs dan.s
oi'cades. ProdiiiTdons etrangsiXs cjiic Ic tliix
;tic (iir ditVeicntes c.’ites, PieiTcs ponces ponees
.-'Cl- duns les iiaiircs-incrs par les counms. X.
s . {^M.irir.:') dcfcripiion dii phénomène des marées.
Reravdemert des maices d‘un jour à raiurc. Elies reviennent
aux méiiirs hemes an bout de quinze jours. En quel
teins l'o.'it les fimtes marées , & les mortes-eaux. I/id'érence
Ci'ire le. mie. «X tes antres. Les mirées du m.iiin & du fuir
ne loiii pas sgalenunt fuites, mais l'ordie de ces marées
cii.'.nge ati b.out de li.x nuis. X. 96. h. IVoù dépend la dif-
feieiu'c d'heure des m.trécs pour dilTéreiis ports d’une même
cote. C : qu’on entend p.ar le mot itabliJJ'i'nair en fait
de m.trées. Ulage des pilotes pour e.xpvimer rétabiüremeiit
des ports. Ouvrage à conlultcr peur de plus grands détails.
Table dc.s cènes be ports de l’Europe où i’iieiire de la pleine
mer r.rv'ive , le jour de la nouvelle &. pleine lune. IbiJ. 97.
J. Table du retardement des marées. Ufagede ces tables. Ibid.
98. .r. Marées qui portent an vent, Marées & comrc-inarées.
rvlarees ont loiitienneiir. !biJ. b.
M.fcc. i . ;A:rence dans riiciive des marées le long des cotes
oeculenralcsdcFr.mce. Suppl. 111. 3 1 1. i.
M .vn r s , ( Judjpr. ) Chambre de la marée. III. 54. J.
Comnul! .très t.e la marée. 709. e. Compteurs &. dédiar-
geurs. <j. Confcilde la marée. IV. 12. é. Conlérvatciir
de la maire. 36. b. Elus de la marée. V . 332.u.
M.LREÜ r iii)E J ht, ( Giogr. aric.) pays d'A frique. X . 98. b.
?.isrionde . Lie, on pouvoit s’y rendre par eau de toute 1 isuypie. Port que les habitans d’Alexandrie avoient fur ce
lac. E r n ue du lac. Vin qui croiflbit fur fes bords. X.
98. b. ( aiadcre de Cléopâtre peint par Horace. Delféchc-
nienr aéiue; du lac inaréotide. IbU. 99. j.f'oy.Suppl.W. 184. o.
AiARl (.'RIO , vüjrp pASQUiy.
MARG.ARITINI , { A n s ) petites pieces de compofulon-
divcrlemcm colorées, que l'on fait fur-tout à Murano près de
\ ^n.le. Manière de les faire.X. 99. j .
M.ARCi.XRlTÜNE , peintre &. fculpteur. X IV . 831. R
M.'MlCdu. ( kJieur) Slargc appellee gciiitlere. VU, 782. <2.
^ lA ld oC ilA ^ E., ( H ’ß. mo.i. ) titre que l’on donne à qiid-
q.:e,i prmres de l'empire. Etym. <h: mot. Quatre marggraviats
au om d iiiii en Allemagne , ceux du Brandebourg, de Mifnie ,
de Baue , X: de Moravie. X. 99. h.
.r.-. j. En quoi ilsdid'éroicnc des landgraves. IX. 240. h.
M A lA R A X E , la , {Clopr. anc.) pays d’.Afic. Eloge ik
ddcnjuic.n une Pline en fim. X. 99. b.
M .A T C n L :^ , imbécllle chez les Grecs. VIII. 363. b.
M A k b t i iK lT E , (E u t .) Deux plantes de ce no n de
genre dmcient. la grande 6c la petite marguerite. Cavaéleres
de la pi'w.nuc: e. Dsicription de l’efpece h plus commune dans
les cainpaicnes. Caraéleres de la fécondé. L)efcription de l’ef-
pecc la plus commune qu’on voit dans les prés. Marguerite
jaune , ( ii lüiiey des cliamps. Cette plante décrite fort au long
liât M. de /iilTicu. Expéric-necs par Icfquelles il s’eft convaincu
que cette plante peut fervir à teindre en jaune. X. 100. a.
Marr::crhcs d'Efpagne. II. 778. b.
Marguerite, {Pha-m. M.n. médie.) grande Sc petite
marguerite. Propriétés de tes plantes. Mrdadies pour lefquelles
on peut les employer. Ufage extérieur qu’on peut en faire.
£au diflillée de marguetite. Cette eau n'a aucune verni. X.
Marguerites, {Marir.e) X. 100. b.
Marguerite, la , ( Glegr.) üle ïe l’Amérique. Son étendue.
Pêche des perles de cette ifle. Les natuiels de ce pays
ont infenfibiur.cnt p éri, 6c l’on n’y voit plus que quelques
miilâcres. D-.fcentc des Hollandois dans cette ifle en 1626. X.
100. b.
Marguerite, Sambirie, {Hiß. de D.2ncm.) reine & régente
de Danemarck , fille d'un duc de Poméranie, & qui
avüic époiifé Chriflophe I , roi de 13ancmarck. Son caratflerc.
Comment elle aouverne le royaume après la mort du roi.
Cm/-/. 111. 84$: U.
M.irgiieriie ,TCins de D anemarck, de Suede 6c de Norvège.
Hilloire de fa vie Sc de fon regne. Suppl. lU, 849. a.
iM.irpieri'c de F ranc e, hllc de François I. V II . 643. a.
Ma’-puer.'c de France , fille d’Henri I I , premiere femme
d'He.nri IV. X VII . 323. a , b.
MAR.GÜÎLL1E R , { Jurijpr, ) adminiflrateur des biens
o’une égliie. Autres noms, foit latins, !oit françols , donnés
à ceux qui exerc..nt cette charge. Ils étaient autrefois dé-
Ijefiitiires de la matricule des pauvres , 5c aclntiniflrateurs
des aumônes. Menus fcrvices envers i’églife dont les pau-
v ics étoient chargés, 6c dont les inargu'lliers fe chargèrent
enfuite cMx-mêmes , Sc quelque tems après les bédaiits 6c aii-
frçs mimftres inférieurs. Les marguiliirrs étoient chargés de
vccuellllr 6c faire élever les enfiins expofés. Los niarguilüers
furent établis d’abord dans les églifes paroifliales , & eiifiiiie
dans les catliédrales 6c les monafleres. M.uguilllers des^cgü-
fc. cathédrales, dos coliégialcs 6c des paroiffialcs. X. 101.
bonélions de oette chai ge. IXi'éleélion des margullllers.
’lems de leur admtn.illration. Jbi.L b.
.\t.i;guil!n"s, um la charj-.e do l'oeuvre & fabtiquo. IV.
3-.)..t. .Autrefois appcilés ceeléfiarques , V. 222. u.Si gardes
d’igllfc. V llI . 482. . ; ,C
M A R I , ( Jurijpr. ) de la ptiilTancc du mari fur la femme.
X. 101. b. Cette puiüanec établie par le droit divin, 6c par
le droit des gens. Cliez quelques peuples barbares on tiroir
au i'oit qui devoir être le maître du mari, ou de la femme.
Droit du mari fur fa femme clicz les premiers Romains,
lorfcju’clle étoit coupable d'udultcre , de liberiinage , ou d'avoir
bu du vin. Ibid. 102. a. Droit dos GauloiS fur leurs
‘ e-nmes 6c leurs onfiins. Pulffaiice maritale établie en i'raiice.
S^s efiets. Ses bornes. La femme participe aux titres, li'Ui-
neurs 6c privileges de fon mari ; celui-ci jjarticipc aulll à
certains droits de fa femme. Ibid. b. Du deuil des maris pour
leurs femmes. Ibid. 103.
M a n , de fon pouvoir fur fa femme. VI. 477. u. XIII.
338. b. Droit de concélion qu’il ext-ice fur d ie. IV. 273.
VI. 477. û. Ce qu’ordonne S. Pierre aux maris à l'égard
de*s femmes. V I. 470. b. La fupériorité du mari fur la femme
fondée fur le droit pofuif de l’Europe: raifons qu'on peut
oppofer à ce pouvoir marit.il. 471, , i. Droit fmgulier dont
jouilfoient autrefois dans une ville d’Angleterre les maris
heureux. Suppl. IL 743, a.
M A R IA , loi. IX. 664. b.
MARIAG E , ( Thcolog. ) nature de cette union. Le mariage
confidéré fous trois diri'ércus rapports.
1“. Comme f.icrcment. Sur quoi eü fondé le femiincnt des
catholiques à ce fujet. X. 103. a. L’obligation de regarder
le mariage coilimc un facrement n'a été bien établie que par
le concile de Trente. On ne prétend pas que tous les mariages
que les chrétiens coiltraélent foient autant de facre-
niens. Les théologiens ne conviennent pas emr’cux l'ur la
matière ni fur la forme du mariage confidéré comme facie-
meni. Obfcrvations fur ces difféiciuos opinions. Ibid. b. Quel
efl le femiincnt le plus fuivi. Les prêtres Ibnt les niiniltres
nèceflaires du facrement de marir.ge.
‘1°. Le mariage confidàè comme contrat /2.;f«oe7. Par-tont où
il le trouve une place oii deux perfonnes peuvent vivre
commodément, il i'e fait un nituiage. Raifons qui portent les
filles .1 embralTer cet état. Ibid. 104. .1. La fin du mariage cfl la
naifirnee d'une famille 6c le bonheur des conjoints. Dans les
pays où régnent les bonnes moeurs , on ne coniioît point
d’état plus heureux. Tableau que fait Montaigne du boii-
lieur de cet état. La comiption des moeurs contribue fur-tout
à en dégoûter. Paflage de Bacon. Des obfiacles que trouveront
les loix d’Augufie pour porter fes ftijets au mariage.
Dilcours qu’il tint aux chevaliers Romains qui refufoientde
le marier. Ibid. b. Obfcrvations fur les loix papiennes que publia
cet empereur. Réflexions de M. Montcfqiiieu contre le
célibat formé par le libertinage. D e l’aucorité des peres &
des incrcs fur leurs enfans en tait de mariage. Obfervations
fur cet aéle du parlement d’Angleterre qui a établi des
gênes à la grande facilité des mariages. Ibid. 103. De
la prohibition de mariage entre parens. Les mariages entre
les afeendans Sc les defeendans en ligne direéfe , font contraires
aux loix naturelles comme aux civiles. D e l’incefie
du frere avec la foeur. Origine de la prohibition du mariage
entre confins germains. Ibid. b. Chez différentes nations, des
idées religieufes ont fbuvent fait admettre les mariages entre
les peres Sc les enfans, les freres 6c les foeiirs. Diftin»
ftion entre les mariages défendus par la loi civile , Sc ceux
qiii ne peuvent l’être que par la loi namelle. D e la durée
de la fociété conjugale félon le droit naturel, indépendamment
des loix civiles. Ihid. 106. a.
3°. Du mariage confidéré comme contrat civil, {Jiuifpr. ) fui-
vaiir l’infiituiion du mariage, l’homme ne doit avoir qu’une
feule femme, Sc la femme qu’un fmil mari. Peine que Dieu
prononça contre Lamech, le premier polygame. Loix romaines
en faveur de la polygamie ou de la bigamie, mais qui 11e
furent pas obfervées. Loix de quelques nations barbares contraires
à la polygamie. Nations chez lefquelles la pluralité des
fcjumes cfl ou a été permifè. D e la communauté des femmes
: peuples barbares Sc liérétiques qui l’cm admife. Ancien
droit de quelques feigneurs de coucher avec la nouvelle mariée
la premiere nuit de fes noces. Abolition de ce droit. Ibid. b.
D ’en; tléj,;nd la vrdidité du mariage. Confemenicns nécefl'ai-
res à cette validité. Formalités qui doivent précéder le mariage.
Desprr.mcfl'es : de ce qui les rend valables, ibid. 1 0 7 , Sede
leurs efiets. Des peines appofées dans les promeffes de mariage.
Des fiançailles. Le conr.i-at civil du mariage doit être parfait
en foi pour être élevé à la dignité de fiicremeru. Il arrive
quelquefois que le contrat ne produit point d’efl'ets c ivils ,
quoique le facrement loit parfait. Des perfonnes en droit de
contraélcr mariage. Ibid. b. Des empcchcmcns au mariage.
Devoirs impofés aux curés Sc vicaires par l'ordonnance de
Blois, 6c l’édit de 16 9 7 , pour prévenir les mariages illégitimes.
Autres dilpofitions de l’ordonnance <!e Blr)is fur les per-
Ibnnes en dtoit de conirafter mariage. Déclaration du 3 juin
1633, D e la publication des bans. Ibid. io8. a. D e là célébration
du mariage. Des juges compétons pour coiinoitre des
caitfes de mariage. De la dilTolmion de cette fociété. Du
contrat de mariage Sc de ce qui en fait l’objet. Obfcrvations
fur le douaire. Ibid. b. C e ft au mari à actpiittcr les charges
du mariage fur les féconds, troifiemes tk. autres mariages, /'é;./.
109. a. Voyc\ Secondes NOCES. Loix Sc ouvrtiges à conlultcr.
Mariage, définit du dilemme par lequel Ariflippe vouloir
diffiiader du mariage. IV. joo6. b. On vit [>lus long-rems dans
l’état de mariage que dans le célibat. X V II . 254. a. Cérémonies
du mariage chez les anciens Juifs. X. JI4. b. XL 182.
J. Des mariages des veuves parmi eux. X V I I . 224. a. Combien
le mariage étoit en honneur chez ce peuple. 265. b. Mariage
des Parfis. XII. 84. a. Mariages des Romains, voyeç ci-
delfoiis , mariages, per cocrnptioncm, per confarreationern, per
ujiicapioncm. Mariage des T u rc s , voye^ cet article ci-deflbiis. 1. Le mariage confidéré comme jdcrcmcnt Quand le contrat efl
mil par défaut de cotrfentement légitime, le facrement n'y
efl point appliqué. Mariages nuis quant aux effets civils, qui
font valables quant au facrement. IV. 124. b. IL Le mariage
confidéré comme contr.it naturel. Principal but Sc principaux
devoirs de cttte fociété. I. 369. b. IV. 916. b. VI. 471. a.
•Réflexions fur les difjiroportions d’âge dans les mariages. X.
S18. b. Droit de mariage cnirc étrangers chez les anciens.
XV II . 7 7 1 . a. Si un enfant peut fe marier fiins le confenre-
mciit de fes parens. V. 633. b. Peu de flabilité des mariages
dans les iiecles d’ignorance. XV. 172. a. Platon vouloit qu’on
f, 1 niât i;n corps de veuves qui anroient infpcéHon fur les
mariages. X V ll. 224. b. Du rapport entre le nombre des mariages
Sc celui des liabirans d'un Heu.6'«^;)/. IV. 303. i. Effets
du m.iriage dans ceux qui n’oni point eu de véritable amour.
Le feiil amour fondé fur la vertu rend le mariage heureux. I.
369. b. Maxime des anciens fur le mariage. IV. 647. b. Caiifcs
des mariages heureux Sc malheureux félon les Juifs. IX. 48. b.
Penféeconfolantefur les mariages. V III. 183. a. Mariage d’une
femme à pliifieurs maris, voye^; Polyandrie. Celui d’un
homme à deux femmes, voyc^; Bigamie : à plufieurs femmes,
Polygamie. III. Le mariage confidéré comme contrat civil. Du
droit de contraiier mariage des fils de famille. V I . 803. b.
L e mariage ne doit pas être interdit aux androgynes. Suppl. 1. 423. a. Convention de mariage. IV. 163. è. Des promefles.
X l i l . 443. b. Des arrhes. IV . 879. b. D u confentement des
parens; ibmmarion refpeélucufe. X V , 330. <2, fl. Contrat de
mariage. IV. 124. é. Bans. II. 31. a. Bénédiélion. XI. 283..2.
Autrefois en France on marioit à la porte de l’églife. V I. 660.
a. Conjoints par mariage. III. 871. b. Droit de mariage qu'il
falloir acquitter autrefois envers le feigneur. IV . 348. b. Eni-
pèchemens de mariage. V . 373. a , b. Diffolution de mariage.
IV. 1049. a. Réhabilitation de mariage. X IV . 43. b. Un
mariage clandeflin ne produit point d’effets civils. V. 406. a.
Validation de mariage. X V I. 821. a. La cohabitation feule
n’cfl pas capable de faire préfumer le mariage. Maximes de
droit fur la cohabitation, lorfque ce terme efl employé pour
fignifier la confommation du mariage. III. 603. b. CoiUom-
mation du mariage : fes effets civils. IV . 49, a. Auquel des
deux conjoints appartient l’autorité. V I. 471. a, b. Sur l’état
de la femme dans le mariage, Femme MARIÉE. npjS.h.
D e là communauté de biens entre conjoints. III. 718. a , b.
j i \ . b. Charges du mariage. 199. a. Devoir réciproque du
mari Sc de la femme felon le code Frédéric. 374. b. Loix de
ce code fur les mariages. Ibid. Réflexions de M. de Montef-
quieu fur les loix concernant le mariage. V . xij. a. Note. Foyc^
JVIatrimonial.
Mariage abufif.X. 109. a.
Mariage accompli. X. 109. a.
Mariage avenant, en Normandie. X .'i0 9 . a.
Mari.ige caché OU fecret. Obfervations fur ces mariages 8c
fur leurs effets. X. 109.^2. En quoi ils dift'erent des mariages
clandeftins. Ouvrage à confulter. Ibid, h.
Mariage célébré. X. 109. b.
Mariage charnel. X. 109. b.
Mariage per coemptionem , une des trois formes de mariages
ufités chez les Romains. En quoi confifloit cette forme. A u teur
à confulter. X. 109. b.
Mariage per coemptionem. Trois fortes de mariages parmi
les Romains. IX. 669. b. Deux fortes de mariages légitimes.
III, 830. a. Loix de Jules Céfar 6c de Valentinien fur le nui-
riage. Ibid. b. 11 n’y avoir point de paraphernal dans les mariages
per coemptionem. XI. 919. a.
Mariage par confarréatioii, étoit aiifli une des trois formes
ufitées chez les Romains. En quoi elle confifloit. Ouvrages à
confulter. La troifieme forme étoit par ujucapion. X. 109. b.
Afariage par confarréation : quelle étoit la maniéré la plus
parfaite de contrafter mariage. X llI . 3 3 8. i. Maniéré de con-
Tome 11.
forer le mariage par confarréation. III. 846. <2, Cérémonies
(jiii fiiivoiom les fiançailles. XI. 917, b. Sacrifice qu’on faifoit
.à Jiinon le jour du mariage. V llI . 143, ù. Formalités qui fe
pratiqiiüicm après la conchifion. IX. 670. a. l'vyei ci-doffous
Mariages des Romains.
Mariage clandcjUn.Scs cfFets civils font mils. On le fait confirmer
quelquclbis. X. 109. b.
Alariiige de confcience. En quoi ces mariages dift'erent des
ariages claïulefiiiis. X. i
Ma, .ige jrijbmmé. Scs effets civils. Le lage non conr
fommé cfl réfolti de plein droit, quand l’imc des panics entre
dans immonaftere approuvé. X. i i o . a.
Aiariage contrarié. X. i io . a.
Mariage difi'ous. X. 110. a.
Aiatiagc diflind, divis ou j'éparc, dan« le duché de Bourgogne.
X. 1 10. a.
Mariage ou dot. X. 1 10. a.
Alariage par échange. X. i i o , a.
Mariage encombré. Terme ufité en Normandie. X, 1 10. b.
Mariage inccßiicux. X, i i o . b. — Ceyiq ce dernier mot.
Alariage in extremis. D e leurs effets. X. 110. b. Foyc^
E x t r e m i s .
Mariage de la main gauche, pratiqué en Allemagne,par les
princes qui époufent une perfoniie de condition inférieure à
la leur. Quelquefois le prince époufe enfuiie fa femme de la
main droite. X. 110. b.
Aiaiiage à la gomi/ie. X. i i i . a .
Mariage à mortgage. X. i i i . a.
Mariage ù , pratiquécnAllemagne. X. i i i .
a. Voyei MORGANATIQUE.
Alariage nul. X. i i i . a.
Mariage nul quant aux effets civils ficuUment. X . 1 1 1 , b.
Mariages par paroles de préfent. Ces fortes de mariagess’é-
toient introduits d’après le droit canon. Ils ont été long-tems
pratiqués en France. En quels tems les mariages entre catholiques
Sc huguenots furent prohibés. Caufe panée au parlement
en 1687, liir un mariage contraflé par paroles de pre-
fenr. X. i i i . b. Déclaration du 13 juin 1697, contre ces
fortes de mariages. Ibid. 112. a,
Alariage précipité. X. i !2 . a.
Alariage préfumé o\\ prêj'ompti}'. Alexandre III femble avoir
approuvé ces mariages. Ils fi;vent enfuite condamnés par
Honorius 111. Grégoire IX fon fueceffeur, leur attribua le
titre Sc l’eftet du mariage. Aujourd’hui l’cglife ni les trihiinaux
ne recomioifl'cnt pltis de telles conjonélions pour des mariages
valables. X. ii2.<t.
Mariage par procureur, cérémonie qui fe pratique pour les
mariages des princes. X. 112. ^2.,En quoi elle confifle. Cette
cérémonie ne rend pas le mariage accompli. Comment elle fe
pratiqua, lorfque M. le duc d’Orléans fut chargé de rejiré-
feiiter Don Philippe dans la cérémonie du mariage de ce prince
avec Madame. Ibid. n i . b.
Alariage prohibé. X. 112. b.
Alariage réchauffé. X. 112. b.
Al.triage rompu. X. 11 2. b.
Alariage folemnel. X. 112. b.
Mariage fipirititel. X. 1 1 3. »2.
Alariage fiubféquent. X . 1 1 3. a.
Alariage à lems. Exemple d'un tel mariage fait dans l’Armagnac
en 1297. Mariage à tems pratiqué par les matelots qui
arrivent dans IcTonquln. X. 1 13 .« .
Alariage par ujucapion, citez les Grecs & chez les Romains.
C e mariage étoit moins folemnel c[ue celui per coemptionem,
ou par confarréation. Une femme inflituée héritière par fon
mari à condition de ne point fe remarier , pouvoit cependant
contraéler mariage par ufucapion. X. 113. a.
Mariage des Romains, ( H ijl rom. ) détail des cérémonies
ufitées dans les mariages des Romains. X. Les femmes
mariées coiifcrvoicnt toujours leurs noms de filles. Peine
impofée à un citoyen romain quiavoit féduii une fille libre.
Deux maniérés de comraéler mariage chez les anciens R o mains,
D u concubinage iifité parmi eux. Durée de cet ufage,
Ibid. 1 14. a. Diverfes nations qui l’ont pratiqué. Ibid. b.
Alariage des Romains , voyez ci-deffiis Mariage per coemptionem
, m.iriagc per confarreationern, par ufucapion.
Mariage légitime & non-légitime, ( Hifl. Droit rom. ) mariages
légitimes des enfans chez les Romains. Mariages non-
Icgitimes, ceux des enfans q ui, vivant fous la ptiilTance paternelle,
fe marioient fans le confentement de leur pere. D es
eft'ets de ces mariages. Ce qu’en entendoit par u.xor injufia.
Défaut de formalités qui empêchoit de regarder la femme
comme pleinement 6c légitimement mariée. Comment on
fiippléoit à ce défaut.,X. 114. b.
Mariage des Hébreux, {H if . des Juifs) fimplicUé avec
laquelle les mariages fe faifoient chez les anciens Hébreux.
X. 1 14, b.
Mariage des Hébreuxivoycz fur ce fujer. XI. 182. a. XVII .
224. a. 263. b.
Mariage des Turcs, {H if . mod.) ce mariage n’eft qu’un
 a a