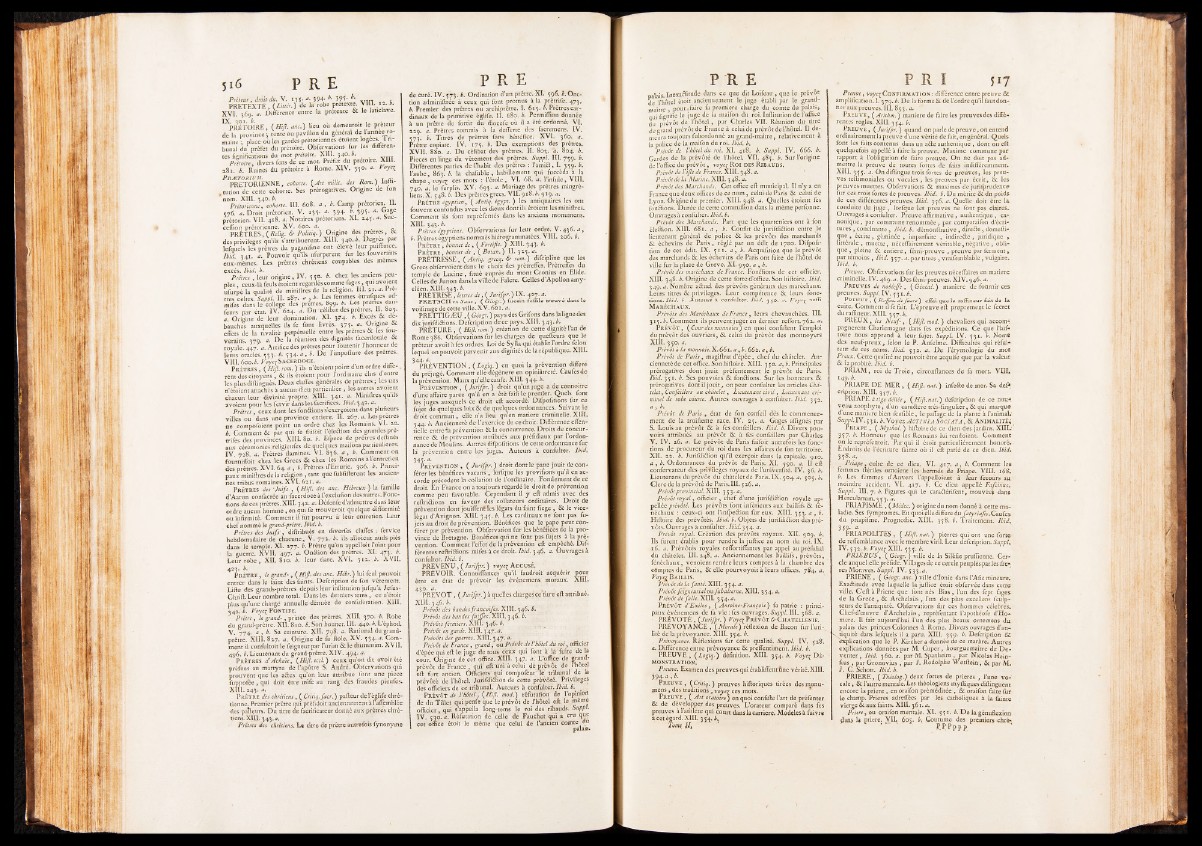
’ I !!
5 1 6 PRE
'I ! " , if
-jiil :iP
: h m
li 1: r
M i ^
.M
I ‘
rr
1 ' \
P rm u r, droit du. V . i ; î . 3 9 4 - *• 3 9 Ï- *■
P R E T E X T E , (.Liiiîr.) de la robe pteieSK. ^
X V I , 369. Dirt'ci'CHCc entre h prctexte & le laticlave.
*"'^PRÉroiRE, (H ip. ‘inc.) lieu où clemeuroit le préteur
de la proviiîce i tente on pavillon du général de l’armec ro-
m line • place où les gardes prétoriennes croient logées. 1 n -
bunai du préfet du prétoire. Oblcryations lur les difieren-
tes iicnifications du niot/irérot«. XIU. 3 4 0 -^- , . Prétoire, divers fens de ce mot. Prêter du pretotre. XIII.
281. />. Ruines du prétoire à Rome. X IV . 330. <a. f-oyei
PliÆTORnrM. \ T A"
PRETORIENN E, cohorte. {A rt rnilu. des /îo/n.) inüi-
, tmioj] .le cotte colionc. Ses prérogatives. Origmc de ion
nomPr.é tXorIiIeIn. n3e4, 0c.o hh.o rte. ^ III. 608. 41 , b. Camp pretonem U.
576. a. Droit prétorien. V . 133. a. 394. ^ 1 9 5 -
prétorien. VII. 418. u. Notaires prétoriens. X L 243- »“ c*
cciTion prétorienne. X V . 600. a. , - c
PRÊTRES, ( / ?% . 6- Pohür^.) Origine des pretres, 6:
des privileges qu’ils s’attribuèrent. X I ll. 340./>. Degrés par
lefquels les prêtres du paganifmc ont élevé leur piullance.
Ibid. 341. a. Pouvoir qu’ils ufurperent fur les fouverams
cux-mèmc5. Les prêtres chrétiens coupables des memes
excPè,sa. rItbsid. b. , leur origitic, IV . 530. t. chez les aiicietis peuples
, ccux-là fculs éioicni regardés comme fages, qii. avoictit
ufurpé la qualité de niinillres de la religion. L L 21. o. l re-
très celtes. Suppl. II. 287. ^ , b. Les femmes ctrufques ad-
mifes dans le college des pretres. 899. b. Les ptetres dan-
feurs par état. IV . 624. Du célibat des pretres. U. 803.
4. Origine de leur domination. X L 374- b. Excès U de-
bauclics auxquelles ils le font livrés. 373. u. Ortgine 8c
effets (le la rivalité perpétuelle entre les pretres 8c les lou-
veraius. 379. u. 1 9 e la réunion des dignités lacerdotale tx
royale 447. a. Aviitlce des prêtres pour joutemr l’honneur de
leurs oracles. 3 , , . i. 334. x , i . D e fitiipollure des prêtres.
VII I. 600. i. F o jc ; Sacerdoce. .
Prêtres , {Jdijl. rom. ) ils n’étoient point d un ordre dihe- .
rent des citoyens , & ils étoient pour l'ordmairc élus d'entre
les plusdifcingués. Deu.x clalTes générales de proti cs 3 les uns
n'étoient attachés à aucun dieu particulier, les autres avoieiu
c’nacun leur divinité propre. X I ll. 341. u. Mmillres qu ils
avoient pour les fervir dans les facrificcs. 7 é/ù. 342. a.
Prêtres, ceux dont les fonôions s’exerçoient dans plulieiirs
villes ou dans une province entière. IL 267. 4. Les pretres
ne compofoient point un ordre chez les Romains. VI. 20.
b. Comment & par qui fe failbit l’éicéHon des grandes pré-
trlfes des provinces. XIII. 80. b. Efpece de pretres dolùnes
aux cérémonies religieufes de quelques mailbns pariiculicres.
IV . 728. 4. Prêtres flamines. V L 836. a , b. Comment on
fourmifoit chez les Grecs & chez les Romains à l’entretien
des prêtres. X V I . 6 4 - Prêtres d’Etrurie. 306. b. Principaux
minières d elà religion , tant que fubftHerent les anciennes
tribus romaines. X V I . 621. 4.
Prêtres des Juifs , {Htjl. des anc. Hébreux ) la famille
d’Aaron confacrée au facerdoce à i’exchifion des antres. Fonctions
de ces prêtres. X llI . 342. a. Délenfe d admettre dans leur
ordre aucun homme , en qui fe trouveroit quelque dittbrmité
ouintirmité. Comment il fut pourvu à leur entretien. Leur
chef nommé le ^rand-prêire. Ibid. b.
Prêtres des Juifs , diliribués en diverfes clades ; fervice
hebdomadaire de chacune, V . 772. b. ils alloicnt nuds piés
dans le temple. X L 277. é. Prêtre qu’on appelloit l’oint pour
la guerre. X V II . 497. a. Oiiélion des pretres. XL 473. b.
Leur robe , XII. 810. b. leur tiare. X V I. 312. b. XVII.
423. b. Prêtre , U grand-, {H iß. des anc. Héhr.) lui feul pouvoit
entrer dans le laine dos faints. Defcription de Ibn vêtement.
Lifte des grands-prêtres depuis leur inftitution jufqu’à Jefus-
Chrift. Leur nombre total. Dans les derniers tems, ce n’étoit
plus qu’une charge annuelle dénuée de conlidéraiion. XIII.
342. ê, Pontife. Prêtre, le grand- des prêtres. X lil. 370. b. Robe
du grand-prêtre. XII. 810. ê. Son bonnet.HL 440. é. L’éphod.
V . 774. a , b. Sa ceinture. XII. 798 .4 . Rational du grand-
prêtre. X llI . 827. a. Origine de fa Hole. X V . 3 3 4 - Comment
il confulcoit le feigneurpar rurlm & le thummim. XVII.
496. b. Lieutenant du grand-prêtre. X IV . 494. a.
Prêtres d'Achaie, {H ß.cccl.) ceux qu’on dit avoir été
préfens au martyre de l’apôtre S. André. Obtervations qui
prouvent que les aéles qu’on leur attribue font une piece
fiippolêe , qui doit être inife au rang des fraudes pieufes
X iU .2 4 3 . ft.
Prêtre des chrétiens, ( Criii^.ficr.) pafteur del’églife chrétienne.
Premier prêtre qui préfidoit anciennement à l’afiemblée
des payeurs. Du titre de facrificateur donné aux prêtres chrétiens.
XIII. 343.4.
Prêtres des chrétiens. Le titre de prêtre autrefois fynonyme
PRE
de curé. IV . 373. b. Ordination d’un prêtre. X L 396. l. O nction
adminiftréc à ceux qui font promus à la prètrife. 473.
b. Premier des prêtres ou archiprêtre. L 613. é. Prêtres cardinaux
de la primitive églife. IL 680. b. Permiflion donnée
à un prêtre de fortir dn diocefe où il a été ordonne. V L
229. a. Prêtres commis à la delTcrte des facreniens. IV .
373. b. Titres de prêtres fans bénéfice. XVI, 360. a.
Prêtre copiaie. IV. 173. b. Des exemptions des prêtres.
XV II . 880. 4. D u célibat des prêtres. IL 803, a. 804. b.
Pieces en linge du vêtement des prêtres. Suppl. 1 1 1 . 739. b.
Différentes panics de l’habit des prêtres : l’amiél, L 339. b.
l’aube, 863. é. E chafublc , habillement qui fuccéda à la
chape , v jyr ç ces mots : l’ctole , V I . 68. a. l’infule, VIII.
740. 4. le fiirplis. X V . 693. 4. Mariage des prêtres mingré-
liens.X. 348. b. Des prêiros grecs. V IL 918.ê. 919. a.
Prêtre égyptien, ( Antiq. égypt. ) les antiquaires les ont
Ibuvent confondus avec les dieux dont ils etoicnt Icsnuniftres.
Comment ils font repréfentés dans les anciens monumens.
XUI. 343. é. Prêtres égyptiens. Obfervations fur leur ordre. V .4 3 6 .4 ,
b. Prêtres égyptiens nommés hiérogrammacêcs. VII I. 206. b.
Prêtre , bonnet de , ( Fortifie. ) XUI. 345- b.
Prêtre , bonnet de , ( Bot an. ) II. 3 2 5 .4.
PRÊTRESSE, {Antiq. grecq. & rom.) difeipline que les
Grecs obfcrvoient dans le choix des prètreffes. Prètreffes du
temple de Lucine , fituc auprès du mont Croniiis en Elide.
Celles de Junon dans la ville de Falcre. Celles d ’Apollon amy-
cléen. XIII. 343. b.
PR Ê T R IS E , lettres de, ( Jurifpr. ) IX. 427. a.
PRET SCH en Saxe, ( Géogr.) fiiccin foftile trouvé dans le
voifinagc de cette ville. X V . 601. 4.
P R E T T IGÆ U ,(Gée g r.) pays desGrifons dans la ligue des
dixjurifdiélions. Defci iption de ce pays. XUI. 343-
P R Ê TU R E , {H fi.rom .) création de cette dignité l’an de
Rome 386. Obfervations fur lcschar--cs de quefteurs que le
prêteur avoir à fes ordres. Loi de Sylla qui établit 1 ordre fcloti
lequel on pouvoir p.arvenir aux dignités de la république. XIIL
^*^PRÉVENT1 0 N , {Lügiq.) en quoi la prévention différé
du préjugé. Comment elle dégénéré en opiniâtreté. Caulesde
la prévention- Maux qu’ellecaufc. XIII. 344. b.
Prévention, {Jurifpr.) droit qu'un juge a de connoitre
d’une affaire parce qu’il en a été faili le premier. Quels font
les juges auxquels ce droit cft accordé. Difpofitions lur ce
fujet de quelques loix & de quelques ordonnances. Suivant le
droit commun , elle n’a lieu qu’en matière criminelle. X IIL
344. b. Ancienneté de l’exercice de ce droit. Différence eflen-
tielle entre-ta prévention & la concurrence. Droits de concurrence
6c de prévention attribués aux prèfidiaux par l'ordonnance
de Moulins. Autres difpofitions de ccnc ordonnance fur
la prévention entre les juges. Auteurs à confulter. Ibid.
3 4 3 - ‘*-
Prévention , ( Jurifpr.) droit dont le pape jouit de conférer
les bénéfices vacans , lorfque les provifions qu’il en accorde
précèdent la collation de l’ordinaire. Fondement de ce
droit. En France on a toujours regardé le droit de prévention
comme peu favorable. Cependant il y eft admis avec des
reftriiftlons en faveur des collateurs ordinaires. Droit de
prévention dont jouilTent ïcs légars du faint fiegc , 6c le v ice-
léifat d’Avignon. XIII. 343. b. Les cardinaux ne font pas fu-
jers au droit de prévention. Bénéfices que le pape peut conférer
par prévention, Obfevvation fur les bénéfices de la province
de Bretagne. Bénéfices qui ne font pas fujets à la prévention.
Comment l’effet de la prévention eft empêché. D ifférentes
reftriélions mifes à ce droit. Ibid. 346. a. Ouvrages à
confulter./èii/. é.
PREVENU , ( Jurifpr. ) l ’Pyrç A ccusÉ.
PRÉVOIR. Connoiffances qu’il faudroit acquérir pour
être en état de prévoir les événemens moraux. X l i l .
430. a.
P R E V O T , ( Jurifpr. ) à quelles cliarges ce titre eft attribue.
XÏIl. 346, b.
Prévôt des bandesfr.inçoifes. XUI. 346. b.
Prévôt des bandes fuifes. X III. 346. b.
Prévôtsyêr,Tiicrr. X l l i . 346. b.
Prévôt en garde. XUI. 347. a.
Prévôts des guerres. XUI. 347. a.
Prévôt de France , grand, ou Prévôt deVhôtcl du roi, officier
d’épée qui cft le juge de tous ceux qui font à la fuite de la
cour. Origine de cet office. XIIL 347. a. L’office de grajrd-
prévôt de France , qui eft uni à celui de prévôt de l’hôtel
eft fort ancien. Officiers qui compofent le tribunal de la
prévôté de l'iiôtel. Jurifdiftion de cette prévôté. Privileges
des officiers de ce tribunal. Auteurs à confulter./éic/. b.
Prévôt de l’hôtel, {H fi. mod.) réfutation de l’opinion
de du Tillct qui penfe que le prévôt de l’hôtel cft le même
officier, qui s’appella long-tems le roi des ribands. Supp'-
IV . 330.4. Réfutation de celle de Fauchet qui a cru que
cet office étoit le même que celui de l’ancien comte du
* * palais.
PRE
palais. Inexaftitude dans ce que dit Loifeaii , que le prévôt
de V liôtel étoit ancienuemcin le juge établi par le grand-
mnîne , pour-faire fa premiere charge du comte du palais,
ni figiiirie le juge de la maifoii du roi. Inftitution de l’office
du p'iévôt de r iiô te l, par Charles V IL Réunion du titre
tie grand prévôt de France â celui de prévôt de l’hôtel. Il de-
meuia toujours fubordonné au grand-maître, relativement à
la police de la maifon du roi. Ibid. b.
Prévôt de riiôieldu roi. X L 418. b. Suppl. IV . 666. b.
G.udcs de la prévôté de l’hotel. V IL 483. b. Sur l’origine
de l’office du p ré v ô t, voye^ R o i des Ribauds.
Prévôt de Ffie de Prance. X IIL 348. 4.
Prévôt de l.i Miirine. XIIL 348. a.
prévôt des March.inds. Ce t office cft municipal. Il n’y a en
France que deux offices de ce nom , celui de P.iris 6c celui de
Lyon. Origine du premier. XUI. 348. a. Quelles étoient fes
tbnftlons. Durée de cette commiffion dans la même perfonne.
Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Prévôt des Marchands. Part que les quartenlers ont à fon
cleélion. XUI. 681. a , b. Conflit de jurifdiélion entre le
lieutenant général de police 6c les prévôts des marchands
6c échevins de Paris, réglé par un édit de 1700. Difpoft-
fion de cet édit. IX. 5 1 1 . a , b. Acquifition que le prévôt
des marchands 6c les échevins de Paris ont faite de l’hôtel de
ville fur la place de Grève. XL 930. a , b.
Prévôt des m.arêchaux de France. FonéHons de cct officier.
XIII. 348. b. Origine de cette forte d’office. Sou liiftoirc. Ibid.
349.4. Nombre aftuel des prévôts généraux des maréchaux.
Leurs titres 6c privileges. Leur compétence 6c leurs fonctions./
Wi/. b. Auteurs à confulter. Ibid. 350. a. Foye^ luilfi
Maréchaux.
Prévôts des Maréchaux de France, leurs clievauchées. UL
313. />. Comment ils peuvent juger en dernier rcflbrt. 762. a.
Prévôt, {Cour des monnaies) etv, quoi confiftem l’emploi
du prévôt des ouvriers, 6c celui du prévôt des monnoyers
XIIL 330. 4.
Prévôt à Li WD/iwie. X. 661. a , b. 662. a, b.
Prévôt de Paris , magiftrat d’épé e , chef du châteler. Aii-
ciemictéde cet office. Son hiftoire. XIIL 330. a, b. Principales
prérogatives dont jouit préfentement le prévôt de Paris.
Ibid. 351. b. Scs pouvoirs 6c fonélions. Sur les honneurs 6c
prérogatives dont il jouit, on peut confulter les articles Châtelet,
ConfeilUrs au châtelet, Lieutenant civil, Lieutenant criminel
de robe courte. Autres ouvrages à confulter. Ibid. 332.
4 , b.
Prévôt de Paris , état de fon confeil dès le commencement
de la iroifieme race. IV . 23. a. Gages affignés par
5. Louis au prévôt 8c à fes confeillers. Ibid. b. Divers pouvoirs
attribués au prévôt 6c à fes confeillers par Charles
V . IV . 26. 4. Le prévôt de Paris faifoit autrefois les fonctions
de procureur du roi dans les affaires de fon territoire.
XII. 22. b. Jurifdiélion qu’il exerçoit dans la capitale. 910.
a , b. Ordonnances du prévôt de Paris. X L 390. a. Il eft
confervateur des privileges royaux de runiverfité. IV. 36. b.
Lieutenans du prévôt du châtelet de Paris. IX. 304. 4. 305.
Clerc de la prévôté de Paris. III. 3 26. a.
Prévôt provincial. XIIL 333.4.
Prévôt royal, officier , chef d'une jurifcllftion royale ap-
^eWee prévôté. Les prévôts font inférieurs aux baillifs 8c fé-
iiécliaux : ceux-ci ont I’infpeftion fur eux. XIII. 3 3 3 .4 , b.
Hiftoire des prévôtés. Ibid. b. Objets de jurifdiélion des prévôts.
Ouvrages à confulter. Ibid. 334. 4.
Prévôt royal. Création des prévôts royaux. XII, 909. b.
Ils furent établis pour rendre la juftice au nom du roi. IX.
16. 4. Prévôtés royales reffortilTantes par appel au préiidial
du châtelet. III. 248. 4. Anciennement les baillifs, prévôts,
fénécliaux, venoient rendre leurs comptes à la chambre des
comptes de Paris, 6c elle pourvoyoit à leurs offices. 784. a.
Foyej B aillis.
Prévôt de la faiité. XIII. 334. a.
Prévôt fcigneurialou fubalterne. XIIL 334. a.
Prévôt de fille. XIII. 334.4.
Prévôt d'Exiles, {Antoine-François) fa patrie : principaux
événemens de fa vie : fes ouvrages. Suppl. III. 368. 4.
PR É VÔ T É , {Jurifpr. ) Foyc^ Prévôt & Châtellenie.
P R É V O Y A N C E , ( A/t);4/e ) réflexion de Bacon fur l'utilité
de la p révoyance. XIII. 334. b.
P/-cVüy4/jcc. Réflexions fur cette qualité. Suppl. IV . 328. 4. Différence entre prévoyance 8c preffentiment. Ibid. b.
P R E U V E , {Logiq.) définition. XIII. 334, b. Démonstration.
Preuve. Examen des preuves qui établiffent fine vérité.XIII. 394.4, é.
Preuve , {CrUiq. ) preuves hlftoriqucs tirées des monu-
mens, des traditions , voyc:^ ces mots.
Preuve , ( A n oratoire ) en quoi confiftc l’art de préfenter
8c de développer des preuves. L’orateur comparé dans fes
preuves àrathleie qui court dansla carrière. Modèles à fuiyr«
à cet égard, XUI. 3 34, b.
Tome
P R I 317
voyrç C o n f irm a t io n : différence entre preuve 8c
amplification. I. 379. b. De la forme 6c de l’ordre qu’il faut donner
aux preuves, lil. 833. 4.
Pr e u v e , {Arithm.) manicic de faire les preuvesdes différentes
regies. XIII, 354, b.
Pr e u v e , {Jurfpr.) quand on parle de p reuve, on entend
ordinairement la preuve d’une vérité de fait, en général. Quels
font les faits contenus dans un aéle autlieiuitjue , dont on eft
quelquefois appelle à faire la preuve. Maxime commune par
rapport à l’obligation de faire preuve. On ne doit pas admettre
la preuve de toutes fortes de faits tndift'ércmment.
XIII, 335. 4. On diftinguc trois fortes de preuves, les preuves
tellimoniales ou vocales , les preuves par écrit, 6c les
preuves muettes. Obfervations 8c maximes de jurifprudence
liir CCS trois fortes de preuves. Ibid. b. Du mérite 6c du poids
de ces différentes preuves. Ibid. 336. a. Quelle doit être la
conduite du juge , lorfque les preuves ne font pas claires.
Ouvr.ages à confulter. Preuve affirmative , authentique, canonique,
par commune renommée, par comparaifon d’écritures
, concluante , Ibid. b. démonflrative , direéle, domefti-
que , écrite, géminée , imparfaite , indircéfe , juridique ,
littérale, muette, iiéccffaivemeiu véritable, négative , oblique
, pleine 6c emicre , fémi-preuve , preuve par ferment,
par témoins , Ibid. 3 3 7.4. par titres, v raifcmblablc, vulgaire. Ibid. b.
Preuve. Obfervations fur les preuves néceffaires en matière
criminelle. IV. 469. a. Des féini-preuves. XIV. 946. a.
l^R^VVtS de nobleffe , {Généal.) maniéré de fournir ces
preuves. Suppl. IV. 33 i, b.
Preuv e , ( Rafiin. de fucre ) effai que le raffineur fait de la
cuite. Comment il fe fait. L’épreuve eft proprement le fecret
du raffineur. X III. 337. i.
P R EU X , les N euf-, {H fi. mod.) chevaliers qui accompagnèrent
Charlemagne dans fes expéditions. Ce que l’bif-
toire nous apprend à leur fujet. Suppl. IV . 531. b. Noms
des neuf-preux, felon le P. Anfelnie. Difficultés qui réful-
cent de ces noms. Ibid. 332. a. D e l’étymologie du mot
Preux. Cette qualité ne pouvoit être acquifé que par la valeur
6c h probité. Ibid. b.
P llIAM , roi de T ro ie , circonftances de fa mort. VII I.
1 4 9 '
PRIAPE D E MER , ( Hifl. nat. ) infeéle de mer. Sa
cription. XIIL 337. b.
PRIAPE àtige déliée, {H fi.n a i.) defcription de ce nou-,
veau zoopliyte, d’un caraélere très-fingulicr, ôc qui marque
d une maniéré bien lênfible, le paffage de la plante à l'animal.'
SuimLlY. 331, V o y e z A c t ix ia Soc/A T A ,6i A ni.malitk^
Pr ia pe , ( Myihol. ) hiftoire de ce dieu des jardins. XIII-
337. b. Honneur que les Romains lui rendoicnc. Comment
on le repréfentoit. Par qui il étoit particuliérement honoré.
Endroits do récriture faùuc où il eft parlé de ce dieu. Ibid,
338.4.
Priape, culte de cc dieu. VI. 417. a , b. Comment les
femmes flériles ornoient les Jiennès de Priape. VIII. i68.
h. Les femmes d’Anvers l’appelloient à leur fecoùrs au
moindre accident. VI. 417. b. Ce dieu appellé F.ifcinus.
Suppl. Ill, 7. é. Figures qui le caraftérifent, trouvées dans
Herculanum. 333. a.
PRIAPISME , {Médec. ) origine du nom donné à cette maladie.
Ses fymptomes. En quoi ellediffere du fnyriafis.C\iu(\ii
du priapilme. Prognoftic. XIIL 338. b. Traitement. Ibid,
339. 4.
FRIAPOLITES , ( H fi. nat. ) pierres qui ont une forte
de reffemblance avec le membre viril. Leur defcription. Suppl,
IV , 332. é. Foye;^ XIII. 333.
P R IE B U S , ( Géogr. ) ville de la Siléfie prufficnne. Cercle
auquel elle préfide. Villagesdc ce cercle peuplés parles frères
Moraves. Suppl. IV. 333.4.
PRIENE , ( Géogr. anc. ) ville d’Ionie dans l’Afie mineure.
Exaélitude avec laquelle la juftice étoit obfervée dans cette
ville. C ’eft à Pricnc que font nés B ia s , l’un des fept fages
de la Grece , 6c Arcbelaüs , l'im des plus exccllens fculp-
teurs de l’antiquité. Obfervations fur ces hommes célébrés.
Chef-d’oeuvre d’Archelaüs, repréfentant i’apothéofe d’Ho-
mere. Il fait aujourd’hui l’uii des plus beaux ornemens du
palais des princes Colonnes à Rome. Divers ouvrages d’an-
. tiquité dans lefquels il a paru. XUI. 339. b. Defcription 6c
explication que le P. Kirclier a donnée de ce marbre. Autres
explications données par M. Cu p e r , bourguemaitre de D e v
en te r , Ibid. 360. 4. par M. Spanheim , par Nicolas Hein-
fius , par Gronovius , par /. Rodolphe We tfte in, 8c par M.
J. C. Schott. Ibid. b.
PRIERE, {Théotog.) deux fortes de prières , l’une vocale
, 6c l’autre mentale. Les théologiens myftiques diftinguent
encore la priera , en oraifon préméditée , 8c oraifon faite fur
le champ. Prières adreffées par les catholiques à la fainte
vierge 6c aux faims. XIII. 3 6 1 .4.
Priere,Q\x oraifon mentale. XL 331. L D e la génuflexion
dans la priere. VU . 603. b. Coutume des premiers chré-
P.P-PPPP,
M