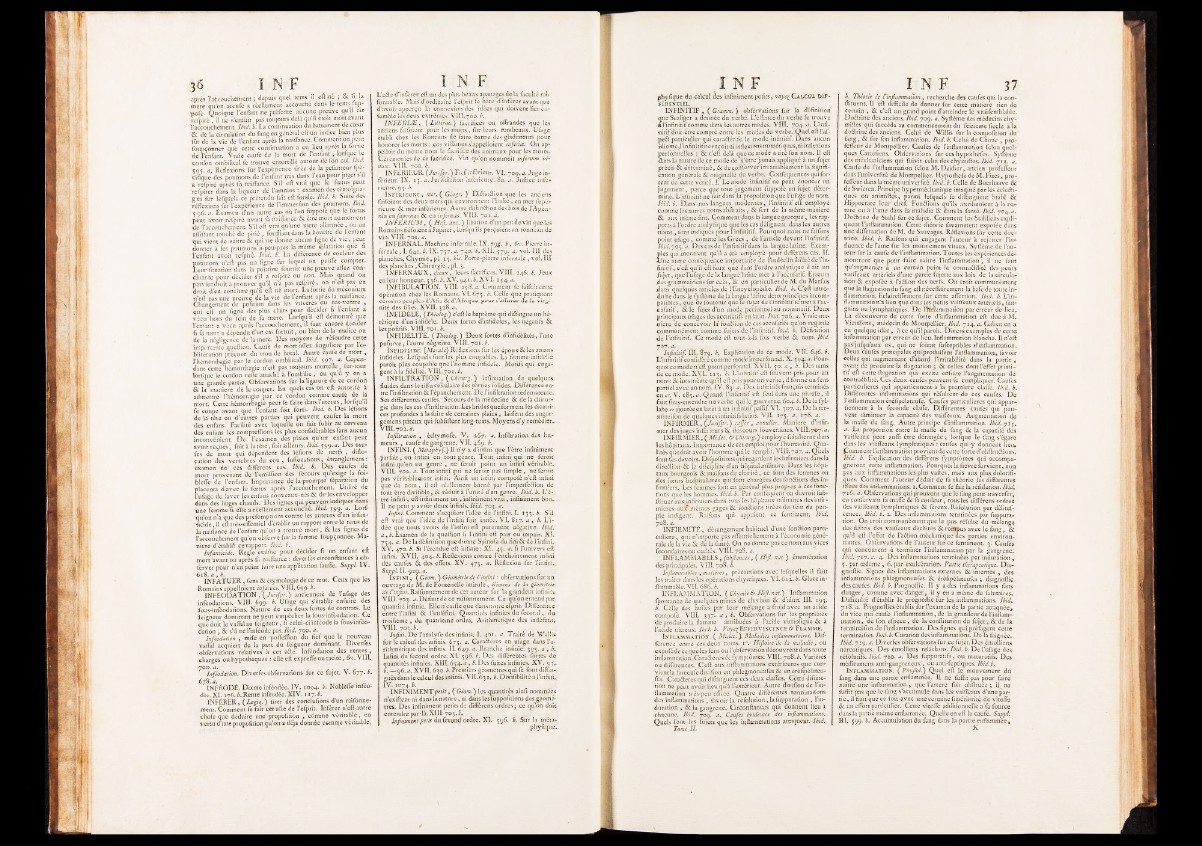
î N F N F
.ipvès Vatcoiichcjnent ; clapui-i quel teins il efi n^ ; »;
mere qnon aceufe a réellement accouché dans le tems iup-
■ pofé. Quoique l'enfant ne pféiénic aucune preuve qu il mt
vcfpiré , il ne s’enfuit pas toujours delà qu il étoit mort avant
raccouchcmcnt. Jtid. b. La continuation <lu battement de coeur
-5c de la circulation du fang en général cil un indice bien plus
i'ûr de la vie de l’enfant après la nailTancc. Comment on peut
foupçonner que cette continuation a eu lieu apres la forne
de l’enfant. Vraie caufe de la mort de l’entant , lorique le
cordon ombilical le trouve entortillé luuoiir de Iqn col. îbid.
59-;. rt. Réflexions fur l'expérience tirée de la pelanteur Ipc--
clfique des poumons de l'enfant mis dans 1 eau pour juger s il
a refpiré après fa nnilTance. S'il d l vrai que le toems peut
refpirer dans la liqueur de l’ainnios : examen des témoignag
es fur Icfqiids ce prétendu frdt efl fondé. Ibid. h. Suite des
réflexions fur l'expérience de l'inimerfion des poumons, /éd/.
<j 96 .7. Examen d’un autre cas oii l’on fuppolb que le foetus
peut avoir refpiré avant fa naiirance 6c être mort au moment
de l'accoucbcment. S’il eft vraiqu'iine mere allarmee , ou un
aflilrant touché de pitié , fouffiunt d.ms la bouche de l’entant
qui vient de naître & qui ne donne aucun fignc de v ie , peut
donner à fes poumons à-peu-prés la même dilatation que fi
l'enfant avoit icfpiré. Ih'td. b. Lu ditTércnce de couleur des
l
:10ns n'cll pas un fignc fur lequel on pmlle compter,
lituution dans la poitrine fournit une preuve afiez concluante
pour décider s'il a refpiré ou non. Mais quand 011
pars iendroit à prouver qu’il n’a pas refpiré, on 11 eil pas en
drjit d’en conclure qu'il eR né mort. Lafortie dumceoniiim
n’eft pas une preuve de la vie de l'enfant après la natliance.
Changement de pofition dans les vifcercs du bas-ventre ,
qui cil un figne des plus clairs pour décider fi 1 enfant a
vécu liofs du fein de fa mere. Lorfqu'il cil démontré que
l'enfant a s’ écu après l’accosuliement, U faut encore decider
fl fa men t a dépendu d'un cas fortuit, ou bien de la malice ou
de la négligence de la mere. Des nroyens de réfouclre ceue
importante* qiicflion. Cauie de mort afl'ez finguliere par lo -
blitération précoce du trou de botal. Autre caiiic de mort ,
rbémonliagie par le cordon ombilical. Ibid. ^97. d. Cependant
cette "hémorrhagie n'ell pas loujours mortelle , iur-tout
lorfque le cordon reîle attaché à l’ombilic , ou q u il y en a
une grande partie. Übfcrvatiops fur la ligature de ce cordon
& la manière de le couper. En cpiels cas on cft autor.le à
admettre l'iiémorragie par ce cordon comme caufe de la
mort. Cette hémorrhagie peut fe taire clans 1 uteius, lorfqu il
fe coupe avant que l’enfant foit fort). Ibid. b. Des léfions
de la tête ou d’autres parties qui peuvent caufer la mort
des enfans. Facilité avec laquelle on fait fiibir au cerveau
des enfans les comprenions les plus confidérables fans aucun
inconvénient. D e l’examen des plaies qu’im enfant peut
avoir reloues., foit à la tète, fuit ailleurs. Ibid. 599. a. Des cau-
fes de mort qui dépendent des léfions de nerfs , dido-
caiion des vertébrés du c o u , fiiflbcations, étranglcmens :
examen de ces dift'érens cas. Ibid. b. Des caufes de
mort provenant de l’onufTion des lecours qu exige la foi-
blclTe de l’enfant. Importance de la prompte féparation du
placenta d'avec le foetus après raccoticbement. Üniité de
l'u fagc de laver les enfans rxmvcaux-n-es 6c de les cnx clopper
dans des linges chauds. Des fignes qui peuvent indiquer d a^
une femme fi elle a réellement accouché. Ihd. 599. a. Lort-
qu'on n’a que des préfomptions contre les auteurs d un infanticide
, il ell ti ès-eifentiel d’ùablir un rapport entre le tems de
la naiifance de l’enfant qu’on a trouvé m o rt, Sc les lignes de
raccoiichement qu’on obfcrve lur la femme foupçonnée. Maniéré
d’étabiif ce rapport. Ib:d. b. r n
Infanticide. Regie établie pour décider U un enfant elt
mort avant ou apres fa naillance : diverles circonftances à ob-
ferver pour n’en point faire une application faulTe. Suppl. IV .
618. a , é.
IN FA TUER , fens Sictymolomc de ce mot. Ceux que les
Romains appelloieni VIII. 699. é.
IN FÉ O D A T IO N , ( /u'j/pr.) ancienneté de 1 ufage des
inféodations. VII I. 699. b. Ufage qui s’établit enfuite clés
fous-inféodations. Nature de ces cleuxlortes de contrats. Le
Icigneiir dominant ne peut empêcher la fous-inféodation. Ce
que doit le vafTal au feigneur , Il celui-ci inféode la fous-inféodation
, 8c s’il ne l’inféode pas. Ibid. 700. a.
Inféodation , mife en poffelTion du fief que le nouveau
valVal acquiert de la part du feigneur dominant. Diverfes
obfervations relatives à cet aéle. Inféodation des rentes ,
charges ou hypotheques ; elle ell exprelTe ou tacite, b-c-VlIl.
^ Inféodation. Diverfes obfervations fur ce fujet. V . 677. b.
678. a.
INFÉODÉ. Dixme inféodée. IV . 1094- é. Noblefie inféodée.
XI. 176. L Rente inféodée. X IV . 1 17. é.
INFÉRER, {L oftq.) tirer des condufions d’nn raifonne-
nicm. Comment fe fait cet aéle de refprit. Inférer n’ell autre
cliofe que déduire une propoiition , comme véritable, on
vertu d'une propofition qu’on a déjà donnée ceinme veritable,
L’aftc d'inférer d l un dos plus beaux apanage; de la faculté rat-
fonnab'.c. Mais d’ordinaire l’efpvi: fe hâte d'intércr avant que
d'avoir appcnjii la connexion des idées qui doivent lier un-
lémble le» deux extrêmc.v V III. 700. b.
I i \ f £ R !Æ , (Litrér.u.) facriliccs ou offrandes que les
anciens failbicnt pour les morts, fur leurs fombeau.x. Ufage
établi chez les Romains de faire battre des gladiateurs pour
honorer les morts : ces vidimos s’appelloicnt inferÎÆ. On ap*
poüoit du même nom le lacrilice des animaux pour lesmoics.
Cérémonies de ce facvitice. Vin qu’on nommoit inferium vi-
iium. V U '. -00. b.
INFLRIEUR. FU f inférieur. V I . 709. j . Jiigeinférieur.
IX. 13. a. Jiiiildlclion iniérieiirc. 80. a. Jufiice inférieure.
95. b.
INFERIEURE, mcr, (_ G.'ogr. ) Dlflinélion tjiie les anciens
faifoient des deux mers qui environnent 1 Iialic , en mer iupé-
rioure & mer inférieure. Autre dilllnélion des bois de l'.Apen-
nin en fupemas 8c en inferr.as. V III. 701. a.
IN F E R IU M , ( Hijî. anc. ) libation d'un peu de vin que les
Romains fallbienc à Jupiter, loriqu'ils percoieiu un conneau de
vin. V III. 701. rf.
INFERNAL. Machine infernale. IX. 791. b , &c. Pien-ein-
fernale, 1-641 . é. IX. 7 3 7 . 7 4 0 . /n X li. 579. ,1. vol. I ll des
planches, Ch ym ie , pl. 13. bis. Porte-pierre infernale , vol. l i l
des planches,Chirurgie , pl. 3.
IN FE RN A U X , dieux, leurs facrrfices. VIII. 2.46. b. Jeux
en leur honneur. 536. /•. X V . 9 4 1> b. X V I. 1 54. .t.
INFIBULAT IO N. V i l l . 238..1. C.ommein fe faifoitcette
opération chez les Romains, v 1. 675. b. Celle que pratiquent
certains peuples d'A fie 6c d'A frique pour s’alTurer de la virginité
des filles. XVII . 328. <j.
INFIDÈLE, {ThéologI) c ’cfl le baptême qui diflingue un hérétique
d'un infidèle. l3cux fortes d’inrideles, les négatifs &
les pofuifs. VIII. -0 1. b.
INFIDÉLITÉ. {T/iéolog.) Deux fortes d’infidélités, l'unc
pofitive, l’autre négative. V I I l. 701. b.
Infid> LITE. f\Ior.iIe) Rétlcxions fur les époux 8c les amans
infidèles. Lefquels font les plus coupables. La femme infidclle
paroit plus coupable qnc l’homme infidèle. iMotils qui engagent
à la fidélité. V 111. jo i .b .
IN F IL T R A T IO N , {C/iinrg.) infiiuiation de quelques
fluides dans le tiflu cellulaire des parties folides. Différence entre
l’infiltration 8c l’épanchemcnt. De t’infiliraiion oedemateuie.
Ses différentes canfes. Secours de la médecine 6c de la chirurgie
dans les cas d’infiltration. Les bridesqueforment les cicatrices
profondes à la fuite de certaines plaies , laUfent des engor-
gemens piteux qui fubfiffent long-tems. Moyens d’y remédier.
VII I. 702. a.
Infiltration , écliymofe. V . 267. a. Infiltration des Iul-
nieurs , caufe de gangrene. VII. 4Ö9. b.
INFINI. ( Métaphyf.') 11 n’y a d’infini qua l’être infiniment
parfait, on infini en tout genre. To ut infini qui ne feroit
infini qu'en un genre , ne feroit point un infini véritable.
VII I. 702. -î. Tout infini qui ne feroit pas Ample , ne feroit
pas vcritableaient inlini. Ainfi un in.ffnl compofé n’cA infini
que de nom , il cil rc.;!lemcn: borné par rimperfeélion de
tout être divifible, 6c réduit à runité d’im genre. Ibid. b. L’être
infini, efl infiniment un , infiniment v r a i, infiaiment bon.
Il ne peut y avoir deux infinis. Ibid. 703. a.
Infini. Comment s’acquiert l’idée do l’infini. I. 133. b. S’il
efl vrai que l'idée do l'infini foit innée. V I . 817. n , b. L'idée
que nous avons de l'infini ell purement négative. Ibid,
a , b. Examen de la quellion fi l'infini cil pair ou Impair. XL
734. a. De la définition que donne Spinofa du fini 8c de l'infinf,
X V . 470. b. Si l’étendue ell infinie : XL 43. a. fl l’univers eil
infini. X V II . 404. />. Réfle.xions contre rench.iinement infini
des caufes 6c des effets. X V . 473. a. Réflexion l'ur l’infini..
929. a.
Infini , ( Géom. ) Géométrie de l 'infini : obfervations fur un
ouvrage de M. de Fontenelle intitulé , élémens de la géométrie
r / e R a i f o n n e m e n t de cet auteur fur la grandeur infinie.
VII I. 703. a. Défaut de ce raifonnemem. Ce qii’on entend par
quantité infinie. Ellen’exiffeque dansnotrecfpric. Différence
entre l’infini 6c l’indéfini. Quantités infinies du fécond , du
troifieme , du quatrième ordre. Arithmétique des indéfinis.
VII I. 703. é.
Infini. D e l’analyfe des infinis. I. 401. a. Traité de 'Wallis
fur le calcul des infinis. 673. a. Caraéleres en ufage dans l’arithmétique
des infinis. IL 649. a. Branche infinie. 393. a , h.
Infini du fécond ordre. X L 596. é. Des differentes fortes de
quantités infinies. XIII. 634.^1, é. D es fuites infinies. X V . 93.
b. — 96. a. XVII . 630. b. Premiers géomètres qui fc font diffln-
giiés dans le calcul des infinis. VII. 631. b. Divifibiiité k l’infini,
f v . 1074. b.
INFINIMENT/Ktir, {Géom.) les quantités ainfi nommées
n’exiflent ni dans la nature, ni dans les fuppofuions dos géomc-
treî. Des infiniment petits de différons ordres; ce qu’on doit
entendre par-là.XIII. 703. É
I/tfinirnfitt petit du (cCQtid OTiiic. XI. 396. b. Sur la inéta-
phyfique.
I N F I N F pbvAcpie du calcul des infiniment petits, Calcul différentiel.
INFINITIF , ( Gramm. ) obfervations fur la définition
qiicScaliger a donnée du verbe. L’offeiicedu verbe fe trouve
à l’infinitif comme dans les autres modes. VIII. 704. a. L’infi-
«itif doit être compté entre Iss modes du verbe. Quel efl l’af-
peél pariicuUer qui caraêlorlfo le mode infinitif. Dans aucun
idiomc.l'infinicifnc reçoit niinflsxions niimér;qucs,ni inflexions
perfonnelles ; 6c c’eft delà que ce mode a tiré fon nom. Il ell
dans la nature de ce mode de n’étre jamais appliqué à un fujet
précis 8c déterminé, & deconferver invari.ablement la fignific.
aticn générale 8c originelle d uv cib c . Conféquencesqtiifor-
tont de cette vérité. I. Le mode infinitif ne peut énoncer iiji
jugement, parce que tout jugement fiippofe un fujet déterminé.
L'infijiitifne fait dans lu propofition que l’ufagc de nom.
Ibid. b. Dans nos langues modernes, l’infiniiif ell etnployé
comme les autres l’.omsabflvaits, 8c fort de la .même maniéré
& au.x meme fins. Comment dans la langue g recque, les rapports
à l’ordre analytique quelescas défignem dans les autres
noms, font indiqués pour l'infinitif. Pourquoi nous ne faifons
point ufage , comme les Grecs , tic l’article devant I’inffnitif-.
Ib iJ .ro ÿ a .£ Des cas de l’infinitif dans la langue latine. Exem- les qui nioim-ent qu’il a été employé pour dlffércns cas. II.
hie autre coiiféqiience importante de i’indéclinabilicé de l’infinitif,
c'eÉl qu’il ellfaiix que dans l’ordre analytique il ait un
fujet, que fufage de la langue latine met à l'acculatif. Erreurs
/des giammalrieiis fur ce la, 8c en particulier de M. du Marfais
xlans quelques articles de l’Encyclopédie. Ibid. b. C ’eff introduire
dans le fyflêinc de la langue latine deux principes incompatibles
, que de foutenir que le fujet de l’infinitil fe met à l’ac-
Cüfatif, 8c le fujet d’un mode perfonnel au nominatif. Deux
principaux ufages desaceufatifs en latin. Ibid. 706. a. Vraie nu-
oiere de concevoir la fonélion de ces accu fatiîs qu’on regarde
commimémcnt comme fujets de l’infinitif. Ibid. b. Définition
de rinfinitif. C e mode efl tout-à-la fois verbe Sc nonr. IbiJ.
707. a.
Infinitif. III. 879. b. Explication de ce mode. VIL 646. b.
L'infinitif confidéré comme mode iniperfonnei. X. 394. a. Pourquoi
ce mode n’eft point perlonnel. XV H. 30. .J J b. Des tems
de ce mode. XVI. 113. b. L’infinitif c(l louvent pris pour un
nom ; 8c lors même qu’il eff pris pour un verb e, i! forme im feus
partielavec un nom, I V .83. a. Des infinitifs françois terminés
en er. V . 183. a. Quand l’infinitif efl feu! dans une phrafe. il
faut fous-entendre un verbe qui le gouverne. 604. b. D e la fyl-
labe er ajoutée en latin à un ir.tmicif pnfllf. V I. 3 07. a. D e la ter-
minalfon de quelquesinfinitifshuins. V IL 173. .7. 176. a.
INFIRMER , {/urifpr.) ca fe r, annulier. Maniéré d’infirmer
des juges intérieurs 8c des cours foiiveraines. \ 111.707..!.
INFIRMIER, ( Médec. & Chirurg.) employé fubalterne dans
les hôpitaux. Importance de cet emploi pour l’iuimanite. Q u alités
quedoit avoir l’homme qui le remplit. V i lI . 707. u. Quels
font fes devoirs. Difi>ofuionsqiii regardent les infirmiers dtms la
direélion- 6c la difcipline d’un hôpital militaire. Dans les hôpitaux
bourgeois Sc maÜbns de charité, ce font des femmes ou
des fesurs hofpiialieres qui font chargées des fonélions des infirmiers.
Les femmes font en général plus propres à ces fonctions
que les hommes. Ibid. b. Par confequent ou devroit fub-
ilitticr aux infirmiers dans tous les hôpitaux militaires des infirmières
aux* mêmes gages 8c fondions tirées du fein du peuple
indigent. Raiions qui appuient ce fcntimcnt. Ibid.
708. ,7.
IN FIRMITÉ, dérangement habituel d’ une fondion particulière
, qui n'importe pas eflcntiellement à 1 économie generale
de la vie 8c de la famé. On ne donne pas ce nom aux vices
fecondairesou cachés. Y l l I . 708. a.
INFLAMMABLES ,ybéy?.i«oer, ( IFifi. nat. ) énumération
des principales. VIII. 708. b.
IifiammabUs , matières, précautions avec lefquelles il faut
les traiter dans les opér.itions ciiymiques. V I . ö 12. é. Glace inflammable.
VII. 686. b.
IN FLAM MAT ION. {Chymie& IJifi.n.it.) Inflammation
Ijjoncanee de quelques mines de charbon 8c. d'alun. III. 193.
b. Celle des huiles par leur mélange a froid avec un acide
compofé. VIII. 337. a , b. Obfervations fur les propriétés
de prouiiirc la flamme attribuées à l’acide vitriolique 6c à
l ’acide nitreux. Ibid. b. Fhytq Effervescence 6* Flamme.
Infla.mMATION- ( Mé.lcc. ) Maladies inflammatoires. D ifférence
enire ces deux noms. i". Hifioire de la nuiladic, ou
expol'éde ce que les fens ou l’übfervation découvrent dans toute
inflammàtion. Caraderes 8c fymptömes. VU I. 708. L Variétés
on diflérences. C ’cfl aux inflammations extérieures que convient
la fameiife divifioii en phlegmonctifes 8c en éréfipélateu-
fes. Caraderes qui diffingueiu ces deux claffés. _ Cette diffinc-
tion ne peut avoir lietiqu’à l’extérieur. Autre divifion de l’inflammation
très-peu ufitêc. Quatre différentes Terminaifons
des inflammations , favoir la rèfolution, la fuppuratlon , 1 induration
, 8c la gangrene. Circoiiflances qui donnent lieu a
chacune. Ibid. 709. u. C.mfes évidentes des inflammations.
Quels font les fujets que les inflammations aitaqucHV, Ibid.
Tome IL
3 7
h. Théorie de Tinfi.immamn , recherche des caufes qui la con-
fliment. Il efl difficile de donner fur cette matière rien de
certain , 8c c’efi un grand point d’atteindre le vraifemblable.
D od iiiic (les anciens. Ibid. 709. a. Syffême des médecin» cliy-
imfles qui fiiccéda au commcnccineiudn feizieme fiecle à la
dûdrine des anciens. Celui de Willis fur la compofition du
fan g , 8c fur fon inflammation. Ibid. b. Celui de Chirac , pro-
fefféiir de Montpellier. Caufes de l’inflammation félon quelques
Canéfiens. Obfervations fur ces liypoihefes. .Syfteme
des mcchaniciens qui fuivit celui des chymiffes. Ibid. 7 1 1. a.
Caufe de l’inflammation felon M.Deidier, ancien profefleur
dans l’imiverfité de Montpellier. Hyporhefc de M. Fizes, pro-
feffeur dans !a même univerfité. Ibid. b. C elle de Boerhaave 8c
de Swieten. Principe hypermédianiqiie imaginé par les écleéli-
qiics ou animiftes, parmi lefquels fe diflinguenc Stahl 8c
Hij)j)ocrate leur chef. Fouélions qu’ils attribiioient à la nature
ou à l’ame dans la maladie & d.ans la famé. Ibid. 704. a.
Dodliine de Stalil fur ce fujet. Comment les St.ililicns expliquent
l’inllaimnation. Cette théorie favamment expofée d.iiis
une difl'ertarion de M. de Sauvages. Réfle.xions fur cette doctrine.
Ibid. b. Raifons qui engagent l’auteur à rejetter l’influence
de l’amc fur les moiivemens vitaux. Syffême de l’au-
leu rfu r ia caufe de l’inflammation. Toutes les expériences démontrent
que pour faire naitre rinflammation , il ne faut
qu’aiigmeiucr à un certain point la contraililicé des petits
vaiffeaux artériels d’une partie fujette au.x loix de la circulation
8c expofée à l’aélion des nerfs. On croit communéinenE
que la llagnationdu fang eff nécefiai renient la bafe de toute inflammation.
EdaircilTemcnt fur cette afiertion. Ibid. é. L’inflammation
n’a lieu que dans les petits vaifleaux artériels, fan-
guins ou lymphatiques. D e fftiflammation par erreur de lieu.
La découverte de cette forte d’inflammation eff due à M.
Vicuflens, médecin de Montpellier. Ibid. 714. <2. Galien en a
eu quelque idée , à ce qu’il paroit. Divers exemples de cette
inflammation par erreur de lieu. Inflammation blanche. Il n’eff
pasjufqit’aux o s , qui ne foient fufceptibles d’inflammation.
Deux caufes principales quiproduifent l’inflammation, favoir
celles qui augmentent d’abord l’irritabilité dans la partie ,
avant de produire la ffagiiation ; 8c celles dont l’effet primit
if eff cette ffagnatlon qui excite enfuite l’augnicntation de
contraélilité. Ces deux caufes peuvent fe compUvjucr. Caufes
particulières qui appartiennent à la premiere clalïe. Ibid. b.
Différentes inflammations qui réfulicnt de ces caufes. D e
l’inflammation éréfipélateufe. Caufes paniculieres qui appar-
licnneiu à la fécondé clalfe. Différentes caiifes'qui peuvent
diminuer la capacité des vaiffeaux. Augmentation de
la niaife du fang. Autre principe d’inflammation, Ibid. 713.
a. La proportion entre la maffe du fang 8c la capacité des
vaiffeaux peut aiifli être dérangée , lorlqne le fang s’égare
dans les vaiffeaux lymphatiques : caufes qui y donnent lieu.
Çommcnr rinflammation provient de cette forte d’obffruftions.
Ibid. b. Explication des différens fymptômes qui accompagneront
cette inflammation. Pourquoi la fievrefurvient, non
pas aux inflammations les plus vaffes, mais aux plus dolorifi-
ques. Comment l’auteur déduit de fa théorie les différentes
ilfiies des inflammations, i. Comment fe fait la rèfolution. Ibid.
■ J 16. a. Obfervations qui prouvent que le fang peut traverfer,
en cüufervant fa maffe Sc fa couleur, tous les différens ordres
des vaiffeaux lymphatiques 8c féreux. Rèfolution par délitef-
ccnce. Ibid. b. 2. Des inflammatians terminées par fuppiira-
tion. On croit communément que le pus réluhe du mélange
des débris des vaiffeaux déchirés Scrontpus avec le fang, 8C
qu’il eff l’effet de l’aélion méchanique des parties environnantes.
Obfervations de l’auteur fur ce fentiment. 3. Caufes
qui concourent à terminer l’inflammation par la gangrene.
Ibid. 717. a. 4. Des inflammations terminées par induration,
3. par cedeme , 6. par exulcération. Partie thérapeutique. Dia-
gnoffic. Signes des inflammations externes 8c internes , des
inflammations phlegmoncufes 8c éréfipélateufcs ; cliagnoûiç
des caufes. Ibid. b. Piognollic. Il y a des inflammations fans
danger, comme avec danger, il y en a même de f.iliitaires.
Difficulté d’établir le prognoffic fur les inflammations. Ibid.
718. rf, Prognoffics établis fur l’examen de la partie attaquée,
du vice qui caufe rinflammation, de la grandeur de l’inflammation
, de fon cfpece , de la conffitution du fu je t, 8c de la
renninaifon de rinflammation. Des fignes quipréfagent cette
terminaifon. Ibid. b. Curation des inflammations. D e la faignée.
Ibid. 719. a. Diverfes obfervations fur ce fujet. Des cir.olliens
narcotiques. Des émolliens relàchaiis. Ibid. b. D e l'ufage des
réfolutifs. Ibid. 720. a. Des fuppuratif», ou inaturatifs. Des
médicamens anti-gangreneux, ou anti-feptiques./éii/.é.
Inflammation. {Phyfiol.) Q u el eff le mouvement du
fang dans une partie enflammée. Il ne fuffit pas pour faire
naitre une inflammation , que l’avtcre foie obffruéc ; il ne
fuffit pas que le fmg s’accumule dans les vaiffeaux d'une partie
, il faut que ce foit avec une certaine fupérioricé de viteffe
8: un effort paniculier. Cette vîteffe additionnelle a fa fource
cl.ms la partie même enflammée. Quelle en eff la caufe. Suppl.
l i l . 399. b. Accumulation du fang dans la partie enflammée.