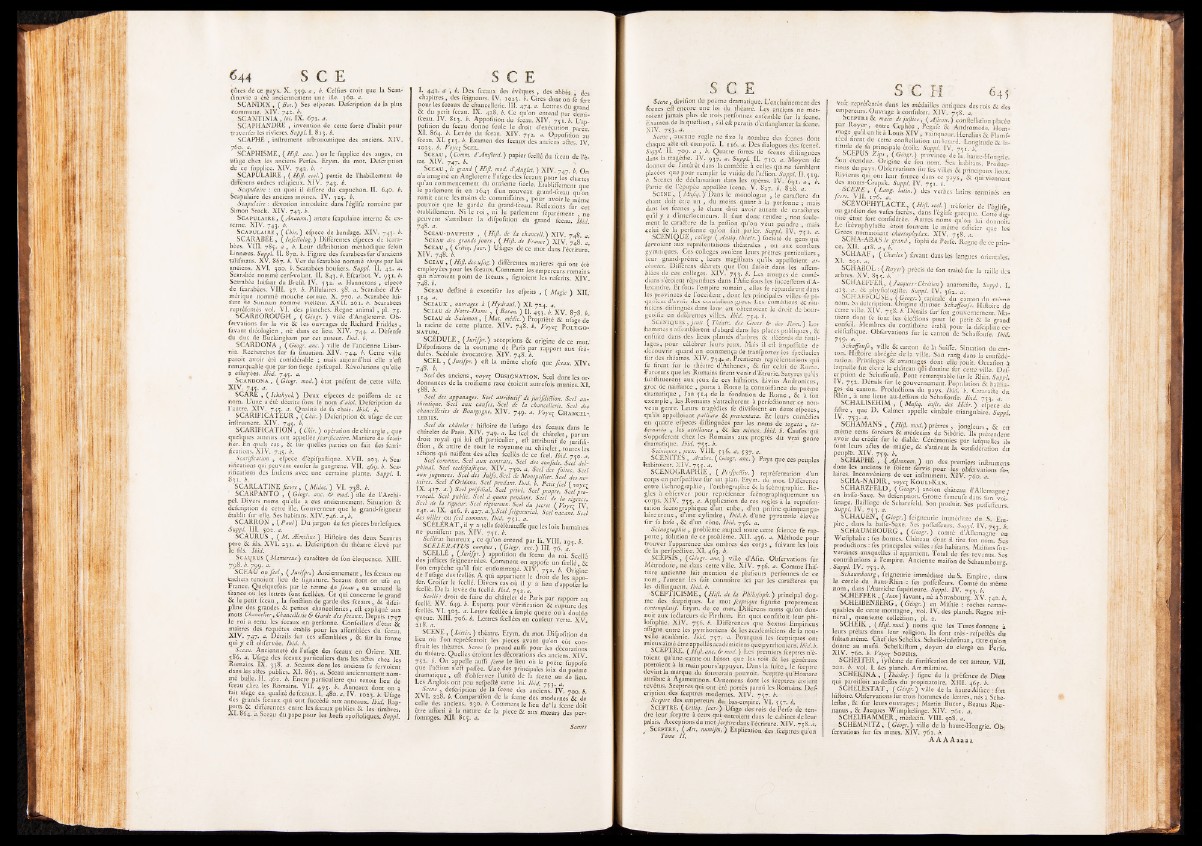
iiivinW!.
! '( " il
i
»
' ‘- - '' f t
(>44 S C E
Cotes de ce pays. X . 359. <1, A Celfius croit que la Scan-
tlin.ivic a été anciennement une Ille. 360. .t.
S C AN D IX , ( ßor.) Ses efpeces. Deferipeion da la plus
commune. X IV. 742. />.
SC A N T IN IA , /öi. IX. 672. a.
SCAPH.4 NDRE , Invention de cette forte d'habit pour
travetfer les rivieres.iV.'/tp/. 1. 813. è.
SCAPHÉ , inllrument aftronoinique des anciens. XIV.
SCAPHISME, ( //j/f. anç. ) ou le fupplice des auges, en
wfage citez les .'tneiens Perfes. Etym. du mot. Defeription
de ce fupplice. XIV. 742. b. •
SC A PU L A IR E , {H ifl. cccl.) partie de l’habillement de
différens ordres religieux. X IV . 743. b.
Sc.ipid.iire : en quoi il dillere du capuchon. II. 640. b.
Scapulaire des anciens moines. IV . 325. b.
ücapuhire : dévotion intiodiiitc dans l'églife romaine par
Simon Stock. X IV . 743./’.
S c a p u l a ir e , (^Anjtom.') artere fcapulaire interne externe.
X IV. 743. b.
Sc a p u l a ir e , (f/nV.) cfpecc de bandage. X IV . 743. b.
S C A R A B É E , I Infe&ohg.) Différentes cfpeces de feara-
bées. Vin . 785. li , b. Leur diffribution méthodique félon
Linnæiis. Suppl. II. 870. b. Figure des fearabees fur d'anciens
talifiiians. XV. 867. b. Ver du fearabee nommé thrips par les
anciens. X VI. 500. b. Scarabées boufiers- Suppl. IL 42. j .
Scarabée nommé cerf-volant. IL 843. b. Efearbot. V . 931. b.
Scarabée luifuu du Brcfil. IV^ 532. a. Hannetons , efoecc
de Icarabées. VIII. 37. b. Pillulaires. 38. a. Scarabée d’A mérique
nommé mouche cornue. X. 770. u. Scarabée Itii-
fant (le Surinam nommé vielleur. X V ll. 261. b. Scarabées
reprélcmés vol. V I . des planches. Rogne animal , pi. 75.
SCA R BO R O U GH , ( Giogr. ) ville d'Angleterre. Ob-
fervations fur la vie 6c les ouvrages de Richard Friddes,
favant théologien , né dans ce lieu. X IV . 744. a. Dcfenfe
du duc de Buckingham par cct auteur. Ibid. b.
SC A R D O N A , ( Géogr. anc. ) ville de l’ancienne Libur-
nie. Rcciierchcs fur fa fituation. X IV . 744. b. Cette ville
paroit avoir été confidérable ; mais au;oiird’hui elle n'eft
remarquable que par fon fiege épifcopal. Révolutions qu'elle
a effuyées. Ibid. 743. a.
ScARDONA , ( Gi'ogr. mod.) état prefent de cette ville.
X IV . 745. ,1.
SCARE , ^Ichthyol.) Deux efpeces de poiffons de ce
nom. L’une a été décrite fous le nom d'aiol. Defeription de
l ’autre. X IV . 743. .1. Qualité de fa chair. Ibid. b.
SC A R IF IC À FEUR , ( Chir. ) Defeription 6c ufage de cet
inftrument. X IV . 743. b.
SC A R IF IC A T IO N , ( Chir. ) opération de chirurgie, que
quelques auteurs ont appellee jcurific.uïon. Maniéré de feari-
hcr. En quels ca s , & Itir quelles parties on fait des feari-
iîcations. X IV . 745. b.
Scarific.uiûn , efpece d’éplfpaftique. X V II . 203. b. Scarifications
qui peuvent cauferla gangrène. V IL 469. b. Scarifications
des Indiens avec une certaine plante. Suppl. I.
S 3 1. b.
SCARLATINE ßevre , (^MeJec.) V I. 738. b.
S C A K P AN TO , ( Géogr. une. 6> mod. ) ifle de l’Archi-
pcl. Divers noms qu’elle a eus anciennement. Situation Sc
defeription de ceuc ifle. Gouverneur que le grand-feigneur
établit fur elle. Ses habitans. XIV.746. a, b.
SCARRON , { P mU) D u jargon de fes pieces burlefqiies.
Suppl. III. 502, a.
SCAURUS , ( AL Æmilius ) Hifloire des deux Scaunis
perc 6c fils. X V I . 231. a. Defeription du théâtre élevé par
le fils. Ibid.
ScAURus {^Mumercus) caraélere de fon éloquence. XIII.
798. é. 799. U.
SCE AU ou f e e l, (^Jurifpi.) Anciennement, les fceaux ou
Cachets tenoient lieu de lignature. Sceaux dont on ufe en
France. Quelquefois par le terme de fceau , on entend la
féance oit les lettres font fccllées. Ce qui concerne le grand
6c le petit Iccau , la fonffion de garde des fceaux, & difei-
pline des grandes 6c petites cliancelleries, cft expliqué aux
mots Chancelier, Chancellerie & Garde des fceaux. Depuis 1737
le roi a tenu les fceaux en perfonne. Confeillers d’état &
maîtres des requêtes établis pour les affembiées du fceau
X IV . 747. a. Détails fur ces affembiées , 6c fur la forme
qui y efl ohfervée. Ibid. b.
Scc.m. Ancienneté de I'ufijge des fceaux en Orient. XII.
386. a. Ufage des fceaux particuliers dans les aftes chez les
Romains. IX. 338. a. Sceaux dont les anciens fc fervoient
dans les aéies publics. X L 863. a. Sceau anciennement nommé
bulle. IL 462. b. Encre particulière qui tenoit lieu de
Iceau chez les Romains. V IL 493- b. Anneaux dont on a
fait ufage en qualité de fceaux, I. 480.^. IV, 1023. b. Ufage
des grands fceaux qui ont fuccédé aux anneaux. Ibid. Rap-
ports & différences encre les fceaux publics 6c les timbres.
A L 864. a. Sceau du pape pour les brefs apofloliques. Suppl.
S C E
I. 441. 4 , L Des fceaux des éx'êques , des abbés , de-
chapitres, des feigneurs. IV. 1023. b. Cires dont on fe Grî
pour les fceaux de chancellerie, HL 474. a. Lettres du grand
6c du petit l'ccau. IX. 428. b. Ce qu’on entend par clemi-
fceaii, IV. 813. b. Appofitiondu fceau. X IV . 751. L L’ap-
pofition du fceau donne feule le droit d’exécution purée
XI. 864- b. Levée du fceau. XI'V. 752. a. Oppofition au
Iccau. XL 313. b. Examen des Iccaux des anciens aéles. IV
1023. b. Fovci SCEL.
Sc e a u , (Comm. i'Amferd.) papier fcellé du fceau de l’état.
XIV. 747. b.
Sceau , U grand ( H if. mod. d'Angla. ) XIV. 747. b. On
11 a imaginé en Angleterre i’ufage des fceaux pour les chartes
qu au commencement du onzième fiecle. Etahliffemcnt que
le parlement fit en 1643 d’un nouveau grancl-fceau qu’on
remit entre les mains de commiffaires , pour avoir le même
pouvoir que le garde du giand-fceau. Réflexions fur cct
ctablilTcmcnt. Ni le roi , ni le parlement féparément , ne
peuvent s'attribuer la difpofition du grand fceau Ibid
748. 4.
Sc e a u -d au ph in , {H if . de la duncell.) X IV . 748. a.
Sceau des grands jours, ( H if. de France) X IV . 748. à,
^ Sceau , ( Critiq. facr. ) Ufages de ce mot dans l’écrirurc!
X IV . 748. b.
Sceau , (Hifi.dcsufag.) différentes matières qui ont été
employées pour les fceaii.x. Comment les empereurs romains
qui n’avoient point de fceaux , flgiioient les referits X IV
748. é. _ _
S ceau defliné à cxorcifer les efprits , ( Migie ) XII.
314. a.
Sc e a u x , ouvrages à (^Hydraul.) XI. 724. a.
Sceau de Notre-Dame , {B oian.) IL 453. b. X V . 878. b.
Sceau de Salomon {Mat. médic.) Propriété 6c ufage de
la racine de cette plante. X IV . 748. b. Foyer Po l y g o -
NATUM.
S C É D U L E , {Jurifpr.) acceptions & origine de ce mot.
Difpofitions de la coutume de Paris par rapport aux fcé-
dules. Scédule évocatoire. X IV . 748. b.
SCE L , {Jurifpr. ) eft la même cliofe que fceau. XIV«
74S. b.
5« / des anciens, voye^ O b s ig n a t io n . Scel dont les or-
tîonna^nces de la iroifieme race étoîcm autrefois immics. X L
Scel des appanages. Scel attributif de jurifdiâion. Scel authentique.
Sccl aux caufes. Scel de la chancellerie. Scel des
chancelleries de Bourgogne. X IV . 749. a. Foyer C h aN'CEL-
LERIES.
5a-/ du châtelet : liifloire de l’ufage des fceaux dans le
(thâtelet de Paris. XIV. 749. Le léel du châtelet, par un
droit royal qm lut eff particulier, eft attributif de jurifcli-
étion , & attire de tout le royaume au châtelet, toutes les
aélions qui naiffent des aRes fcellés de ce fcel. Ibid. 730 a
Scel commun. Sccl aux contrats. Scel des confuls Scel del-
phinal. Scel eccUfafiique. X IV . 750. ,1. Scel des foires. Scel
aux jugemens.^ Scel des Juifs. Scel de Montpellier. Scel des notaires.
Scel d'Orléans. Scel pendant. Ibid. b. Petit fc el ( vvvt-
IX. 417. a .) Scel préftdial. Scel privé. Scel propre. Scel provençal.
Sccl public. Scel à queue pendant. Scel de la régence.
Scel de la rigueur. Scel rigoureux. Scel du Jecret ( Foyet i v l
i4 1 . t f . IX . 416. h .â t i j .a fS c e l feigneurial. Scel vacant. Scel
des villes ou jeel commun. Ibid. 731. a.
S C É L É R A T , il y a telle fcéléraceffe que les loix humaines
ne pumffent pas. X IV . 731. b.
Scélérat heureux , ce qu’on entend par là. VII I. ro t b
S C E LER A TU S campus, {Géogr. anc.) III ^
SCELLÉ , {Jurifpr.) appol'itioii du fceau du r'oi.'Scclli
des juftices fcigneun.iles. Comment on appofe un fcellé &
l’on empêche qu’il foit endommagé. XIV. 731. b. Origine
de l’ufage des fcellés. A qui appartient le droit de les appo-
fer. Croifer le fcellé. Divers cas où il y a lieu d’appofer I0
fcellé. De la levée du fcellé. Ibid. 732. a.
Scellé: droit de fuite du châtelet de Paris par rapport au
fcellé. X V . 649. b. Experts pour vérification 6c. rupture des
fcellés. V L 303. a. Lettre feeliéeà fimple queue ou à double
queue. XIII. 706. b. Lettres fcellces en couleur verte. X V .
SCENE , {Litter. ) théâtre. Etym. du mot. Difpofition du
lieu où Ion repréfentoir les pieces av.ant qu’on eût con-
ftriiit les théâtres. Scene fc prend aufli pour les décorations
du tliéatre. Quelles étoient les décorations des anciens. X IV .
732. b. On appelle aufll fcetie le lieu oii le poète fuppofe
que l'aftion s'eft paffée. Une des principales loix du poème
dramatique , eft d’obferver l’unité de la feene <?u de lieu.
Les Anglois ont peu refpeélé cette loi. Ibid. 753.
^ Scene , defeription de la feene des anciens. IV . 700. b.
X V I . 228. b. Comparaifon de la fccne des modernes & de
celle des anciens. 230. b. Comment le lieu de*la fccne doit
être aflbrti à la nature de la pièce & aux moeurs des per-
fonnages. XIL 813. a.
Scenes
. - 4
Scene, divifion du poeme dramatique. L ’eiicliaincmcnt des
fcencs eft encore une loi du théâtre. Les anciens ne met-
toient jamais plus de trois perfonnes enfemltle fur la feene.
Examen de la q iiellioii, s’il eft permis d’enfanglantcr la feene.
XIV. 733. tf.
Scene, aucune règle ne fixe le nombre dos fcencs dont
chaque acte cft comjjole. I. 116. a. Des dialogues des fceneL
S.'/ppl- II. 709. tf , b. Quatre fortes de feenes diftinguees
dans la tragédie. IV . 937. a. Suppl. II. 710. a. Moyeu de
donner de i’inrérèt dans la comédie .à celles qui ne femhlcm
placées que pour remplir le vuide de l’affion. Suppl. II. 319.
b. Scenes de déclamation dans les opéras. IV. 691. <z, b.
Partie de l’épopée appellee feene. V . 827. b. 828. a . ’
Scene , {Mujîq.) le monologue , le caraélerc du
chant doit être un , du moins quant .à la perfonne ; mais
dans les feenes , le chant doit avoir aucanc de caractères
qu’il y a d'interlocuteurs. Il faut donc rendre , non feulement
le caraélcre de la pallîon qu’on veut peindre , mais
£clui de la perfonne qu’on fait parler. Suppl, IV . 731. a.
S C E N IQ U E , college ( Antiq. ihcatr. ) fociéié de gens qui
fervoient aux reprélcntations théâtrales , ou aux combats
gymniques. Ces colleges avoient leurs prêtres )wrticL;liors,
leur grand-prêtre , leurs magiftrais qu'lis appclloient archontes.
Différens décrets que l'on falloir dans les affem-
hlécs de ces colleges. X IV . 733. b. Les troupes de comédiens
s’étoicin répandues dans i’A fie fous les fucceffeurs d'A-
le.xandre. Et fous l’empire romain , elles fe répandirent dans
les provinces de l'occident, dont les principales villes fe ])i-
(juoiont d’avoir des comédiens grecs. Les comédiens 6c nui-
ficiens diàiiigués dans leur an obtenoient le droit de ixtiir-
geoifie en difteremes villes. Ibid. 734. b.
SCEMQUES {Théatr. des Grecs 6- des Rom.) Lcs
hommes s'alTemblerent d’abtyd dans les places publiques, 6c
enfuite dans des lieux plantés d’arbres ix décorés cio feuillag
es, pour célébrer leurs jeux. Mais il eft impofnble de
découvrir quand on commença de iranfporter les fpeiffncies
fur des théâtres. X IV . 734. a:. Premieres repréfentations qui
fe firent lur le théâtre d’A tlien es , & fur celui de Ro.ne.
Farceurs que les Romains firent venir d’Errurie. Satyres qu’ils
fui.ftituercnt aux jeux de ces hiftrlons. Livius Andronicus,
grec de naiffancc , porta à Rome la connoiflànce du poème
dramatique , l’an 314 de la fondation de Rome , éc à fon
exemple, les Romains s’attachèrent à perfeftionner ce nouveau
genre. Leurs tragédies fe divifoient en deux efpeces,
qu’ils appelloicnr p.tlliaia & prectextata. Et leurs comédies
en quatre efpeces diftingiiées par les noms de to^ata , ta-
bernaria , les attellanes , & les mimes. Ibid. h. Caufes qui
s’oppoferent chez les Romains aux progrès du vrai genre
dramatique. Ibid. 733. b.
Scéniques , jeux. VU I. 336. a. 337. <?.
SCENITES , Arabes.{Geogr. anc.) P.ays que ces peuples
îiabitoient. X I v . 733. a.
SCÉNOGR APHIE , ( Pcrfpcélh. ) repréfentation d’un
corps en pcrfpeélivc fur un plan. Etym. du mot. Difl'éroncc
entre l’ichnographio, ronhographic & la feenographie. Rè gles
à obferver pour repréfenter fcé'nograpliiqiiement un
corps. X IV . 733. tf. Application de ces regies .à la repréfen-
tation fccnograpliique d'un cub e, d’un pnfme quinqiiangu-
lairc c reu x, d’une cylindre, Ibid. b. d’une pyramide élevée
lur fa bafe , 6c d’un cotte. Ibid. 736. a.
Scénographie , problème auquel toute cette fcieitce fe rapporte
; fohition de ce problème. XIT. 436. a. Méthode pour
trouver l’apparence des ombres des corps , fuivant les loix
de la perfpeflive. XI. 463. b.
SCE PSIS, {Géogr. anc.) ville d’Afic. Ohfervatioiis fur
Métrodorc, ne dans cette ville. X IV . 736. a. Comme l'iiif-
toire ancienne fait mention de plufieitrs perfonnes de ce
nom, l’auteur les tait connoître ici par les caraifteres qui
les diftinguenr. Ibid. b.
S C E P I IC ISM E , {J Jif. de la Philofopk.) principal dogme
des feeptiques. Le mot feeptique lignifie proprement
contemplatif. Etym. de ce mot. Dift'érens noms qu'on don-
noit aux feélateiirs de Pirrlion. En quoi confiftoit leur phi-
lofophic. X IV . 736. b. Difl'érences que Sextus Empiricus
affigne entre les pyrrhoniens 6c les académiciens de la nouvelle
acadm-nie. Ibid. 737. a. Pourquoi les feeptiques ont
mieux aimé être appellés académiciens que pyrrhoniens. Ibid. b.
SCEPTRE. {H if.anc . & mod.) Les premiers feeptres n’é-
toicnt qii’uiie canne ou bâton que les rois 6c les généraux
portoicnt a la main pours’appuyer. Dans la fuite , Je feeptre
devint la marque du fouverain pouvoir. Sceptre qu'Hoincre
attribue à Agamemnon. Onicmens dont les feeptres étoient
revêtus. Sceptres qui ont été portés parmi les Romains. D e feription
des feeptres modernes. X IV . 737. b.
.Sceptre des empereurs du bas-empire. V I . 337. h.
Sc e p tre . {Crinq. Jacr.) Ufage des rois de Pcrl'e de tendre
leur feeptre à ceux qui entroient dans le cabinet de leur
palais. Acceptions du mot jeeptre dans l’écriture. XIV.. 738.
Sc e p t r e , {Art, numijm.) Explication des.feeptres au'oii
Tome U.
C H 6 4 5
voit reprofentés dans les médailles antiques des rois Sc des
empereurs. Ouvrage à confulter. X IV . 738. tf.
Sceptre & mam de juflice , (^//ruTt.) conftellation placée
par Royer , entre Cephée , Pegafe 6c Andromède. Hom-
inagc qu il en ht a Lotus X IV , vainqueur. Hcreliiis 6c Flamf-
tLctl hrent de cette coiiftcllation uii lézard. Lon(»hudc & l i-
titiide de fa principale étoile. Suppl. IV. 7« !. i f
SCEPUS Z ip s , {Géogr.) province d e là haute-Hongrie.
Son crendue. Origine de Ion nom. Ses habitans. Produc-
noiis du pays. Ohicrvations lur fes villes Si itrincioaux lieux
K.vieres qm ont leur lource dans ce p ays , & qui viennent
des monts-Crapak. Suppl. IV . 731. b.
r verbes latins terminés en
Jccrc. VH. 176. tf.
S C É V O PH T L A C T E , {Hiß. eccl.) tréforier de le g life ,
ou gardien des vafes facrés, dans l’églife grecque. Cette dignité
etoit tort confidérce. Autres noms qu’on Uii donnoit.
Le Icevopiiylaélc étoit fouvent Je même officier que les
Grecs nommoiem chanophyUx. X IV . 738. a.
SCHA -A BA S le grand, fophi de Perfe. Regne de ce prince.
X ü . 418. a , b. r> I
^ S C H A A F , {Charles) favant dans les langues orientales.
S CH A BO L : précis de fon traité fur la taille des
arbres. X V . 833. b.
SCHA EF FER, {Jacques-Chrétien) anatomifte, Suppl. I, 4 Î 1. a. 6c phyfiologiftc. Suppl. IV . 362. a.
S C h A E l-O U SE , {Géogr.) capitale du canton du même
nom. S;i ae(crii>tion. Origine du mot ScLtffoufe. Hiftoire de
cette Ville, X IV . 738. b. Détails fur fon gouvernement. Ma-
mere dont fe font les élevions pour le petit 6c le grand
confed. Membres du confiftoirc établi pour la difciplinc ec-
cleftaltique. Obfervations fur le canton de Schnffoufe. Ibid
739. tf.
Sdiaffoufe, ville 8c canton de la Suiffe. Situation du canton.
Hiffotre abrégée de l.a ville. Son rang dans la confédération
1 rivileges 6c avantages dont elle jouit. Occafion à
laquelle fut élevé je château qiii domine fur cette ville. Def-
cnpcion de Schaftoufe. Pont remarquable fur le Rliin. 5tfmV.
IV . 732. Details lur le gouvernement. Population & bailliages
du canton. Produirions du pays. Ibid. b. Catavare du
Rhin , à une lieue au-deffous de Schnffoufe. /Hj; 7 t2 j
SCHALISEHIM t^Mußq. infir. d „ H ih ,.) e fpecc 'de
iiüre , que D . Calmet appelle cimbalc triangulalie. Suppl
IV . 733. a. "
SCHAM ANS , ( /fty?./Koff. ) prêtres , jongleurs, & en
meme teins forciers & médecins de Sibérie. Ils prétendent
avoir du crédit fur le diable. Cérémonies par lefqucllcs ils
font leurs afles de magie, & s’ardrem la confidcraiion du
peupK. X IV . 739. b.
SCHAPHÉ , ( Ajlronsm. ) un des premiers inftrmncns
dont les anciens le foient fervis pour les obfervarions folâtres.
inconvemens de cet inftrumcnr. X IV . 7Ö0. a
S C K A -N A D IR , voye^ K o u l i-Ka n .
ancien châte.iu d’AUemagne:
en baile-Saxe. Sa defeription. Grotte fnineiife dans fon voi-
fmage. Bailliage de Scharzfeld. Son produit. Ses poffdl'eurs
Suppl. IV . 733. tf. ‘
S CH A U EN , {Géogr.) feigneuric immédiate du S. Empire
dans la balfe-Saxe. Scs polTcffeurs. Suppl. IV. je - ,, h
S CH A U M B O U R G , {Geogr.) comté d'A llemagne eu
Wellphaüe : fes bornes. Château dont il tire fon nom. S-3
produrions ; fes principales villes ; l'es habitans. Mail'ons fou-
verames auxquelles il appartient. To tal de fes revenus. Scs
contributions â l’empire, Ancienne maifon de Schauniboure
. Suppl. IV. 733. é. °
Schaumbourg, {cigneiiric immédiate du S. Empire, dans
le cercle du liaut-Rhiii : fes poffefleurs. Comté du même
nom, dans rAurriche ftipérieure. Suppl. IV . -733. b.
SCHEFFER , {Jean ) favant, né à Strasbourg. X V . <40. b,
SCHEIBENBERG, {Géogr.) en Mifnie : roches remarquables
de cette montagne, vol. IV . des planch. Regne mineral
, quatrième colleétion, pl. 2.
SCHEIK , {Htjl.mod.) noms que les Turesdonnent à
leurs prélats dans leur religion. Ils font très - refperés du
fultanméme. C h e f des Scheiks. Scheik-halefman , titre qu ’on
donne au mufti. Scheikiftuni , doyen du clergé en rerfe.
X IV . 760. b. Foye:^ SOPHIS.
SCHE ITER , fyliême de fortification de cet auteur. 'V IL
2or. b. vol. I. des plancli. Art militaire.
SCHO CINA , ( Théolog. ) figne de la préfence de D ie a
qui paroifl'oit aii-dcfl'us du propitiatoire. XIII. 463. b.
^ S CH E L E S T A T , { Géogr. ) ville de la haute-Alface : fon
hiftoire. Obfervations fur trois hoinmcs de leitre«, nés à Sehe*
leftat, & fur leurs ouvrages ; Martin Bitccr, Beatus Rhe-
jianus, 6c Jacques Wimphellnge. X IV . 761. a.
SCHELHAM M E R , médecin. VII I. 308. a.
SCH EM N IT Z , {Géogr.) ville d e là haute-Hongrie. Oh«
fervatioBS fur fes mines. X lV . 761. é.
A A A A a a a a
H