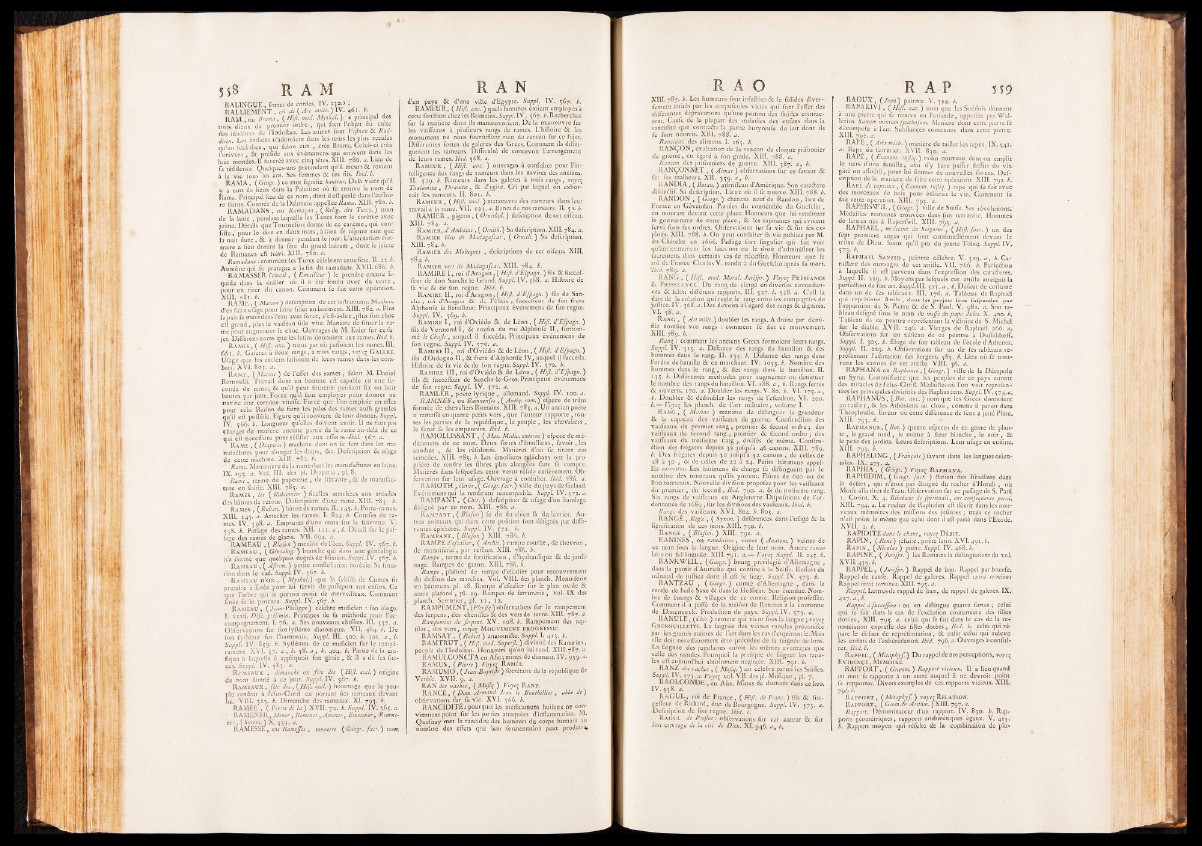
î
ii'i
« i ; k'il:.' K [’
'îl
t i; t1
:58 R A M
R A L IN G U E , fortes de cordes. IV. 23C.Î ;
RA L L IEM EN T , cri Je ( J n milu. ) IV. <61. h._
R AM ou , ( Hiil. mod. Mythol. ) e principal des
trois (lieux (lu pfe(«i=f “ rfre , qui font l’()b)ct dt. culte
des itlolàncs de l'Imlodan. Les autres lont Vijlnoa & Rud-
diren. Les indiens n’adorolent dans les tems les plus recules
qu’un leul dieu, nui lelon eux , créa Rianu. Celui-ci créa
l’imivcrs , & préüdc aux événemens qui arrivent dans les
huit mondes. 1 1 tiucrèéavec cinq têtes. XIII. 780. j . Lieu de
fa réfidcncc. Quelques-uns prétciuleiu qu’il meurt élc revient
à la vie tous les ans. Scs temmes Sc les fils. Ihid.b.
RA.MA , ( Géo^r. ) ce mot fignifie hauteur. Delà vient qu’il
y a tant de lieux dans la Paleltine où fe trouve le iioin de
Rama. Principal lieu de ce nom , dont il ell parlé dans l’écrlni-
re fainte. Contrée de la Dalmatic appellee Rama. XIII. 780. b.
R AM AD AN S , ou R.maian , ( Rclig. des Turcs. ) nom
de la lune , pendant laquelle les Turcs font le carême avec
jeûne. Détails queTournefort donné de ce carême, qui con-
fifte , pour le dire en deux mots, à bien fe réjouir tant que
la nuit dure , & à dormir pendant le jour. L’alternation contraire
a lieu durant la fête du grand bairam , dont le jeûne
de Ramazan eft luivi. XI 1 1 . 780. b.
RamaJ.ins : comment les Turcs célèbrent cette fête. II. 0.1. b.
Aumône qui fe pratique à latin du ramadans. X V U. 686. b.
RAMASSER , {Em.iiUcur) le prendre encore liquide
dans la cuiller où il a été fondu avec du verre ,
pour en tirer du canon. Comment fe fait cette opération.
X l l l . 781. b.
RAME , ( Marine ) defeription de cet mftrument. Mameve
d’en faire uiùge pour faire filler un bâtiment. X llL 782. a. Plus
la palefemeutdansl’eau avec force, c’eft-à-dire ,plus fon choc
eft grand, plus le vailfeau fille vice. Maniéré de fitucr la rame
pour augmenter le choc. Ouvrages de M. Euler fur ce fit-
jet. Diiférens noms que les latins donnoienc aux rames. ïbid. b.
R ames , ( anc. ) trous par oii pafibient les raines. III.
661. b. Galères à deux rangs, à trois rangs, G a lere.
Ufage que les anciens faifoicm de leurs rames dans les combats.
X VI. 805. a.
Rame, [Marine) de l’effet des rames, felon M. Daniel
Bernoulli. Travail dont un homme cft capable en une féconde
de tems, 6c qu'il peut foutenir pendant fix ou huit
heures par jour. Force qu’il faut employer pour donner au
nav'u-c une certaine viteife. Force que l'on emploie en effet
pour cela. Raifon de faire les pales des rames auffi grandes
qu’il ell polVilile. Figure qu’il convient de leur donner.
IV . 566. b. Longueur qu’elles doivent avoir. Il ne faut pas
charger de matière aucune partie de la rame au-delà de ce
qui eff nécefiaire pour réfifter aux efforts. Ibid. 567. a.
Rame , ( Draperie ) machine dont on fe fort dans les ma-
nufaélures pour alongcr les draps, 6cc, Defeription 6c ufage
de cette macliinc. XIII. 782. b.
Rame. Manoeuvre de la rame dans les manufaAurcs en laine.
IX. 193. a. Vol. III. des pi. Draperie , pl. 8. Rame terme de papeterie , de librairie ,6c de manufacture
en foirie. XUI. 783. a.
Rames , les ( Ruh.umicr ) ficelles attachées aux arcades
des bâtons de retour. Defeription d’une rame. XIII. 785. b.
Rames , {Ruban. ) bâton de rames. IL 145. i-. Porte-rames.
X l l l . 143. a. Attacher les rames. 1 . 824. b. Courfes de rames.
IV . 398. a. Emprunts d’une rame fur la fuivanre. V .
598. b. Paiiâge des rames. XH. 121. a , b. Détail fu r lcp af-
fage des rames de glacis. VU . 694. a.
"r a m e a u , ( Blafon ) meuble de l’écu. Suppl. W . 367. b.
R ameau , ( Généalop,. ) branche qui dans une généalogie
n’a donné que quelques degrés de filiation. St/pp/. IV. 567. b.
Rameau , ( Aßron. ) petite conftellation boréale. Sa litua-
tion dans le ciel. 1V. 367. b.
Rameau d’or , ( Mythol.) que la fybille de Cumes fit
prendre à Enée pour lui fervir de palTcporc aux enfers. Ce
que l’arbre qui le portoit avoit de merveilleux. Comment
Enée fc le procura. Suppl. IV . 367. b.
R a m e a u , {Jean-Philippe) célébré muficlen : fon éloge.
I. xxxij. Difc. prélhnin. Principes de fa méthode pour Tac-
coir.pagr.cment. I. 76. a. Ses nouveaux chiffres. III. 337. a.
Obfervaiions fur fon fyftémc diatonique. V II . 464. b. De
fon fyftème fur l’harmonie. Suppl. 1 1 1 , 300. b. 30t. a , b.
Suppl. IV . 839. h. Svftèmes de ce muficicn fur le tempérament.
X V I . 57. <2 , i . 58. (7 , b. 404. b. Partie de la mu-
fique à laquelle i! appliquoit fon g énie, 6c il a dû fes fuc-
cès. Suppl. IV. 383. a.
R/MEAUX , dimanche ou fite des (//i/?. cccl.) origine
du nom donné à ce jour. Suppl. IV. 367. b.
Ra m e a u x , y?/c des ^{H ifi. eccl.) hommage que le peuple
vendoit à Jefiis-Chrift en portant des rameaux devant
lui. VIII. 313. b. Dimanche des rameaux. XI. 703. b.
RAMÉE , ( Pierre de la ) X V II . -ji. b. Suppl. IV . 363. i7.
RAMENER , Mener, Rcmener, Amener, Emmener, Remmener,
{Synojt. ) X. 333. a.
RAMESSE, ou RameJJes , tonnerre {Gèogr. facr.) nom
R AN
d’un pays & d’une ville d’Egypte. Suppl. IV . 367,
R AM EU R , {H iß. anc. ) quels hommes ctoient employésà
cette fonélion chez les IXomains. Suppl. IV . 367. b. Recherches
fur la maniéré dont ils manoeuvroient. D e la manoeuvre fur
les vaHÎ'eaux à .pluficurs rangs de rames. L'hiftoire Sc les
monumens ne nous fourniffcin rien de certain fur ce fiijec.
Dift'éventes forces de galeres des Grecs. Comment ils diftin -
guoienc les rameurs. Difficulté de concevoir l’arrangement
de leurs rames. IbiJ. 368. a.
Rameur , ( Hiß. anc. ) ouvrages à confulter pour l’in-
tclligence des rangs de rameurs dans les navires dos anciens.
II. 329. b. Rameurs dans les galeres à trois rangs, voye^
Thalamica:, Thranitae, 6c Zygitoe. Cri par lequel on exhor-
toit les rameurs. II. 801. b.
Rameur, {H iß. ) manoeuvre des rameurs dans leur
travail à la rame. VII. 123. a. Bancs de nos rameurs, il. 32. b.
RAMIER , pigeon, ( Orniibol. ) defeription de cet oifeau.
XIII. 7S4. U.
Ramier, d’Amboïnc, ( Orniih.) Sa defeription. XIII. 784. a.
Ramier bleu de M.idag.tfc.tr, ( Ornii/i. ) Sa defeription.
XIII. 784. b.
Ramier des Moluques , deferiptions de cet oifeau. XIII.
784. b.
Ramier ven de ALidagjfcar. X l l l . 784. b.
RAMIRE 1 , roi d’Aragon , ( Hifl. iTEjpap^n. ) fils 8c fuccef-
feur de don Sanche le Gramî. Suppl. IV. 368. a. Hiftoire de
fa vie Sc de fon regne. Ibid. b.
Ramire I I , roi d’Aragon , ( Hiß. d'Efp.2pn. ) fils de Sanche
, roi d’Anigon 8c de F é lic ie, fucceifeur de fon frere
Alphonfe le Batailleur. Principaux événemens de fon regne.
Suppl. IV. 369. b.
Ramire 1 , roi d’Oviédo 8c de Léon , ( Hiß. d'E/pagn. )
fils de Vennoml 1 , 8c coufui du roi Alphonfe I I , fiirnom-
mé le Ch.iße, auquel il fuccéda. Principaux événemens d«
fon rogne. Suppl. IV . 370. a.
Ramire I I , roi d’Oviédo ôc de Léon , ( d'E/pagn.)
fils d'ürdogno I I , 8c frere d’Alphonfe IV , auquel il fuccéda.
Hiftoire de fa vie 8c de fon regne. IV . 370. b.
Ramire 1 1 1 , roi d’Oviédo 8c de Léon , ( Hiß. d’Efpagn. )
fils 8c fucceffeur de Sandie-le-Gios. Principaux événemens
de fon tcÿ\Q. Suppl. IV . 372. a.
R AM L E R , poète lyrique , allemand. Suppl. IV. 100. a.
R A M H E S , ou Ramnenfes ,{A n tiq . rom.) cfpcce de tribu
formée de chevaliers Romains. XIII. 783. rf. Un ancien poète
a ramaffé en quatre petits vers , que l’aiucur rapporte , toutes
les parties de la république, le peuple , les chevaliers ,
le fénat Sc les empereurs. Ibid. b.
R AM O LLISSAN T , ( Mat. Midlc. externe ) efpece de mé-
dicamens de ce nom. Deux fortes d’émolliens, fa v o ir , les
•anodins , 8c les réfolutifs. Matières d’où fe tirent ces
remedes. XIII. 783. /».Les émolliens relâclians ont la propriété
de rendre les fibres plus alongecs fans fc rompre.
Matières dans lefquelles cette vertu réfidc entièrement. Ob-
fervation fur leur ufage. Ouvrage à confulter. Ibid. 786. a.
R AM O TH , f/êv«, ( Géogr.Jdcr.) ville du pays de Galaad.
Evénemens qui la rendirent remarquable. IV . 372. u.
R AM P A N T , {C hir.) defeription 8c ufage d'un bandage
défigné par ce nom. XIII. 786. a.
Rampant , ( Blafon ) fe dit du chien 8c du lévrier. A u tres
animaux qui clans cette pofition font défignés par différentes
épithetes. Suppl. IV . 372. b.
Rampant, {B L jo n ) XIII. 786. b.
RAMPE d'efcalier, ( Archit. ) rampe courbe , de chevron ,
de mcniiifcrle , par reffaut. XIII. 786. b.
Rampe , terme de fortification , d'hydraulique 6: de jardinage.
Rampes de gazon. XIII. 786. b.
Rampe , plafond de rampe d'efcalier pour recouvrement
du dcltous des marches. V o l. VIII. des planch. Meniiiferie
en bàtimens. pl. 18. Rampe d’efcalier fur le plan ovale 8c
autre plafond, pl. 19. Rampes de ferrurerie, vol. IX des
planch. Serrurier, pl. n , 12.
RAMPEMENT, (P;^yAf)obfervations fur le r-ampemenc
des ferpens , des chenilles Sc des vers de terre. XIII. 787.*/.
R.impement du ferpent. X V . to8. b. Rampcmcnc des reptiles
, des v e r s , voye^ Mouvement progres.sif.
R AM S A Y , {Robert) anatomifte. 1 . 413. b.
R AM TR U T , ( Hiß. mod. Superß. ) divinité des Kanarins,
peuple de l’Indoftan. Honneurs qu’on lui rend. XIII.787. u.
R AM U L C O N C T A cn A fic ; mines de diamant. IV. 939. a.
RAMUS, (Pierre) Voyei RamÉe.
RAMUSIO , {Jean-Baptißc ) fecréiaire de h réjiubliquc de
Venife. X V II . 9.
R AN des vaches, {Mufiq ) Voye^ R an Z.
RANGÉ , ( Dom Arnumâ Jean le Buuthillier , abbé de )
obfcrvations l'ur fa vie. XVI. 366. h.
R A N C ID IT É ; pourquoi les médicamens huileux ne conviennent
point fur les parties attaquées d’infiammation. M.
Qiiefnay met la rancidité des Inimeins du corps humain au
nombre des effets que leur fermentation peut produite»
R A O
XIII. 787. b. Les luimeurs font infeftées Sc le folides dlver-
fement irrités par les corpufcules viciés qui font l’effet des
différentes dépravations qu’une jjonion des fluides contractent.
Caufe de la plupart des maladies des enfans clans la
rancidité que contrafte h partie butyreulè du lait dont ils
fe font nourris. XIII. 788. a.
Rancidité des alimens. I. 263. b.
R A N Ç O N , évaluation de la rançon de chaque prifonnicr
de guerre, eu egard à fon grade. XIII. -88. u.
R.tncon des prifonniers de guerre. XIII. 387. a, b.
R A N ÇO N N E E , ( Aimar ) übfervations fur ce favant Sc
fur fes malheurs. XII. 3 3 9 .it, b.
R A N D IA , ( Botan. ) arbriffeau d’Amérique. Son caraftere
dillinélif. Sa defeription. Lieux où il fe trouve. X lll. 788. b.
RAN D O N , ( Géogr. ) cliâccau neuf de Randon , lieu de
France en Gévaudan. Paroles du connétable du Guefelin ,
en mourant devant cette place. Honneurs que lui rendirent
le gouverneur de cette place, 8c les capitaines qui avoient
fervi fous fes ordres. Obfervations fur fa vie Sefur lès exploits.
XUI. 788. b. On peut confulter fa vie publiée par M.
du Châtelet en 1666. Paffage fort fmgulicr qui fait voir
(ju’anciennement les laies ont eu le droit d’aclminlftrer les
facremciis clans certains cas de ncceffité. Honneurs que le
roi de France Charles V . rendit à du Guefelin après fa mort. Tùid. 789.
R A N G , ( Hijl. mod. Moral. Jurifpr. ) Foye^ PRÉSÉANCE
6c PRESS'ÉANCE. Du rang dn clergé en diverfes clrconftan-
ces Sc Idon clifférens rapports. IIL 327. b. 328. a. C ’eft la
date de la création qui regie le rang entre les compagnies de
jiiflice.IV . 368. U. Des devoirs à l’égard des rangs & dignités.
.VL 38. U.
Ra n g , ( Art milit. ) doubler les rangs. A droite par demi-
file doublez vos rangs : comment fe fait ce mouvement.
XIII. 789. b.
Rang : comment les anciens Grecs formoient leurs rangs.
Suppl. IV. 313. a. Diftance des rangs du bataillon Sc des
hommes dans le rang. II. 133. h. Diftance des rangs clans
l’ordre de bataille Sc en marchant. IV , 1033. b. Nombre des
liommes clans le rang , Sc des rangs dans le bataillon. II.
Î33. b. Différentes méthodes pour augmenter ou diminuer
le nombre des rangs du bataillon. VI. 188. a , b. Rangs ferres
& ouverts. 170. a. Doubler les rangs. V . 80. b. VI. 1 7 3 .u,
b. Doubler Sc dédoubler les rangs de l’efcadron. V I . 200.
b.— les planch, de l’art militaire, volume 1.
R ang , ( Alarinc ) manière de diftmguer la grandeur
& la capacité des vaiffeaux de guerre. ConftruéHon des
vaUTeaux du premier rang , premier Sc fécond ordre ; des
vaiffeaux du i'econd rang , premier Sc fécond ordre ; des
vaiffeaux du iroifieme rang , divifés de même. Conftru-
(ftion des frégates depuis 32 jufqu’à 46 canons. XIII. 789.
b. Des frégates depuis 30 jufqu’à 32 canons, de celles de
28 à 30 , Sc de celles de 22 à 24. Petits bàtimens appelles
corvettes. Les bàtimens de charge fe diftinguent par le
nombre des tonneaux qu’ils portent. Flûtes de 600 on de
800 tonneaux. Nouvelle divifion propofée pour les vaiffeaux
du premier, du Iccond, 7 9 0 . a. 6c du troificme rang.
Six rangs de vaiffeaux en Angleterre. Difpofuions de l’ordonnance
de 1689 , fiir les divifions des vailïcaux. Ibid. b.
Rant;s des vaiffeaux. X V I . 804. b. 803, a.
R ANGÉ , Réglé , ( Synon. ) diff'érences dans Tufage 8c la
fignification de ces mots. XIII. 790. b.
Rangé , {Blafon. ) XIII. 791. a.
RANINES , ou ranulaircs, veines {Anatom .) veines de
ce nom fous la langue. Origine de leur lU'in. Artere ranu-
l.iire ou fublinguale. XIII. 791. a.— Foyc^ Suppl. II. 243. é.
R A N KW E IL , {Geogr.) bourg privilégié d’Alieiiiagne ,
dans la partie d’Autriche qui confine à la Sniffe. Refforedn
tribunal de jnftice dont i! cft le fiege. Suppl. IV. 373. b.
R A N T Z A U , ( Geogr. ) comté d'A llemagne , dans le
cercle de baffe Saxe 8c dans le Holftein. Son étendue. Nombre
de bourgs 8c villages de ce comté. Religion profeft'éc.
Comment il a paffé de la maifon de Ranir.au à la couronne
de Danemarck. Prodmftion du pays. Suppl. Y\’. 373. a.
R A N U L E , {Chir. ) tumeur qui vient fous la langue ; voyc^
Grenouillette. La faignée des veines ranules préconifée
par les grands maîtres de l'art dans les cas d’eiquiirancie. Mais
elle doit néceirairemcnt être précédée de la faignée au bras.
La faignée des jugulaires auroit les mêmes avantages que
celle des ranules. Pourquoi la pratique de faigner les rauu-
les cft aujourd’hui abfolumcnt négligée. XIII. 791, b.
R AN Z des vaches , ( Mujïq. ) art célébré parmi les Sniffes.
Suppl. IV . 373. a. Voycs;_ vol. V IL des pl. Mufiqiie , pl. 7.
R A O L CO N D E , en Afic. M'aies de diamant dans ce lien.
IV . 938. <7.
Ka G L J - , roi de Franc e, {H ifl. de F,~anc. ) ü\s Sc fiic-
çeffciir de Richard, duc de Bourgogne. Suppl. IV . 373. a.
Defeription de fon regne. Ibid. b.
Raoul de Prejîes : obfervations fur cet auteur 8c fur
fon ouvrage Je la cité Je Dieu. XL 946. a^ b.
RA P 559 RAOUX , {Jean) peintre. V . 322. b.
R A PAK IV I , {H iß. nat.) nom que les Suédois donnent
a une pierre qui fe trouve en Finl.mde, app--llée |)ar\Val-
Icrius Saxum mixtum fpathojum. Maniéré dont cette pierre fe
decompofe a l'air. Siibftances contenues dans cette pierre.
XIII. 792. a.
R A P E , {Arts méch.) manière de tailler les tapes. IX. 341. a. Rape du Icirurler. XVII . 830. a.
I IA P É , ( Æco/iü/«. rußiq.) raifin nouveau dont on emplit
le tiers dune tiitaille, afin d’y faire palier deffus du vin
gâté ou affoibli, pour lui donner de nouvelles forces. D cf-
cnprion de la maniéré de faire cette operation. XIII. 792. b.
Râpé de copeaux, {Econom. rußiq. ) râpé qui fe fait avec
des morceau.x de bois pour éclaircir le vin. Comment fe
fait cette opération, XIII. 793. a.
RAPERb W IL , {Géogr.) ville de Suifte. Ses révolutions.
Médailles romaines trouvées dans fon territoire. Hommes
de leitres nés à Rapevfwil. XIII. 793. a.
R A PH A Ë L , mc-iyraHd Ju Seigneur , {H iß. fa cr.) im des
f e p premiers anges qui font continuellement devant le
trône de Dieu. Soins qu’il prit du jeune Tobiç. Suppl.W .
373. b.
Raphael Sanzio , peintre célébré. V . 329. a , />. Ca-
raélerc des ouvrages de cet artifte. V IL 766. b. Perfeéliou
à laquelle il cft parvenu dans l’expreffion des carafteres.
Suppl. II. 229. b. Moyens par lefquels cet artifte atteignit la
perfeélion de fon m .SuppLÏW . 313. a , /».Défaut de coiluine
dans im de fes tableaux. III. 176. a. Tableau de Raphael
qui reprefente Attila , dont les projets font fufpendus par
l’apparinon de S. Pierre 8c de S. Paul. V . 982. a. Son tableau
défigné fous le nom de rnejfe du pape Jules. X. 400. b.
Tableau de ce peintre repréfentant la viiftoire de S. Michel
fur le diable. X V II . 246. a. Vierges de Raphael. 266. a.
übfervations fur un tableau de ce peintre à Duffeldorff.
Suppl. 1 . 303. b. Éloge de fon tableau de l’école d'Achenes.
Suppl. II, 229. b. Obfervations fur un de fes tableaux re-
préientant l’adoration des bergers. 383. b. Lieu oii fe trouvent
les cartons de cet artifte. VIII. 36. a.
R A PHAN A on RapLin, cé , ( Géogr. ) ville de la Dccapole
en Syrie. Connoiffancc que les peuples de ce pays eurent
des miracles de Jefus-Chi'ift. Médailles oil l’on voit repréfen-
tées les principales divinités des Raphanéens. Suppl. IV i 374.
R A PH AN U S , ( Bot. anc. ) nom que les Grecs domioient
au raifort, 8c les Athéniens au chou , comme il paroit dans
Thcophralle. Erreur où cette difference de fens a jetté Pline.
X ill. 793. b.
Raphanus , ( Bot. ) quatre efpeces de ce genre de plante
, le grand rond, le même à Heur blanche, le no ir, 6c
le petit des jardins. Leurs deferiptions. Leur ufage en cuifine,
XIII. 793. b.
RAPHELING , ( Trj/’/foÀ ) favant dans les langues orientales.
IX. 273. a.
RAPHIA , ( Géogr. ) roye^ Raphana.
R A PH ID IM , ( Géogr. facr. ) ftation des Ifraélites dans
le défère, qui n’étoic pas éloigné du rocher d’Horeb , où
Moife alla tirer de l’eau, übfervation fur ce paffage de S. Paul
I. Corint. X. 4. Bibebant de fpirituali, eos conjequente petrd.
XIII. 794. a. Le rocher de Raphidim cft décrit dans les nouveaux
mémoires des miffions des jéfiiites ; mais ce roclter
n’eft point le même que celui dont il eft parlé dans l’Exode.
XV II . 2. b.
RA PID ITÉ dans le chant, i'oyc{ DÉBIT.
R A P IN , {René) jéfuite, poète latin. XVI, 4 9t./>.
Rapin , {Nicolas ) poète. Suppl IV. 468. b.
RAPINE , ( Jurifpr. ) les Romains la diftinguoient du vol,
XVII . 439. b.
R A P PE L , {Jurifpr.) Rappel de ban. Rappc-I parboiirfe.
Rappel de caufe. Rappel de galeres. Rappel extr.i lerrnines
Rappel inlrà terminus. XIII. 795. a.
Lettres de rappel de ban, de rappel de galeres. IX,
427. a , b.
Rappel à fuccejfion : on en diftingue quatre fortes ; celui
qui fc fait dans le cas de l’exclufion coucumiere des filles
dotées, XIII. 793. a. celui qui fe fait dans le cas de la renonciation
expreffe des filles dotées, Ibid. b. celui qui répare
le défaut de repréfentation, 8c enfin celui qui releve
les enfans de l’exliérédation.//»/</. 796. 2. Ouvrages à conful-
ter. Ibid. b.
Rappel, ( M étaphyf) Du rappel de nospcrccptions, voye^
Evidence, Mémoire.
R A P PO R T , {Gramm.) Rapport vicieux. Il a lieu quand
un mot fe rapporte à un autre auquel il ne devroit point
fe rapjKirrer. Divers exemples de ces rapports vicieux. XIII,
796,/».
Rapport , ( Métaphyf ) voye^ Relation.
R.sPPORT, ( Géom.tÿ Arithm.)XlU.. 797. a.
Rapport. Dénominateur d’un r;ij)port. IV. 830. b. Rapports
géométriques, rapports arirhmétiques égaux. V . 413.
b. Rapport moyen qui réfult« d« la coptbinaifon de pluj'Ml
t' f,