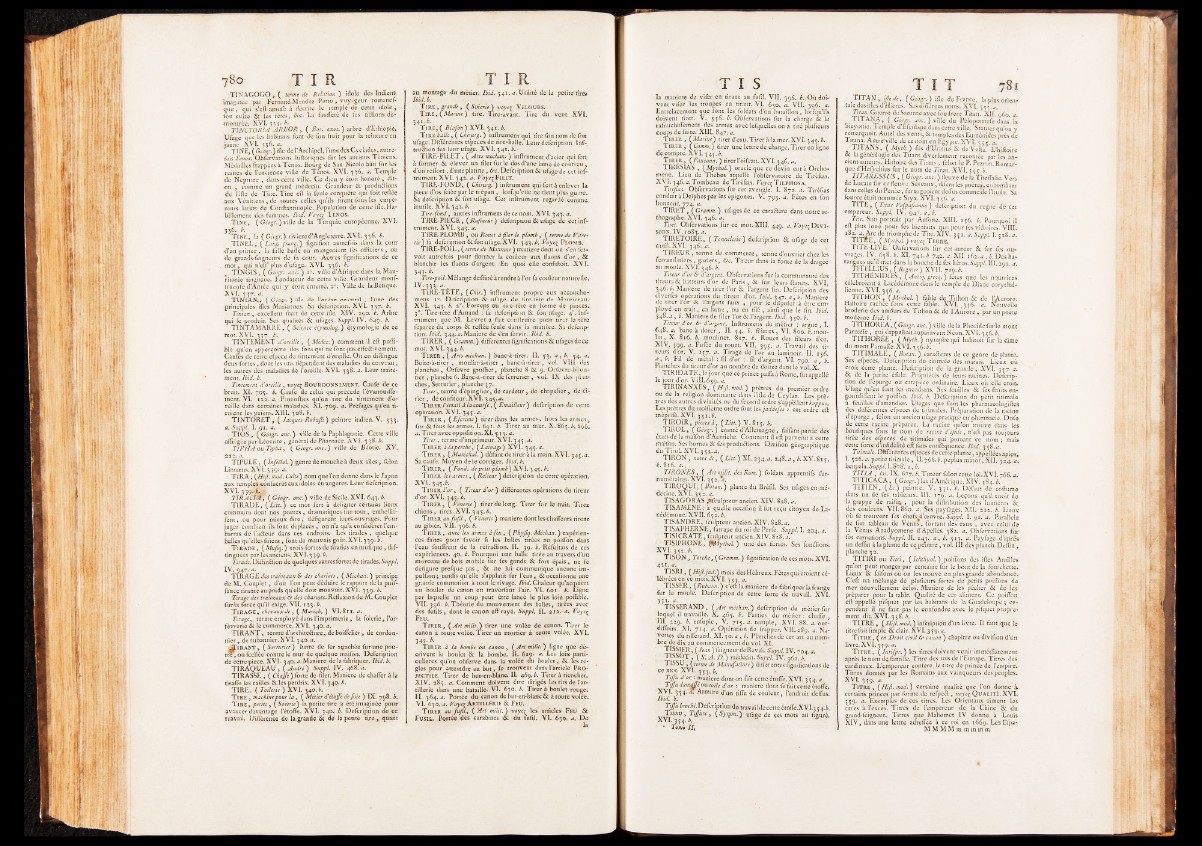
f ' m . t
■ ïiül
:':kk
780 T I R T I R
T ÎN A G O G O , ( terme de RcUùo.t ) idole des Indiens
înugince par Fernand-Mcndez Pinto , voyageur roinnnef-
que , qui s’s ll ainufc à décrire le temple de estts idole ,
lüii culte & Ces fêtes, Ôcc. La fuulîeté de les délions démontrée.
X VI. 335. !’ ■
TINCTORl^I ^-iRBOR ^ {B a t. «o r. ) arbre d'Etlnop-.c.
Ufage que les habitans l'ont de Ibn {'mit pour la teinture en
jaune. X V l. 336. .r.
TINE, {Gcoç,r. ) iAe de l’Archipel, Tune des C yclades, autrefois
Tenus. Oblerv.'uions liilloriques ftir les anciens Téniens.
Médailles frappées à Tenos. Bourg de San-Nicolo bâti fur les
ruines do I’aiicicnne ville de Tenos. X V l, 336. u. Temple
do Neptune , dans cette ville. Ce dieu y étoic honoré , tlic-
on , comme un grand médecin. Grajideur & prodnilions
de l'ifio de Tii;e. Tine eft la foule conquête qui fait reliée
aux Vénitiens, de toutes celles qu’ils firent fous les empe-
roiits latins de Conftantinoplc. Population de cette ifto. Habillement
dos femmes. !hiJ. Toye^ TiNOS.
T in e , ( Gfogr. ) v ille de la Turquie européenne. XVI.
33(5. l>.
T in e , la {Géogr.) Hvlered’Angloterre. X VÎ, 336. h.
T IN E L , ( I-ang. franc.) figuifioit autrefois dans la cour
d’un p iinc e , la falle balfe où mangeoiciit les olHciers , ou
de gr.auds-feigncurs de fa cour. Autres fignifîcritlons de ce
m o t, qui n’eü’ plus d'ufage. X V I. 336. b.
TIN G IS , ( Géugr. MIC. ) I". ville d’Afrique dans la Mauritanie
tingitane. Fondateur de cette ville. Grandeur moni-
irucufe d’Àntéc qui y étoit enterré, a'’. Ville de laBetique.
X V I . 337. m
TINIAN., ( Gi'o^r. ) ifte de l'océan oriental , l'une des
principales ifles Mariannes. Sa defeription. X V l. 337. b.
Tinïan , excellent fruit de cette iftc. X IV . aqo. h. Arbre
qui le produit. Ses qualités & ufages. Suggl. IV. 649. b.
T IN T AM A R R E , {Sckncc ètymuiog) étymologie de ce
mot. XV'I. 337 b.
T IN T EM EN T d'oreille, {Mcdcc.) comment il eft polft-
ble qu’on apperçoive des fons qui ne font pas elfeélivement.
Cailles de celte cfpece de tintement d’oreille. On en dillingue
deux forces , dont les uns dépendent des maladies du cerveau ,
les autres des maladies de l’oreille. X V l. 338. a. Leur traitement.
Ibid. b.
Tintement d'oreille , voyei' BOURDONNEMENT. Canfe de ce
bruit. XI. 703. b. Calife de celui qui precede l’évanouilTe-
mem. VI. i i a , a. Pvonoftics qu’on tire du tintement d’oreille
dans certaines maladies. XL 709. a. Préfages qu’en ti-
l'oient les païens. X l l l . 308. b.
T IN T O R E T , { Jacques Robtifi) peintre italien. V . 333.
a. Suppl. I. 91. J.
T IÜ S , {Géogr. anc.) ville de la Paphlagonie. Cette ville
aftîég:e par Léocrite , généra! de Piiarnace. a VI. 338. b.
fiPHAo\xTiphce, { Gèogr. anc.) ville de Béotie. XV .
TIPULE , {InfeBol.) genre de mouche à deux ailes, félon
Linnæiis, X V L 339. a.
T iR A , {Hijl.mod. Culte) nom que l’on donne dans le Japon
aux temples confacrés aux idoles étrangères. Leur defeription.
X V I. 339. b.
T IR A C IA , {Gèogr. atic.') ville deSicile.X VI. 643.è.
T IR A D E , {L it t .) ce mot fert à defigner certains lieux
communs dont nos poètes, dramatiques liir-toiit, embellil-
fent, ou pour mieux dire, défigurent leurs ouvrages. Pour
juger combien ils font déplacés, on n’a qu’à confiderer l’embarras
de l'aifreur clans ces endroits. Les tirades , quelque
belles qu’elles foient, fontde mauvais goût. X V I .339. b.
T ir a d e , {Mußq.) trois fortes de tirades en nuifique , dif-
tingnées par les anciens. X V I. 339. b.
Tirade. DiftinéUon de quelques autresfortesde tirades.
IV . 947. a.
T IR A G E des traine.tux & des chariots, ( Méchan. ) principe
de M. Couplet , d’où l’on peut déduire le rapport de la puif-
fance tirante au poids qu’elle doit mouvoir. X V l. 339. i.
Tirage des traîneaux & des chariots. Réflexion de M. Couplet
fur la force qu’il exige. VU . ii'^.b.
T ir a g e , chev.tuxde, ( Maréch. ) V I .8 1 1 . a.
Tirage, terme employé dans l’imprimerie , la foierie, l’or-
févrerie & le commerce. X VI. 340. a.
T IR A N T , terme d’architeélure, deboiflelier, de cordonnier
, de rubannier.XVI. 340. <î.
^'iR AN T , {Serrurier) barre de fer auachée fur une poutre
, ou fccllée contre le mur de quelque maifon. Defeription
de cette piece. X VI. 340. ir. Maniéré de la fabriquer. Ib 'id. b.
T IR A Q U E A U , {A n d r é ) Suppl. IV. 468.«.
TIRASSE , ( Chajfe ) forte de filet. Maniéré de chalTer à la
tirafle les cailles & le s perdrix. X V I . 340. b.
T lR E j ( Toilerie ) X V I . 340.t.
T ire , machine pour la , ( Métier efetoße de foie ) IX. 798. b.
T ire , petite, ( Soierie) la petite tire a été imaginée pour
avancer davantage l’étoffe. X V I . 340. b. Defeription de ce
travail. Différence de la grande ôc de la petite tire , quant
an montage du métier. Ibid. 3 41. «x. Utilité de la petite tire#
Ibid. b.
T ir e , grande, {Soierie) voyet^ VELOURS.
T ir e , ) tire. Tire-avant. Tire du vent. XVI.
T ire, ( .B/rf/on) X V I . 341.
T ire-^j //«- , ( Chirurg, ) inftrument qui tire fon nom de fon
ufage. DifFéreines efpeces de tire-balle. Leur defeription. Inf-
triiéiion fur leur ufage. X V I . 341. b.
T IRE-F ILE T , ( A n s méchan. ) infiniment d’acier qui fort
à former &c élever un filet fur le dos d’une lame de couteau,
d’im refl’o r t , d’une platine, &c. Dcfciiption & ufage de e u inftrument.
X V l. 34e. a. Filet .
T IR E -FO N D , ( Chirurg. ) inftrument qui fert à enlever la
piece d’os fciée par le trépan , lorfqu’elie ne tient plus guère.
Sa defeription & fon ufage. Cet inftrument regardé comme
inutile. X V L 342. b.
Tue-fond, autres infirumens de ce nom. X V I.3 4 3 .ii.
T IR E -P IE C E , {Rafneur) defeription & ufage de cet inftrument.
X V I . 343. a.
TIRE-PLOMB , ou Rouet à filer le plomb, ( terme de Vitrerie)
fa defeription&fon uCage.XVI. 343. Voye^ Plom b .
T IR E -PO IL , ( terme de Monr.oie ) maniéré dont on s’en fer-
voit autrefois pour donner la couleur aux flaons d’or , &
blanchir les flaons d’argent, En quoi elle confilloit. X V L
343-/ ‘
Tire-poil. Mélange demiiéàrendreàl’or fa couleur naturelle.
IV.333.iX.
T IR E -T Ê T E , {Chir.) inftrumcnc propre aux accouche-
mens. i". Defeription & iifige du tire tête de Muiiriccau.
X V I . 343. b. 2“. Forceps ou tire-tête en forme de pinces.
3°. Tire-tête d’Amand : fa defeription & fon ufage. 4‘'.ln f-
triimem que M, Levret a fait cnnftruire jiour tir.r la tête
féparée du corps & reftée feule dans la nïatiice. Sa defeription./
éii/. 344, U. Maniéré de s’en lèrvir. Ibid. b.
T IR E R , {Gramm.) dift'érentesfigiiificatiüiis& . iifagc.sdcce
mot. X V I. 344. b.
T irer , { Arts méchan.) batic-à-tirer. II. 53. a , b. 34. rf.
Boiie-à-tirer , moulin-à-tirer , banc-à-tircr , v o l V U l ries
planches, Orfèvre grofficr, planche 8 6c 9. Orfevre-bijoii-
tier , planche 6. Banc-à-tirer de ferrurier , vol. IX des planches,
Serrurier, plaiiclie 37.
Tirer, terme d’épinglier, de cardeur , de chapelier , de ci-
r ie r , deconfileur.X'Vl. 345.d.
TiRERl'émail à lacourje, { Emailleur) defeription de cette
opération. X V I . 343. a.
T ir e r , {EJ'crimc) tirerdans les armes, hors les armes,
fur & Ibus les armes. I. 6 y i. A Tirer au mur. X .8 65 .A8O6.
a. Tirer avec oppofition.XI. 3 1 3. a-
Tirer, terme d’imprimeur. X V I . 343. ii.
T irer à laperche, {Lainage) X'Vl. 343.-x.
T ir e r , {Maréchal.) défaut de tirer à la main. X V I . 343.iî.
Sa caillé. Moyen de le corriger. Ibid. b.
T ir e r , {Fond, de petit p lom b )W \ . b.
T irer les armes , ( Relieur ) delcription de cette opération.
X V l . 343-^.
T irer Tor, ( Tireur d’o r ) différentes opérations du tireur
d’or. X V L 343. A
T ir e r , ( Vénerie) tirer de long. Tirer fur le n-ait. Tirer
chiens, tirez. X V L 345./>.
T irer au fufd , ( Vénerie ) maniéré dont leschaiTeurs tirent
au gibier. V IL 396. A
T irer , avec les armes à feu , ( Phyfiq. Méchan. ) expériences
faites pour favoir fi les balles tirées au jioiffon dans
l’eau foiiffrent de la réfraélion. II. 39. A Réfiiltats de ces
expériences. 40. A Pourquoi une balle tirée au travers d’un
morceau de bois mobile lur fes gonds & fort épais, ne fe
défigure prefqtie pas , & ne lui communique aucune ini*
pullion; tandis qu'elle s’applatit fur l’eau, ficoccaftonne une
grande commotion à tout le rivage. /AA Chaleur qu’acquiert
un boulet de canon en traverfant l’air. VI. 601. b. Ligne
par laquelle un coup peut être lancé le plus loin poinble.
VII. 396. A Théorie du mouvement des balles, tirées avec
des fufiis , dont le canon eft rayé. Suppl, i l. 212. a. Voyc^
Feu.
T ir e r , { A n miüt.) tirer une volée de canon. Tirer le
canon à toute volée. T irer un mortier à toute volée. X V I.
345- b-
T irer à la bombe ou canon, { A n milit.) ligne que décrivent
le boulet & la bombe. IL 619- n. Les loix particulières
qu’on obferve dans la volée du boulet, & les regies
pour atteindre au but, fc trouvent dans l’article Pr o je
ct ile. Tirer de but-en-blanc. U. 469. A Tirer à ricocliet.
X IV . 283. a. Comment doivent être dirigés les tirs de l’artillerie
dans une bataille. V I . 630. A Tirer h boulet rouge.
II. 364. <7. Portée du canon de but-en-blanc6c à toute volée.
VI. 630. a. Péyfç A rtillerie 6c F eu.
T irer au fufil, {A r t milit.) voyet^ les articles Feu &
F usil. Portée dss carabines & du fufil. V I . 630. a. D e
T I S la maniéré de vifer en tirant au fufil. VII. 396. b. Où doivent
vifer les troupes en tir.int, VI. 630, a. VIL 396. a.
Enticlacement que font les foldars d’un bataillon, lorfqu’ils
doivent tirer. "V. 336. b. Obfervations fur la charge 6c le
rafraichifl'ement des armes avec Ufquelles on a tiré pinfieurs
coups de fuite. XIII. 847. .j.
T irer, (Manne) tirer d’eaii. Tirer îi la mer. X V I. 343. J.
T irer, {Comm.) cirer une lettre de change. T irer en ligne
d ccompcc .AVI. 343.^.
T irer , {Fauconn. ) tirerl’oifeau. X V L 346. a.
TIRÉSIAS , {Mythol.) or.acle que ce devin eut à Orclio-
jnenc. Lieu de Thebes appellé i’obfcrvatoire de Tiréfias.
X V I . 346,tf.Tombeau de Tiréfias. T ilphosa.
Tiréfias. Obfervations fur cet aveugle. I. 872. a. Tiréfias
conduit à D elphes par les épigones. V . 793. a. Fêtes en fon
honneur. 774. a.
TIRE’! ' , ( Gramm. ) ufages de ce caraftere dans notre orthographe.
X V L 346. a.
Tiret. Obfervations fur ce mot, XIII. 449. a. Voyer D ivision.
IV. 10S3. .7.
T IR E TO IR E , {Tonnclerie) defeription 6c iifao-e de cet
outil. X V L 346.
TIREUR , terme de commerce , terme d’ouvrier chez les
ferrandiniers , gaziers, &c. Tireur dans la fonte de la dragée
au moule. XVI. 346. é.
Tireur d’or & d'argent. Obfervations fur la communauté des
tireurs & batteurs d’or de Paris, 6c fur leurs ftatms. X V L
346. A Maniéré de tirer l’or & l’argent fin, Defeription des
diverfes opérations du tireur d’or. Ibid. 347, a , b. Manière
de 'tirer l’or 6c l’aigcnc faux , pour le difpofcr à être employé
en trait, en laine , ou en filé , ainfi que le fin. Ibid.
348. a , b. Maniéré de filer l’or 6c rargent. Ibid. 3 30. A
Tireur d’or 6- d’aigent. Inftrumens du métier : argue, I.
648. a. banc à dorer , II. 34. A filières, VI. 800. b. moulin
, X, 816. b. moulinet. 817. b. Rouet des fileurs d’or.
X IV . 399. a. Fufée du rouet. VIÎ. 393. a. Travail des tireurs
d’or. V . 137. a. Tirage de l’or au laminoir. IL 136.
a , A Fil de métal : fil d’or ; fil d’argent, VI. 790. a , A
Planches du tireur d’or au nombre de douze dans le vol. X.
T IR ID A T E , le jour que ce prince palTaàRome, fut appelle
le jour d’or. V ill. 639. a.
T IR IN AN X E S , {H f i . mod.) prêtres du premier ordre
ou de la religion dominante clans l’ifle de Ceylan. Les prêtres
des antres divinlcés ou du fccond ordre s’appellent koppus.
Lesprétres du trolficme ordre font les jaddefes : cet ordre eft
méprifé. X V I . 3 31. A
T IR O IR , pieces à , {Lite.) V . 813. A
T IR O L , {Géogr.) comté d’Allemagne , faifant partie des
états de la maifon d'Autriche. Comment il eft parvenu à cette
maifon. Scs bornes 6c fes produftions. Divifion géo'’ raphiqiie
t lu T iio l. XVI.332 .rf. O a < 1
T IR O N , notes de, ( L in .) XI. 234.rf. 248. a , A X V . 81 3.
T IR O N E S , { A n milit. des Rom.) foldats apprentifs fur-
numéraires. XVI. 3 32. rf.
T IR O Q U I , ( Botan.) plante du Bréfil. Ses ufages en médecine.
X'Vl. 332, rf,
T 1S.A.GORAS »«fculptenr ancien. X IV . 828. a.
TISAMENE : à quelle occafioti il fut reçu citoyen de Lacédémone.
XV U. 63 2. b.
T ISAN D R E , fculptenr ancien. X IV . 82S. a.
TISAPHERNE, fiitrape du roi de Perfe. Suppl. I. 204. a.
T I S IC R A T E , fculpreur ancien. XIV. 828. a.
TISIPHON E, ) une des furies. Ses fonélions.
X V I . 332, A
TISON , Torche, {Gramm. ) fignification de ces mots. XVI.
421. rf.
T I S R I , {Hfi.jud.)mo\% desHébreux. Fêtes qui étoient célébrées
en ce mois.XVL 333. a.
TIS SE R , {Ruhanri.) c’eft la maniéré de fabriquer la frange
fur le moule. Defeription de cette forte de travail. X V l.
33t. rf.
TISSERAND , ( A n médian. ) defeription du métier fur
lequel il travaille. X. 463. b. Parties du métier : chaft’e ,
III. 229. A enfuple, V. 713. a. temple, X V L 88. a. oiir-
diffoirs. XI. 714. rf. Operation de frapper. V IL 289. a. Navettes
du tiflciaml. XL 30. a , />. Planclies de cet arc au nombre
de dix au commencement du vol. XL
TISSIER, {Jean ) fcigncur dcRavifi. Suppl. IV. ^04. a.
îlwcU; ^ ^ ^“rrr iv. ^6i. 1 IbbU , Uerme de MantifaÜtire) Qifterentes lignifications de
ce mot. X V l. 3^3.
Tfiu d or : manière dont on fait cette étoffe. X V I. 334. a.
Tifiiidamajféoatoile d'or : maniéré dont fe fait cette étoffe.
X V L 334. a. Armure d’iin liffu de couleur, l'endroit deffus.
Ibid. b.
T [fil iroc/;/. Defeription du travail de cette étoffe.X\T.334.A
ufage de ces mots au figuré.
A V I . 334. A
T I T 781
T I T A N , ifiede, {Géogr.) ifle de France, la plus orientale
des ifics d’Hieres. Ses différens noms. X V L 3 33, ,1.
Titan. Gâteri e de Saturne avec fonfrere Titan. XII. 960. a.
T IT AN A , ( Géogr. anc. ) ville du l’cioponnefe dans la
oicyonie. Temple d’Êlculape danscette ville. Statues qu’on y
i^tiiarquoit. Autel des vents, 6c temjiles des Euménides près de
Titana. Autre ville de ce nom en Egypte. X V L 333. .7.
T IT A N S , ( Myth.) fils d’Uranus 6c de VelVa. L’hiftoirc
cc la généalogie des Titans diverfement racontée par les anciens
auteurs. Hiftoire desTnaii- , felon le P. Pezron. Remarque
d’Hefychius fur le nom de Tiun. X V l. 3 3 5. A
TJTARESSL/S , { Géogr. rf/7c. ) fleuve de la Theffalie. Vers
de Lucain fur ce fleuve. Se.scaux, difenc les poètes, en tombanr
dans celles du Penée, fiirnageoient deffus comme de l ’Iuiiic. Sa
füurce étoit nommée Styx, X V L 336, a.
T I T E , {Titus Vefpajianus ) defeription du regne de cet
empereur. Suppl. IV. 94-. a, b.
Tite. Son portrait par Aiifone. XIII. 136, b. Pourquoi il
eft plus loué pour fes bienfaits qii : pour fes viftoires. VIII.
182. rf. Arc de triomphe de Tite. X IV . 331. u. Suppl. I. Ç28. a.
T I T É E , ( Mythul. ) voye^ T erre.
TITE-L IVE. Obfervations fur cet auteur 6c fur fes ouvrages.
I\fi 638. b. XL 741. é 742. U. XIL 161. a , b. Des harangues
qu'il inet dans la bouche de fes hèros.Siipvl. 111.201 a.
T lT E L L IU S ,_ (Â o ;„ .r ) X V I I .7 t9,A
T ITH É N iD lE S , {Annq. grecq.) têtes que les nourrices
célébroicm à Laccdéinone dans le temple de Diane coi vthal-
lienne. XVI. 336. a.
T I T H O N , {Mythol. ) fable de Tiihon 5c de l’^Aurore,
Hiflüire cachée fous cette fable. XVI. 336. a. Nouvelle
broderie des amrfurs de Tithon 6c de l’Aurore , par un poète
moderne Und. A
T ITH O R E A , ( Géogr. anc. ) ville de la Phodde furie mont
Pamaffe , qui s’appelloit auparavant Néon. X V i. 336.
TITH Û R É E , {M yth.) nymphe qui habicoit fur la cime
du mont Parnaffe.XVI. 336.^.
T IT IM A L E , {Botan.) carafteres de ce genre déplanté.
Ses efpeces. Deteriprion du titimalc des marais. Lieux où
croit Cette plante. Defeription de la grande, X V L 337-rf.
& de la petite éfiile. Propriécé-s de leurs racines. Deferip-
tion de l’cpurge ou catapuce ordinaire. Lieux où elle croit.
Ufage qu’en font les mcndians. Ses feuilles 6c fes fruits en-
gourdiifent le poiflon. Ibid. b. Defeviption du petit tltimale
à feuilles d’amandier. Ufages que fo r t ie s pharmacologifies
des différentes efpeces de ii:im:iles. Préparation de la racine
d’épurge , félon un ancien ufage pratiqué en pharmacie. D ofe
de cette racine préparée. La racine qu’on trouve dans les
boutiques fous le nom de racine d'éjule, n’ell pas toujours
tirée des efpeces de titimales qui portent ce nom 3 mais
cette forte d’infidélité eft fans cnnl'équencc. Ibid. 3 38..2.
Tltimale. DWérentcs efpeces de cette plante, appdlées apips,
1.326. rf. petite tltimale , IL 766. A peplus minor, .XII. 3 24.' a,
benpala.5/7/7/)/. 1. 878. a, b.
T IT IA , loi. IX. 677. A Tuteur felon cette loi. X V L 766. rf.
T I T IC A C A , ( Géegr.) lac d’Amérique. XIV. 384. é.
T IT IE N , (L e ) peintre. V. 331. b. Defaut de coftume
dans un de fes tableaux. 111. 176. ./. Lettons qu’il tlroit de
la grappe de raifiii , pour la cliftribiition des lumières 6c
des couleurs. VII. 860. rf. Scs payfages. XIL 212. h. Lieux
où fe trouvent fes chefs-d'oeuvre. 5///)/)/. 1, 91. a. Parallele
de fon tableau de Vénus , fortant des eaux , avec celui de
la Vénus Anadyomene d’Apeilcs. 382. a. Obfervations fur
fes carnations. 5k/)/)/. II. 243. a , b. 313. a. Payfage d’après
un defiîn à la plume de ce pe’intre , vol. 111 des piancli. Deffln ,
planche 3 2.
T IT IR I ou Tari, {Ichthyol.) poiiTons des iftes Antilles
qu’on peut manger par centaine fur le bout de la fourchette.
Lieux 6c faifons où on les trouve en plus grande abondance.
C ’eft un mélange de plufieurs fortes de petits poifl'ons de
mer nouvellement éclos. Manière de les pécher 6c de les
préparer pour la table. Qualité de ect aliment. Ce poiffon
eft appellé pifquet par les habitans de la Guadeloupe ; ce pendant
il ne faut pas le confondre avec le pifquer proprement
dit. X V L 338. A
T I T R E , ( ///J/./no./. ) infeription d’un livre. Il faut que le
titre foit Ample 6c clair. X V I . .339. j .
T itre , ( en Droit civil & canon ) chapitre ou divifion d ’un
livre. X V L 339. a.
T itre, {Jurifpr. ) les titres doivent venir immédiatement
après le nom dq famille. Titre des rois de l’Europe. Titres <les
cardinaux. L’empereur conféré le titre de prince de l’empire.
Titres donnés par les Romains aux vainqueurs des peuples.
XVI. 339.
T itr e , {Hiß. mod.) certaine qualité que l'on donne à
certains princes par forme de rcfpcét, ropeç Q ualité. X V I .
339. rf. Exemples de ces titres. Le.s Orientaux aiment les
titres à l’excès. Titres de l’empereur de la Chine 6c du
gr.md-feigncur. Titres que Mahomet IV donne à Louis
X IV , dans une lettre adrefl'ée à ce roi en 1669. Les Efpa-
M M M M m ni m m m