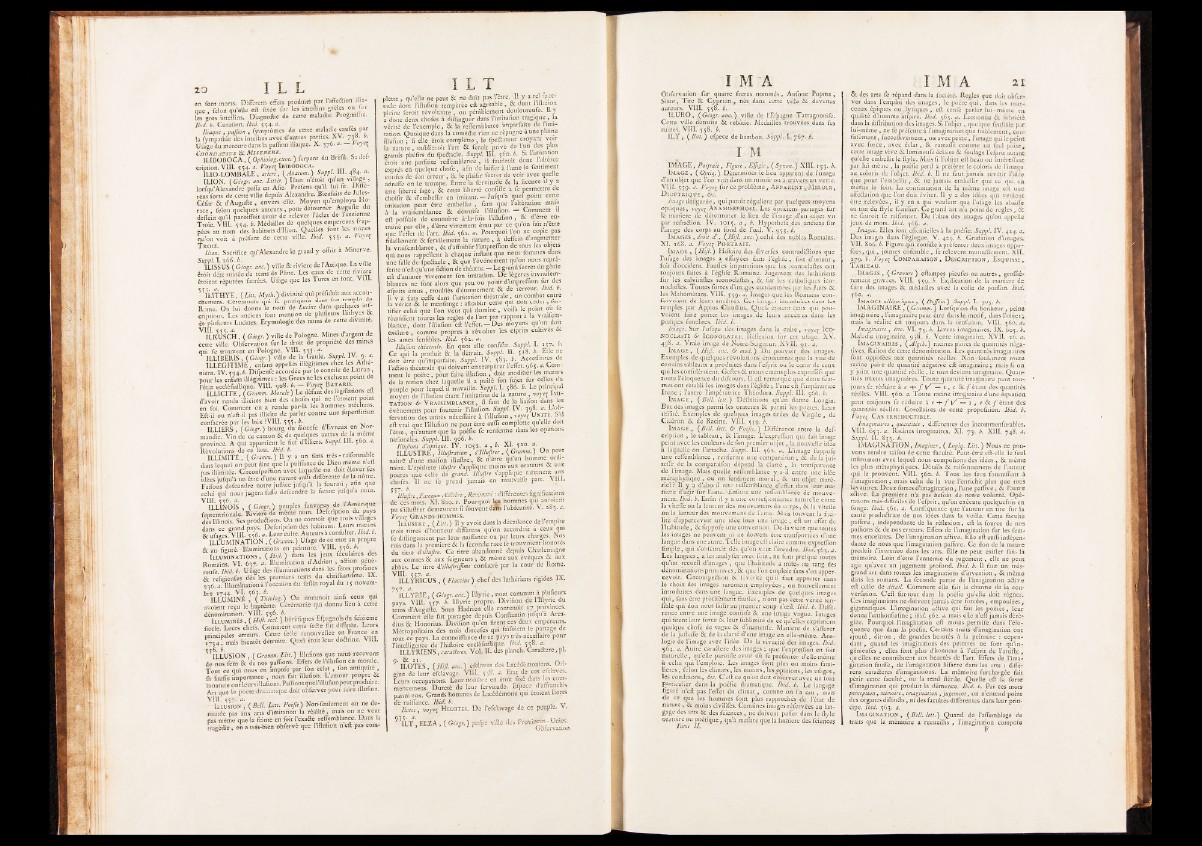
20 ILL cn font mons. DnErens effets produits pst VafFçaion ilE-
qoe , felon tlii'elle eif fixée fur les inicftms grêlés ou lur
les gros liitellins. Diagnoftic de cette maladie. Ptogiioltic.
lh:J. b. Curation. IbiJ. 5>;4- r»' , rlÜa^
ni , paffion , lyniptômcs tic cette maladie canies par
U fymputhic des imcilms avec d'autre.s pt^ties. X V . 73b. i>.
U û g c du mercure dans la palTion iliaque. X. 376. u. — i
Chorvapsus Si. Miserere. , n c \ c
l l lB O B O C A , {Ophiolog.cxoï.) ferpent du Brefil. badel-
cription. V m . 5<;4-‘ï- q
ÎL IO -LOM B A LK , arUn, {Àn^tom.) SuppL 111. 4«4- '?•
ILIÜN. (Giogr. anc. Liner. ) Ilicm n’étwi qu un village ,
lorlqu’Alexandrc paffa en Afie. Prefens qu'il lui ht. J Jitte-
rens ibrts de cette v ille depuis Alexandre. Bienfaits de Jules*
Céfiir & d’Augu fte , envers elle. Moyen qu employa Hora
c e , félon quelques auteurs , pour détourner Augultc üu
delTein qu’il paroilfoit avoir de relever l’eclat de 1 ancienne
Troie. V llI . <<;4- b. Médailles de quelques empereurs trap-
pées au nom des habitans d’Ilion. Quelles loin les ruines
qu’on voit à préfent de cette ville. Ibid. 333. J- J'oyci^
lUon. Sacrifice qu'Alexandie le grand y oftnt a Minerve.
Suppl.1 . 266. b. , . T '11
ILISSUS ( Geogr. anc. ) ville & rivicre de 1 Atcique. La ville
étoit déjà ruinée du tems de Pline. Les eaux de cette '■ 'vicre
étoient réputées facrées. Ufage que les Turcs en font. V i l l .
^^ILITHYE, {Lin. Myth.) divinité quiprcfidolt auxaccou-
chemens. Cérémonie qui fe praiiquoit dans fon temple de
R imc. On lui donne le nom de Lucine dans que ques iiil-
crioiions. Les anciens font mention de plufieurs U
de plufieurs Luciiies. Etymologie des noms de cette divinité.
ILKUSCH , ( Gcegr. ) ville de Pologne. Mines d’argent de
cette ville. Obfervation fur le droit de propriété des mines
qui fc trouvent en Pologne. VUI.
ILLTBERIS, (Giogr.) ville de la Gaule. Suppl. IV. <). a.
IL L ÉG IT IM E , enfans appelles ülégitimes chez les Athéniens
IV. CU4- L Difpenfe accordée par le concile de Lairan ,
pour les enfans illégitimes ; les Grecs ne les excluent point de
l’état eccléfuiftique. V l l l . 908. b. — n
ILL ICITE , ( Gramm. Morale ) Le defaut des legiüations clt
d’avoir remiu’ illicites bien des chofes qui ne l’étoient point
en foi. Comment on a rendu par-là les hommes niechrms.
Eft'il ou n’efi il pas illicite de parler contre une luperllirion
confacrée par les loix ?V11I. 333. L
ILLIERS {Giogr.) bourg du diocefe dEvreux en Normandie.
Vin de ce canton Si de quelques autres de la même
province. A qui appartient le fief d Illiers. Suppl. HL 360. a.
Révolutions de ce lieu. Ibid. b. , , ui
IL L IM IT É , i^Gramm.) Il y a un fens t rè s -radonnable
dans lequel on peut dire que la puilTance de Dieu même n eft
pas illimitée. Circonfpeaion avec laquelle on doit e ever fes
idées iufqu’à un être d’une nature aulTi difrcrcme de la nuire.
FaifoéS défcentlre notre juIUce jiifqu’à la fourmi , atin que
celui qui nous jugera fafPe defcencire la lienne jufqii a nous.
'" 'Il l IÏTOB , (C c o g r.) peuples fauvapes de l'Amérique
fentcntrionale. Riviere de même nom. Defcnpiion dit pays
des Illinois. Ses produaions. Ou ne connoit que trots villages
dans ce graitd pays. Dcfcripilon des Itabttans. Leurs nioeurs
Seufaees VIII Sîd. m Leur culte. Auteurs aconfiiltc r./M. i.
ILLUMINATIO N , ( G,.,m,n. ) Ufage de ce mot au propre
& a u figuré, lllumitiafions en peinture. V l l l . 556. ».
iLLufilNATlONS. ( Â / l. ) dans les jeux feculatres des
Romains. VI. 637. a. Illumination d Adrien aaion gene-
reuie. Ibid. b. Ufage des illummauons dans les fetes profanes
& relivieufes dès les premiers tems du chnlhanilme. lA.
236.u.'^llluminationàl’occafioii du tefiinroyal du 13 novembre
1744- Y I . 3^3" . . r
ILLUMINÉ {Thioloz-) Dn nommoit ainli ceux qm
avoient reçu le’ baptême.'Cérémonie qui donna lieu à cette
dénomination. V lü . 336. L 1 . /-• •
ILLUMLVÉS , ( Hiß. eccl. ) hcretiques Efpagnols du feizieme
fiecle. Leurs chefs. Comment cette leRe fut difiipee. Leurs
principales erreurs. Cette fecte renouvellee en France en
1734 , mais bientôt détruite. Quel ctoitleur dcftrme. V l i l .
^ ^ Il l u s io n , r Gramm, u n . ) Illufions que nous recevons
de nos fens & de nos paffions. Efiéts de nUiifion en morale.
To ut ce qui nous en impoie par fon éclat , Ion antiquité ,
fa fauffe importance , nous fait illufion. L’amour propre Si
la nature ont leurs illufions. Paffions que l’illufion peut produire.
Arc que le poète drai.'.auque doit oblerver pour iaire illuhon.
L n jS io / i {Bell. Lett. Poéfte) Non-feulement on ne demande
pas aux arts d’imitation la réalité, mais on ne veut
pas même que la feinte en foit l’exaae reflemblance. Dans la
rriigédie, on a très-bien obfervé que rillufion n’eft pas coin-
I L T plette , qu’elle ne peut Sc ne doit pas I être. I! y a tel ip-C-
tncle dont l’illufion tempérée eft agréable , & dont hllulion
pleine feroit révoltante, ou péniblement douloureufe. ü y
a donc deux chofes à cUftlnguer dans l’imitation tragique
l’exemple, & la refTemblance imparfaite de L
la
ration. Quoique dans la comédie rien ne répugne à une pleine
illuhon ; fi elle étoit complettc , ie fpeftatcur croyant voir
la nature, oublieroir l’an & leroit privé do l’vin des plus
grands plaifirs du fpeftacle. Suppl. I lL 360. /.-. Si limnimon
étoit une parfaite reffemblance , il tuudroir donc 1 altéré,
exprès en quelque diofe , afin de laiffcr à l’ame le feiuiment
confus de fon erreur, & le plaifir fecvct de voir avec quelle
adrdfe on le trompe. Entre la fèrvitude & la licence Ü y a
une liberté fage , Si cette liberté confifte à fc permettre de
choifir 5c d’embellir en imitant. - Jufqu’à quel point ceuc
imitation peut être embellie , fans que l’altération mule
à la vraifemblaiice & dètruife rillulion. — Comment u
eft poffible de connoître à-la-fois I’iUufion , & ^ etre entraîné
par e lle , d’être vivement ému par ce qu on ia itne tre
que l’effet de l’arr. Ibid. 361. a. Pourquoi l’on ne copie pas
hdellement Sc fervileinent la nature , à defteiii d augmenter
la vraifemblance, Si d'affoiblir l’impreffion de tous les objets
qui nous rappellent à chaque inftant que nous fommes dans
une làlle de fpedacle , & que l’événement qu’on nous repre-
fentc n’eft qu'une fiiftion de théâtre. — Le grand fecret au gy'he
eft d’animer vivement fon imitation. D e légères invrailem-
blances ne font alors que peu ou point d’imprcfiion
el'prits émus , troublés d’étonnement Si de terreur. Ibid. b.
11 y a fans celîé dans l’imitation théâtrale, un combat entre
la vérité &. le menfonge : affoibllr celle ifonge qui doit cede r, tortifier
celui que l’on veut qui domine ,
oilà le point où le
réunilïcnt toutes les regies de l'art par rapport
rraifemblanceV
dont l'.llufion"eft l'effet.—'Des moyens qu'on doit
exclure , comme propres à révolter les elprics cultives e '
les âmes fenfibles. Ibid. 362. a. , t u
lilunon théâtrale. En quoi elle confifte._Sa;i^/. 1. i_37-
Ce qui la produit & la détruit. SuppL IL 318. b. Elle ne
doit être qu'imparfaite. Suppl. ÏV . 383. L Acceffoires c
l’aftion théâtrale qui doivent en tempérer l’cfiet. 963. a. Comment
le poète , pour faire illufion , doit modifier les moeurs
de la nation chez laquelle il a puifé fon fujet fur celles clu
peuple pour lequel il travaille. Suppl, l. 386. b. Le principal
moyen de l’illufioii étant l’imitation de la nature , voyei Imitation
6- V raisemblance, il faut de la liaifon dans^ les
événemens pour foutenir rillufion. Suppl. IV . 398. a. *
fervatioii des unités nécelTaire à l’illufion , voye^ L nite. e ii
eft vrai que l’illufion ne peut être aulTi complettc qu elle doit
l’ètre , qu’autant que la poéfie lé renferme dans les opinions
nationales. Suppl. III. 906. b.
Illufions d'optique. IV . 1032. a , b. XI. 320. a.
IL LU ST R E , Jllußration, sllluflrer, {Gramm.) On peut
naître d’une maifon illuftre, & n’ôcre qu’un homme ordinaire.
L’énirhete illujbe s’applique moms aux orateurs ÖC aux
poètes que celle de grand. Iltußre s’applique raremetit aux
chofes. il ne fe prend jamais en inauvaiic pan. V i l l .
!lluûre,Etm~u.x .Cclcb. c , Renommé : dift'érentes figiufications
de ces mots. XL 800. b. Pourquoi Içs hommes qm ^auroient
pu s'illuftrer demeurent fi fouvent dafts I’obfcuritc. X . 2S3. a,
Voyer G r .'iNDS-HOMMES.
Illustre, {L in .) 11 y avolt dans la décadence d e l empire
trois titres d’honneur différons qu’on accordoit à ceux qui
fe diftinguoieni par leur naiffancc ou par leurs charges. Nos
rois dans la premiere & la fécondé race le trouvoient honores
du titre S'illußre. C e titre abandonné depuis Charlemagne
aux comtes & aux feigneurs 3 Si même aux évêques & aux
abbés. Le titre d'Hluflnfme confacré par la cour de Kome.
VIII. 337. • , . . , TV
ILL YRICU S , ( Flaccius ) chef des luthériens rigides. IX.
^"’ iL L Ÿ R lE , ( Géogr.anc.) Illyv ie , nom commun à plufieurs
pays V i l l . 337. b. lllyrie propre. Divifioii de l’IUyne du
tems d’Augtifte. Sous Hadrien elle contenoit 17 provinces.
Comment elle fut partagée depuis Conftantin julqu a Arca-
dius Si Honorius. Divifioii qu’en firent ces deux empereurs.
Métropolitains des trois diocefes qui fiufoient le partage de
tout ce pays. La connoiffance de ce pays très-néceflairc pour
l’intelligence de l’hiftoire eccléfiaftique. Ibid. 538. -r.
IL L YR IEN S , caraüeres. V o l. H- des planch. Caractère, pi.
^ ILO T E S , {H iß . anc.) efclaves des Lacédémoniens. Origine
de leur efclavagc. VIII. 338. a. Etat de ces ciclaves.
Leurs occupations. Leur nombre en étoit fixe dan.s les com-
mencemens. Dureté de leur fervitude. Efpecc d aftranch.s
parmi eux. Grands hommes de Lacédémone qui ecoient Ilotes
de naiffance. Ibid. b. , , \r
Ilotes, voyei Helotes. D e l’efclavage de ce peuple. V.
.1
i'i s i
I M A
933
IL T , ELZA , ( Géogr. ) petite ville des Provinces-Unies.
Obfervation
Obfervation fur quatre frères nommés, Aiifoiie Popma ,
Six te , Tite Si Cyprien , nés dans eeitc ville éc devenus
auteurs. VU I. 338. b.
ILU R O , {Géogr. anc.) ville de l'Efpagne Tarragonoifir.
Cette ville détruite Si rebâtie. .Médailles trouvées dans fes
ruines. V i î l . 338. b.
I L Y , {B o t.) efpece de bambou. Suppl. I. 767. b. I M
IM A G E , Portrait, Figure, Effigie, {Synon.) XIII. 133. b.
Image , ( Optiq.) Détenniner le lieu apparent de rimnge
d'un objet que l’on voit dans un miroir ou à travers un verre.
V i i f . 359. .î. Foyei fur ce problème. A pparent, Mir oir ,
D ioptrique , 6‘ c.
Jm.igc défigurée, qui paroît régulière par quelques moyens
opiiques, veyr^ A namorphose. Les opticiens partagés fur
la maniéré de déterminer le lieu de l’image ,d’uii oiijet vu
par l'cfraélion. IV . 1013. a , b. Hypothefe des anciens fur
l ’image des corps au fond de l’oeil. V . 933. b.
Images , droit d’ , {Nijl. anc.) celui des nobles Romains.
X L 168. a. Foyci PORTRAIT.
Image , {H ijl.) Hiftoire des diverfes contradiftions que
l’ufage des images a elfuyées dans l’églilè , foie d’orient ,
l'oit d'occident. Fauffes imputations que les iconoclaftes ont
toujours faites à l’églife Romaine. Jugement de% Uiihériens
lu t les calviniftes iconoclaftes, Sc fur les catholiques iconoclaftes.
Toutes fortes d’im.iges condamnées par les Juifs Si
les Mahometans. VIII. 539. a. Images que les Romains eoii-
fcrvüicnt de leurs ancêtres. Ce> images introduites dans les
temples par Appius Claudius. Quels étoient ceux qui pou-
Voient faire porter les images de leurs ancêtres dans les
ponqies funèbres. Ibid. b.
Image. Sur l’iifiigc des images dans le culte , voye^ ÎCO-
HOCLAsTE dÿ Ico.nolatre. Uéiîexioii fiir cet ufage. XV.
498. J. Vraie image de Notre-Seignuir. X V IL 91. a.
l.MAGE , {H ijl. .me. & mod.) Ou pouvoir des images.
Exemples de quelques révolutions étonnantes que la vue de
certains tableaux a produites dans l’efpric ou le coeur de teux
qui les conficléroient. Geftes ék mouvemens plus expreiîiR que
toute l’éloquence du difeours. 11 eft remarqué que deux femmes
ont rétabli les images dans l’églife 3 l’une eft l’impératnee
Irene 3 l’autre l’impératrice Theodora. Suppl. III. 366. b.
l.MAGE, {B ell. Un.) Délinitious qu’en donne Lo.igin.
But des images parmi les orateurs Si p.irmi les poètes. Leiir
luiüté. Exemples de quelques images tirées de Virgde , de
Cicéron ck de Racine. VUI. 339. b.
l.MAGE, {Bell. Un. & Poéfu.) Différence entre la def-
cripàon , le tableau , & l’image. L ’exprclfion qui fait image
peint avec les couleurs de fon premier o i j e t , la nouvelle idée
à laquelle ou l’attache. Suppl. III. 362. a. L'image fuppofe
une reffemblance , renferme une comparaifon 3 Si de la ju(-
iclTe de la comparaifon dépend la clarté , la tranTparence
de l'image. Mais quelle relicmblance y a-il encre une idée
ïiiétaphyfiqne , ou un fentimerit moi a l , & un objet niaté-
j i e l? Il y a d’abovd une relTcmblance d'effet dans eur maniéré
d’agir fur l’ame.''Eiifuùe une reffemblance de mouve-
nieiit. Ibid. b. Enfin il y a une correfpontlanee naturelle entre
la viteffe ou la lenteur des mouvemens du ci rps, & la vitelle
ou la lenteur des mouvemens de l’..n;e. Mi.is Ibuvcnt la f.ict-
lité d’appercevoir une idée tous une image, eft un efi'et de
l'habitude, 6cfuppofe une convention. De-làvient que toutes
les images ne peuvent ni ne doivent ètie tranfportées d’une
langue dans une .nitre. Te lle image cil claire comme exprelfion
fimple, qui s’o'ufcurcit dès qu’un v .uc i’étendre. Jbiaf-^S-^. a.
Les langues, à les analyfer avec fi in , ne font preique toutes
qu’un recueil d'images, que I h-ibiiiide a miles au rnn<^ des
dénominations primim es. Si que l’on emploie fans s’en apper-
cevoir. Circompcéhon 6e fiv e ritt qu'il fimt apporter dans
le choix des images niremeiu employées, ou nouvellement
introduites dans une l.mguc. Exemples de quelques images
q u i, fans être préciféinent faufi'cs, n’ont pas cetie vériié len-
fible qui doit nous faifir au premier coup d'oeil. Ibid. b. Différence
entre une image contiile Si une image vague. Images
qui tirent leur force 6c leur fiiblimité de ce qu'elles expriment
quelque chofe de vague & «riiiimenfe. Manière de s’alfurer
de la juftelfe Si de h clarté d’une image en elle-même. Analogie
de l'im.ige avec l’idée. De la vivacité des images. Ibid.
564. a. Autre cariiélere des images 3 que l’cxpreffion en foit
naturelle, qu’elle paroiffe avoir dû fc préfenter d’eilc-méme
à celui qui remploie. Les images font jilus ou moins familières
, filon les climats, les moeurs, les ppinions, les ufai^cs
les conditions, €,x. C e ll ce qu’on doit obfirver avec un loin
fiarriculier dans la poéfie dramatique. Ibid. b. Le langage
figuré n’eft pas l’effet clu climat , comme on l'a cru , mais
de ce que les liommes font plus rapprochés de l'éiat de
nature , 6c moins civilifés. Certaines images rcfci vées au langage
des arts & des i'ciences , ne doivent paffer dan.s le ftyle
oratoire ou poétique , qu'à mcfurc que la lumière des fciciices
Tome II.
I M A 21 Sc (les arts fe répand dans ia fociétc. Regies que doit ob firv
er dans l’emploi des im.iges, le poète qu i, dans les morceaux
épiques ou .ly r iq u es , eft cenfé parler lui - même en
qualité d homme inipiré. Ibid. 363../. Economie Si lôbriété
dans la diftribution des images. Si l’ob jet, quoique feiifible par
lui-même , ne fe préfinte à l'imagination que foiblcment, coii-
lulcment, fucccirivemem , ou avec peine, l’image qui le peint
avec fo rce , avec é clat. Si ramaft'é comme un feul point,
cctce image vive Si. lumiiieufi éclaire Si foulage refprit autant
qu’elle embellit le ftyle. Mais fi l'objet eft beau ou iiuéreli'aiit
par lui-même , la poéfie perd à préférer le coloris de l'image
au coloris de l’objet. Ibid. b. Il ne faut jamais revêtir l’idée
que pour l’embclür, Si ne jamais embellir que o . qui en
mérite le foin. La contiintation de la même image eit une
affccbiiüii que l’on doit éviter. Il y a des idées qui veulent
être relev ées, il y en a qui veulent que l'ufage les abaiffe
au ton du ftyle fiuuilier. C e grand art n’a point de regies , &
ne f.iuroit fe raifonner. D e l’abus des images qu’on appelle
jeux de mots. Ibid. 366. a.
Images. Elles font cffciuielles à la poéfie. Suppl. IV, 424, a.
Des images dans l’églogue. V. 429. b. Gradation d’images.
VII. 806. b. Figure qui confifte à prél'enter deux Images oppo-
f ie s , q u i, jointes enfemblc , fe relèvent iTuituclleiùcm. X il.
279. b. Foye^ Co.MPARAlSON, DESCRIPTION, ESQUISSE,
T ableau.
I.MAGES , ( Gravure ) eftampes pieufis ou autres, groffié-
remem gravées. VIII. 339. b. Explication de la maniéré de
faire des images Si médailles avec lu colle de poiffon. Ibid.
360. a.
Images alUnoriqucs , {D c jjcin) Suppl. T. 303. b.
IMAGINAIRE , ( G,"u/zr«. ) Lorfqu'on dit bonheur , peine
imagin.üre , l’imaginaire peut être dans le motif, dans l'objet;
mai-, la réalité elt toujours dans la lenfinion. 'V IU. 360. «r.
Imaginaire , être. VI. 73. b. Livres imaginaires. IX. 605. b.
MuLidiC imaginaire. 938. b. Vente imaginaire. XVII. 26. u.
Imaginaires, {Algeb.) racines paires de quantités négatives.
Rail'on de cette dénomination. Les quantités imaginaires
font ojjpofées aux quantités réelles. Non - feulement toute
racine paire de quantité négative eft imaginaire 3 m.iis fi oa
y joint une quantité réelle, le tout devient imaginaire. Quantités
mixtes imaginaires. Toute quantité imaginaire peut toujours
f i réduire ix. e f \ / — i , e & /'éc.uu des quantités
réelles. VU I. 360. a. Toute racine imaginaire d’une éqiiation
peut toujours fe réduire à e - + - / v / — 1 , c Si f étant des
quantités réelles. Corollaires de cette propofuion. Uid, b.
Foye^ C as irréductible.
Imaginaires , qu.intités , différentes des IncommenfurahleS.
M i l . 653.«. Racines imaginaires. XL 73. b. XIII. 748. a.
Suppl. Il, 833. b.
IM A G IN A T IO N , Imaginer, ( Logiq. Lin. ) Nous iie pouvons
rendre raifon de cette faculté. Peut-être cft-elie le fin i
inftrument avec lequel nous compofions des idées , Si même
les plus métaphyfiques. Détails Si raifonnemens de l’auteur
qui le prouvent. VIII. 560. b. Tous les fer.s foiirnilTent à
1 imagination 3 mais celui de la vue l’enrichit plus que tous
les autres. Deux fortes d’imagination, rune paftive , Si l’autre
aéUve. La premiere n’a pas befoin de notre volonté. Opérations
très-difficiles de refprit, qu’on exécute quelquefois en
fonge. Ibid. 361. a. Conflquence que l'auteur en tire fur la
caul'e produéirice de nos idées dans la veille. Cette faculté
palîive , indépendante de la réflexion, eft la fource de nos
paflions 8c de nos erreurs. Effets de l’imagination fur les femmes
enceintes. D e l’imagination aftive. Elle eft auffi indépendante
de nous que l'imaginaiion paftîve. Ce don de la nature
produit l'invention dans les arts. Elle ne peut exifter fan.y la
mémoire. Loin d’être l’ennemie du jugement, elle ne peut
agir qu’avec un jugement profond. Ibid. b. Il faut un très-
grand art dans routes les imaginations d’invemion , 8c même
dans les romans. La fécondé partie de l’imagination aéfive
eft celle de détail. Comment elle fait ie charme de la con-
verfation. C e ft fur-tout dans la poéfie qu’elle doit régner.
Ces imaginations ne doivent jamais être forcées, empoulées,
gigaïuelques. L’imagination aéfive qui fait les .poètes , leur
donne l’eiuhoufiafnie 3 ibid. 362../. mais elle n’eft jamais déréglée.
Pourquoi l’imagination eft moins permife dans l’élo-
quencc que dans la poéfie. Certains traits d'imagination ont
ajouté, dit-on , de grandes beautés à la peiniure : cependant
, quand les imaginations des peintres ne font qu’in-
génieiifes , elles font plus d’honneur à l’cfprit de l’arcifte ,
tjU elles ne contribuent aux beautés de l’art. Effets de l’ima-
gination fauffe, de l’imagination bifsrre dans les arts : dift'é-
rens caiaéleres d’imaginations. La mémoire furchargée fai:
périr cette faculté, ou la rend ftérile. Quelle eft la forte
d’imagination qui produit la démence. Ibid. b. Par ces mots
perception, mémoire, imagination , jugement, on n’entend point
des organes diftiiiéls, ni des facultés différentes dans leur principe.
ibid. 363. a.
Im.\gination , {Bell. Un.) Quand de l’aiTemblage de
traits que la mémoire a recueillis , l'imagination compofe
F