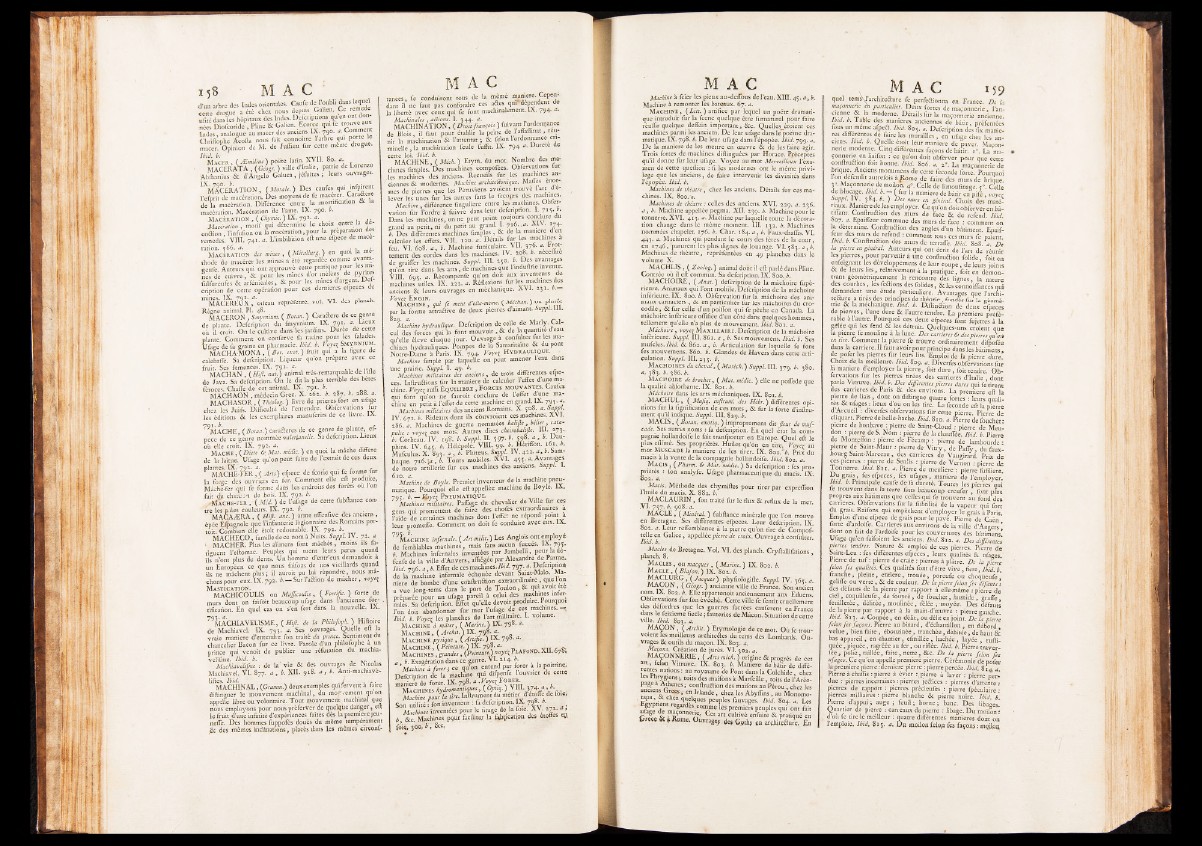
i I* Cîii'i
.
1 58 MAC M A C
■ i ■ !
(Î*
„ des Indes orientnies. Csufe >'J,'’»“ “ ' d“ “
c e t f droEiie a etc d r e i nous depuis Galien. Ce lemcde
„fneidandes hôpi.a.ot des Indes. Defeiiptions ,u
nées Diolcoride , Pline 8e Galien. Eeorce qm fe
Indes, aindogue au niacer des anciens IX. 790.
Qniftoplae Acolta nous fait connoioc latb te f ‘
inacct. Opinion de M. de Jiiffieu lut ecite meme drogue.
M -sena , f ÆmUms) poëte latin. XVII . 80. .1.
M A C E R A T A , (Gtost. ) ville d'Italie, patrie de L°>-“ zo
Alillciniiis 8é d'A ngelo Galu ca, jifuites ; leurs ouvrag 1.
’ " V a C É R AT IO N , (Moru/r.) Des eaufes qu'i
Vcfprit de macération. Des moyens de (c itiacerer. Cara^cre
de la macération. Différence encre la mortihcation 6c la
macération. Macération de l’ame. IX. 790. è.
M a c é r a t io n , ( a ym i r . ) IX. 791 . <ï- _
ALiccrJiion, motil qui détermine le choi.x entre la üo
coélion , I'infufion ou la macération, pour la
rcmedes. VIII. 741 . u. L’imbibuion eff une efpece de macération.
^66. n. ,. A - 1 „sr’.
Ma c é r a t io n des mines, {MéuHurg.) en quoi la ne-
thode de macérer les mines a été regardée comme avmta-
geufe. Am an s qui ont approuve cette |iiaiiqne pour
nés de cttivre, & pour les rames d or melees de PV " "«
fulfureufes & arlenicales, Se pour les mines d argent. Del
cription de cette operation pour ces dermeies clpeccs ae
' " 'm A C E R É A , oifeaii repréfenté. vol. V I . des plancli.
RcÊtne animal. PI. 48. , ^ .s ,
MA CER ON , Smymium. ( Boian. ) CaraAere de ce genre
de plante. Defeription du fmyruium. IX. 79V
oil il croît. On le cultive dans les jardins. Duree
plante. Comment on conferve fa racme pour les lalades.
Ufaae de fa graine en pharmacie. Uid. b. Voye^ Sm y r n iu .m.
MACHA-MONA , ( Bot. exor. ) Iriut qui a b hgure de
calebaffe. Sa defeription. Liqueur qu’on prépare avec ce
fruit. Ses femences. IX. 791 . ‘ï- ,
M A C E K N , (Hiß. HfJf.) animal tres-remarquable de I dle
do /ava. Sa defeription. On le dit la plus terrible des botes
féroces. Chaffe de cet animal. ÏX^_ 791..
M A C H A O N , médecin Grec. X, 262. b. 287. b. 288. a.
M A CH A SO R , ( T/iéolog. ) livre de prières fort en ulage
chez iss Juifs. Difficulté de l’oniondre. Obfervations lur
les éditions 6c los exemplaires mamifcnts de co livre. 1Ä.
’^^MACUE, (Solan.) carafferes de ce genre de plante, ef-
•pecc de ce genre nommée valcrianelU. Sa defeription. Lieux
où elle croit. IX. 79-- , ,-a-
M a c h e { Dicte & Mat. médic. ) en quoi la mache dittere
de la laitue. Ufage qu’on peut faire do l’extrait de ces deux
plantes. IX. 792. j . , ^ ■ r c r
MACHE-FER , ( A n s ) efpece de feone qm fo torme lur
la force des ouvriers en fer. Comment elle eff produite,
Mâche-for qui fc forme dans les endroits des forets ou Ion
.fait dji chari;;.’! de bois. IX. 79} - ,
M a ch e -ter , ( M:d. ) do l’ufage de cette fubftance contre
les pales couleurs. IX. 792. h. _ . , . ^
M A C AÆ R A , ( H ß . anc. ) arme offenfive des anciens ,
epee Efpagnole que l’infanterie légionnaire des Romains por-
toit. Combien elle étoit redoutable. IX. 792. b.
M A CH E C O , familledece nomàNuits. Suppl. IV . 72. ƒ
^ MACHER. Plus les alimens font mâchés, moms ils fa-
ticruent l’effomac. Peuples qui tuent leurs peres quand
ils nom plus de dents. Un homme d’entr’eux clemandoïc a
un Européen ce que nous faifons de nos vieillards quand
ils ne mâchent plus; il auroit pu lui répondre, nous mâchons
pour eux. IX. 792. é.— Surl’aétiou de mâcher,
M a s t ic a t io n . , ^ v , ,
MACHICOU LIS ou Maßcoulis, ( Fortifie. ) forte de
murs dont on faifoit beaucoup ufage dans l’ancienne fm-
tification. En quel cas on s’en fert dans la nouvelle. iX .
^ ^ llA CH IA V E L lSM E , (^Hifi. de U PhUofopk.) Hiftoire
de Machiavel. IX. 793. Ses ouvrages. Quelle eff a
vraie maniéré d’entendre fon traité du prince. Sentiment du
chancelier Bacon fur ce livre. Parole d’un philofophe à un
prince qui venoit de publier une réfutation du machia-
velifme. Ibid. b. , xt' 1
MachiaveUfme : de la' vie & des ouvrages de Nicolas
Machiavel. V I. 877. a , é. XII. 918. a , b. Ami-machiave-
liftes. Ibid. , / , . .
M A CH IN A L , (Gr<j/nffl.) deuxexemplcs quifervcnt a faire
dlftinf'uer le mouvement machinal, du mo-".'emcnt qu on
appelTe libre ou volontaire. Tout mouvement machinal que
nous employons pour nous préferver de quelque danger, eff
le fruit d'une inffiiité d’expériences faites dès la premiere jeu-
neffe. Des hommes fuppofés doués du même tempérament
des mêmes inclinations, placés dans les memes circonfrances,
fe conduiront tous de la mèmè maniéré. Cepen^
dant il ne faut pas confondre ces aftes qui depaident de
la liberté avec ceux qui fe font machinalement. IX. 794- •
Machinales .avions. I. 344. d.
MA CH IN A T IO N , ( Droit français ) fuivant l ordonnance
de Blois, il faut pour établir la peine de l’affaffinat , reunir
la macliination & l’attentat ; & felçn l ordonnam.e criminelle
, la machination feule fuffit. IX. 794- Durcie de
cette loi. Ibid. b. vt 1 1 -
M A CH IN E , ( Mficé. ) Etym. du mot. Nombre des ma-
dunes (impies. Des madiines compofées. Oblervauons fur
les machines des anciens. Recueils fur les madunes an-
deimes & modernes. M.ichhie arcluttSom,int. Malles énormes
de pierres que les Péruviens avqient trouve 1 art d e-
lever les unes fur les antres fans le Iccoprs des machines.
Machhc, différence fmgulicre entre les machines. Dbltr-
varion fur l'ordre à fulvre dans leur defcripnon. E
Dans les machines, on ne peut point toujours conclure du
grailtl au petit, ni du pair au grand. 1 716. ,n. '■ I74-
L Des d ikrentes machines f.mples , 8c de la manière d en
calculer les effets. V i l . lao . u. Détails fur les madiines a
feu. V I. 608. a , b. Machine funiculaire V II. 376- I f « -
tement des cordes dans les machines. IV . îo8. b. necelfite
de graiffer les machines. Suppl. 111. ^50. i. Des avantages qu’M tire dans les arts, de machines que 1 mdullne invente.
•('111 60Ï U. Récompenfe qu'on doit aux inventeurs de
machines utiles. IX. aaa. u. Réflexions fur les machines des
anciens & leurs ouvrages en niéchaniqiie. XV .2 3 1 . -
Voyer En GIN. , \ i
M a c h in e , qui fie meut d'elle-même. (^Mechan.) o\\
par la forme aitraélive de deux pierres daimam. ü l .
\idchine hvdraullqui. Defeription de celle de Marly. Ca lcul
'(les forces qui la font mouvoir , & de la quantité d eau
qu’elle élève chaque jour. Ouvrage a confiilter fur les machines
hydrauliques. Pompes de la Samaritaine èc du pont
Notre-Dame à Paris. IX. 794- Voyeç_ Hv d k a u e iq u e .
Machine fimple par laquelle on peut amener le au dans
une prairie, Suppl. I. 49. b. r „
Machines militaires des anciens , de trois dif^rentes efpe-
CCS. Inftruélions fur la maniéré de calculer 1 effet d une machine.
rcy ïrau ffi ÉQUILIBRE, F orces m o u v an t es . Caules
qui font qu’on ne faiiroit conclure de l’effet dune machine
en petit à l’effet de cctie machine en grand. IX. 793. a.
Machines militaires des anciens Romains. X. 308.
IV . 671. é. Rideaux dont ils cbuvroient ces machines. XVI.
286. .J. Machines de guerre nommées baiifie, belier cata^
pulte : voyei ces mots. Autres dites cheirobalifle. H/- ^73-
b. Corbeau. IV . 198. b. Suppl. II 3 ç?;. b ÿ )8. a , b. Dauphins.
IV . 645- b. Hélcpole. V I I I , 99- É Hi^riffon. z 6 i. b.
Miifculus.X. 893. a , b. Pluteus.5W . IV . 422. é. Sam-
biique. j i6 . \ a ,b . Tours mobiles. 'XVI. 4^ 5 ; Avantages
de notre artillerie fur ces machines des anciens. Suppl, i.
Machine de Boyle. Premier inventeur de la maclunc pneumatique.
Pourquoi elle eff appellee machine de Boyle. iX .
793. é. — Kùyf? Pn e um a t iq u e .
Machines militaires. Paffage du chevalier de V il e fur ces
gens qui promettent de faire des chofes extraordinaires a
faide de certaines machines dont l’effc: ne répond po>ot a
leur promeffe. Comment on doit fe conduire avec eux. IX.
^^Mach in e infernale. ( milh. ) Les Anglois ont employé
de femblables machines, mais fans aucun fucces. IX. 793.
b. Machines infernales inventées par Jambelli , pour la de-
fenfe de la ville d’A nv ers , affiégee par Alexandre de Parme.
Ibid. 706. . î , b. Effet de ces machines. Ibid. 797 -ƒ • ? ƒ
de la machine infernale échouée devant Samt-Malo. Maniéré
de bombe d’une conftriiaion extraordinaire , ' p™
a vue long-tems dans le port de T o u lo n , & q iu a vo ite te
préparée pour un ufage pareil à cclui des machines infer-
L le s . Sa defeription. Effet qu’elle dcvoit produire. Pourquoi
l’on doit abandonner fur mer l’ufage ce ces madiines. .
Ibid. b. Voyei les planches de l’art militaire. 1, volume.
M achine à mater, f IX. 798. a.
M a ch in e , ( Archu.) IX. 79y - g
M achine pyrique, {Anific. ) IX. 790. a.
M a c h in e , (Peinture.) IX. 790.a. ... v n a C'
M a ch in is 1 (Prràt«« ) v»yr;Pl.AEOtlD. X ll. 67S.
a i.E x a g é ra t io n d an s c e g en re .V l.2 14 .^ . ^ _
Muchim à furer; CS qil'oi. entend per forer a h poitrine.
Defeription (le la machine qiu difpmfe 1 ouvrier rie cette
maniéré de forer. IX. 79.8- A - ^ j
M achines hydremunuqu,,, ( Opnq. ) VII I 374; /
MuMn , pour bu rirr. Inftrr.ment da mener d étoffe de fore.
Son utilité : fon iovenicnr : fa defeription. IX. 79>f »• ,
Machines inventées pour le tirage de la foie. X V . 272. a ,
i , &c. Machines pgut facililef la fntpcarroil des étoffes q !
foie. 3QO.- ^ 5
MAC Machine à feier les pieux au-dcffbus de l'eau. XIII. 4'^.a,b.
Machine à remonter les bateaux. 67. a.
Machine , (L iu . ) artifice par lequel un poëte dramatique
introduit fur la feene quelque être furnaturei pour faire
réiilTir quelque deffein important, Sic. Quelles étoient ces
in.ichines parmi les anciens. De leur ufage dans le poème dramatique.
IX. 798. b. D e leur ufage dans l’épopée. Ibid. 799. a.
D e la maniéré de les mettre en ceiivre Sc de les faire agir.
Trois fortes de machines diflinguées par Horace. Préceptes
qu’il donne fur leur ufage. V o y ez au mot Merveilleux l’examen
de cette queffiou ; fi les modernes ont le même privilege
que les anciens, de faire intervenir les divinités dans
l'épopée. Ibid. b.
Machines de théâtre , chez les anciens. Détails fur ces m achines.
IX. 800. U.
Machines de théâtre : celles des anciens. X V I . 2.29. a. 236.
a , b. Machine appellee pegma. XII. 239. b. Machine pour le
tonnerre. X V I . 413. a. Machine par laquelle toute la décoration
change dans le même moment. III. 132. b. Machines
nommées chapelet. 176. b. Char. 184. a , b. Faux-chaffis. VI.
443. a. Machines qui pendant le cours des fêtes de la cour,
en 1746, parurent les plus dignes de louange. VI. 3 8 3 .« , é.
Machines de théâtre, repréfentées en 49 planches dans le
volume X.
MACHLTS , ( Zoolog. ) animal dont il eff parlé dans Pline.
Contrée où il eff commun. Sa defeription. IX. Soo. b.
M A CH O IR £ , (^Anat.) defeription de la mâchoire fiipé-
rietire. Animaux qui l’ont mobile. Defeription de la mâchoire
inférieure. IX. 800. b. Obfervation fur la mâchoire des animaux
carnaciers , Si. en particulier fur les mâchoires du crocodile,
& fur celle d’un poiffon qui fe pêche en Canada. La
mâchoire inférieure oflifice d’un côté dans quelques hommes,
tellement qu’elle n’a plus de mouvement. Ibid. 801, a.
Mâchoire , vo yq M a x il l a ir e . Defcripnon de la mâchoire
inférieure. Suppl. 111. 861. a , b. Ses mouvemens. Ibid. b. Ses
mufcles.Jéiu'. & 862. Ét, b. Articulation fur laquelle fe font
fes mouvemens. 860. b. Glandes de Havers dans cette ani-
culation. Suppl. III, 253. b.
Mâchoires du cheval,(^Maréch.) Suppl.1\\. 379. b. 380.
a. 383. b. 386. b.
Mâchoire de brochet, ( Mat. médic. ) elle ne poflede que
la qualité abfoibante. IX. 801. b.
Mâchoire dans les arts méchaniqiies. IX. 801. b.
M A CH U L , ( Mufiq. infirunï. des Hébr.) différentes opinions
fur la fignificaiion de ces mots , Si fur la forte d’iiiffru-
ment qu’il indique. Suppl. III. 829. b.
MACIS , ( Botan. exotiq. ) improprement dit fleur de muf-
cade. Ses autres noms : fa defeription. En quel état la compagnie
hollandoife le fait tranfporter en Europe. Q uel eff le
plus eftimé. Ses propriétés. Huiles qu’on en tire. Voye? au
mot M uscad e la maniéré de les tirer. IX. 8 o i.‘‘é. Prix du
macis à la vente de la compagnie hollandoife. Ibid. 802. a.
Macis , ( Pharm. 6> Al.it. médic. ) Sa defeription : fes pro»
prietes : fon analyfe. Ufage pharmaceutique du macis IX
802. a. ^
Macis. Méthode des chymiffes pour tirer par expreffion
l’huile du macis. X. 882. b.
M A CL AU R IN , fon traité fur le flux Sc reflux de la mer
.VI. 737. b. 908. a.
M A C L E , ( Minéral. ) fubftance minérale que l’on trouve
en Bretagne. Scs différentes efpeces. Leur defeription. IX.
Sû2. a. Leur reffemblance à la pierre qu’on tire de Compof-
tclle en Galice, appellee pierre t/« croiA'. Ouvrage à confulccr.
Macles de Bretagne. Vol. V I . des planch. Cryffailifations
planch. 8.
Macles , ou macques , (^Marine. ) IX. 802. b
MaCLE , ( Blajon. ) IX. 802. b.
M A C LU R G , ( Jacques) phyfiologiffe. Suppl. IV . aôç. a.
, ( Géogr. ) ancienne ville de France. Son ancien
IX. 802. b. Elle appartenoit anciennement aux Eduens.
übfervaiions fur fon évêché. Ce ttev ille fe femit cruellement
des défordres que les guerres facrées cauferent en France
dans le feizieme fiecle ; fauteries de Mâcon. Situation de cette
Ville. Ibid. 803. a.
M A ÇO N , (^Archit. ) Etymologie de ce mot. Où fe trou-
voicnt les meilleurs arcliiteéles du tems des Lombards. O u vrages
6c outils du maçon. IX. 803. a.
Maçons. Création de jurés. VI. 302. a.
MAÇONNERIE , ( Arts méch. ) origine & progrès de cet
art, felon Vitruve. IX. 803. b. Maniéré de bâtir de difte-
renws nations : au royaume de Pont dans la Colchide, chez
les Rhrygieiîs ; toits des maifons à Marfeille, toits de l’A réopage
a i^henes; conffruélion des maifons au Pérou chez les
« n A h y f f m s , an Monomo-
tapa, _ec chez quelques peuples fauvages. Ibid. 804. a. Les
gyp lews regardes comme les premiers peuples qui ont fait
C r ! L t 8c pratiqué e ï
Grece & & Rome. Ouvrage^ dei QpffiJ çn arçhicçaure. £n
M a c 159
quel tems\l'ardiitefliire fe perfoaionm en Friiicc. Dr b
muçonurru r>, y u rW i i r . Deux fortes rie maçonnerie, l'aiv
« " ( " f m i ? Détails fur la maçonnerie ancienne.
U,d. b. lab lc ries maniérés anciennes de bâtir, préfcniées
fous im meme afpefl. U,d. 805. a. Defeription des flx maniérés
diflerentes de fane les im,railles , en ufage diet les ancons.
Ib.d b. Quelle étoit leur maniéré de paver. Maçonnerie
moderne. Cinq différentes façons de bâtir, fo La iin-
çonnene en ha,fon : ce qu'on doit obferver pour que cette
conflruflion fo.t bonne. Ibid. 806. u. a", La maçonnerie de
brique. Anciens momimens de cette fccoiide forte. Pburqiioi
Ion défendit autrefois à^ onio de faire des murs de brique
3". Maçonnerie de moilon, 4». Celle de limoiifinage. Celle
de blocage. Iby. b - ( fur la maniéré de bârir en' pifé . voyrr
iuppl. IV. j S q . b ) „1 Clioix des maréé
riarix. Manière de les employer. C e qu'on doit obferver en bâ-
tiliant, Conffméiion des murs de face 8c de refend Ibid
807 a. EpatlTeur commune des murs de face : coinmeiu on
h determme. Conffruaion des angles d’iin bâtiment. Epaif-
feiir des^mnrs de refend : comment tous ces nuirs fe palenr.
Ibid. b. Conftruflion des murs de terraflé Ibid 808 a De
la pierre en général. Auteurs qui ont écrit de l’art de réunir
les pierres, pour parvenir à une conflruffion folicle, foit en
enfetgiiant les dcveloppemens de leur coupe , de leurs joints
Si de leurs lits, relativement à la pratique, Ibit en démontrant
géométriquement la rencontre des lignes, la nature
des courbes, les feélions desfolides, 6clesconnoiffances qui
demandent une etude particulière. Avantages que rarchi-
leéture a tires des principes de théorie, fondés fur la géoni“ -
trie & la méchamque. Ibid. b. DiffincTon de doux efpeces
de pierres, 1 une dure 8c 1 autre tendre. La premiere préférable
à l’autre. Pourquoi ces deux efpeces font fuiettes à la
g^lee qm les fend 8c les détruit. Quelques-uns croient que
la pierre le mouline a la lune. Des carrières & des pierres qu'o-.t
en lire. Comment la pierre fe trouve ordinairement difpofée
dans la carnere. Il faut avoir pour principe dans les bâtiniens .
de pofer les pierres fur leurs lits. Emploi de la pierre dure.
Choix d e là meilleure. Ibid. 809. Diverfes obfervations fur
la maniéré d’employer la pierre, foit dure , foit tendre Ob-
feryations fur les pierres tirées des carrières d’Italie , dont
parle Vitruve. b. Des dijféremcs pierres dures qui fe tirent
des carrières de Fans 8c des environs. La premiere eff la
pierre de liais, dont on diftingue quatre fortes : leurs qualités
8c ufages : lieux d'ou on les tire. La féconde eff la pierre
d A rcueil : diverfes obfervations fur cette pierre Pien-e de
cliquart. Pierre de belle-hache. Ibid. 810.«. Pierre de fouchec •
pierre de bonbave : pierre de Saint-Cloud ; pierre de Meu-
don : pierre de S. Nom : pierre de lacliaufféc. Ibid. b. Pierre
de Monteffon : pierre de Fécamp : pierre de lambourde •
pierre de Saint-Maur ; pierre de V i t r y , de PalTy, du ffuix-
bourg Sainc-Marceaii, des carrières de Vaiigirard. Prix de
oes pierres ; pierre de Scnüs ; pierre de Vernon : pierre de
l oniierre- Ibid. 811 . .r. Pierre de meuliere ; pierre fufiliere.
Du grais, fes efpeces, fes u ffg es , maniéré de l ’employer.
Ibid. b. Principale caufe de fa dureté. Toutes les pierres qui
le trouvent dans la terre lans beaucoup creufer , font plus
propres zùx hàiimens que celles qui fe trouvent au fond des
carrières. Obfervations fur la ffibtilité de la vapeur qui fore
du grais. Raifons qui empêchent d’employer le grais àParis
Emploi d’une efpece de giais pour le pavé. Pierre de Caën *
forte d’ardoife. Carrières aux environs de la ville d’Angers *
dont on fait de l'ardoife pour les couvertures des bâtimens’
Ufage qu’en faifoicnt les anciens. Ibid. 8 ia . a. Des différentes
pierres tendres. Nature 8c emploi de ces pierres. Pierre de
Saint-Leu : fes différentes efpeces, leurs qualités &. ufages
Pierre de tu f : pierre de craie ; pierres à plâtre. De la pierre
fdon fes qualités. Ces qualités font d ’être v iv e , fiere, Ibid. b.
franche, pleine, entière, trouée, poreufe ou choquetife ’
geliffe ou verte , 8c de couleur. De la pierre félon fia défauts :
des défauts de la pierre par rapport à elie-mcnie : pierre dé
ciel , coquilleufe, de foupré, de foiidiet, humide , giaffe
feuilletée, délitée, moulinée, fêlée , moyée. Des défauts
de la pierre par rapport à la main-d’eeuvre : pierre gauche.
Ibid. 813. .1. Coupée, en délit, ou délit en joint. Ai
felon fes façons.Pierre au binard, d’échantillon, en débord
v e lu e , bien faite, ébouzinée , tranchée, débitée, de haut 6c
bas appareil, en chantier, cfmillée , hachée , layée , ruffi-
quée, piquée, ragréée au fe r , ou riflée. Ibid. b. Pierre traver-
lé e , polie, taillée, faite, nette, 8cc. De la pierre felon f i s
ufages. C e qu’on appelle premiere pierre. Cérémonie de pofer
la premiere pierre iderniere pierre : pierre p e r c é e . 814. a.
Pierre à chaffis : pierre à évier : pierre à laver ; pierre perdue
: pierres incertaines : pierres jeélices : pierres d’attente ;
pierres de rapport : pierres précieufes : pierre fpéculaire :
pierres milliaires : pierre blanche 8c pierre noire. Ibid b
Pierre d’appui ; auge ; feuil ; borne ; banc. Des libages*
Quartier de pierre : carreaux de pierre : iibage. D u moilon :
d’oii fe tire le meilleur : quatre dift'érentes maniérés dont on
l’emploie. Ibid. 815. a. Du moilon felo;i fes façons ; mqilpjj