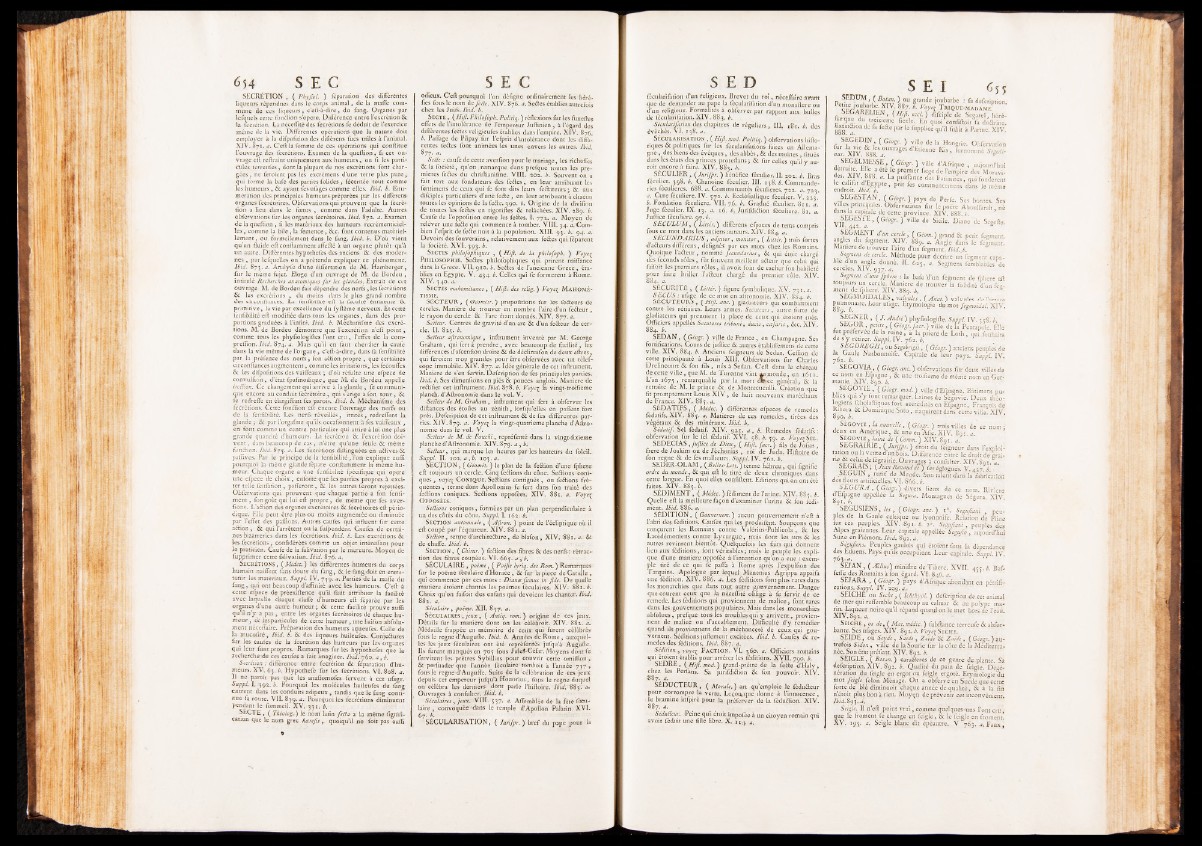
654 SEC
SECRÉTION , ( Phyfîol. ) fcpanitlon des différentes
liqueurs répandues datis le corps animal j de la niaffe coin-
imine de ces liqueurs, c'cll-à-dire , du fang. Organes p.ir
Icl'q^iiels cctfc tundion s'opère. Différence entre l'excrétion Ck
la leciecioii. Ea ncccdkc des lécréiions le déduit de l’exercice
meme de l.i vie. l^ifférenies opérations que la nature doit
employer à la dii'pol'uioii des ditlérens lues utiles à Taniinal.
•XIV. 871. U. C e l l la lomine de ces opérations qui conllitue
l'ouviage des l'ecrctions. Examen de la quellion, A cet ouvrage
ell reffraint uniquement aux humeurs, ou li les particules
terreul'es, dont la plupart de nos excrétions font chargées
, ne fevoient pas les cxcrémens d'une terre plus pure ,
qui tonne la bafe des parties lolides, fécerncc tout comme
les humeurs , & ayant fes iifages comme elles. IbU. h. Enumeration
des principales humeurs préparées par les diftérens
organes fecrétoires. Obfervations qui prouvent que la lecré-
tion a lieu dans le foetus , comme dans l’adulte. Autres
oblervarions l'ur les organes lécrétoires. Ibid. 872. a. Examen
de la qneffion , fi les matéri.iux des humeurs recrémenticiel-
le s , comme la bile , lu lémonce, 6cc. font contenus matériellement,
ou formellement dans le fang. IbiJ. b. D'oü vient
quiin fluide ell conllamment aff'eAé à un organe plutôt qu'à
un autre. Différentes hypothefes des anciens & des modernes
, par lefquelles on a prétendu expliquer ce phénomène.
Ibid. 873. J. An.ityfe d’une diff'ertation de iM. Hambeiger,
fur le même liijet. Eloge d’un ouvrage de M. de Bordeu ,
intitulé Recherches ar.diomiejucs fur les glandes. Extrait tie Ci.t
ouvrage M. deBotden fait dépendre des nerfs, les fecréiions
& les excrétions , du moins dans le plus grand nombre
des circonlt.inces. La ienfibiiité ell la faculté éminente éé
pnmiiive, la vie par excellence du fyllème nerveux. Et cette
téiiiibilicé efl modiffée dans tous les organes, dans des proportions
graduées à rinffnt. Ibid. b. Méchanifme des excrétions.
M. de Bordeu démontre que l'excrétion n'eff point ,
comme tous les phyfiologilles l’ont c ru , l'eftet de la coni-
pvellinn. Ibid. 874. u. Mais qu'il en faut cher tlicr la caufe
dans la vie même de l'organe , c’dl-à-dire, dans fa fenfibilité
par 1.1 prélence des nerfs, Ton aétion propre , que certaines
circonltances augmentent, comme les irritations, les l'ecouff'es
6c les dilpofitions des vailTeaux ; d'où réfultc une efpece de
conviilfiun , d'état fpafmodiquc, que ,M. de Bordeu appelle
£>c-i‘r;on. Ce changement qui arrive à la glande , fe communique
encore au conduit l'ecrétoire , qui s'érige à fou tour , £k
le redreffe en élargiffam fes parois. Ibid. b. Méchanifme des
fecrétions. Cette foncUon eff encore l'ouvrage des nerfs ou
de la feniîbilité. Les nerfs réveillés, irrités, redreiTent la
glande j 6c par i’orgaline qu'ils occafionnent à fes vailfeaux ,
en font comme un centre particulier qui attire à lui une plus
gr.ande quantité d'humeurs. La fecrétion 6e l’excrétion doiv
en t , dans beaucoup de ca s , n’écre qu’une feule 6c même
fonefion. Ibid. 875- Les fecrétions diihnguées en afHves6c
palhves. Par le principe de la feniîbilité, l’on explique auffi
pourquoi la même glande fépare conlhmunent la meme humeur.
Ciiaque organe a une fcnfibilicé fpécifique qui opéré
une efpece de choix , enforte que les parties propres à exciter
telle Iciifation , pafferom, 6c les autres feront rejettées.
Oblervations qui prouvent que chaque partie a fon fenti-
m en t, fon goût qui lui eff propre , de même que fes aver-
Aor.s. L’aéiion des organes excrétoires 6c fecrétoires eff périodique.
Elle peut être plus ou moins augmentée ou diminuée
par l’eftet des pafiions. Autres caufes qui influent fur cette
aélion , & qui l’arrêtent ou la fufpendenr. Caufes de certaines
bizarreries dans les fecrétions. Ibid. b. Les excrétions 6c
les fecrétions , confidérées comme un objet intérciTant pour
le praticien. Caufe de la falivation par le mercure. Moyen de
fupprimer cette falivation. Ibid. 876. a.
Se cr é t io n s , (A ffile .) les différentes humeurs du corps
humain naiffent fans doute du fang, 6c le fang doit en entretenir
les materinu.ï, Suppl. IV. 7^9. a. Parties de la maffe du
fang, qui ont beaucoup d’affinité avec les humeurs. C e f f à
cette efpece de préexiffence qu’il faut attribuer la facilité
avec laquelle chaque claffe d’humeurs eff féparée par les
organes d’une autre humeur; 6c cette facilité prouve auffi
qu’il n’y a pas , entre les organes fecrétoires de chaque humeu
r, (k les particules de cette humeur, une liaifon abfolu-
ment néceffaire. Préparation des humeurs aqueufes. Celle de
la mucüfité, Ibid. b. 8c des liqueurs huileufes. Conjeélures
fur les cames de la fecrétion des humeurs par les organes
qui leur font propres. Remarques furies hypothefes que la
recherche de ces caufes a fait imaginer. Ibid. 760. a , b.
Secréiion : différence entre fecrétion 6c féparation d'humeurs.
X V. 63. b. Hypothefe fur les fecrétions. VI. 808. a.
Il ne paroît pas que les anaffomofes fervent à cet ufage.
Suppl. I. 392. b. Pourquoi les molécules huileufes du fang
entrent dans les conduits adipeux , tandis que le fang continue
fa route. VII. 839. a. Pourquoi les fecrétions diminuent
pendant le fommeil. X V . 331. b.
Se c t e , ( Théolog. ) le nom latin feHa a la même fignifi-
canon que le nom grec harefis, quoiqu’il ne foit pas aiifli
S E C
odieux. C ’efl pourquoi l’on défigne ordinairement les héré-
fies fous le nom de f a e . X IV . 876. a. Scélcs établies autrefois
chez les Iinf's. Ibid. b.
Secte , Philofoph. Poliriij. ) réflexions fur le.s fiincffes
effets de l’iiiioléraiice de l’empereur Jiiffinien , à l'égard des
diff'érentes l'eéles religieufes établies dans l’empire. X IV . 876,
b. Ihilfagc de Ihlpay fur l’efprit d'intolérance dont le.s dilfé-
rentes leéles font animées les unes envers les autres. Ibid.
877. a.
Sefle : caufe de cette avcrfion pour le mariage, les richefles
8c la fociété, qu’on remarque dans prerqiie'iomcs les premieres
leéles (in chriftianifine. V I ll. 202. b. Souvent on a
fait tort aux fondateurs des feéles, en leur attribuant les
fentimens de ceux qui fe font dits leurs fcélntciirs; 6c aux
difciples particuliers d’une fc é lc , en leur attribuant à chacun
toutes les opinions de lafcéle. 390. b. Origine de la divifion
de toutes les feéles en rigoriffes 6c relâchées. X IV . 289. b.
Caufe de l’oppofftion entre les feéles. I. 772. a. Moyen de
relever une fêéle qui commence à tomber. VIII. 34. «. Com
bien l'efprit de feile nuit à la population. XIII. 93. b. 94. a.
Devoirs des fouverains, relaiivcmenc aux feéles qui féparent
la fociété. X V I . 393. b.
Sectes philofophi^jues , ( Hifl. de la philofoph. ) Voyei^
Ph iloso phie . Seéles philol'ophlques qui prirent naiffance
dans la Grece. VII. 910. b. Seiles de l'ancienne Grece , établies
en Egypte. V . 434, b. Celles qui fe formerent à Rome.
XIV.340.
Sectes mahométanes, {H iß . des relig.) Foye;^ MAHOMÉTISME.
S E C T EU R , (Geometr.) propofftions fur les fefleiirs de
cercles. Maniéré de trouver en nombre l’aire d’un feéleur,
le rayon du cercle 6c l'arc étant donnés. X IV . 877. a.
Seâeur. Centres de gravité d’un arc 6c d’un feileur de cercle.
II. 815. b.
Sebleur ajlratwmiquc, inffrument inventé par M. George
Graham , qui fert à prendre , avec beaucoup de facilité , les
différences d'afcenfion droite 8c de déclinaifon de deux affres,
qui feroient trop grandes pour être obfervées avec un télef-
cope immobile. XLV. 877. a. Idée générale de cet inffrument.
Maniéré de s’en fervir. Defeription de fes principales parties.
Ibid. b. Scs dimenfiütis en piés 6c pouces anglois. Maniéré de
reilitier cet inffrurnent. Ibid. 878. b. Fuye^ îa vingt-troifieme
planch. d’Aftronomie dans le vol. V.
Seâeur de M. Graham , inffrument qui fert à obferver les
diffanccs des étoiles au zénith, lorfqu’ellcs en pafl'ent fort
près. Defeription de cet inffrument 6c de fes différentes parties.
X lV . 879. a. Foye;^ la vingt-quatrieme planche d'A llro*
nomie dans le vol. V.
Sebleur de M. de Foiichi, repréfenté dans la vingt-fixierae
planche d’Allronomie. XIV. 879. a , b.
Selleur, qui marque les heures par les hauteurs du foleil.
Suppl. 11. 102. rf,é . 103, d.
S E C T IO N , ( Giomét. ) le plan de la feftion d’une fphere
eff toujours un cercle. Cinq feiffions du cône. Seélions coniques
, C o n iq u e . Serions contiguës , ou ferions fréquentes
, terme dont Apollonius fe fert dans fon traité des
ferions coniques. Serions oppofées. X IV . 881. a. Foye^^
O pposées.
Sellions coniques, formées par un plan perpendiculaire à
un des côtés du cône. Suppl. I. 162. b.
Se ct io n automnale, ( Afron. ) point de l’écliptique où il
eff coupé par l’équareur. X IV . 881. a.
Seblion , terme d’architeéiure , de blafon, X IV . 881. «a. &
de chaffe. Ibid. b.
Section , ( Ciûrur. ) feélion des fibres 6c des nerfs : rétraction
des fibres coupées. V I , 663. a , b.
SÉCULAIRE , poème, ( Pùéfte lyriq. des Rom. ) Remarques
fur le poème féciilaire d’Horace , 8c fur la piece de Catulle ,
qui commence par ces mots ; Diana fumas in fide. De quelle
maniéré éioient chantés les poèmes féculaires. X IV . 881. é.
Choix qu’on faifoit des enfansqui dévoient les chanter. Ibid.
881. U.
Séculaire , poème. XII. 837. a.
Séculaires , { Antiq. rom.') origine de ces jeux.
Détails fur la maniéré dont on les célébroit. XIV, 882. a.
Médaille frappée en mémoire de ceux qui furent célébrés
fous le regne d’Augufte. Ibid. b. Années de Rome , auxquelles
les jeux féculaires ont été repréfentés jiifqu’à Auguffe.
Ils furent manqués en 703 fous JiileS-Céfar. Moyens dontfe
fervirent les prêtres Sybilllns pour couvrir cette omilfioii ,
8c perfiiader que l’année féculaire tomboit à l’année 737 ,
fous le regne d'Auguffe. Suite de la célébration de ces jeux
depuis cet empereur jiifqu’à Honorius, fous le regne duquel
on célébra les derniers dont parie l’iiiffoire. Ibid. 883. a.
Ouvrages à coiifulter. Ibid. b.
Séculaires, jeux. V ü l . 337. a. Affemblée de la fête fécii-
îairc , convoquée dans le temple d’Apollon Palatin XVI-
67. b.
SÉ CU LA R ISA T IO N , ( Jurïfpr. ) bref du pape pour la
S ED
fécularlfation d’un religieux. Brevet du r o i, néceffaire avam
que de demander au ]iape ta iécularifation d'un itiunaffere ou
(l’mi religieux, Fonnaliiés à obferver par rapiiort aux bulles
de féciilarifation.XIV. 883. "
des chapitres de réguliers. III. 181. b. des
évêchés. VI, 138. a.
Sé cu lar isa tio n , {Hiß. mod. Politiq. ) obfervations hiffo-
rl(|ues & politiques fur les fécularifations faites eu Allemagne
, des biens des évêques, des abbés, 8c des moines, litués
dans les états des princes proicffans ; 8c fur celles qu’il y aii-
roir encore à faire. X IV . 883. b.
SÉCULIER , {Jurifpr. ) bénéfice féculier. Il, 202. b. Bras
féciiiier. 3 9 8 . Chanoine féculier. III. 1 38. t. Commande-
ries léciiliercs. 688. a. Communautés féciilicrcs. 722. a. 723.
J. Cure fcculiere. IV. 372. b. Eccléfiallique féculier. V . 223.
h. Fondation fcculiere. VII. 76. b. Gradué féculier. 8 1 1. a.
Jttge féculier. IX. 13. a. i6. b. Jurifdiéiion féculicrc. 81. a.
Jullice fécuUcrc. 97. b.
S E C U LU M , { Liitèr.) différens efpaccs de teins compris
fous ce mot dans les anciens auteurs. XIV. 884. a.
SECU N D A R .IU S , adjutor, monitor, ( ) trois Tories
d’aéleurs différens, defignés par ces mots chez les Romains.
Quoique l’aélcur, nomme Jecundarius, 8c qui éioit chargé
des féconds rôles, fiitfouvcm meilleur aélciir que celui qui
faifoit les premiers rôles, il avoir foin de cacher fon habileté
pour faiie biillcr l’aéleur chargé du premier rôle. XIV.
SÉCURITÉ , ( Linèr. ) figure fymbüliquc. XV. 73 i. a.
SE CU S : uliigc de ce mot en altronomie. XIV. 884. b.
S É CU F EU R S , {H iß . anc.) gladiateurs qui conibattoicnt
contre les rétiaires. Leurs armes. Secateurs, aune forte de
gladiateurs ejui prenoieut la place de ceux qui étoient tués.
Officiers appelles Scaitorcs tribuni, ducis, cafaris , & c X iV
884. b.
S E D A N , {Gèogr.) ville de France, en Champagne. Ses
fortifications. Cours de jufficc 8c autres éiabliiremens de cotte
ville. XIV. 884. b. Anciens felgneurs de Sedan, CelTion de
cette principauté à Louis X lil. Obfervations fur Charles
Dreüncoiirt 6c fou fils , nés à Sedan. C e ff dans le château
de cette ville , que M. de 1 iircnne vint jui monde, en 1611,
L ’an 16 7 3 , remarquable par la mort d r ’cc général, 6c la
retraite de M. le prince 6c de Moinecuculli. Création que
fit promptement Louis X IV , de huit nouveaux maréchaux
de France. X IV . 883. a.
S É D A T IF S , ( Médec. ) différentes efpcces de remedes
fédatifs. X iV . 883. a. Matières de ces remedes, tirées des
végétaux 6c des minéraux. Ibid. b.
Sédatif Sel fédatif. X IV . 923. a , b. Remedes fcd.irifs;
obfervation fur le fel féclafif. XVI. 38. b. 39. a. P'oyer'StL.
SEDECIAS ,;«/?/« de Dieu, { Hiß. facr. ) fils de Jofias,
frere de Joakim ou de Jcchonias , roi de Jud.a. Hiffoire de
fon regne 8c de fes malheurs. Suppl. IV. 761. b.
SED ER -O LAM , ( Belles-Lc.t. ) terme hebreu, qui fignifie
ordre du monde, 6c qui eff le titre de deux chroniques dans
cette langue. En quoi elles confiftcnt. Editions qui en ont été
faites. X IV . 883.
SÉDIMENT , ( Médec. ) fédiment de l’urine. X IV . 883. b.
Quelle eff la meilleure façon d’examiner l’unnc 6c fon ledi-
rnent. Ibid. 886. a.
S ÉD IT IO N , ( Gouvernem.) aucun gouvernement n’eff à
l’abri des féditions. Caufes qui les produifent. Soupçons que
conçurent les Romains contre Valérius-Piiblicola , 6c les
Lacédémoniens contre Ly cu rgu e, mais dont les uns 6c les
aiiires revinrent bientôt. Quelquefois les faits qui donnent
lieu aux féditions, font véritables; mais le peuple les explique
d’une manière oppofée à l’inrcmion qu’on a eue : exemple
tiré de ce qui fe pafl'a à Rome après rexpulfion des
Tarquins. Apologue par lequel Menenius Agrippa appaifa
une lédition. X IV . 886. a. Les féditions font plus rares dans
les monarchies que clans tout autre gonvernement. Danger
que courent ceux que la néceflîté oblige à fe fervir de ce
rcniedc. Les féditions qui proviennent de malice, font rares
dans les gouvernemens populaires. Mais dans les monarchies
îibfolues, prefque tousles troubles q u iy arrivent, proviennent
de malice ou d'accablement. Difficulté d'y remédier
quand ils proviennent de la méchanceté de ceux qui gouvernent.
Séditions jnffenieiit excitées. Ibid. b. Caufes 6c remèdes
des féditions. Ibid. 887. a.
Sedition, FACTION. VI. 36p. a. Officiers romains
qui étoient établis pour arrêter les féditions. X V II . 790. b.
SED R E , {H iß . mod.) graiul'prétrc de la feéle d’H a ly ,
chez les Perians. Sa jurifdiéiiün 6c fon pouvoir. XIV,
SÉD U C T E U R , ( Morale.) art qu'emploie le fédmffeur
pour corrompre lu vertu. Leçon,que donne à l’innocence,
le braminc infpiré pour la préferver de la féduélion. X IV .
887.
Séduéleur. Peine qui eioit impolée à un citoyen romain qui
avoir fédnit une fille libre, X. n , j . j.
S E 1 6 5 5
Sm U M . ( Bolm. ) ou granclf joubarbe .■ fa (Icfcrirnioe.
^l'(.Y'’au rr T iUQUI-MADAMK.
S LG A I .rX IbN , {H ijl. eccL) difciple de S c e a r c l.lifr é -
fiarque d,i ,,c ,,,e „ ,c ficclc. hu quoi confifloii fa (loarinc.
txuna iou de f , fe£te par le fupplicc qu'il f„b|, i |>a„nc. XIV.
SÉGI'.Dm ( G e V . ) ville de la Hongrie. Oi-.fervation I". xiv. 888 0°“"'’®“ %er/ed
é o u i ^ f ' l X ' ' ' A f r i ' l ™ , aujourd'hui
de X IV 88«“ ‘" T " T
É ; batimirci, qui fondèrent
le cahl.tt cl Eg yp te, pnt fes cominencemens dans le même
endroit. Ibid. l>.
SLGESTAN , { Céogr. ) pays de Perfe. Ses bornes. Ses
villes prmupales, Obfervauons fur le poète Aboiilfaraii, né
dans la capitale de cette province. XIV. 888. i.
x/ii ) ville de Sicile. Diane de Sc-f>cffe
Vil. 442. a. °
SEG.MENT dim cercle, ( Géom.) grand Sc petit fegment.
angles du fegmenr. X IV . S89. a. Angle dans le l'Jmc.it.
Maniéré de trouver l’aire d’un fegmem. Ibid. b.
Segment de cercle. Méthode pour décrire un fcgmc.nr caoa-
ble dim angle donné. 11. 625, Sc-gmens femblaules de
cercles. X I \ . 937. a.
Segment d une fphere : la bafe'd’un fegment de fphere eff
toujours un corde. Maniéré de trouver la folidit- d’un f c -
nicm de fphere. XIV. 889. b. °
SEGMUiUALE.S, v u W f j , valvules de l’artere
puhnonaire.Lctirulage. Etymologie du mot fegmoidal. X IV .
^ pliyfiologiffe. Suppl. IV . 338. b.
S L G U l l , pente, { Géogr. J act.) viWo de la Pentapole. Elle
hit prefervee de la ruine , à la priere de Loih , qui foiihaita
de s y retirer, Suppl. IV. 762. b.
S E G O R E G ll, ou Segobngii, ( Géogr. ) anciens peuples de
la Oaiile Narbonnoife. Capitale de leur pays. Sufp’ IV
762. b. r J cr
SEGO'V IA , ( Géogr. anc. ) obfervations fur deux villes de
ce nom en Eljiagne , 6c une troifieme de même nom en Germanie.
XIV. 890. b.
S£GO"VIE , ( Geogr. mod. ) ville d’Efpagne. Bâtimens publias
qui s y font remarquer. Laines de Ségovie. Deux théo-
logiens Icholaffiq.ies fort accrédités en Efpagne, Francois de
Kibera 6c Dominique Soto , naquirent dans ccite ville! X iV .
090. b.
StGOviy., la nouvelle, {Géogr.) trois villes de ce nom;
deux en Amérique , 6c une en Aile. XIV. 891. u.
Ség o v ie , laine de ( Comm. ) XI\h S91. a.
S E G R A IR IE , ( ) droit du feignenr dans l’exploitation
ou la vente d unbois. Différence entre le droit de erai-
Ouvrages à confulter. X lV h Sg i. a.
SEGRAFS; {Jean Renaud de ) fes é'^losues. V a ‘ - b
S E G U IN , natif de .Mende. Son talent dans la fabricaiion
des fleurs artificielles. VI. 866. b.
S E G U R A , {Géogr.) divers lieux de ce nom. Riviera
d^Efpagne appellee la Segura. Moiuagiies de Ségura, XIV.
S É G U S I^ 'S , /rj anc. ) 1 “. Sigiifiani , peuples
de la Gaule celtique ou lyonnoife. Relation de Pii,ie
iur ces peuples. XIV. 891. b. 2“. Segufani , peuples des
Alpes graiemies. Leur capitale appellee Segufo , aujourd’hui
Suze en Ficmont. Ibid. 892. a.
Ségujicns. Peuples gaulois qui étoienr fous l,a dépendance
des Eduens. Pays qu'ils occiipoieni. Leur capitale, Suppl. IV.
SEJAN , ( Ælius) minlffre de Tibere. XVII . 453. E Baf-
feiîe des Romains à fon égard. M . 846. a.
SEJAR.A , ( Géogr. ) p.iys d'A frique abondant en pétrifications.
Suppl. IV. 109. a.
SEICHE ou Seche , ^ Icbtkyol. ) defeription de cet animal
de mer qui relTcmble beaucoup nu calmar 6c au polype marin.
Liqueur noire qu’il répand quand on le mec hors de l'exil.
X IV , 892. J.
Seiche , os de, ( M.h. médic. ) fubffance lerrcufe 6c abfor-
banre. Ses iifages. XIV. 892. b. i'oye^ Seche.
S E ID E , ou Seyde, Saide , Zndc 6c Zaide, { Géogr. ) autrefois
Sidon , v ille de la Sourie fur la cote de la Méditerranée.
Son état préfciit. X IV . 892. b.
SEIGLE, ( Botan.) cnracffcres de ce genre de plante. Sa
defeription. X IV . 892. b. Qualité du pain de feigle. Dc-k--
nération du feiglc en ergot ou l'eigle ergoté. Etyniolo^’ ie du
mot feigle felon Ménage. On a obferve en Suede que ccrtc
forte de blé diminuoit chaque année de qualité, 8: à b fin
n’étoit pins bon à rien. Moyen de prévenir cec inconvénicnr.
/E./.893. a.
Seigle. Il n’eff point v r a i, comme quelques-uns l'ont eu:
que le froment fe change en feigle, 6c le feigle en tromer.r!
X V . 193. J. Seigle blanc dit epeamre. V 763. u. Fau.v,