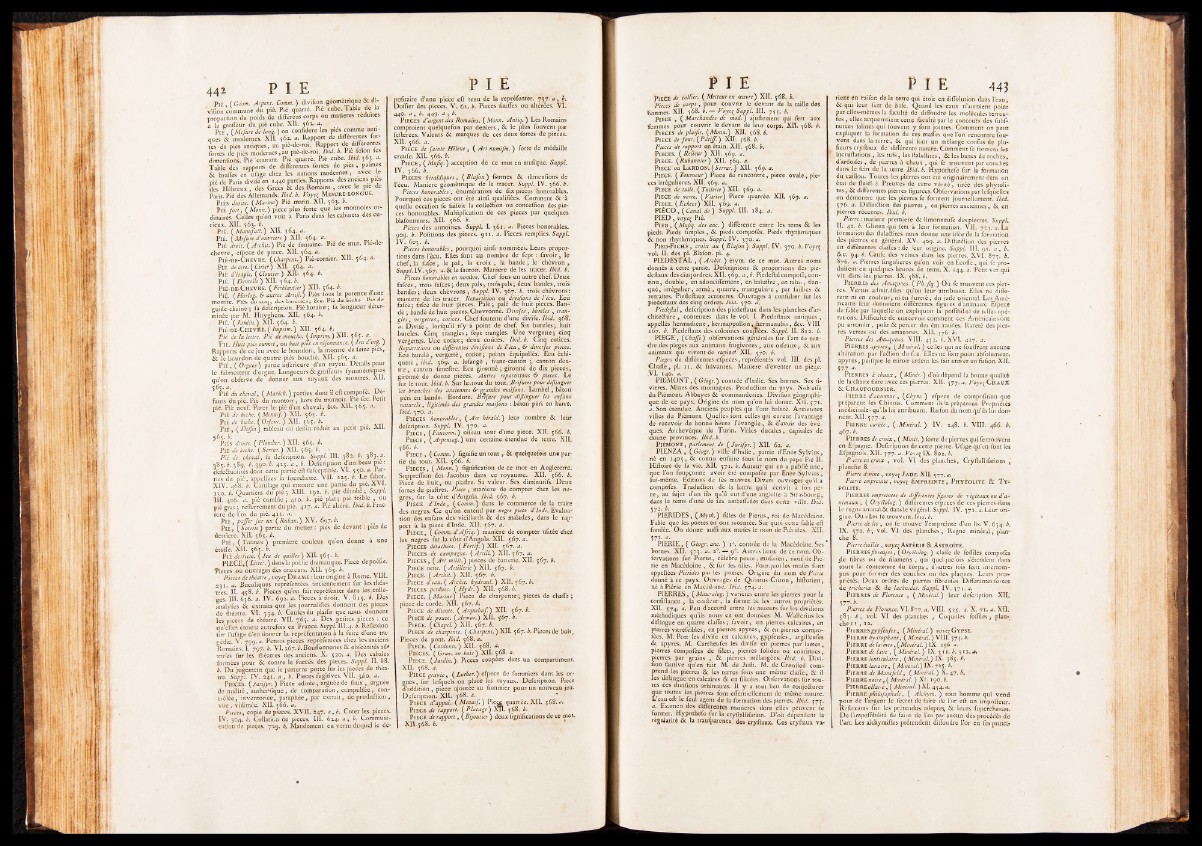
i M t
i.if
■ÜI i h
' I h‘!
442 P I E
Pli£, ( Gfom. Arpent. Comm. ) dlvHion gcomcmqiie & tli-
vifioii commune du pie. Pie quarri. Pie cube. Table cte la
proportion du poids de difi'ereus corps ou matières réduites
à la iiroileur du pié cube. XII. 562. u.
PiÉ (Mcfiire de long.) on confidere les pies comme antiques
& modernes. XII. 56a- Rapport de différemes lottes
de pies antiques, au pic-de-roi. Rapport de differentes
fortes de pics modernes.au pié-de-roi. li>id. b. Pi^lelo»
dimenCions. Pié'courant. Piè quarré. Pie cube. 0 3 -''-
des Hébreux , des Grecs & des Romains , avec le pie de
Paris. Pié des Allemands. J b id . b . F o y e ^ M esure-long ue.
PiÉS d r o its . { M u r i n e ) Pié marin. XII. 563. b .
PlÉ J o r r , { M o n n . ) piece plus forte que les monnoies ordinaires.
Celles qu’on voit à Paris dans les cabinets des curieux.
XII. 563. b.
PlÉ. { M u n u f a H . ) XII. 564. «i.
Pié. ( M e f u n d ’o u v r ie rs ) X ll. 564. u. r». • 1
Pié d r o it. { A r c h i t . ) Pié de fontaine. Pié de mur. Pie-de-
ch e vre , cfpcce de pince. XII. 564.
P I E P I E P I E
Pié-de-C he v re . {Charpent.) Pié-cornier. XII. 564.^.
PlÉ de cire, {d r ie r ) X ll. 364. a.
P ié d'ctaple. {Cloutier) X ll. 364. b.
PlÉ. {Dentelle) XII. 564. b.
P iÉ-DE-CheVRE. {Ferblantier) X ll. 564. b.
P ié. (Horlog. & autres Artijl.) Piés fous la potence d une
montre. Piés du coq, des barattes, & c. Pié de biche. Pié de
guide-chaiue ; fa defcripcion. Pié Iioraire ; la longueur déterminée
par M. Huyghens. XII. 564. b.
PlÉ. {Jardin.) A ll. 564. b.
P ié-de-C hevre. (//Hjin«.) XII. 564.
•Pic de la lettre. Pié de mouche. ( împrim.) XII. 365. *r.
PlÉ. Huit pics ouwn, ou huit pies en réjonnance. {Jeud org. )
Rapports de ce jeu avec ie bourdon, la montre de feize piés,
&: le bourdon de quatre piés bouché. XII. 365. a.
P i t , { Orgues) partie inférieure d’un tuyau. Détails pour
le fabrieaieiir d'orgue. Longueurs & groffeurs fymmécriques
qu'on obferve de donner aux uiyaiiX des montres. X ll.
^ Pié du cheval^ { Marcch.) parties dont il efteompofé. D é fauts
du piè. Pié du inontoir , hors du montoir. Pié fee. Petit
pié. Pié neuf. Parer le pié d’ un cheval, ixc. X ll. 565- a.
PlÈ de biche. {Mcnuij.) X ll. 563. b.
P ié de biche. ( Orfevr. ) XII. 3(15. b.
P lÉ , ( DeJJîn ) tableau ou deilm réduit au petit pie. A li.
565. b.
P lis droits. { Plomber.) X li. 565. b.
PlÉ de biche. {Semer.) X ll. 565. b.
Pié de cheval, fa del'cripiion. Suppl. III. 382. b. 303-
383. b. 389. b. 390. b. 413. U , b. pefcripiion d’un beau pié :
dcf'efluolités dont cette partie eft fufceptible. VI. 350.
ries du p ic , appcllées la fourchette. V i l. 223. b. Le facot.
X IV. 468. b. tartilage qui entoure une partie du pxé. XVI.
Ï30. b. Quartiers du pié ; X lll. 192. b. pié dérobé; Suppl.
111. 406. a. pié comble; 410. b. pié plat; pic foibie ou
pié gras ; refferrement du pic. 417. a. Pié altéré. Ibid, é .t raclure
de l’os du pié. 4 1 1 . a.
P l i , puffer jur un {Ruban.) X V . b.
P ié , (ét>i«r/e) partie du métier : pics de devant ; pies de
derrière. X ll. 363-il.
Pi é , {Teinture) premiere couleur qu'on donne à une
étoffe. XII. 363. b.
Pié derrière. {Jeu de quilles) XII. 363- b.
PIECE, ( Liicér. ) dans la pocfie dramatique. Piece depocfic.
Rieces ou ouvrages des orateurs. XII. 563. b. ^
Pieces de théâtre, D r am e : leur origine à Rome. VIII.
i 3 i . a. Bucoliques repréfentées anciennement iur les théâtres.
l i. 458. b. Pieces qu’on fait repréfenter dans les colleges.'
III. 636. a. IV . 692. a. P'teces à tiroir. V . 813. E Des
analyfes 6c extraits que les journaliftes donnent des pieces
de théâtre. VI. 334-^. Caulésdu plaifir que nous donnent
les p'iccc-s de théâtre. VII. 763. a. Des petites pieces ; ce
qu’elles étoiem autrefois en France. Suppl. III. 4. b. Réflexion
fur l’ufngc d’en donner la repréfentation à la fuite dune tragédie.
V, 799. a. Petites pieces repréfentées chez les anciens
'Romains. I. 797. b. VI. 267. ^.Bouffonneries 8c obfcénités ad-*
mités fur les théâtres des anciens. X. 320. a. Des cabales
formées pour 8c contre le fuccés des pieces. Suppl. II. 88.
h. Du jugement que le parterre porte fur les pieces de théâtre.
Suppl. IV. 24:. a , b. Pieces fugitives. VII. yCo. a.
Pieces, {jurijpr.) Pièce adirée, arguée de fau x , arguée
de nullité, authentique, tic comparailon, compulfée, contrôlée,
inventoriée, paraphée, par e.xtrait, de produélioir
v u e , vidimée. XII. 366. a.
Puces, copie de pieces. X VII . 247. a, b. Coteries pieces.
iV . 304. b. Collatic.n de pièces. 111. 624. a , b. Comnniui-
cation de pieces. 729. b. Mandement eu venu duquel ie délofitalre
d’une pièce eft tenu de la repréfenter. 797. a , h.
)oflier des pieces. V.. 61. b. Pieces fauffes ou altérées. VI.
440. a , b. 449. a , b.
Pieces d'argent des Romains. {Monn. Antiq.) Les Romains
comptoient quelquefois par deniers, 8c le plus fouvent par
fefterces. Valeurs 8c marques de ces deux fortes de pieces.
X ll. 366. n.
Piece de fainte Hélène, ( Art numifm. ) forte de médaille
creufe. XII. 366. b.
Piece, {Mufiq.) acception de ce mot en mufique. Suppl.
IV . 366. b.
Pieces héraldiques , ( Blafon ) formes Sc dinienfions de
’écu. Maniéré géométrique de le tracer. Suppl. IV. 366.
Pieces honorables, énumération de dix pieces lioiiorables.
Pourquoi ces pieces ont été ainfi qualifiées. Comment 8c-à
quelle occafioii fe faifoit la colleftion ou concelTion des pieces
honorables. Multiplication de ces pieces par quelques
blafonneurs. XII. 366. b.
Pieces des armoiries. Suppl. I. 361. a. Pieces honorables.
109. b. Pofitions des pieces. 9 1 1. a. Pieces remplies.
y. 603. b.
Pieces honorables, pourquoi ainfi nommées. Leurs proportions
dans l’écu. Elles font au nombre de fept : favo ir, le
chef, la fafee, le pal, la croix j la bande, le ch e vron,
Suppl.lV.-^6j. a. Sc le fautoir. Manière d eles irzcer. Jbid. b.
Pieces honorables en nombre. Ch e f fous un autre chef. Deux
fafees, trois fafees; deux pals> trois pals; deux bandes, trois
bandes; deux chévrons , Suppl. IV. 367. b. trois chevrons:
maniéré de les tracer. Repartition ou divifions de Vécu. Ecu
fafcé; fâfcé de huit pieces. Paie; palé de huit pieces. Ban-'
dé ; bandé de huit pieces. Chevronné. Divifes , biireles , tran-
gles, vergeites, cotices. C h e f foutenu d’une d i v i f e . 368.
a. D iv i fe , lorfqu'il n’y a point de chef. Six bureles; huit
bureles. Cinq traiigles ; fept trangles. Une vergette; cinq
vergettes. Une cotice; deux cotices. Ibid. b. Cinq cotices.
Repartitions ou différentes divifions de l ’écu, 6- diverfes pieces.
Ecu burelé , vergetté , cocicé; points équipollés. Ecu échi-
queté , ibid. 369. a. lofangé , franc-canton ; canton dex-
tre , canton fenelire. Ecu gironné ; gironné de dix pieces,
gironné de douze pieces. Autres répartitions 6* pieces. Le
fur le tout. Ibid. b. Sur le.tout du tout. Brifurespour difinguer
les branches des anciennes 6- grandes maifons. Lambel, bâton
péri en bande. Bordure. Brlfure pour diflinguer les enfans
naturels, légitimés des grandes maifons : bâton péri en barre.
Ibid. 3 70. a.
Pieces honorables, {A r t hérald.) leur nombre Sc leur
defcripcion. Suppl. IV. 370. a.
Piece, {F.iuconn.) oifeau tout d’une piece. X ll. 366. h.
Piece, {Arpentag.) une certaine étendue de terre. XII,
366. b.
Piece , ( Comm. ) fignifie un tout , 8c quelquefois un« partie
du tout. XII. 566. b.
Pieces, {M onn.) ftgnification de ce mot en Angleterre.
SupprelTion des Jacobus dans ce royaume. XII. 366. b.
Piece de huit, ou piaflre. Sa valeur. Ses diminutifs. Deux
fortes de piaiires. Piece , maniéré de compter chez les nègres,
fur la côte d’Angola. Ibid. 367. b.
Piece d’Inde, {Comm.) dans le commerce de la traite
des iiegres. C e qu’on entend par negre piece d'Inde. Evaluation
des enfans des vieillards 8c des malades, dans le rapport
à la piece d’Inde. XII. 367. a.
Piece, ( Comm. d’Afriq.) maniéré de compter ufitée chez
les negres fur la côte d’Angola. XII. ^6 j.a.
Pieces détachées. {F o n if .) X ll. 367. a.
Pieces de campagne. { Artill.) XII. 367. a.
Pieces, { A n m/lit.) pieces de batterie. XII. 3Ô7. b.
Piece nette. {Artillerie) X ll. 367. b.
Piece. {Archit.) X ll. 567. b.
Piece d'eau. ( Archit. hydr.wl. ) XII. 367. b.
Pieces perdues. ( Hydr. ) X ll. 368. b.
Piece. {Marine) Piece de charpente; pieces de cliaffc ;
piece de corde. XU. 567. b.
Piece de détente. {Arquebuf.) XII. 567. i.
Piece de pouce. {Armur.) X ll. 3’67- b.
Piece. {Chapel.) X ll. 367. b.
Piece de charpente. ( Charpent.) XII. 367. b. Piecesde bois.
Pieces de pont. Ibid. 368. a.
Piece, (cordonn.) X ll. 368. a.
Pieces. {Grav. en bois) XII. 368. a.
Piece. {Jardin.) Pieces coupées dans un compartiment.
XII. 368. .3.
Piece gravée, ( Luther.) cfpece de fommiers dans les orgues
, fur lefquels ou place les tuyaux. Defeription. Piece
d’addition , piece ajoutée au fommier pour un nouveau jeu.
Defeription. XII. 368. a.
P iece d’appui. {Menuif.) P ic ^ quarree. XII. 368.-1.
Piece de rapport. {I^laçage) A il. 368. b.
Piece de rapport, {Bijoutier ) deux fignifications de ce mot.
X ll.36 8. é. • '
P iece de collier. {Metteur en oeuvre) XII. 368. h.
Pieces de corps , pour couvrir le dev:int de la taille des
foiimes. XII. 568. k — Suppl. Ul. 755. t.
Piece , ( Marchandes de mod. ) ajuflement qui fert aux
femmes pour couvrir le devant de leur corps. X ll. 368. h
Pieces de plaifr. {Monn.) X ll. 368. é.
P ie c e -/<;/oar. XII. 368.
Pieces de rapport en étain. X ll. 368. b.
Pieces. ( Relieur ) XII. 369. a.
Piece. {Rubannier) X ll. 569. a.
Piece ou Lardon, (ô’rrrür.) XII. 369.11.
Piece. ( Tourneur ) Piece de rencontre, piece ovale , pieces
irrégulières. XII. 369. a.
Piece de tuile. ( Tuilerie) XII. 369. a.
Piece de verre. ( Vitrier) Piece quarrée. XII. 369. a.
Piece. {Echecs) XII. 369. a.
P IÉ C O , {Canal de ) Suppl. III. 184. a.
P IE D , voysç PiÉ.
Pied, {Mu/iq. des anc.) différence entre les tems 8c les
pieds. Pieds fiiuples, & pieds compofés. Pieds rbythiniques
&. non rhythmiques. Suppl. IV. 370. a.
Pied-FicHÉ, croix au {B lafon ) Suppl. IV. 370. b.Voycr
vol. II. des pi. Blafon. pl. 4.
PIEDESTAL , ( Archit.) étym. de ce mot. Autres noms
donnés à cette partie. Deferiptions 8c proportions des pie-
deftaux des cinq ordres. X ll. 369. a , h. Piedeflalcompofé, con-
rinu, double, en adouciffement, en baluflrc , en talu-, flanqué,
tirégulier, armé , quarré, triangulaire, par faillies 8c
i-etraites, Piedeftaux acroteres. Ouvrages à confulier lur les
piedeftaux des cinq ordres. Ib'id. 370. a.
Piedejîal, defeription des piedeftaux dans les planches d’ar-
ch ited u re , contenues dans le vol. I. Piedeftaux antiques,
appellés hermathene, hermappoUon ,.hermanubis, 8cc. VIII
167. b. Piedeftaux des colonnes couplées. Suppl. II. 812. b.
P IEG E , {Ch.tffe) obfervations générales fur l’art de tendre
des piégés aux animaux frugivores, aux oifeaux , 6c aux
animaux qui vivent de rapine*. XII. 370. b.
Piégés de différentes efpeces, repréfentés vol. III. des pl.
Ch affe , pl. I I . 8c fuivantes. Maniéré ci’éventcr un ptCite.
,VI. 140. n.
P IEM O N T , ( Géogr.) contrée d’Italie. Ses bornes. Ses rivieres.
Mines des montagnes. ProdiiClion du pays. Nob'elTe
du Piémont. Abbayes 8c commanderies. Divilion géographique
de ce pays. Origine du nom qu'on lui donne. X*l. 371.
a. Son étendue. Anciens peuples qui l'ont habité. Anciennes
villes du Piémont. Quelles font celles qui eurent l'avantage
de recevoir de bonne heure l’évangile, 8c d'avoir des é v ê ques.
Archevêque de Turin. Villes ducales, capitales de
douze provinces. Ibid. b.
VliLyiOtit, parlement de {Jur'ifpr.) XII. 6a. a.
PIENZA , {Géogr.) ville d’Italie , patrie d'Enée S y lv 'u s ,
né en 1403, & connu enfuiie fous le nom du pape P,e II.
Hiftoire de fa vie. XII. 371. /».Auteur qui en a publié une,
que l’on foupçonne avoir été compofée par Enée Sylv ius,
lui-même. Editions de fes oeuvres. Divers ouvrages qu’il a
compofés. Traduélion de la lettre qu'il écrivit a fon pe-
r e , au fujet d’un fils qu’il eut d’une angloiié i Strasbourg,
dans le teins d’une de fes anibaffides dans cette ville. IbiJ.
372. b.
PIERIDES, {Myth.) filles de Pierus, roi de Macédoine.
Fable que les poeces en ont racontée. Sur quoi cette fable eft
fondée. On donne auflî aux mules le nom de Piérides, XII.
57V
PIERIE , ( Géogr. anc.) i° . contrée de la Macédoine. Ses
bornes. XII. 3 73--i- z “-— 9". Antres lieux de ce nom. Obfervations
fur Pierus, célébré po e ie , mufteien , natif de Pie-
rie en Macédoine , Sc fur fes filles. Pourquoi les mufes font
appellées Piérides p-u les poètes. Origine du nom de Pierie
donné à ce pays. Ouvrages de Quinuis Ciiton , hiftorien,
né àPiérie en Macédoine. Ibid. 374. u.
PIERRES, {M-nendog.) variétés entre les pierres pour la
confiftaiiCe , la couleur, la forme 6c les autres propriétés.
XII, 374. a. Peu d'accord entre les auteurs fur les divifions
méthodiques qu’ils nous en ont données M. Wallerius les
diftingue en quatre claffes; (avoir, en pierres calcaires, en
jnerres vitrefcibles, en pierres apyres, 6c en pierres compo-
fées. M. Pott les diviié en calcaires, gypfeufes, argiUeufes
8c apyres. M. Cartheufer les divife en pierres par lames,
pierres compofées de filets, pierres folides ou continues,
pierres par grains , 8c pierres mélangées. Ibid. b. Dlvi-
fion fautive qu’en fait M. de Jufti. M. de Croufted comprend
les pierres 8c les terres fous une même clafté, 6c il
les diftingue en calcaires 6c en filicécs. Obfervations fur toutes
ces divifions arbitraires. Il y a tout lieu de conjeéliircr
que toutes les pierres font effeuticllement de meme nature.
L ’eau oft le feul agent de la formation des pierres. Ibid. 373.
a. Examen des différentes maniérés dont elles peuvent lé
former. Hypothefe fur la cryft.-iUifation. D ’où dépencleui la
régularité 8c la traufparencc des cryftau-x. Ces cryllaux va-
AA^
rient en taifon de la terre qui étoit en dinbhnion dans l’eau >
6c qui leur (ert de bafe. Quand les eaux n’auroient point
par elles-mêmes la faculté de dilToudrc les moléuiles terreu-
fes , elles acquerroient cette faculté par ie concours des fubf-
tances lalines qui fouvent y font jointes. Comment on peut
expliquer la formation de ces malTes que l’on rencontre fouvent
dans la terre, 6c qui fout un mélange confus de plu-
fieiirs cryllaux de différente nature. Comment fc forment (cs
incruftations , les tufs, les ftalaftites, 8c les bancs de roches,
dardoifcs, de pierres à chaux, qui fe trouvent par couclies
dans le fein de la terre. Ibid. b. Hypothefe fur ]-a formation
du caillou. Toutes les pierres ont été originairement clans un
état de fluid; e. Preuves de cette vérité, tirée des phytoli-
tes , & différentes pierres figurées. Obfervatious par Icfquelles
on démontre c|ue les pierre-s fe forment journellement. Ibid.
376. a. Diftinétion des pierres, en pierres anciennes, 6c en
pierres récentes. Ibid. b.
Pierre irnuxere premiere 8c limonneufe des pierres. Suppl.
II. 42. b. Gluten qui fert à leur formation. 'V il, 723.-2. La
formation des ftalaélites nous donne une idée de la forniation
des pierres en général. XV, 409. a. Diftinétioii des pierres
en différentes claffes : de leur origine. Suppl, ill. 91. a , b.
6cc. 94. b. Caufe des veines d.ins les pierres. XVI, 873. b.
876. a. Pierres ftngulieres qu’on voit en EcolTc, qui fe pro-
duilént en quelques heures de tems. X. 144. u. Petit ver qui
vit d'ans les pierres. IX. 388./».
Pierres des Amarpines. ( Ph fiq. ) Où fe trouvent ces pierres.
Vertus admirables qu’on leur attnbuoit. Elles ne different
ni en couleur, ni en tlureié,du jade orienial. Les Américains
leur donnoienr différentes figures d'animaux. Efpcce
de fible par laquelle on expliquoir la polTibilité de telles t-pé-
rat ons. Difficulté de concevoir comment ces Américains ont
pu arrondir , polir 8c percer des ém ratifies. Rareté des pierres
vertes ou des amazones. X ll. 376. b.
Pierris des Am..ip^nes. VIII. 432. b. XVI. 417. a.
Pierres .ipyres, {^Mncral. ) celles qui ne fotirf'rcnt aucune
altération par l’aélion du Eu. Elles ne four point abrolumeiit.
apyres, puilqtie le miroir arclem les fait entrer en fufion. X IL
577 ,
Pierres à chaux, {Miner.) d’où dépend la bonne qualité
de la chaux faite avec ces pierres. X ll. 377. a. Voye^ Chaux
6c Chaufournier.
Pierre ffjütu/nnc , {Cbym.) efpece de compofition que
préparent les Chinois. Comment ils la préparent. Pr(»priétés
médicinales qu'ils lui attribuent. Raifon du nom qu'ils lui donneur.
X ll, 377. a.
Pierre cuméc, ( Minéral. ) IV. 248. b. VIII. 466. b,
467. b.
Pierres de croix, ( Miner. ) forte de pierres qui fe trouvent
en E'pagne. Defeription de cette pierre. Ufage qu’i.n font les
Efpagnols. X ll. 377. a. Vo\ IX 802. b.
P erre en croix , vol. V I des plaiiLlies, Cryftallifations ,
planche 8.
Pierre divine , voye^ Jade. XII. 377. a.
Pierre emprcinie, voye^ EMPRtltiTE , Phytoeite & T y -
POLITE.
Pierres empreintes de dfférenies figures de végétaux ou d’a~
nimuux , ( Oryâolog. ) diflérentes eipece.s de ces pierres dans
le régné anima! 8c dans le végéniL Suppl. IV. 371. u. Leur origine.
Où elles lé trouvent. Ibid. b.
Pierre de Us , ou fe trouve l’empreinte d'un lis. V. 634, b.
IX. 371./», vol. V I des planches. Régné minéral, planche
8.
Pierre étoilée , voye^ AsTÉRIE 8c AsTROtTE.
Pi e r r e s {OrySlolog.) ciailé de foffiles compofés
fie fibres ou de filamens , qui quel.jue bis s’érendent dans
toute la contexture du corps, d’autres fois font iiucnom-
pus pour fi'rmer des couches ou fies plaques. Leurs propriétés.
Deux ordres de pierres fibreufes Ditîérences fortes
de tneherix 8c de laclmides. Suppl. IV. 371, a.
Pierres de Florence , {Minéral.) leur defe.-iption. XII.
S77. b.
Pierres de Florence. VI. 8-7. 4. VIII. 533. 4. X. 71. 4. XII.
383. b , vcl. V I des planches , Coquilles foinies , plan-,
che 11 , 12.
fie'R.Ri.S gypfeufes, {Minéral.) vovr^GvpSE.
Vli.RRghydrophane, {M:néral.)V\\\. 373.é.
Pierre delai mes, {Minéral. ) IX 296. a.
P ierre ife lave , ( Minéral. ) iX. 3 11. é. 3 12. 4v
PiZRRE lenticulaire, {Miné-al.) IX. 3S3. b,
Pierre lunaire, { M-.néral.) IX. 723. /».
P\ERRt de MansfelJ, {Mméral.) X. 47.
V\iRR-E.noirc , {Minéral.) X ’ . 190.^.
PlERREo/foi'e , ( Minéral. )X I ,434.4.
Pierre philojophalc, ( Alchym. ) tout homme qui vend
pour de l’argent le fecret de faire de l’or eft un impofteur.
Reflexions lur les prétendus adepte^ 6c leurs fuperchenes.
D e l'impoftibilité de faiie de l’or par aucun des procédés de
l’art. Les aldiymiftes prétendent dilfoudre l’or en fes princir
; ' Il