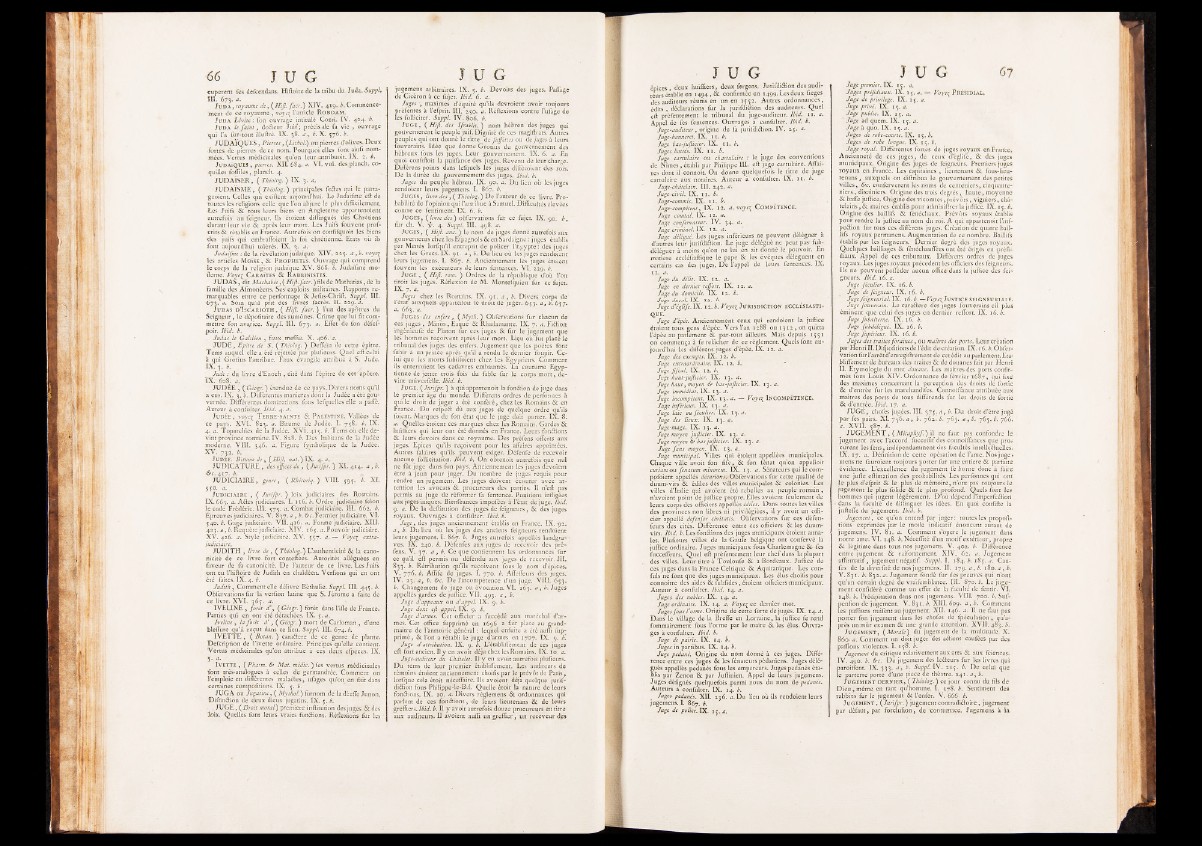
Ö6 J U G J U G
P) I
, ^
"
;
:
■ 3
■ .
1
■
1
i
'l '1
4
cupevent les clefcenclaiis. Hiftoirc de la tribu du Juin. Suppl.
5Ii. 673. U.
SVDA , roy.Jufnc Je, {Hiß. fucr.) X IV . 419. i , Commencement
de ce royaume , l'article ROBOAM.
JUDA Lévite: fon ouvrage intitulé Cozri. IV . 414- h.
Jl'DA U fa in t , doéteiir Juif; précis de fa vie , ouvrage
qui l’a fur-tout illulli'C. IX. 38. a , b .X . ^76./'.
JU D A ÏQ U E S , Pierres , {Liihol.) ou pierres d’olives. Deux
fortes de pierres de ce nom. Pourquoi elles ionc ainfi nommées.
Vertus médicinales qu'on leur attribuoic. IX. a. l>.
JuDAïQUis , pu-rus. XII. 684. </. VI. vol. dcs planch. coquilles
foliiles, piandi. 4.
J U D A iS tR , ( Théolo;^.) IX. 3.
JU D A ÏSM E , {Thèolog.) ))riucipalos fedes qui le parta-
geoient. Celles qui exifli.nt aujourd'hui. Le Judailine ert de
toutes les religions celle que l'on abjure le plus diflicilemem.
•Les Jirifs & tous leurs biens en Angleterre appartenoient
autrefois au feigueur. Ils ctoient diilingués des Chrétiens
durant leur vie & après leur mort. Les Juifs foiivent prof-
critsSc rétablis en Erancc. Autrefois ou courtfquoit les biens
des juifs qui embiaffoient la foi chrétienne. Etats où ils
font aujourd'hui tolérés. IX. 3. j .
JiuLtifmc : <\q la révélation judaïque. X IV. 123. a ,b .
les articles .MoïSE, & Pro phètes. Ouvrage qui comprend
le corps de la religion judaï((uc XV'. 868. b. Judaïlme moderne.
Voyei C araïtes & R abbinistes .
JU D A S , dit Machabie ,{Hiß.facr.^f\\'sd,'i Muthatias,de la
famille des Afmonécns. Ses exploits militaires- Rapports remarquables
er.tre ce perfonuage & Jefus-Chrifl. Suppl. III.
673. J. Soin qu’il prit des livres facrés. IL 229. a.
Ju d a s d’Is c a r iOt h , ( Hiß. f i e r .) l’im des apôtres du
Seigneur, le dépofitaire des aumônes. Crime que lui fit commettre
fon avarice. Suppl. III. 673. a. Eftet de fon dclef-
poir. Ibid. k.
Judas le Galïlcen , faux meffie. X. 406. a.
JU D E , Epdre de S. ( Tkeoloß. ) DelTein de ccîte épître.
Tems auquel elle a été rejeirée par plufieuis. Quel e ficd t ii
à qui Grotius l’attribue. Faux évangile attribué à S. Jude.
î- .
Jude : du livre d’Enoch , cité dans l’epître de cet apôtre.
IX. 608. it.
JUDÉE , ( GJogr. ) étendue de ce pays. D ivers noms qu'il
a eus. IX. 3. b. DifFérentes manières dont la Judée a été gouvernée.
Différentes dominations fous Iclquellcs elle a paffé.
Auteur à confuher. Ibid. 4, a.
Ju d é e , vovq T erre-saînte &. Palest ine. Vallées de
ce pays. X V l. S23. a. Bitume de Judée. I. 738. b. IX.
4. a. Toparchies de la Judée. X V i. 413. b. Tems où elle devint
province romaine. IV, 828. b. Des habicans de la Judée
moderne. VII I. 346. a. Figure fymboliqiic de la Judée.
X V . 732. b.
JUDEE. Bitume de , {Hiß. n a t .) lX . 4. .i.
JU D IC A TU R E , des offices de , {Jurifpr. ) X L 414. ^ , b.
iÛDTCIAIRE, genre, {R/iéloriq.) VUI. 593. b. XI.
530.
Ju d ic ia ir e , ( Jurifpr. ) loix judiciaires des Romains.
IX .663. a. Aéles judiciaires. I. 116. b. Ordre judiciaire felon
le code Frédéric. 111. 373. a. Combat judiciaire, l l ï . 662. b.
Épreuves judiciaires. V . 837. a , b. S-c. Fermier judiciaire. VI.
340. h. Gage judiciaire. V II . 416. a. Forme judiciaire. X llI .
403. d,b. Reqitétejudiciaire. X IV . 163. j .P ouvoir judiciaire.
X V . 426. J. Style judiciaire. X V . 337. a. — exiraludiciaire.
JU D ITH , livre de , ( Thèolog. ) L’authenticité & la cano-
nicité de ce livre fort contellées. Autorités alléguées en
faveur de fa canonicité. D e rameur de ce livre. Les Juifs
ont eu rhiftoire de Judith en chaldéem Verfions qui en ont
été faites. IX. 4. b.
Judith, Comment elle delivre Béthulie. Suppl. III, 443. b.
Obfervations fur la verfion latine que S. Jérome a faite de
ce livre. X V L 363. a.
IV'ELINE , j'orct d’ , { Géogr. ) forêt dans l’ifle de France.
Parties qui en ont été détachées. IX. 3. a.
Iveline , l.j forêt d’ , { Géogr. ) mort de Carloman , d’une
bleflùre qu’il reçut dans ce lieu. Suppl. III. 674./'.
IV E T T E , ( Botan. ) carafteie de ce genre de plante.
Defeription de l’ivette ordinaire. Principes qu'elle couticut.
Vertus médicinales qu’on attribue à ces deux cfpeces. IX.
5. .1.
Ivette , ( Phatm. & Mat. mcdic. ) fes vertus médicinales
font très-analogues à celles de gormandrée. Comment
l’emploie en cliftéremes maladies, ufages qu’on en fait d
certaines compofttions. IX. 3. b.
t dans
JUGA ou Jugatine, ( Mythol.') fiirnom de la deeffe Junon.
Difiinélion de deux dieux jugatins. IX. 3. b.
JUGE , {Droit moral) premiere infflrution des juges & tics
loix. Quelles font leurs vraies fonélions. Réilexions fur les
jugemeiis arbitraires. IX. 3. b. Devoirs des juges. Pafl'age
de Cicéron à ce fujet. Ibid. 6. a.
Juges , maximes d’équité qu’ils dcvroîent avoir toujours
préfentes à rcfprit. 111. 230. a. Réflexions contre Tufage de
les folliciter. Suppl. IV . 806. b.
Ju g e , {H iß . des Ifraèiu.) nom hébreu des juges qui
gouvernèrent le peuple juif. Dignité de ces magiftrttts. Antres
peuples qtti ont donné le titre de jiiffieiu-s ou de juges à leurs
fouverains. Idée que donne Grotius du gouvernement des
hébreux fous les juges. Leur gouveruement. IX. 6. En
quoi confifioit la puùrance des juges, Revenu de leur charge.
Difi'é-.-cns points dans lefquels les juges diriéiolent des rois.
D e la durée du gouvernement des juges. Itid. b.
Juges du peuple hébreu. IX. 90. a. Du lieu où les juges
rendoient leurs jugemens. l. 867. b.
Juges , livre des, ( Théohg.) De l'auteur de ce livre. Probabilité
de l’opinion qui rntiribue à Samuel. Ditficultés élevées
contre ce fentinient. IX, 6. b.
Ju g e s , {livre des) obfervations fur cc fujet. IX. 90. b,
fur ch. V. ÿ ’ . 4. Suppl. III. 498. a.
Ju g e s , ( Hiß. anc. ) le nom de juges donne autrefois aux
gotiverueurs chez IciElpagnols & en Sardaigne : juges établis
par Menés lorfqu’il entreprit de policer l'Egypte: des juges
citez les Grecs. IX. 91. a , b. Du lieu oit les juges rendoient
leurs jugemens. 1. 867. b. Anciennement les juges étoicnt
fotivent les exécuteurs de leurs fentences. VI, 229. b.
Juge , ( H ß . rom. ) Ordres de la république d’où l'on
tiroii les juges. Réfiexion de M. Montelquieu fur ce fujet.
IX, 7, a.
Juges chez les Romains. IX. 91. a , k. Divers corps de
l'état auxquels appartenoit le droit de juger. 633. a , b. 657-
JuGES-iJer enjers, OLfervations fur chacun de
ces juges , Minos, Eaqiic & Rliadamame. IX. 7. a. Fiélion
ingénicule de Platon fur ces juges & fur le jugement que
les hommes reçoivent après leur mort. Liçii où fut placé le
tribunal des juges des enfers. Jugeinenr que les poètes font
ftihir à un prince après qu’il a rendu le dentier Ibupir. C e lui
que les morts fubiiToient chez les Egyptiens. Comment
ils enterroiem les cadavres embaumés. La counimc Egyptienne
de jener trois fois du fable fur le corps mo rt, devint
tiniverfelle. Ibid. b.
Ju g e . {Jurifpr. ) à qui appartenoit la fonition de juge dans
le premier âge du monde. Dift'érens ordres de perfonues à
qui le droit de juger a été conféré, chez les Romains & en
France. Du refpefl dû aux juges de quelque ordre qu’ils
foient. Marques de fon état que le juge doir porter. IX. 8.
a. Quelles étoienr ces marques chez les Romains. Gardes &
huilliers qui leur ont été donnés en France. Leurs fonilions
Sc leurs devoirs dans cc royaume. Des préfens offerts au.x
juges. Epices qu’ils reçoivent pour les affaires appointées.
Autres falaires qu’ils peuvent exiger. Défcnfe de recevoir
aticuue follicitatioii. Ibid. b. On ohtenoit autrefois que nul
ne fût juge dans fon pays. Anciennement les juges dévoient
être à jeun pour juger. Du nombre de juges requis pour
rendre un jugement. Les juges doivent écouter avec ar-
rention les avocats 8c procureurs des parties. Il n’eft pas
permis au juge de réfornter fa fcntcncc. Pimiitons infligées
aux juges iniques. Bienféances impofees à l’état déjuge. Ibid.
9. a. D e la deffitution des juges de feigneurs, Sc des juges
royaux. Ouvrages à confultcr. Ibid. b.
Juge, des juges anciennement établis en France. IX. 92.
a , b. Du lieu où les juges des anciens feigneurs rendoient
leurs jugemens. I. 867. b. Juges autrefois appellés landgva- •
ves. IX. 240. b. Défenfes aux juges de recevoir des préfens.
V . 37. a , b. Ce que contiennent les ordonnances fur
ce qn’il eft permis ou défendu aux juges de recevoir. IH.
833. b. Rétribution qu’ils reçoivent fous le nom d'épices.
V . 776. b. Aflîfe de juges. I. 770. h. Afl'jffeurs des juges.
IV . 23. a, b. &c. D e l’incompércncc d’un juge. VIII. 633.
b. Changement de juge ou évocation. V I . 163. a , b. Juges
appellés gardes de jiifiice. VII, 493. , b.
Juge d\ippcatix ou d'.ippel. IX. 9, b.
Juge dont ejl appel. IX. 9. b.
Juge d'armes. Cet oflàcicr a fuccédé aux maréchal d’armes.
Cet olBce fuppriiné en 1696 a fait place au grand-
maître de l’armoiric général : lequel enUiitc a été auffi fuppriiné,
8c l’on a rétabli le juge d’armes en 1707. IX. 9. b.
Juge d'attribution. IX. 9. b. L’établiflemcnt de ces juges
eft fort ancien. Il y en avoir déjà chez les Romains. IX. 10 a.
Juge-auditeur du Châtelet. 11 y en avoir autrefois plufieitrs.
Du tems de leur premier établiffemenc. Les auditeurs de
témoins étoient anciennement choifis par le prévôt de Paris,
lorfque cela étoit néceffaire. Ils avoient déjà quelque jurif-
diélion fous Philippe-le-B.-l. Quelle étoit la nature de leurs
fonébons. IX. 10. a. Divers réglemeus 8c ordonnances qui
p.trlent de ces fotiélions, de leurs licutenans 8c de leurs
greffiers. Ibid. b. H y avoir autrefois douze procureurs en titre
aux auditeurs. Il avoient auffi un greffier, un receveur des
J U G épices, deux huiftiers, deux fergeus. Juvlfdiiftion des auditeurs
énablie en 1494 , Sc confirmée en 1499. Les deux fteges
des auditeurs réunis en un en 133a. Autres ordonnances,
édits , déclarations fur la jiirifdiélion des auditeurs. Quel
eft préfeiiremenc le tribunal du juge-aucliteiir. Ibid. i i .
Appel de fes fentences. Ouvrages à confultcr. Ibid. b.
Juge-auditeur, oue jm de fa jurifdiélion. IV . 23. u.
Jitge-banncret. IX. i i . b.
Juge bas-jiijlicier. IX. il. b.
Juges bottés. IX. I I . é.
Juge cartuLitre Ou chartul.iire : le juge des conventions
de hîimes , établi par Philippe HL eft juge caruflaire. Affaires
dont il connoît. On donne quelquefois le titre de juge
cnrtulaire aux notaires. Auteur à confulter. IX. i i . i.
Juge-cLiteLiin. III. 242. a.
Juge-civil. IX. i t . b.
Juge-commis. IX. i i . b.
Juge-compétent, IX- 12. a. voye^ COMPÉTENCE.
Juge comtal. IX. 12. a.
Juge confervatcur. IV . 34. a.
Juge criminel. \X. 12. a.
Juge délégué. Les juges inférieurs ne peuvent déléguer à
d’autres leur jnnfdi<ftion. Le juge délégué ne peut pas- lub-
déléguer à moins qu’on ne lui en ait donné le pouvoir. En
matière eccléfiaftiqiie le pape 8c les évoques délèguent en
certains cas des juges. D e l’appel de leurs feiucnccs. IX.
Juge du délit. IX. 12. a.
Juge en dernier refjort. IX. 12. u.
Juge du domicile. IX. 12. b.
Juge ducal. IX. 11. b.
Juge d'églife. IX. 12. b. Voye^ JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE.
Juge d'épée. Aucieniiement ceux qui rendoient la juftice
ctoient tous gens d’épée. Vers l’an 1288 ou 1 312 , on quitta
l’épée au parlement 8c par-tout ailleurs. Mais depuis 1331
on commença à fe relâcher de ce réglement. Quels font aujourd’hui
les différens juges d’épée. IX. 12. a.
Juge des exempts. IX. 12. b.
Juge extraordinaire. IX. 12. é.
Juge fifcal. IX. 12. b.
Juge haut-juflicier. IX. 13. a.
Juge haut, moyen & bas-jiijlicier. IX. 13. a.
Juge immédiat. IX. 13.
Juge incompétent. IX. 13. a. — Key«{ INCOMPÉTENCE.
Juge inférieur. IX. I3. a.
Juge laïc ou féculicr. IX. 13..?.
Juge des lieux. IX. 13. u.
Juge-mage. IX. 13. <ï .
Juge moyen juflicier. IX. 13. <i.
Juge moyen éÿ basjuf icier. IX. 13. J.
Juge fans moyen. IX. 13. a.
Juge municipal. Villes qui étoient appellees municipales.
Chaque ville avoir fon fife , 8c fon fénat qu’on appelloir
curiam ou fenatum minorem. IX. 13. a. Sénateurs qui le com-
pofoient appellés décurions. Obfervations fur cette qualité de
diuim-virs 8c édiles des villes municipales 8c colonies. Les
villes d’Italie qui avoient été rebelles au peuple romain ,
n’avoient point de juftice propre. Elles avoient feulement de
leurs corps des officiers appellés édiles. Dans toutes les villes
des provinces non libres ni privilégiées, U y avoir un officier
appelle defenjor civitatis. Obfervations fur ces défen-
feiirs des cités. Différence entre ces officiers 8c les duumvirs.
Ibid. b. Les fonélions des juges municipaux étoient annales.
Plufieurs villes de la Gaule belgiquc out confervé la
juftice ordinaire. Juges municipaux fous Charlemagne Sc- fes
fucceffeurs. Quel eft préfentement leur chef dans la plupart
des villes. Leur titre :i Toiiloufe 8c à Bordeaux. Juftice de
ces juges dans la France Celtique 8c Aquitanique. Les con-
fuls ne font que des juges municipaux. Les élus choifis pour
connoitre des aides 8c fubfides, étoient officiers mimicipaux.
Auteur à confultcr. Ibid. 14. a.
Juges des nobles. IX. 14. a.
Juge ordinaire. IX, 14. a. ce dernier mot.
Juges fous l'orme. Origine de cette forte de juges. IX. 14. a.
Dans le village de la Breffe en Lorraine, la juftice fe rend
fommaircment fous Forme par le maire 8c les élus. Ouvrages
à confulter. Ibid. b.
Juge de pairie. IX. 14. b.
Juges \n partibus. IX. 14. b.
Juge pedané. Origine du nom donné à ces juges. Différence
entre ces juges 8c les féiiaieurs pédaniens. Juges délégués
appellés pedanés fous les empereurs. Juges pedanés établis
par Zenon 8c par Juftinien. Appel de leurs jugemens.
Juges defignés quelquefois parmi nous du nom de pedanés.
Auteurs à confulter. IX. 14. b.
Juges pedanés. XII. 236. a. Du lieu où üs rendoient leurs
jugemens. 1. 867. b.
Juge de police. IX. 13.
J U G 67 Juge premier. \X. 13. a.
Juges préfidiiux. IX. 13. d. •— Voyei pRÉSIDlAL,
Juge de privilège. IX. 13. a.
Juge privé. IX. 13. a.
Juge public. IX. 13. a.
Juge aci qiiem. IX. 13. a.
Juge à quo. IX. 1 3. a.
Juges Je robe-courte. IX. 13. b.
Juges de robe longue. IX. 13. b.
Juge royal. Différentes fortes de juges royaux en France.
Ancienneté de ces jug es, de ceux d’églife, 8c des juges
nuinicipaux. Origine des juges de feigneurs. Premiers juges
royaux en France. Les capitaines , lieiitenans 8c fous-licu-
renaiis , auxquels ou diftribua le gouvernement des petites
ville s, &c. conferverent les noms de centeiiicrs, cinqiiame-
nlers, dixainiers. Origine des trois degrés, haute, moyenne
8c baffe juftice. Origine des vicomtes, prévôts , viguiers, châtelains
, 8c maires établis pour adminiftrer la juftice. IX, 13. b.
Origine des baillifs 8c féncchaux. Prévôts royaux établis
pour rendre la juftice nu nom du roi. A qui appartenoit Finf-
peélion fur tous ces dift'érens juges. Création de quatre baillifs
royaux pennanens. Augmentation de cc nombre. Baillifs
établis par les feigneurs. Dernier degré des juges royaux-
Quelques bailliages Sc fénéchauffées ont été érigés en préfi-
diaux. Appel de ces tribunaux. Différens ordres de juges
royaux. Les juges loyaux précèdent les officiers des feigneurs.
Ils ne peuvent polTedcr aucun office dans la juftice des feigneurs.
Ibid. 16. a.
Juge féculicr. IX. 16. h.
Juge de feigneur. IX. 16. b.
Juge feigncuri.ü. IX, 16. b. JUSTICE SEIGNEURIALE.
Jii-^e jouverain. Le caraélerc des juges fouverains eft plus
éminent que celui des juges en dernier reffori. IX. 16. b.
Juge jubalterrie. IX. 16. b.
Juge fubdélégué. IX. 16. b.
Juge fupérieur. IX. 16. h.
Juges des traites foraines, ou maîtres des ports. Leur création
par Henri II. Difpofitionsde Fcdit de création. IX. 16. b. O bfcr-
vation furFarréid’enrcgiftrement de cet édit au parlement. Eta-
bliflemenrde bureaux des traites 8c de douanes fait par Fleuri
II. Etymologie du mot douane. Les maîtres des ])orts confirmés
fous Louis X IV . Ordonnance de février 1687, qui fixé
des maximes concernant la jierceptioii des droits de fortie
8c d’entrée fur les marehandifes. Connoiirancc attribuée aux
maîtres des ports de tous dlfterends fur les droits de fouie
8c d’entrée. Ibid. 17, a.
JU G É , chofes jugées, n i . 373. a , b. Du droit d’être jugé
par fes j>airs. XI. 736. u , b. y6z. b. 763. a , b. 765. é. 766.
a. X V I I . 387. b.
JU G EM E N T , {Mciaphyf.) ï\ ne faut pas confondre le
jugement avec l'accord ûiccelfif des connoiftances que pror
curent les feus, iiidépendammeiu des f.tcultés intelleéluelles.
IX. 17. a. Définition de cette opération de Famé. Nos juge »
mens ne fauroieut toujours porter fur nue entière 6c parfaite
évidence. L ’excellence du jugement fe borne donc à faire
une jufte eftimatlon des probabilités. Les perfonues qui ont
le jflus cl’efprit Sc le plus de mémoire, n’ont pas toujours le
jugement le plus folide 8c le plus profond. Quels font les
hommes qui jugent légèrement. D ’où dépend l'imperfeéHoit
dans la faculté de diftinguer les idées. En quoi confifte la
juftclTe du jugement. Ibid. b.
Jugement, ce qu’on entend par juger: toutes les propoft-
tions exprimées par le mode indicatif énoncent autant de
jugemens. IV . 81. a. Comment s’opère le jugement dans
notre ame. V I . 148. b. Néceffué d’un motif extérieur, propre
8c légitime dans tous nos jugemens. V. 402. b. Dift'ércnce
entre jugement 8c raifonnement. X IV . 62. a. Jugement
affirmatif, jugement négatif- Suppl.}. 184. ^.183.^, Cati-
fes de la diverfité de nosjugemeiis. II. 179. a, h. 180. a , b.
V. 831. é. 832. U. Jugement fondé fur des preuves qui n’ont
qu’un certain degré de vrnifeinblance. III. 870. b. Le jugement
confidèré comme un eft'et de la foculté de fcutir. VI.
148. b. Précipitation dans nos jugemens. VIH. 700. b. Siif-
penfion de jugement. V. 831. é. XIH. 609. a , b. Comment
les paffions nuifent au jugement. XII. 146. a. Il ne taui pas
porter fon jugement dans les chofes de fpéculation , qu’a-
près un mûr examen 8c une grande attention. XVII . 483. b.
Jug emen t , {Morale) du jugement de la nmltituc'c. X.
860 a. Comment on doit juger des affions cauféos par des
paffions violentes. 1. 1 38- b.
Jugement du critique relativement aux arts & aux feiences.
IV . 490. b. &c. Du jugement des leéleurs fur les livres qui
paroilfent. IX. 333. a , b. Suppl. l \ . 213. b. D e celui que
le parterre porte d’une picce de théâtre. 241. a, b.
Jugement d ernier, ( Théolog. ) ce jour connu du fils de
D ie u , même en tant qu’homme. I. 178. b. Sentiment des
rabbins fur le jugement 8c Fenfer. V . 666- b.
Jug emen t , {Jurifpr.) jugementcontradi>ftoire, jugement
par défaut, par forclufion, de contumace. Jugemens à la