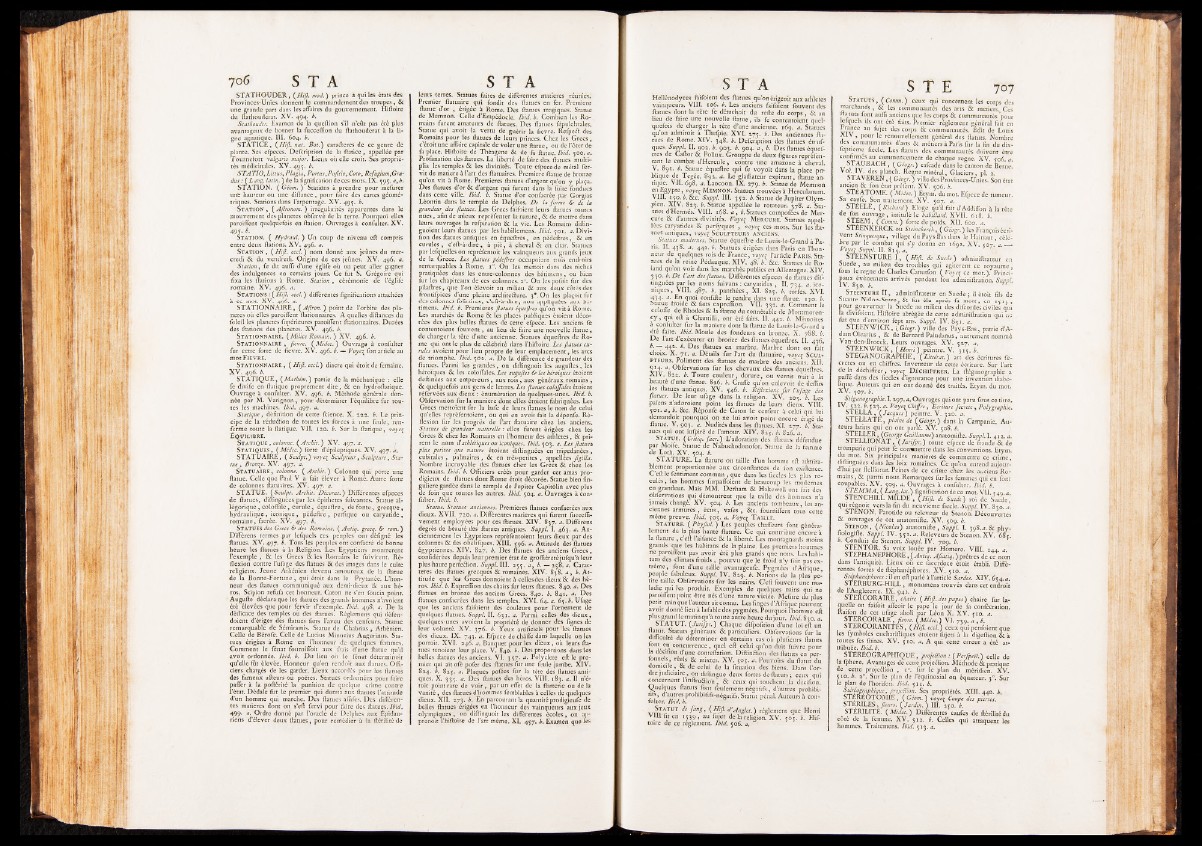
T
II' l'i ' I^J rn't!i'^'«lp
Il ' H v ï f f
il i’M
j
'u ■!
; It
ï 1 'H il
706 s T A
S T A T H O U D E R , (///y?./«o.î'.) prince à fjn lles états des
Provinces'Unies donnent le coniinnndementdes troupes, &
une grande part dam les affaires du gouverneinent. Hiftoire
du ftathonderar. X V. 494. b.
SiuihouJcr. Examen de la qneOion s’il n'eilt p.as été plus
av.amagcux de borner la fucceflion du ftatbouderat à la ligne
agnatique. III. 604. b.
S T À T IC E , {Hip. nat. Bot.'j caraéleres de ce genre de
plante. Scs elpeces. Dofeription de la ffaticc, appellée par
Tournefort vulgaris major. Lieux oii elle croit. Ses propriétés
médicinales. X V . 49^. b.
STA T IO , Linus, Plagia, Portas, Poßiio, Coro, Refugium,Gra-
dus : ( Lang, latin. )d e la lignification de ces tnots. IX. 595. d .i.
ST A T IO N . ( Céovi. ) Stations à prendre pour mefurer
line haïueur ou une diffance , pour faire des cartes géométriques.
Stations dans l’arpentage. X V . 49^. b.
St a t io n , ( Aßronom. ) irrégularités apparentes dans le
mouvement des planeres obfervé de la terre. Pourquoi elles
paroiffent quelquefois en rtatton. Ouvrages à confulter. X V .
A%- é.
St a t io n . ( Hydraul. ) Un coup de niveau eff compris
entre deux Hâtions. X V . 496. a.
St a t io n , {_Hip. eccl.j nom donné aux jeûnes du mercredi
lie du vendredi. Origine de ces jeûnes. X V . 496. a.
Station, fe dit auffi d’une églife où on peut aller gagner
des indulgences en certains jours. Ce fut S. Grégoire qui
fixa les nations à Rome. Station , cérémonie de l’églife
romaine. X V . 496. a.
St a t io n s : ( ^/y?. eccl.) différentes fignilîc.'itions attachées
à ce mot. X V . 406. a.
STA T IO N N A IR E , ( Aßron. ) point de l’orbite des planètes
oii elles paroiffent Hationnaires. A quelles diflances du
foleil les planeres fupérieures paroiffent llationnaires. Durees
des Hâtions des planètes. X V. 496. b.
St a t io n n a ir e . {Milice Romain.) X V . 496. b.
St a t io n n a ir e , fievre. {Mcdec.) Onvraga à confulter
fur cette forte de fievre. X V . 496. b. — Foye:^ Ton article au
mot F ie vre .
St a t io n n a ir e , ( Hiß. eccl.) diacre qui étoit de fcmainc.
X V . 496. b.
S T A T IQ U E , {Mathîm.) partie de la méclianiquc : elle
fe divife en H.itique proprement dite, & en hydroflatique.
Ouvrage à confulter. X V . 496. b. Méthode générale donnée
par M. Varignon, pour déterminer l’équilibre fur toutes
les machines. Ibid. 497. a.
Statique, définition de cette fciencc. X. 222. h. Le principe
de la réduéllon de toutes les forces à une feule, renferme
toute la Hatique. VII. 120. b. Sur la Hatiqite, voyei
É q u il ibr e .
St a t iq u e , ct>/o/;/2c. ( ) X V . 497. <7.
Statiques, {Mcdcc.) forte d’épileptiques. X V . 497. .7.
S T A T U A IR E , {Sculpt.) voye^ Sculpteur, Sculpture, Statue
, Bronze. XV. 497. a.
St a t u a ir e , colonne. {A r ch h .) Colonne qui porte une
Hatue. Celle que Paul V a fait élever à Rome. Autre forte
de colonnes Hatmires. X V. 497. a.
S T A TU E . {Sculpt. Archh. Décorât.) Différentes efpeccs
de Hantes, diHinguées par les épithetes fuivames. Statue allégorique
, coloHalc , ciirule , équcllre, de fonte, grecque,
hydraulique , icoiilque , pédeHre , perfique ou caryatide ,
romaine, facréc. X V. 497. b.
Statues des Grecs & des Romains. ( Ar.tiq. grecq. & rom. )
Différens termes par lefquels ces peuples ont défigné les
Hatues. X V . 497, b. Tous les peuples ont confacré de bonne
heure les Hatues à la Religion. Les Egyptiens montrèrent
l’exemp le, & les Grecs Scies Romains le fuivirent. Réflexion
contre l’ufage des H.mies ôc des images dans le culte
religieux. Jeune Athénien devenu amoureux de la Haute
de la Bonne-Fortune , qui étoit dans le Prytance. L’honneur
des Hatues comimmiqué aux demi-dieux >k aux héros.
Scipion refufa cet bonnetir. Caton ne s’en foucia point.
AiiguHe déclara que les Hautes des grands hommes n’avoient
été élevées que pour fervir d'exemple. Ibid. 498. a. D e la
dédicace des temples ou des Hatues. Rcglcmens qui défen-
doiem d’ériger des Hatues fans i'aveu des cenfciirs. Statue
remarquable de Sémiiamis. Statue de Chabrias , Athénien.
Celle de Bérofe. Celle de Lucius Minncius Augurinns. Statues
érigées à Rome en fhonncur tic quelques femmes.
Comment le fénat fourniffoit aux fr.iis d’une Hatue qu’il
avoir ordonnée. Ibid. b. D u lieu où le fénat détcrniinoit
qu’elle fût élevée. Honneur qu’on r endoit aux H.irtics. Officiers
chargés de les garder. Lieux accordés pour les Hautes
des fameux afleurs ou poètes. Statues ordonnées pour faire
paffer à la poHérité la punition de quelque ci-ltrie contre
i ’état. Dédale fut le premier qui donna aux Hautes l’attitude
d’un homme qui marche. Des Hautes afhfcs. Des différentes
matières dont on s’eH fervi pour faire des Hautes. Ibid.
499. a. Ordre donné par l’otacle de Delphes aux Épidait-
riens d’élever deux Hautes, pour remédier ù la Hériiiiéde
S T A
leurs terres. Statues faites de différentes m.atîeres réunies.
Premier Hatuaire qui fondit des Hautes en fer. Première
Haute d’or , érigée à Rome. Des Hatues magiques. Statue
de Memnon. Celle d’Empédode. Ibid. b. Combien les Romains
furent amateurs de Hautes. Des Hatues fépiilchrales.
Statue qui avoir la vertu de guérir la fievre. RefpeH des
Romains pour les Hatues de leurs princes. Chez les G rec s ,
c’étoitune affaire capitale de voler une Hatue, ou de l’oter de
fa place. HiHoife de Théagene & de fa Haute. Ibid. 500. a.
Profanation des Hatues. La "liberté de faire des Hautes multiplia
les temples & les divinités. Tome efpeccde métal fer-
vit de matière à l’art des Hatuaires. Premiere Haute de bronze
^ ’on vit à Rome. Premieres Hatues d’argent qu’on y plaça.
Des Hatues d’or & d’argent qui furent dans la fuite fondues
dans cette ville. Ibid. b. Statue d’or confacrée par Gorgias
Léontin dans le temple de Delphes. De la forme de la
grandeur des Parues. Les Grecs fail'oient leurs Hautes toiite-s
nues, afin de mieux reprefenter la nature, & de mettre dans
leurs ouvrages la refpiraiion Sc la vie. Les Romains diHin-
giioient leurs Hatues par les habillemcns. Ibid. 501. a. Divi-
fion des Hautes antiques en équeHres , en pédeHres, & en
curules , c’eH-ii-dire, à p ié, à cheval ik en char. Statues
par lefq|ieHes on repréfentoit les vainqueurs aux grands jeux
de la Grece. Les jlacues pédeftres occupoienr trois endroits
remarquables à Rome. i ”. On les mettoit dans des niches
pratiquées dans les entre-colonnes des bâtimeiis, ou bien
fur les chapiteaux de ces colonnes. 2". On les pofoit fur des
pliaHres, que l’on clevoit au milieu & aux deux cotés des
froiitifpices d’une pleine architeililure. 3*. On les plaçoit fur
des colonnes folitaires, c’eH-à-dire, non appliquées aux b.;-
timens. Ibid. b. Premieres (îatues équejlres qu’on vit à Rome.
Les marchés de Rome & les places publiques étoieiit décorées
des plus belles Hatues de cette efpece. Les anciens fe
contentoienc fou v ent, au lieu de faire une nouvelle Hatue,
de changer la tête d’une ancienne. Statues équeHres de Rome
qui ont le plus de célébrité dans I’liiHoire Les pataes cu-
riiles avoient pour lieu propre de leur emplacement, les arcs
de triomphe. Ibid. 502. a. D e la différence de grandeur des
Hatues. Parmi les grandes, on diHinguoit les àuguHcs , les
héroïques Sc les coloffales. Les aiigupes 6* les héroïques étolcnt
deHinées aux empereurs, aux ro is , aux généraux romains ,
& quelquefois aux gens de lettres. Les païues coloffales écoienc
réfervées aux dieux : énumération de quelques-unes. Ibid. b.
Obfervation fur la maniéré donc elles étoiciu fabriquées. Les
Grecs mettoient fur la bafe de leurs Hatues le nom de celui
qu’elles roprefentoient, ou qui en avoit fait la dépenfe. Ré-
flo.xion Hir les progrès de l’art Hatuaire cliez les anciens.
Statues de grandeur n.uurdle : elles furent érigées chez les
Grecs & chez les Romains en l’honneur des athletes, & prirent
le nom ^’athlétiques ou iconiques. Ibid. 503. a. Les patua
plus petites que nature éioient diHinguées en tripedanées,
cubitales , palmaires, &; en très-petites , appellees fgilla.
Nombre incroyable des Hatues chez les Grecs Si. chez les
Romains. Ibid. b. Officiers créés pour garder cet amas prodigieux
de Hatues dont Rome étoit décorée. Statue bien Hn-
guiiere gardée dans le temple de Jupiter Capitolin avec plus
de foin que toutes les autres. Ibid. 504. a. Ouvrages à confulter.
Ibid. b.
Statue. Statues anciennes. Premieres Hatues confacrées aux
dieux. XVII. 720. <7. Différentes matières qui furent fucceffi-
vement employées pour ces Hatues. X IV . 837. a. Différens
degrés de beauté des Hatues antiques. Suppl. î. 463. a. Anciennement
les Egyptiens repréfentoient leurs dieux par des
colonnes & des obélirques. XIII. 596. a. Attitude des Hatues
égyptiennes. X IV . 827. b. Des Hatues des anciens G re c s ,
confidérées depuis leur premier état de groffiéretéjiifqu’h leur
plus haute perféflion. Suppl. III. 2^^. a , b. — 2^8. a. Caractères
des Hatues grecques & romaines. XIV. 838. a , b. Attitude
que les (ji'ccs donnoient à celles des dieux & des héros.
Ibid. b. Expreflîon des chairs fur leurs Hatues. 840. a. Des
Hatues en bronze des anciens Grecs. 840. b. 841. a. Des
Hatues confacrées dans les temples. XVI. 64. a. 6e,. b. Ufage
que les anciens faifoient des couleurs pour l’ornement de
quelques Hatues. Suppl. II. 631. a. Parmi celles des d ieux,
quelques-unes avoient la propriété de donner des Agnes de
leur volonté. X V . 376. b. Yeux artificiels pour les Hatues
des dieux. IX. 743. a. Efpece de cliàlîe dans laquelle on les
ponoit. XVI, 246. a. Banquet pour les dieux, où leurs Hatues
tenoient leur place. V. 840. b. Des proportions dans les
belles Hatues des anciens. VI. 357. a. Polydete eH le premier
qui ait ofé pofer des Hatues fur une feule jambe. X IV .
824. h. 825. a. Plaques pofccs fur la tête des Hatues antiques.
X. 335. a. Des Hatues des héros. V I ll. 183. a. Il n’é-
toit point rare de v o ir , par un effet de la flatterie ou de la
vanité , des Hatues d’hommes feinblables à celles de quelques
dieux. XII. 273. b. En parcourant la quaiitiré prodigiciifc de
belles Hatues érigées en l’honneur des vainqueurs aux jeux
olympiques, on diHinguoit les différences é coles, on ap-
prenoit l’hifloire de l’art même. XI. 457. b. Examen que les
S T A
Hellénodyces fiiifotent des Hatues qu'on érigeoit aux aililetes
vainqueurs. VIII. 106. b. Les anciens faifoient fouvent des
Hatues dont la tête fe dotachoit du refle du corps , & au
lieu de faire une nouvelle Hatue, ils fe contentoient quelquefois
de changer la tête d’une ancienne. 169. a. Statuc.s
qu’on admiroit à Tlrefpie. X V I . 275. b. Des anciennes Haines
de Rome. X IV . 348. b. Defeription des Hatues étruf-
ques W / . II. 902. b. 903. b. 904. <7, é. Des Hatues cquei-
tres de CaHor & Pollux. Grouppe de deux figures reprél'eu-
lant le combat d'Herciile > contre une amazone à cheval.
V . 891. b. Statue équeHre qui fe voyolt dans la place publique
de Tcgée. 892. a. Le gladiateur expirant, Hatue antique.
VII. 698. a. Laocoon. IX. 279. b. Statue de Memnon
en Eg ypte , voyci Memnon. Statues trouvées à Hcrculanum.
y i l l . 1^0. é. &c. Suppl.lW. 352. i. Statue de Jupiter O lympien.
X IV . 823. b. Statue appellée le rotateur. 378. a. Staines
d’Hermès. VIII. i6S. a , b. Statues compofées de Mercure
& d’autres divinités. Foye^ MERCURE. Statues appellees
caryatides & perfyques , voye^ ces mots. Sur les Haines
antiques, voyeq SCULPTEURS ANCIENS.
_ S/.nues modernes. Statue éqiieHi e de Luiiis-le-Grancl à Pans.
II. 438. a. 442. b. Statues érigées dans Paris en l'hon-
no’.ir de quelques rois de France, vove^ l’article Pa r is . Statues
de la reine Pédaiique. X IV . 48.'é. Scc. Statues de Roland
qu’on voit dans les marchés publics en Allemagne, X IV .
3 30. b. De l art despatues. Différentes efpeces de Hatues dif-
ringuées par les noms fiiivans : caryatides , II. 734. a. ico-
iiiques, VIII. 487. b. pamhées, XI. 823. b. torfes. XVI.
434. a. En quoi confiHc le tendre dans une Hatue. 130. b.
Statue froide & fans e.xpreflîon. V IL 332. a. Comment le
coloffe^ de Rhodes & la Hatue du connétable de MontmortMi-
c y , qui eH à Chantilli, ont été faits. II. 442. h. Mémoires
à coniulter fur ta manière dont la Hatue de Louts-le-Graiid a
été faite. Ibid. Moule des fondeurs en bronze. X. 7S8. b.
D e l’art d’exécurer en bronze des Hatues équeHres. H. 430.
h. — 442. b. Des Hatues en marbre. Marbre dont 011 fait
choix. X. 7 1 . a. Details fur l’arc du Haïuaire, voye^ SCULPTEURS.
Poliment des Hatues de marbre des anciens. XII.
914. a. Obfervations fur les chevaux des Hatues équeHres.
X IV . 822. b. Toute couleur, dorure, ou vernis nuit à la
beauté d’une Hatue. 826. b. Craffe qu’ou cnlevoit de dcffiis
les Hatues antiques. XV. 346. b. Refexions fur l'iifage des
parues. D e leur ufage dans la religion, X V . 203. 'b. Les
païens n’adoroient point les Hautes de leurs dieux. VIII.
<^oi.a,b. Sec. Réponfe de Caton le cenfeur à celui qui lui
tlcmandoit pourquoi on ne lui avoit point encore érigé de
Haute. V . 903. a. Nudités dans les Hatues. XI. 277. b. Statues
qui ont infpiré de l’amour. X IV . 823. b. 826. a.
St a tu e . {Critiq. facr.) L’adoration des flauics défendue
par Moïi'e. Statue de Nabuchodonofor. Statue de la femme
de Loth. X V . 304. b.
ST A TU R E . La Hature ou taille d’un homme eH nclmira-
blement_ proportionnée aux circonHances de fon exiHencc.
CeH le fentimenr commun , que dans les Hecles les plus reculé
s, les hommes furpaffoient de beaucoup les modernes
en grandeur. Mais MM. Derham & Hakeweli ont fait des
obfervations qui démontrent que la taille des hommes n’a
jamais changé. X V . 304. b. Les anciens tombeaux, les anciennes
armures, écus, vafes , &c. fourniffeiit tous cette
même preuve. Ibid. 303. a. Voyeq_ T aille.
St a tu r e . ( Phyfol. ) Les peuples chaffeurs font généralement
de la plus iiaute Hature. C e qui contribue encore à
la Hature , c’eH l’aifance & la liberté. Les montagnards moins
grands que les habitans de la plaine Les premiers hommes
ncparoilfent pas avoir été plus grands qtte nous. Lesliabi-
îans des climats froids , pourvu que le froid n‘y (bit pas extrême,
font d’une taille avantageufe. Pygmées d’A frique,
peuple fabuleux. Suppl. IV . 829. b. Nations de la plus petite
taille. Oblèrvations fur les nains. CeH fouvent une maladie
qui les produit. Exemples de quelques nains qui ne
paroiffent point être nés d’une nature viciée. Mefure du plus
petit nain que l’auteur ait connu. Les finges d’Afrique peuvent
avoir donné lieu à lafablcdcs pygmées. IVniiquoi l’homtnc eH
plus grand le matinqn’.à toute autre heure du jour. Ibid. 830.
s t a t u t . (Juri/y?/-.) Chaque difpofitioii d’une loi eH un
Hatiit. Statuts généraux & particuliers. Obfervations fur la
difficulté de déterminer en certains cas où plufieurs Hatms
font en concurrence , quel eH celui qu’on doit fuivre pour
la decifton d’une coiucHation. DiHinflioii des Hatiits en i>er-
fbnnels, réels Si mixtes. X V . 303. a. Pouvoirs du Harut du
domicile , & de celui de la fituatiou des biens. Dans l’ordre
judiciaire, on difUngue deux fortes doHatiits; ceux qui
concernent linHruflion, & ceux qui touclieni la dècifion.
Quelques Hatms font feulement négatifs, d’autres proliibi-
lits, d autres proliibitifs-négaiifs. Statut pénal. Auteurs à confulter.
Ibid. b.
réglemcut que Henri
V i l l f i t c n 1339, au fujet de la religion. XV. 303. é. Hif-
toirc de ce réglement. Ibid. jo6. a
S T E 707
St a tu t .? , ( Comm. ) ceux qui concernent les corps des
niarchands , Si les comimmautés des arts & métiers. Ces
H.ums font auffi anciens qi;e les corps Si communaiiics ‘poui
leiqucls ils ont été faits. Premier réglement général fait en
m n c c au fujet des corps Si comimmautés. Édit de Louis
■ XIV , pour le reuouvellcment général des Hatiirs. Nombre
des comimmautés d’arts Si métiers à Paris fur la fin du dix-
icpticme fiecle. Les Hatms des communautés doivent être
confirmés au commencement de chaque regne. XV, 30C. a.
vS T A U B A CH , {Céogr.) cafeade dans le canton de Berne.
Vol. IV. des ])lanch. Regne minéral, Glaciers, pl. 2.
STA VEREN , ( Géogr. ) ville desProvinces-Unies. Son état
ancien Si fon état préfenr. X V . 306. b.
STÉ ATOM E . ( .Medec. ) Etym. du mot. Efpece de tumeur.
Sa cauie, Son traitcnienr. X V . 307. a.
STÉ E LE , {Richard) Eloge qu’il fait d’Acldiffon à la téie
de fon ouvrage, intitulé le Ribillard. X V ll. 618. b.
STÉ EM , ( Comrn.) forte de poids. XII, 600. a.
STEENK ERCK ou Steinckerck, {Géogr.) les François écrivent
, village du Pays-Bas d.nns le H.alnaiit, célébré
par le combat qui s’y donna en 1692. X V . sot. a __
FoyeqSuppl. II. 813.^. ^ ^
STEENSTURE 1, ( Hiß. de Suède ) adminiHrateur en
Suede , au milieu des troubles qui agitèrent ce royaume ,
fous le regne de Charles Canutfon ( f'oyc:^ ce mot.). Princi-
P^ux^évéïmnicns arrivés pendant fon WminiHratîon. Suppl.
St e e n t u r e I I , adminiHrateur en Suede; il étoit fils de
Suante Nifloii-Sture, Si fut élu après fa mort, en 1313 ,
pour gouverner la Suede au milieu des difeordes civiles qui
la divifoicnr. HiHoire abrégée de cette adminiHration qui ne
fut que d’environ fept ans. Suppl. IV. 831. a.
S T E E NW IC K , {Géogr.) ville des Pays-Bas, patrie d’A dam
Oleariiis, Sc de Bernard Paludanus, autrement nommé
Van-den-Brocck. Leurs ouvrages. X V . 327. a.
S T E E NW IC K , {Henri) peintre. V . 313. b.
ST É G AN O G R A PH IE , {Littér.it.) art des écritures fe-
cictes ou en chiffres. Inventeur de cette ccriturc. Sur Fart
d e là déchiffrer, voye^ D é chif frer. La Héganogr.aphie a
paffé dans des fiecles d’ignorance pour une invention diabolique.
Auteurs qui en ont donné des traités. Etym. du mot.
X V . 307. b.
Steganographie. 1. 297. a. Ouvrages qui ont paru fous ce titre.
IV . 322. 5.3 23. m Voycr^Chiffre, Ecriture fecrcie , Polygraphie.
S T E L L A , {Jacques) peintre. V . 320. a.
S T E L L A T E , plaine de {Géogr.) dans la Campanie. A u teurs
latins qui en ont parlé. X V . 308. é.
ST E L LE R , {George Guillaume) anatoiniHe, Suppl. I. 412. a.
S T E L L IO N À T , {Jurifpr.) toute efpece de fraude & de
tromperie qui peut fe conwnettre dans les conventions. Etym.
du mot.^ Six principales maniérés de commettre ce crime,
dùlingiiées dans les loix romaines. Ce qu'on ciireiul aujourd’hui
par Hellionat. Peines de ce crime chez les ai.ciens Romains
, & parmi nous. Remarques fur les femmes qui en font
coupables. XV, 309. a. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
STEM M A , ( Lang.lat.) fignirication de ce mot. VU . <40. a
STENCH ILL M IL D E , ^Hiß. de Suedz) roi de Suede,
qui régnoit vers la fin du neuvième fiecle. Suppl. IV . 830. a.
STENON. Parotide ou releveur de Stenon. Découvertes
Sc ouvrages de cet anatomifle. X V . 509. b.
St en o n , {Nicolas) aiiatomiHe , Suppl. I. 398.<7. & phy-
fiologiHe. Suppl. IV . 33 T. rf. Reîeveurs de Stenon. X V . 6 îe .
b. Conduit de Stenon. Suppl. IV . 709. b.
STEN TO R . Sa voix louée par Homere. VIII. 144. a.
STE PH AN EPHOIIE , Afatiq. ) prêtres de ce nom
dans l’antiquité. Lieux oîi ce litccrdoce étoit établi. Difl'é-
rentes fortes de Héphanéphores. X V . 310. ,7.
Stéphanephores : il en cH parlé à l ’article Sardes. XIV. 634. a.
STERBURG-HILL , monumens trouvés dans cet endroit
de l’Angleterre. IX. 941. b.
STE R CO R AIR E , chaire {H iß . des papes) chaire fur laquelle
on faifoit afleoir le pape le jour de fa confécratiou.
Railbn de cet ufage aboli par Léon X. X V . cio . a.
STE R CO R AL E , fievre. {Médec.) VI. 739. a , h.
S T E R CÜ R AN IT É S , {Hiß. ccd.) ceux qui penfolent que
les fyinbolcs eiichariHiqucs étoient fiijets à la digeHion 8c à
toutes fes fuites. X V . 310. a. A qui cette erreur a été attribuée.
Ibid. b.
STÉRÉO GR.APHIQ UE, projeflion : {Pcrfped.) celle de
la fphere. Avantoges de cette projeéHon. Aléthode 8c pratique
de cette projeéHon , 1®. fur le plan du méridien. X V .
310. b. 2®. Sur le plan de l’équinoxial ou équateur. 3". Sur
le plan de l’horifen. Ibid. 311. b.
Stéréographique, projdlion. Ses propriétés. XIII. 440. b.
STÉRÉO TOMIE , ( Géom. ) voyer Coupe des pierres.
.STÉRILES , {J.trdin.) III. 230. b.
STÉRILITÉ. {Médec.) Différentes caufes de flériliiédn
coté de la femme. X V . 312. b. Celles qui attaquent les
liommes. Traitemens. Ibid. 313.17.