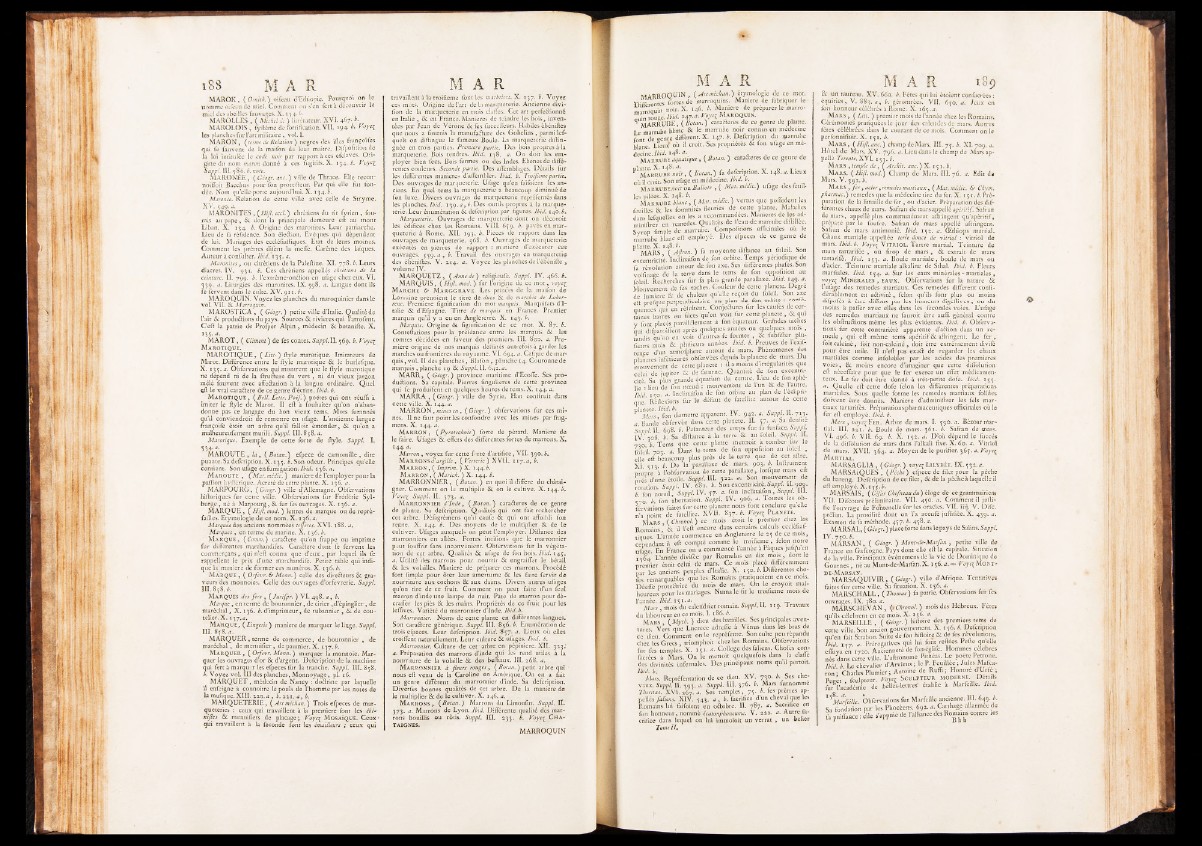
iSS M A R M A R M M A 189
qiii lui étoiont confacrées 1
oquiries, V . />. j’ crontrccs. VII. 650. u. R u x cn
I'ou liontieur cclOhris à Rome. X. i6<;.a.
Mars , ( Liu. ) premier mois etc I’enncc chez les Romnins.
Cérémonies pratiquées le jour des calendes de .aiars. Autres
fêtes célébrées dans le courant de te mois. Comment on le
perl'onnifioit. X. i<;i. ù.
Ma r s , { Hiß, iî/ic.') champ de Mars. III, 7^. ù. XI. 709.
Hôtel de Mars. X V . 706. a. Lieu dans le champ de Mars ap-
pdlé 7'rrr/itf.XVI. l o . i .
M ar s , UmpL- di , ( Archit. une. ) X. 1 5 i . i.
Mars. (Hifl.mod.) Champ de Mars. III. 76. u. Edit dé
Murs. V . 392. i.
M ars , f i r , aeù-r ,rcmcdes marn,7!jx, AIj !. medic. 6’ Chym.
pfi.trinjc.') remedes que la médecine tire du ter. X, 151./', Preparation
de la limaille de f e r , ou d’acier. Préparation des dif-
ferenics chaux de mars. Safran de m.irs appelle-j/jc/ / , S afran
de mai s , appelle plus communément atlringeiu qu’upéritif,
jnepaié par le foiifre. Safran de mars appelle alîringcnt.
Safran de mars antimonié. Ibid. 132. .2. (Ethiops martial.
Chaux martiale appellee terre douce de vitriol : vitriol de
mttrs. Ibid. b. ViTRiOL. Tartre martial. Teinture de
mars tartarifée , ou firop de mars , 6c extrait de mars
tartarilo. Ibid. 133. a. Boule manialc , boule de mars ou
d’acier. Teinture martiale alkaline de Schal. Ibid. b. Fleurs
martiales. Ibid. 134. a. Sur les eaux minérales - martiales ,
voye^ Minérales , eaux. Obfjrvations fur la nature 6c
l'ufage des remedes niartiraix. Ces remedes different conli-
dcrablement en aélivité , félon qu’ils font plus ou moins
difpofés à être diflbus par les humeurs digcllivcs , ou du
moins à palfcr avec elles dans les fécondés voies. L’ufage
des remèdes martiaux ne fauroit être aufli général contre
les obllruétions même les plus évidentes. Ibtd. b. Oblerva-
tions fur cette contrariété apparente d’aélion dans un re-
iiiede , qui efl même tems apéritif Sc albingent. Le fer ,
foit calciné , fbit non-ca!ciné , doit être extrêmement divifé
pour être utile. I] n’efl pas exaél de regarder les chaux
martiales comme infoluhlcs par les acides des premieres
v o ie s , 6c moins encore d’imaginer que cette difVoluiioii
efl nécclTaire pour que le fer exerce un efiet médicamenteux.
Le fer doit être donné à très-petite dole. Ibid. 133.
U. Quelle cft cette dofe félon les différentes préparations
martiales. Sous quelle forme les remedes martiaux folid-es
doivent être donnés. Maniéré d’adminillrer les fels martiaux
tartarilés. Préparations pharmaceutiques ofEcinales où le
fer cil employé. Ibid. b.
M.tof, voy^3; Fer. Arhre de mars. I. 390.^1. Bézoar martial.
111. 221. b. Boule de mars. 361. b. Safran de mars.
VI, 496. b. VU. 69. b. X. 132. a. D ’oîi dépend le fuccès
de la diffolution de mars dans l’alkali fixe. X. 60. a. Vitriol
de mars. X V II . 364- a. Moyen de le purifier. 365 .-t.
Martial.
M A R S A G L IA , (Géogr.) Lilybée. IX. 352.0.
M A RSA ÎQU ES , {Pèche') efpece de filet pour la pèche
du hareng. Defeription de ce filet, 6c de la pêcheà laquelle il
efl employé. X. 1
M.A.RSA1S, {Ceßir Chepieau du) éloge (\e ce grammairicui
V i l. Difeours préliminaire. VII. 430. </. Comment il jufU-
fie l'ouvraf'c de Fontenelle fur les oracles. VU . iiij. V , Dilc.
prclim. La°proxilité dont on l'a aceufé juffifiée. X. 439. a.
Examen de fa méthode. 457. b. 438..i.
MARS A L, ( Géugr.) place forte dans le pays de Salins. Suppl.
IV . 730. b.
M A R S A N , ( Géo^r. ) Moni-de-M.irfm , petite ville de
Fiance en Gafeogne. Pays dont elle off la capitale. Situation
de la ville. Principaux événemeiisde la vie de Dominique de
Gouvncs, né au Mont-dc-Marfan. X . 136. j . — Mont-
de-Marsan.
M A R S A Q U IV IR , (Gèogr.) ville d’Afrique. Tentatives
faites fur cette ville. Sa fitiiation. X. 136. u.
M A R S CH A L L , ( Thomas ) fa patrie. Obfervations fur fes
ouvrages. IX - 380. .Z.
MARSCHEVAN , {- Chronol.) mois des Hebreux. Fetes
qu’ils célèbrent en ce mois. X. 136.-0
MARSEILLE , { G hg r.) I.illoire ÿ s premiers rems lie
cette ville. Son .rncien giniverneitrcnt. X. 156. i. Delcription
qu'en fait Sttabon. Suite de fou hillo.te Se de fes revoluttous.
UiJ. 1 ,7 . a. Prérogatives qui lui lout rcIlees. Pefle qu elle
elTuya en lyao. Ancienneté de foiuéglifc. Hommes célébrés
nés dans cette vtlle. L'aftronomc Pitheas. Le P»«;:
n:,l. i. Le cltcvalier d'A rvieii.s; le P y e iu lle e ; ftiles Malc.a-
ron; Cl.arles Plumier ; Antoine de Ruffi ; Honore d Urte ;
Pnget , fculptour. n y . 'i SCULPTEUR »■ ODE»«-
fur racadéiliie de bcllcs-leitrcs établie a Marfcille. JbtJ.
MirrtiU, Ôbfervationsfur Marfcille ancienne. III. 649. b.
Sa fondation par les Pboccens. 69a. u. Carthage allarmee de
fa puiirunce : à le s'appuie de l'allianee des Romains contre les
If
Mb,
M .AR OK , {OniUh.) oifeau d’Ethiopie. Pourquoi on b
ïtomme oifc.ui do miel. Commeni on >’cn fert à découvrir le
mi.l tics .1 bol lies fau vages. X. 1 3 4. l\
M.AHOLLES , ( AUJul.:. ) li.iér.tteur. X V I. 467- ,
MARÜLOIS , l’yffcme de fortification. VU. 194-
les jiLmchcs fur l’art militaire , vol. l.
M A R O N , {renne de Relation) negres des iffos fnnçoîfes
qui le l'auvent de la maifon do leur m.iitre. Dilpofition de
la loi intitulée le code noir pur rapport .à ces eldavcs. O rigine
<hi nom maron donné à ces tugiiifs.X. 134- b.
Suppl III. 386. b. note.
.MARONÉE, {Oèogr. anc.) ville de Thrace. Elte rccoir
Tioin'üic Bacchus pour Ibn protcéleiir. Par qui elle fut foii-
déo. Nom qu’elle pone aujourd’hui. X. 134. E
M.ironèc. Relation de cette ville avec celle de Stryme.
X V . 349-
M.ARONITES, {f-Iß.ccc l.) chrétiens du rit fyricn , fou-
mis au pape, 60 dont la principale dcmenrc eli ;m mont
Liban. X. 134. b. Origine des maronites. Leur patriardie.
Lieu de f l rélidciice. Son éleclion. Evêques qui dépendent
de lui. M.iriagcs des eccléfiaffiques. Etat de leurs moines.
Comment les prêtres dil'ent la nielle. C.ircme des laïques.
Auteur à confulter. Ibid, i 33.
Maronites, OU chrétiens de la Paleffine. XI. 778. b. Leurs
diacres. IV, 931. b. Ces chrétiens appelles chrétiens de la
ceinture. U. 799. b. l’extréme-onéboii en ufiige chez eux. VI.
339. a. Liturgies des maronites. IX. 398. .2. Langue dont ils
le fervent dans le cnlcc. X V . 9 1 1. é.
M A RO QU IN . \ 'oyez les planches du maroquinier dans le
vol. VU, 6i Af.irrotfuin.
MARO-STiCA , ( Géogr.) petite ville d’Italie. Qualité de
l'air & produébons du pays. Sources 6c rivieres qui l’ariofent.
C ’eff la patrie de Profper Alpin , médecin 5c botaniffe. X.
133,47.
M A R O T , ( Clément ) de fes contes. Suppl. II, 369. b. f'oye^
Marotique.
M A R O T IQ U E , ( Litt- ) ffyle marotique. Imitateurs de
Marot. Différence entre le ffyle marotique 6c le burlefque.
X. 133. a. Obfervations qui montrent que le ffyle marotique
ne dépend ni de la ffruRiire du vers , ni du vieux jargon
mêlé fouvent avec affeRaiion à la langue ordinaire. Q u el
çff le vrai caraélere de ce genre d’écrire. Ibid. b.
Marotique , {Bell. Leur. Poéf.) poètes qui ont réuffi à
imiter le ffyle de Marot. 11 eff à fouhaiter qu'on n’abandonne
pas ce langage du bon vieux tems. Mots furannés
qu’il conviendroit dé remettre en iifage. L ’ancienne langue
françoife étoit un arbre qu'il falloit émonder, 6c qu’on a
malheureiifcmem mutilé. Suppl. III. 838. a.
Marotique. Exemple de cette forte de ffyle. Suppl. I. 334.^.
M A RO U T E , la y {Botan.) efpece de camomille, dite
puante. Sa defeription. X. 133. b. Son odeur. Principes quelle
contient. Son ulage en fumigation./iid. 136.47.
Maroute , {M.tt.médic.) maniéré de l’employer pour la
paffion iiyfférique. Acreté de cette plante. X. 136. a.
M.ARPOURG, {Géogr.) ville d’Allemagne. Obfervations
hifforiques fur cette ville. Obfcrvacions fur Frédéric Syl-
fciirge , né à Marpourg, 8c fur fes ouvrages. X. 136. .7.
M A R Q U E , ( H ß . mod. ) lettres de marque ou de repréfailles.
Etymologie de ce nom, X, 136. a.
Aîarques des anciens nommées teßeres. X V I . 188. a.
M.u^ques , cil terme de marine. X. 136. b.
Mar qu e , {Comm.) caraélere qu’on frappe ou imprime
fur différentes marchandlfes. Caraétere dont lé fervent les
comm.Tçans, qui n’eft connu que d’e u x , par lequel ils fe
rappellent le prix d’une maichandife. Petite table qui indique
la maniéré de former ces numéros. X. 136. b.
Marque , ( Orfevr. 6» Mann. ) celle des direReiirs 6c graveurs
des moiinoies. Celle des ouvrages d'orfevrerie. Suppl.
111.838.^.
Marques des fers , {lurifpr. ) VI. 498. a , b.
M.irque , en terme de bomonnier, de drier , d’épinglier , de
maréchal, X. 1 36. b. d’imprimeur, de rubaunier , Ôc de cou-
telier.X. 137.47.
Marque, ( £i/2g<né ) maniéré de marquer le liage. Supy/.
III. 838.47.
M A RQ U ER , terme de commerce, de boutonnler , de
maréchal , de menuificr, de paumi er. X. 137. b.
Marquer, {Orfevr. Monn.) marquer la monnoie. Marquer
les ouvrages d'or 8c d'argent. Defeription de la machine
qui fert à marqu.r les efpeces fur la tranche. Suppl. UI. 838.
t. V o y ez vol. III des planches, Monnoyage, pl, 16.
M À R Q U E T , médecin de Nancy : doélrine par laquelle
il enfdgnc à coiinoitre le pouls de l’homme par les notes de
Umufiqiie.XIlI. 220.47, b. 2 11 . a, b.
M A RQ UET ERIE , {Anmédian.) Trois efpeces de marqueteries
: ceux qui travaillent à la premiere font les ébé-
nßes 8c memiifiers de placage ; Mosaïque. Ceux •
qui travaillent à la fécondé lont les émailkurs ; ceux qui
travaillent à la troifienio font les m.2rbri:rs. X. 137. b. V o y e t
CSS m.ns. Origine de l’arc de l.i marLC-ieteric. Ancienne divi-
fion de la marqueterie en trois cl.iffcj. Cet art perfeétionné
en Italie , 6c en France. Maniérés de t-indre les bois, inventées
par Jean de Vérone 6c fes fucceficurs. H.ibiles ébéniffes
que nous a fournis la mamifaélurc des Gobelins , parmi lef-
quels on diffingue le f.imeux Boule. La marqueterie diffin*
guéo on trois jiaities. Premiere partie. J.^cs bois propres à la
marqueterie. Bois tendres. Ibid. 138. a. On doit les employer
bien fees. Dois fermes ou de.s Indes. Ebenes de différences
couleurs. Seconde partie. Des alïemblages. Détails fur
les différentes maniérés d’affcinhler. Ibid. b. Troifeme partie.
Des ouvrages de marqueierie. Uiage qu’en faifoient les anciens.
Eu quel tems la marqueterie a beaucoup diminué de
f«n luxe. Divers ouvrages de marqueterie reprefemés dans
les planches. Ibid. 139.47, b. Des outiK propres à la marqueterie.
Leur énumération 6c defeription par ligures. Ibid. 14O. b.
M.irqueterie. Ouvrages de marqueterie üoiu on décoroic
les édifices chez les Romains. V l l l . 639. b. pavés en marqueterie
à Rome. XII. 193. b. Pieces de rapport dans les
ouvrages de marqueterie. 368. b. Ouvrages de marqueterie
exécutes en pierres de rapport : m inière d’oxécuicr ces
ouvrages. 339.47, b. Travail des ouvrages en marqueterie
des ébéniffes. V . 214. a. V o y e z les planches de l’ébéniffe ,
volume IV.
M A R Q U E T Z , {Anne de) reügieufe. Suppl. IV . 466. b.
M.ARq U IS, {Hijl. mod. ) fur l’origine de ce m o t, voyc^
Marche 6' MargGRAVE. Les princes de la maifon de
Lorraine prenoient le titre de ducs 6c de nurchis de Loher-
rene. Premiere fignification du motmanpiis. M.irquifats d’Italie
6c d’Efpagne. Titre de vuirquis c-n France. Premier
m.irqiiis qu’il y a eu en Angleterre. X, 143. b.
M.irquis. Origine 6t fignification de ce mot. X. 87. b.
Contellations pour la préléance entre les marquis 6c les
comtes décidées en faveur des premiers. III. 8co. .1. Premiere
origine de nos marquis deitincs autrefois à garder les
marches ou frontières du royaume. VI. 694.47. Cafqus de marq
u is ,v o l. Il des planches, lU.ifon , plmche 14. Couronne de
marquis , planche 19 6c Suppl. II. 642.47.
M A R K , ( Géûgr.) province maritime d’EcolTe. Ses pro-
duébons, Sa capitale. Pierres fingulleres de cette province
qui fe produifent en quelques heures de tems. X. 144. .7.
M A RRA , ( Géü^r. ) ville de Syrie. Han conllruii dans
cc tie ville. X. 144. a.
M A R R O N , C27, {Géogr.) obfervations fur ces mines.
Il ne faut point les confondre avec les mines par frag-
mens. X. 144. a.
Ma r ro n , {Pyrotechnie) forte de pétard. Maniéré de
le faire. Ufages 6c effets des differentes fortes de marrons. X.
144. J.
Marron , vo ye z fur cette f rte d’artifice, VII. 390. b.
Marrons , {Perreric) X V i\ . 117.47, b.
Marron , ( hnprim. ) X. 144.é.
Marron , ( M.iréch. ) X. 144. b.
M A R RO N N IER , {Botan.) en quoi il différé du châtai-
gner. Comment on le muhiphe 6c on le cultive. X. 144. b.
f'ovc^ Suppl. II. 373. a.
Marronnier d'Inde, {B o tan.) carafferes de ce genre
de plante. Sa defeription. Qualités qui ont fait rechercher
cet arbre. Défagrémens qu’il caufe 6c qui ont affbibli fon
régné. X. 144. b. Des moyens tie le multiplier 6c de le
cultiver. Ufages auxquels on peut l'employer. Diffancc des
marronniers en allées. Fortes inciflon^ que le marronnier
p.ut füuffrir fans inconvénient. Obfervations fur la végétation
de cet arbre. Q.iahcés 6c ufage de fon bois. Ibid. 143.
47. Utilité des marrons pour nourrir 6c engrailTer le bétail
6c les volaillet. Maniéré de préparer ces marrons. Procédé
fort fimple pour ôter leur amertume 6c les faire fervir d«
nourriture aux cochons 6c aux daims. Divers autres ufages
qu’on tire de ce fruit. Comment on peut faire d’un Ictil
marron d’inde une lampe de nuit. Pâte de marron pour dé-
cralTer les pies 6c les mains. Propriétés de ce fruit puur les
leffives. Variété du marronnier d’Inde. Ibid. b.
Marronnier. Noms de cette plante en différentes langues.
Son caraélcrc générique. Suppl. III. 836. b. Enumeration du
trois efpeces. Leur defeription. Ibid. 837. a. Lieux où elles
croilTent naturellement. Leur culture 6c ufages. Ibid. b.
Marronnier. Qültmte de cet arbre en pépinière. XII. 323.'
47. Préparation des marrons d’inde qui les rend miles à la
nourriture de la volaille 6c des beffiaux. III, 268. 47.
M a r r 'xnnier 47 fleurs rouges, {Botan.) petit arbre qui
nous eff venu de la Caroline en Améritpie. On en a fait
un genre différent du marronnier d’inde. Sa defeription.
Diverfes bonnes qualités de cet arbre. De la maniéré de
le multiplier 6c de le cultiver. X, 1 46. a.
Marrons, {Botan.) Marrons du Limoufin. Suppl. II.
373. 42. Marrons de Lyon. Ibid. Différente qualité des marrons
bouillis ou rôtis. Suppl. III. 233. b. Voyer^ CHATAIGNES.
m a r r o q u i n
» •A R R O Q U IN , {Arimédian.) étymologie de ce mot.
l-fwv-rc-nics fortes de marroquins. Mamcre de fabriquer le
în.rroüuin prép.uer le marrormi'‘
e Ibid. I47..r. MAROQUIN.
^^MARRÛBE, {Botan.) caradeics de ce genre de plante,
l e marrube blanc 6c le marrube noir connus en médecine
font de genre différent. X. 147- Defeription du jvamibe
blanc. Lieux où U croit. Ses propriétés 6c fon iitagc en médecine.
ié i42'. 148.42. , „ V a 1 I
Marrube aquatique , ( Botan. ) caraiteres de ce genre de
MARRUut^imr, {Botan.) fa defeription. X. 148.,/. Lieux
cil il c--oit. Son ufage en médecine. Ibid. b.
M a r rUBE/20;> ou , ( Mut.médic.) ufage desteuilles
pilées. X. 148. é. ... s 0 - 1 1
M ar r ub e bl.mc , { M.u. mcdic. ) vcrim que podec eut les
feuilles 6c les fommités tleurics de cette plante. Maladies
cLins lefqucllei. on les a rci:omrar,nciiics. Je 1=5 »'1'
,„i„illrer en reraecics. Qualités de 1 eau de mamibe diILllee.
Syrop fimple de mam,te. tompofinons ofna.nales ou e
marrube blanc ell employi. Des dpec es de ce genre de
'’"m a r s I l5 utoycune diftance an foleil. Son
escemricit’é. Indinaifon de fon orbite. Temps périodi^que de
fil révolution antonr de ibn a.ve. Ses différentes pbafes. Son
voTinagc tic la terre dans le tems de fon oppofition an
foleil 'kechcrebes fur fa plus grande parallaxe éiid. 149. a.
Mouvement de fes taches. Cinileur de cette plancte^ Degre
de lumière & de chaleur q tidU reçoit du foleil. Son axe
eff prcfiiue perpendiculaire au, plan de fon orbite t confe-
onenccs ciui en réliilteiit. Conjeaurcs fur les caufes ,1e certaines
barres ou filets qu'on voit Utr cette planète , be qui
V font pliicés parallèlement à fon équateur. Grandes taches
qui dilparolffent après quelques années ou quelques "te'S .
tiniüs qu'on eu voit d'autres le former bc lubl.fter pliu
fieu'S mois Si plufieurs années. Ibtd. i. Preuves de Icxil-
tencc d'iin atmofpliere amour de inars. Phénol,lenes des
p life tc s inférieures obfervées tlcpius la planete de mars. Un
mouvement de cette planète ; il a moins d'irrégularités que
ccUù de jupiter 6: de faturne. Q'.iaiitiie de lo» cxccmn-
cicé Sa plus grande équation du centre. Lieu de fon aphélie
• lieu de fon neeud : inouvcmciu de l’im 6c de l’aiitre.
Ibid i - o .2 Indinaifon de fon orbite au plan de l’éehpa-
quc.’ Réflexions fur le défiiut de latellite amour de cette
planète. Ibid. b. ; tt
^ M-rs fon diamètre apparent. IV . 942. a. Suppl, ü . 7 1 , .
,7. Bande obfervcc dans cette planète. II. 37. 42 Sa denfue
Suiwl II 698. b. Peiaiitcur des corps fur la fui face.
I V '208 è Sa diflaiice à la terre 6c au foleil. Suppl, il.
7 ,0 . L Tems que cette plante mettroit à tomber un; le
foLil. 70". a. Dans le tems de fon oppoluion au loleù ,
elle eff beaucoup plus près de la terre que de ccc affre.
XI t n b De la parallaxe de mars. 903. b. Inlaumcnc
nro-'re à I’obfervaticm de cette parallaxe, lorfque mars eff
[ares d’une étoile. SuppLUl. 322. 42. Son mouvement de
toiation. Suppl. IV . 681. b. Son excentricité. 522/-^/, 11.909.
b. fon noeud, Suppl, 37- mehnaffon , Azzpp/. I I.
.-to b. fou aberration. Suppl. IV . 906. Foutes les ob-
icrvations faites fur cmte planète nous font conclure qu elle
n’a point de fatellite. X V ll. 857. b. Foye^ Planete.
M A R S ,(C 'A ro / ;oO ce mois eto.t le premier cnez les
Romains, 6c il l’eft encore dans certains calculs cedehaf-
tiques. L’année commence en Angleterre le 23 de ce mois,
cependant il eff compté comme le iroifieme , félon notre
ufa<’C. En France on a commence l année a Puqiies jukfu en
ir fo l L'année (liviféc par Ronuiliis en dix mo is, dont le
nremier étoit celui de mars. Ce mois placé différemment
,ar les anciens peuples d'Italie. X. 1 50. i. Differentes cho-
k __ ui,,. e...,. t.-c Tî.ymtiin« iirnrimimenr en ce mois.
Sc un tautean, X V . 660. b .l'é
fes remarquables que les Romains praticiuoieni en ce
Dccffe proteilricc du mois de mars. On le croyoït mal-
beureux pour les mariages. N im u l c h t le troiffcme mois de
l’année./é/ù. 1 5 1. i tt t
Mars , mois du calendrier romain. Suppl. H. 1 19. Travaux
du labomeuren ce mois. 1. 1S6. é. - • 1
Mars {Myth. ) dieu des batailles. Ses principales aventures
Vers que Lucrèce adrclTe à Vénus dans les bras de
ce dieu Comment on le repréfente. Son culte peu répandu
chez les G re c s, triompholt chez les Romains, Üblcrvaiions
fur fes temples. X. 131.-2. College desl.alicns Chofes con-
l’acrécs à Mars. On le inertoit quelquctois dans la daffe
des divinités infernales. Dos principaux noms qu’il portoit.
Ibtd. b.
Mats. Reprefemution de ce dieu. X V . 730. b. Ses chevaux.
Suppl. II. 393.4... Suppl. UI. 376. b. Mars furnomme
Theritas. XVI. 267. .2. Ses temples, 73. i . fes prêtres ap-
V,cliés faliens. XIV. 343. 42, b. facrificc d’un dieval que les
Romains lui faifoient ei: i oaobre. U. 787. a. Sacrifice en
fcjti honneur, nommé èc47202q2/;wic't22/i4.’. V . 222. 42. Autre fa-
crillce dans lequel on lui iimnoloit un verrat , un belier
Tonie i l .