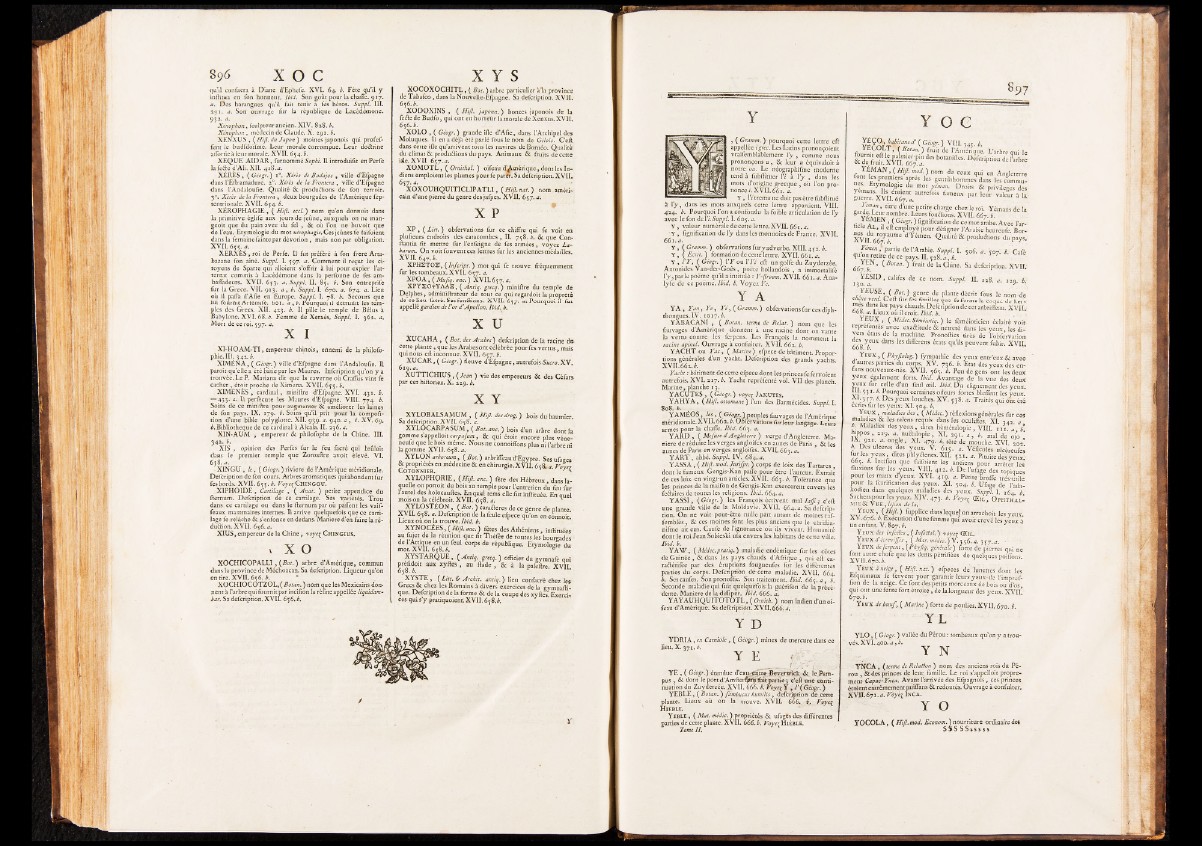
X o c X Y S
qu'il coniucra i Diane d’Epliefe. X V I . 64. b. Fête qu’il y
inüit«a en l'on honneur. Ibi.i. Son goût pour la chaiTe. 917.
a. Des harangues qu’il fait tenir à fês héros. Suppl. III.
a o i . J. Son ouvrage fur la république de Lacédémone.
931. J.
Xenophon, fculpteur.ancien. X IV . 8a8. b.
Xenophon , médecin de Claude. X. 291. b.
XENXUS , du Jupon ) moines japonois qui profef-
fcnt le budl'doilhic. Leur moral« corrompue. Leur doéirine
alîortieà leur morale. X VII . 654. i.
X EQ U E A ID A R , furnommé Sophi. Il introduifit en Perfe
la feéte d'A li, XII. 418.u.
X ÉRÈ S, {Geogr.) 1°. Xéris de B.iJajos , ville d’Efpagne
dans rEllramadare. 2". Xèris de la Froniera , ville d’Efpagne
dans l’Andaloufie. Qualité & productions de ion terroir.
Xérès de U Froniera , doux bourgades de l’Amérique fep-
tentrionale. X VII. 634- b.
la primitive èglile aux jours de jeune, auxquels on ne man-
geoit que du pain avec du l’el , &. où l’on ne buvoit que
de l’eau. Etymologie du motxrVo/>Aj^if,Cesjeiinesl'e fail'oient
dans la femaine faùue par dévotion , mais non par obligation.
X V II , 63^^a.
X E R X È S , roi de Perfe. Il fut préféré à fon frere Arta-
bazane fon ainè. Suppl. I. 397. a. Comment il reçut les citoyens
de Sparte qui .illoient s’offrir à lui pour expier l’attentat
commis à Lacédémone dans la perfonne de fes am-
baffadeurs. XVII . 653. a. Suppl. II. 85. b. Son entreprife
fur la Grece. VII. 913. a , b. Suppl. I. 670. a. 674. a. Lieu
où il paffa d’Afie en Europe. Suppl. I. 78. b. Secours que
lui fournit Artemife. 601. a , b. Pourquoi il démiifit les temples
des Grecs. XII. 423. b. Il pille le temple de Bélus à
Babylone. X VI, 6 8 .4>. Femme de Xcrxés, Suppl, I. 362. a.
Mort de ce roi. 597. a, X I
X O C O X O C H IT L , ( Bot.) arbre particulier à la province
de Tabafeo, dans la Nouvcüe-Efpaiine. Sa del'cripilon. X V IL
656. é.
X O D O X IN S , ( IFip. japonn. ) bonzes japonois de la
feétede Budfo, qui ont en horreur la morale deXenxus.XVIL
656. b.
X O LO , ( Géogr.) grande ifle d'Afie, dans l’Archipel des
Moluques. 1 1 en a déjà été parlé fous le nom de Gilolo. C ’eft
dans cette iile qu’arrivent tous les navires de Bornéo. Qualité
du climat & productions du pays. Animaux & fruits de cette
ifle. X V I I 657. <1.
X Ü M O T L , (^Orniihol. ) oifea'u d’Amérique, dont les Indiens
emploient les plumes pourfe parer. Sa defeription. X VII .
657. tf.
X O X O U H Q U IT IC L IP A T L l, {H ip.nar.) nom américain
d’une pierre du genre des jafpes. X V 1 1 . 657. a.
XP , ( lin . ) obfervations fur ce chiffre qui fe voir en
plufieiirs endroits des catacombes , IL 758. b. & que Con-
itantin fit mettre fur l’enfeigne de fes armées, vo ye z La-
barum. On voit fouvenc ces lettres fur les anciennes médailles.
XV II . 647. b.
XPH2 T 0 2 , ( //lycr/;?/. ) mot qui fe trouve fréquemment
fur les tombeaux. X V II . 657. a.
X ? 0 ^,{^^u flq .a n c .) XVII.637.H.
X P Y 2 0 '4>YAA3 , ( grecq.) miniffre du temple de
Delphes, adminiftrateur de tout ce qui regardoic la propreté
de ce lieu facré. Ses fondions. XVII . 657. d. Pourquoi il fut
appelle gardien de l’or d’Apollon. Ibid. b.
X U C AH A , {^Bot.des Arabes) defeription de la racine do
cette plante , que les A rabes ont célébrée pour fes v ertus, mais
qui nous eft inconnue. XV II . 637. b.
X U C A R ,( Géogr.) fleuve d'Éfpagne, autrefois5 ütTo.XV.
619. a.
X U T T ICH IU S , {^Jean ) vie des empereurs Ôc des Céfars
par cet hiltorien. X . 229. b.
X Y LO B A L SAM UM , {fH p. desdrog.) bois du baumier.
Sa defeription. X VII . 638. a.
X Y LO C A R PA SUM anc. ) bois d’un arbre dont la
gomme s'appelloit carpajum , & qui étoit encore plus véne-
neufe que le bois meme. Nous ne cornioiffons plus ni l’arbre ni
la gomme X'V IL 658. a.
X'^LO^arboreurn, {B ot.) arbriffeaud’Egypte. Sesuface«
& propriétés en medecine & en chirureie.XVII. 6t8. a Fover
C o to nnier, ' ^
X Y LO PH Q R IE , {H ip.anc.) fête des Hébreux , dans laquelle
on portoit du bois au temple pour l’entretien du feu fur
l’autel des holocauftes. En quel tems elle fut inffituée. En ouel
mois on la célébroit. X V l l . 638. a. ^
XV II . 638. Defeription de la feule efpece qu’on en connoît
Lieux ou on la trouve. Ibid. b.
X Y liO C ttS , {H ip.anc.) fêtes des Athéniens , inffituées
au fujet de la reunion que fit Tliéfée de toutes les bourgades
d e lAttiq u e en unfeul corps de république. Etymologie du
mot. X VII . 038. ». °
X ’VST AR QU E , {Antiq. grecq. ) ofHcier du gymnafe qui
^ 8 i xyties , au ftade , & à la pakllre. X V I I .
X Y S T E , ( Lin. 6- Archit. antiq. ) lieu confacré chez les
Grecs & chez les Romains à divers exercices de la gymnafti-
qiie. Defeription de la forme & de la coupe des xyftes. Exercices
qui s’y pratiquoienr.XVI1.638.é.
Y
, ( Gramm. ) pourquoi cette lettre eff
appellee igrec. Les Latins prononçoient
vraifemblablemcnt l’y , comme nous
prononçons u , & leur u équivaloir à
notre ou. Le néographifmc moderne
tend à lubflituer l’i à l ’y , dans les
mots d’origine grecque , où l'on prononce/.
XVII . 661. a.
f , l’/trcma ne doit pas être fubflitué
à l’y , dans les mots auxquels cette lettre appanient. VIII.
424. b. Pourquoi l’on a confondu la foible articulation de l’y
avec le fon Acl'i.Suppl. I. 605..1.
Y , valeur numérale deectee lettre.XVII. 661. .r.
y , fignification de l ’y dans les monnoies de France. X V I I ÛGi.a.
Y , (Gramm.) obfervations fury adverbe. XIII. 432. i.
Y , {E crit.) formation decettelettre. XVII . 6 6 1 .a.
Y , l'Y , ( Géogr. ) \’Y OU l’ J’i;' eff un golfe du Zuyderzce.
Antonides V.in-der-Goès, poète hollandois , a immortaüfé
l’y ,parlepoëme qu’il a intitulé ; Y-proom. X V II . 661. a. Ana-
lyfe de ce ^oém-a. Ibid. b. V o y ez Ye. Y A
Y A , Yan, Y e , }'é, {Gramm.) obfervations fur ces diph-
tliongiies. IV . 1017. b.
Y A B A C A N I , ( Botan. terme de Relat. ) nom que les
fauvnges d’Amérique donnent à une racine dont on vante
la vertu contre les ferpens. Les François La nomment La
racine apincl. Ouvrage à confuher. X V II . 662. b.
Y A C H T ou Yac, ( Muri/u')_efpcce de bâtiment. Proportions
générales d’un yacht. Defeription des grands yachts
XVIL662.3.
Yacht : bâtiment de cette efpece dont les princes fe fervoient
autrefois. X V I. 217. b. Yacht reprefenté vol. V i l des planch.
Marine, planche 13.
Y A C U T E S , {Géogr.) vuycç Ja k UTES.
Y A H Y A , {Hip.oitomane) l’un des Barmecides. Suppl I
808. b.
YAM ÉO S , /« y { / '‘fg ’:-) peuples fauvages de rAmérique
méridionale. XVIJ. 662. b. Obfervations fur leur langage. Leurs
armes pour la cliaffc. Ibid. 663. a.
Y A R D , {Mefure d'Angleterre) verge d’Angleterre. Maniéré
de réduire les verges angloifes en aunes de Paris , & les
aimes de Paris en verges angloifes. X V II . 663. u.
Y A R T , abbé. Suppl. IV . 684.0.
YA S SA , ( Hiß. mod. Jurifpr. ) corps de loix des Tartarcs ,
dont le fameux Gengis-Kan paffe pour être l’auteur. Extrait
de ces loix en vingt-un articles. X V l l . 663. b. Tolérance que
les princes de la niailon de Gengis-Kan exercèrent envers les
fcélaires de toutes les religions. Ibid. 664. a.
Y A S S I , (Geugr.) les François écrivent m û lajp; c’eff
une grande ville de la Moldavie. X V ll. 664. a. Sa defeription.
On ne voit peut-être nulle parc autant de moines raf-
l’emblés , & ces moines font les plus anciens que le cliriffia-
nifme ait eus. Caufe de l’ignorance où ils vivent. Humanité
dont le roi Jean Sobieski ula envers les liabitaiis de certe ville.
ibid. b.
Y A ’W , {Médec.pratiq.) maladie endémique furies cotes
de G u in ée , & dans les pays chauds d’A frique , qui eff ca-
raélérifée par des éruptions fougueufes fur les différentes
parties du corps. Defeription de cette maladie. X V II . 664.
b. Sescaufes. Sonpronoftic, Son tr-iitement. Ibid. 663. <2, b.
Seconde maladie qui fuit quelquefois ia guérifon de la précédente.
Maniéré de la diffiper. Ibid. 666. a.
Y A Y A U H Q U IT O T O T L , (Orii/M. ) nom indien d’un oi-
feau d’Amérique. Sa defeription. X V I I .666. a. Y D
Y D R IA , en Carniole , ( Géogr.) mines de mercure dans ce
lieu. X. 371. b. Y E.
..... ■ . f : ■ >
Y E , ( Géogr.) étendue d’eau-^ntr« Beverwick & le Psm-
YEBLE , {Botan.) fambucus humilis, defeription de cette
pus , & dont lepo rtd ’AmflerlÎÂI^<âilp.irtie; c’eff une continuation
du Ziiyderzée. X V ll. 666. b. f^oyrçY , l'{Geogr.)
plante. Lieux où on la trouve. X V ll. 666., I>, Voye^
Hieble.
Y e b le , ( Aluf. ff«V/c. ) propriétés Si ufagCs des différentes
parties de cette plante, X VII . 666. b. Foyer HiÉBLE. '
Tome II.
897
Y O G
kabitansd'(Géofr.) V I ! l ,2 j t b
‘1 = l'Aiiiériaue. L’arbre qui le
& d"'L'ü.xfïrs?:;
font lesprerrrrers apres les gentilshommes dans les eommu-
v ém a SY l U'oils & pnvileges des
S.mrîrxvil“«“! ““''"'“" P-'
l eman, titre d’une petite charge chez le roi. Yémans de îa
fonélions. XVII . 667. b.
),^8” ‘^^‘'2tiün de ce mot arabe. A ve c l’ar-
A ’ ' """T pour defigncr l’Arabie heureufe. Bor-
X V i r 6 6 7 r " ’ ‘' Q^‘‘*ii'<i&P«ûuaions du pays.
J r/HfTj, partie de l’Arabie. Yapa/. I. 306. <i. <ro7 b Café
q.u on retire de ce pays. II. 3 2 8 .;; b. ^ ^ ^
6 6 ^ é ’ ) fruitde la Chine. S.a d’:fcriptiou. XVII .
c^tifcs de ce nom. Suppl. Il, 128. .7. 129. b.
YEUSE genre de plante décrit fous le nom de c/uneverd. C e ff lur fes feuiiles que fe forme la coque de ker-
mes dans les pays chauds. Defeription de cet arbrifleau. X V l l .
660. a. Lieux oii il croit. Ibid. b.
YEUX , {MéJec.Séméioiiq.) le féméioticicn éclairé Voit
repreientes avec exaélitude & netteté dans les yeux, les divers
états de la machine. Pronoffics tirés de 'l’obfervation
668 7 '"^ les diflerens états qu’ils peuvent fubir. X V I I .
Y eux , ( Phyfiolog. ) fympathie des yeux entr'eux & avec
d autres parties du corps. X V . 736. b. Etat des yeux des en-
nu s nouveaux-nés. XVII. 363. b. Peu de gens ont les deux
yeux egalement forts. Ibid. Avantage de la vue des deux
yeux fur celle d’un feul oeil. Ibid. Du clignement des yeux.
IIL 33 Pourquoi certaines odeurs fortes bleffent les yeux.
A l. 3 37. i. Des y eu x louches. X V . 338. a. Traités qui ont été
écrits fur les j'eiix. XL 304. b.
\ eux , maladies des , ( Mè.iec. ) réflexions générales fur ces
maladies & les taJens requis dans les oculLltes. XL a
b. Maladies des y e u x , dites héméralopie, VIIL ii^i a b
Iqjpos , 019. n. nuanlopic , XI. j ç i . J, mj] j e oj'o i
1 r,’ ” ', ° "S ' - -*7 - A fo'c mouche. XVI. é o f.
A p.;s ulcérés des yeux. V. 615. u. Vificules ulcéreufes
foules yeux ducs phlyaenes. X ll. u. Pituite des y eux.
66 ;. t. Inc,flou que fo,Io,ent les anciens pour arrcier les
fluxions fur les yeux. V l l l . 412. 4 . De l’ufage des topiques
pour les maux d y e u i. XVI. 419. ». Petite broffe très-utile
pour la fcarihcation des yeux. XL 504. b. Ufage de l’acia-
kodien dans quelques maladies des yeux. Suppl. 1 164' ‘b
Sachets pour les yeux. XIV. 473. b. Foyer OEi l , O ph th I l -
mie 6c V ue , lé/ion de U.
ûipiiücG dans lequel on arrachoic les yeux.
A V . 676. é. Execution d’une femme qui avoir crevé les yeux à
un enfant. V . 807. é. ^
Y EUX des infi'cles, ( Infeélol. ) voyez OEil.
Yï.\3X d ’éacvipès, ( Mi.'./7n’Y / e.)V. 336.a. 337.J. •
Y eux defcrpcnt,{Phyfiq. générale) forte de pierres qui ne
font autre choie que les dents pétrifiées de quelques uoiffons
XV I1 .6 70 .i.
YEUXun^fg«, ( H ip.na:.) efpeces de lunettes dont les
Efquimaux fe fervent pour garantir leurs y eux de l’imprvf-
fion de ia neige. Ce font des petits morceaux de bois ou d’os
qui ont une fente fort étroite , de la longueur des yeux. X V ll!
670. é.
Y eux de boeuf, ( Marine ) forte de poulies. XVII . 670. h. YL
Y L O , ( Géogr. ) vallée du Pérou : tombeaux qu’on y a trouvés.
X V I. 400. a , b. Y N
Y N C A , {terme de Relation ) nom des anciens rois du Pérou
, & des princes de leur famille. Le roi s'.appelloit proprement
Capac-Ynca. Avant l’arrivée des Efpagnols, ces princes
étoientextrêmement puiffans & redoutés. Ouvrage à confulter.
X'VII.6 7 1 . 4 . iNCA.Y O
Y O C O L A , ( Hifl. mod. Econom. ) nourriture ordinaire det
S ^ S S S s s s s s