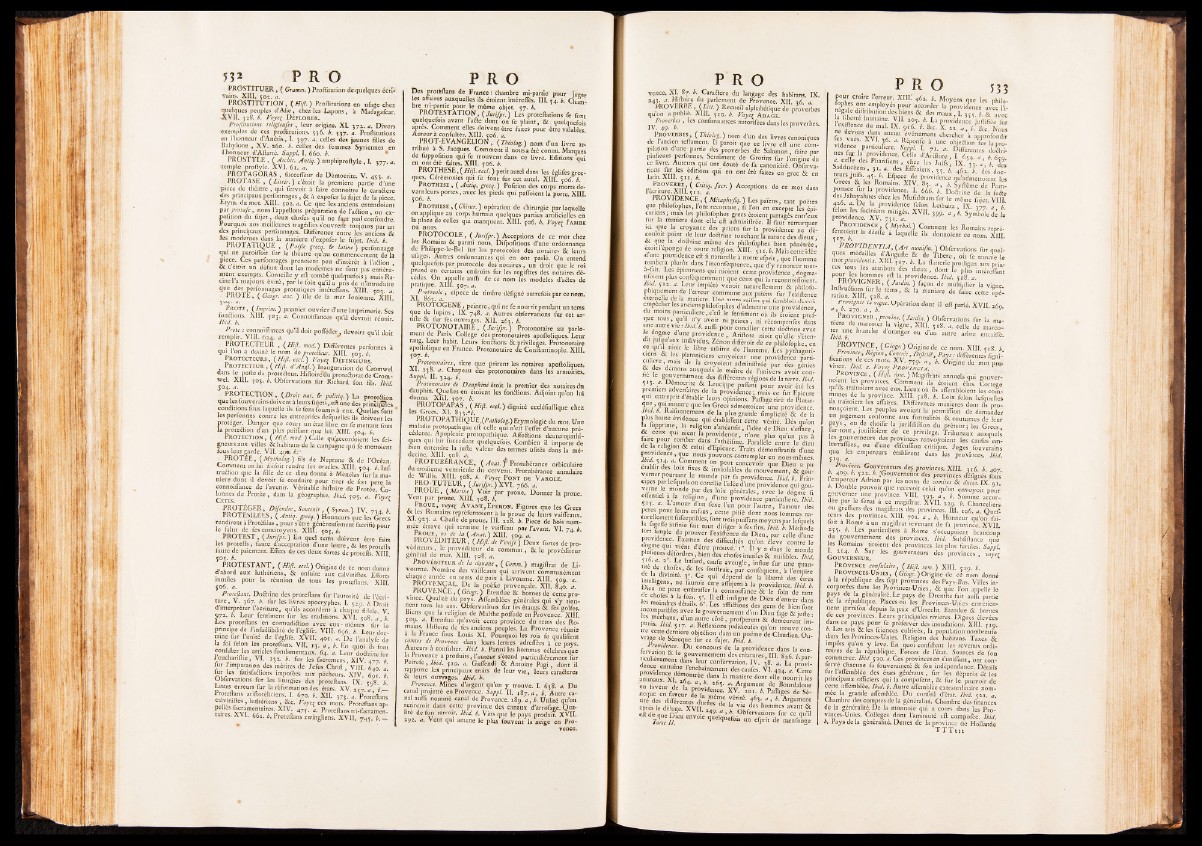
îiH*'
■ÿt i| li
t i i f f '
i;
î
’ I t
l" T ï . .
r
552 PRO
PROST ITU ER , ( Oramm. ) Proflitution de quelques écrivains.
XIII. 502. n.
P R O S T IT U T IO N , ProHitutions en ufage chez
quelques peuples d’A fie , chez les Lapons, à Madanafcar.
X V I I . p ÿ . h. Voyei Déflorer.
Proflhuiions rdigieufes , leur origine. XI. 372. a. Divers
exemples de ces proftitutions. 536. b. 337. a. Proflitiitions
en iliüniîcur d’Aiiétis, T. 397. .1. celles des jeunes filles de
.ôaljylüiie , X V . 260. l>. celles des femmes Syriennes en
l'Jiormeur d’AlIarté. Suppl. I. 660. h.
P R O S T Y L E , ( Archït. Antïq. ) aiuphiproftyle , 1 . 277. a.
icinple nrodylc. X V I . 61. 1. ^ '
PR O T A G O R A S , fiiccc/Teur de Démocriie. V . 4^3. a.
PROFA SE , (L itter.) c’étoït la premiere partie d ’une
piece de théâtre , qui forvoit à faire connoître !c caraftere
des principaux perfonnages , & à expofer le fiijetd e la piece.
Etym. du mot. XIII. 302. a. C e que les anciens entciidoient
par protujc , nous l’appelions préparation de l’aàion , ou ex-
pofiiion du fu je t , deux chofes qu’il ne faut pasi confondre
Pourquoi nos meilleures tragédies s’ouvrem toujours par un
des principaux perfonnages. Ditférence entre les anciens &
ies modernes dans la maniéré d’expofer le fuiet. Ibid b
P R O T A T l(^U E , (Foéfie grecq. 6» latine) perfonnage
qui ne paroifloit fur le théâtre qu’au commencement de la
piece. Ces perfonnages prcnoienc peu d’intérêt à l'adion ,
ix c etoit un défaut dont les modernes ne font p.is entièrement
exempts. Corneille y eft tombé quelquefois; mais Racine
l a toujours évité , par le foin qu’il a pris de n’introduire
que des perlonnages protatiques intérefTans. XIII. 303. a.
P R O T E , (Géogr. anc. ) ille de la mer Ionienne. XIII
503.
, Pk o t i . ( V ™ . . ) preinier ouvrier tl'irne miprimerie. Ses
l U ° r ' l “ ’’! duvroit réunir,
P m e : connoilTmccs qu'il doit poffeder, devoirs qu’il doit
remplir. VIII. 624. a. ' ‘
P RO T E C TEU R , (H iß. mod.) Differentes perfonnes à
qui Ion a doiiné le nom de protdieur. XIII. 303. ù.
Protecteurs, (H ß . ecd.) Voyc^ Défenseurs.
Protecteur , d ’Audi.) Inauguration de Cromwel
proteéleur. Hiftoire du proreftoraede Crom-
wel. XIII. 303. b. Üblervacions fur Richard fon fils. Ibid ,304. a.
P R O T E C T IO N , {Droit net. & politiq. ) La proteaion
que es fouverams doivent a leurs fujets, eft une des p rinciples
conditions fous laquelle ils fc font fournis à eux. Quelles font
les perfonnes contre les emreprifes ciefquelles ils doivent les
protéger. Danger que court un état libre en fe mettant fous
la proteitioa d’un plus puilTant que lui. XIII. 304 b
Protection , ( H ß . mod. ) Celle qu’.iccordoient les fei-
gneurs aux villes tk liabitans de la campagne qui fe mettoient
fous leur garde. V II . 49«, br
P R O T É E , (Myiholog.) fils de Neptune & de l’Océan
Comment on lui faifoit leiuire fes or.icles. XIII. 304. E Inf-
truiftion que la fille de ce dieu donna à Ménclas fur la maniéré
dont il devoit fe conduire pour tirer de fou pere la
connoilTance de l’avenir. Véritable hiftoire de Protée Co-
S te^S géographie. Ibtd. 303. <7. h y e i
PKO TE SILLE S, ( Anuq. grecq. ) Honneurs que les Grecs
rendirent à Protefilas , pour s’être généreufement facrifié pour
le iahit de fes concitoyens. X I ll. 303. é.
P R O T E S T , (Jurifpr.) En quel tems doivent être faits
les protelts, faute dacceptation d’une lettre, & lesprocefts
faute de paiement. Effets de ces deux fortes de proicfts XIII
303. b.
P R O T E S T A N T , ( H ß ecd.) Origine de ce nom donné
d abord aux luthériens, & enfuite aux calvmiftes. Effbrts
mimles pour la réunion de tous les proteftans. XIII.
Proiefl.'int. Doftrine des proteftans fur l’autorité de l’écri-
t iire , V . 367. b. lur les livres apocryphes. I. 529, b Droit
d interpréter l’écriture, qu’ils accordent à chaque fidcle V
972. b. Leur fentiment fur les traditions. X V I . 308. ./ b.
Les proteftans en contracliéHon avec eux - mêmes fur’ le
principe de l’infaillibilité de l’églife. VIII. 696. b Leur doc
mne fur l’unité de l’églife, ^TVII. 401. De l’aualyfc de
la foi félon les proteftans. VII. 13. b. Eu quoi ils font
confiftcr les articles fondamentaux. 64. e. Leur doélrinefur
Icu clu riftie , VI. 132. b. fur les facremens, X IV . 477. b
lur 1 imputation des mérites de Jefiis C liriil, V llI . 640 a
fur les fatisfaftions impofées aux pécheurs. X IV.' 601' b
Obfervations fur les liturgies des proteftans. IX 308' é '
Leurs erreurs fur la réformation des états. X V 237 \
Proteftans ariftotéiieiens. I. 670. b. XII. 37-,. ^ Proreflans
calvmiftes, ludiériens, & c. Poye^ ces mots? Proteftans ap- ,
n i « X V r r / " ' ' f p 4 7 ï . V. Proreft,ns,r.-(acr»,nvl.-
tair«. X V I. C61. t. Proteftans zwingllens. X V I I . 745. b. -
PRO
Des proteftans de France : chambre mi-partie pour iucer
les affaires auxquelles ils étoient intéreffés. 111. 34. b. Chambre
tri-partie pour le même objet. 37. b.
P R O T E S T A T IO N , (Jurifpr.) Les proteflations fe font
quelquefois avant l’afte donc on fe plaint, & quelquefois
apres. Comment elles doivent être faites pour être valables
Auteur à confiilter. X I ll. 306. a.
P R .O T -E V AN G E L IO N , (T/icolog.) nom d’un livre attribue
à S. Jacques. Comment il nous a été connu. Marques
de fiippofition qui fe trouvent dans ce livre. Editions qui
eu ont été faites. XIII. 306. b. ^
PRO TH E SE , ( ecc/. ) petit autel dans les églifes grecques.
Cérémonies qui fe font fur cet autel. XIII. 30Ö. b.
Prothese , ( Antiq. grecq. ) Pofition des corps morts devant
leurs portes, avec les pieds qui paffoient la porte XIII
306. b.
Prothese , ( CéirKr. ) opération de chirurgie pariaquelle
on applique au corps humain quelques parties artificielles en
la place de celles qui manquent. XIII. 306. b. Foyer Jambe
de bois. '•
P R O T O C O L E , (Jurifpr.) Acceptions de ce mot chez
ik parmi nous. Difpofitions d’une ordonnance
de Philippe-le-BcI fur les protocoles des notaiiev & leurs
ufages. Autres ordonnances qui en ont parlé. On entend
quelquefois par protocole des notaires, un droit que le roi
ptend ^ certains endroits fur les regiftres des notaires décèdes.
On appelle auffi de ce nom les modelés d’aéles de
pratique. X I ll. 307. a.
c défigné autrefois par ce nom.
P R O T O G E N E , peintre, qui ne fe nourrit pendant un tems
lupins, IX. 748. rf. Autres obfervations fur cet ar-
tiltc Ck lur fes ouvrages. XII. 263. b.
P R O T O N O T A IR E , (Jurifpr.) Protonotairc au parlement
de I aris. College des protonotaires apoftoliques. Leur
ran^ Leur habit. Leurs fondions & privileges. Protonotaire
apoftoUque en France. Protonotaire de Conftantinople. XIII.
307. i . _ _
P''o‘onotaires, titre que prirent les notaires apoftoliques.
X I. 238. a. Chapeau des protonotalres dans les armoiries, Suppl. II. 324, b.
Protonotaire de D.iuphiné étoit le premier des notaires dn
dauphin. Quelles en cioient les fondions. Adjoint qu’on lui
donna. X l i l . 307. b.
PRÜTOPA PAS , ( Hiß. eccl. ) dignité eccléfiaftiquc chez
les Grecs. XI. 833.-E
PROTOPA T P IlQ U E ,(/ ’ j/éo/o^.) Etymologie du mot. Une
maladie protopathique eft celle qui n’ett l’effet d’aucimc précédente.
Apoplexie protopathique. Affedions denteropatlii-
ques qui lui Inccedcnt quelquefois. Combien il importe de
bien entendre la jufte valeur des termes ufités dans la médecine.
XIII. 308. U.
PRO TU B ÉR AN C E , (A n a t.) Protubérance orbiculaire
du ventricule du cerveau. Protubérance annulaire
de Willis. XIII. 308. b. Foyer Pont de V arole.
PRO T U T E U R , (Ju rifp r.)X W . 766.
P R O U E , (M anne) Voir par proue. Donner la proue.
Vent par proue. XIII. 308. b.
Proue, A van t ,E peron. Figures que les Grecs
& les Kom.^ns reprefemoient à la proue de leurs vaiffeaux.
XI. 923. U. Cliaffe de proue. III. 228. b. Piece de bois nommée
etrave qui termine le vaiffeau pat l’avant. V I 74 b
Proue, or de U (A n a t.) x m . 300. 4.
IR O \ ED IT EU R , (H ß .d e Venife) Deux fortes de pro-
veditcurs , le provcditcur du commun, & le provéditeur
general de me“r. XIII, 308. a.
Provéditeur de U douane , ( Comm. ) magiftrat de L ivourne.
Nombre des vaiffeaux qui airive-nt communément
'? !"s ^ e p a ix à Livourne. XIII. 309. 4.
provençale. XII. 840. a.
P R O V E N C E , (Gfo^/-.) Etendue & bornes de cette province.
Qualité du pays. Affemblées générales qui s’y tien-
nent tous les ans. Obfervations fur fes étangs ik fes golfes.
Biens que la religion de Malthc poffede en Provence. XIIL
309. 4. Etendue qu’avoit cette province du tems des Romain^
Hiftcire de les anciens peuples. La Provence réunie
a la Prance fous Louis XI. Pourquoi les rois fe qualifient
comtes dc^ Provence dans leurs lettres adreffées à ce pays.
Auteurs à confiilter. Ibid. b. Parmi les hommes célébrés que
hi 1 royence a produits, l’auteur s’étend pafticuliércmcnt fur
r e i r e lc , Ibid. 310. a. Gaffcndi & Antoine Pagi , dont il
rapporte les principaux traits de leur v ie , leurs caraéleres
& leurs ouvrages. Ib'id. b.
Provence. Mines d’argent qu’on y trouve. I. 638. a. Du
canal projette en Provence. Suppl. H. 18 7 .4 , b. Antre canal
aufti nommé canal de Provence. 189. 4 , Utilité qu’on
retireroit dans cette province des canaux d’arrofage. Qua-
Jite de fon terroir. Ibtd. b. Vins que le pays produit. XVII .
292. 4. Vent qui amené le plus fouvem la neige en Provence.
P R O
vcnce. XI. 87. b. Carafterc du langage des habitnns. IX.
243. 4. Hiftoire du parlement de Provence. XII 2d *4
PROVERBE ■ >(Lut. ) Recueil alphabétique de proverbes
quoi! a publié. A l ll . 3^^* Foyc^ A d a g E
Proverbes , les coijfonnences n.iiorifécs dans les proverbes.
IV. 49. b. '
Proverbes (Theobg.) nom d’un des livres canoniques
de l ancien teftament. Il paroit que ce livre eft une compilation
d une partie des proverbes de Salomon , faite par
piiifieurs perfonnes. Sentiment de Grotius fur l’origine de
ce livre. Auteurs qui ont douté de fa canonicité. Obferva-
v n f editions qui en ont été faites en grec & en
latin. Alll. 311. b.
Pk o ^erbe ( Cruiq. f,cr. ) Acceptions de ce mot dans
lecnture. XIII. 3 1 1.
{M iu fh y fq .) Les païens, tant poetes
(ine pinloiopbes, lont reconnue, il l’on en excepte les épicuriens
; mats les pliilofoplies grecs étoient partagés entr’eux
lut la mamere dont clic cil adminiftrée. Il faut remarquer
IC. que la croyance des p.aicns fur la providence ne dé-
coiiloit point ÿ leur doflrine touchant la nature des dieux,
& que la doflr.ne même des pliilofopl.es bien pénétrée,
eroitl épongé de toute religion. XIII. 5 i. Mais cette idée
d une pro^dence eft I. nai.ircllc à notre efprit. que l’bomme
tombua plutôt dans 1 inconfequence, que d’y renoncer tout-
a-f:ut. Les épicuriens qui moient cette providence , dogma-
tifomm plus confequemment que ceux qui ta reconnoiffoient.
Ibtd. 312. 4. Leur impifté venoit naturellement & philofo-
phiqucment c.e 1 erreur commune aux païens fur l’exiftcnce
c e rn e le t e la matière. Une autre raifoii qui ferabloit devoir
emp^clierle.sanciensphilofophes d’admettre une providence,
du moins particulière, c’eft le fentiment où ils étoient pref-
Y pciues , ni récompenfes dans
une autre vie : Ibtd. b. auffi pour concilier cette doftrine avec
Je dogme d une providence , Ariftotc nioit qu’elle s’étendit
jiilqii aux individus. Zénon differoit de ce pliilofoplie, en
Hr-nT 1 T f ' f l'homme. Les pythagorii
i.l é.rz. ‘^’■ oyoïeiit une providence partiailicrc
, niais ils l.i croyoienr aciminiffrée par des génies
. tk.mnn.s auxquels le maître de l’univers avoir cou-
fie le gm.vcrmme.it des différentes régions de la terre, ffiid.
513. rr. txemocritc & Leiicippc paffent pour avoir été les
premiers a.lvcrfiurcs de la providence; niais ce fu, Ejlfttl«
qui cn t.cpiitdctablir leurs opinions. Piiffage tiré de Plutar-
»dmettoient une providence. JhJ. b. R.ulonnemeus de la plus grande (implicité & de la
.lus l.a.ite evidence qui érabliffent celte vélité. Dès qu’on
la li.ppr.me, la religion s’anéantit, l’idée de Dieu s’efface,
& ceux qm ment la providence, n’ont plus qu’un nas à
faire pour tomber dans l’athéifme. Parallel e jtre le'^dLÛ
provide . c r ' ’o.m " Traits démouftratifs d’une
Î I i J r îâ ’ ? P“ "™ " ' contempler en nous-mêmes.
■ I .T /■ ; r " ? " ’ ' " ' »n peut concevoir que Dieu a ou
établir des ioix fixes ik inviolables dn mouvement, & gouverner
pourtant le monde par fa providence. IbiJ. b. Principes
par Icfqucls on concilie l’idée d’une providence qui gou-
v c ne le monde par des lo.x généralesI avec le dogme f.
clicntiel .1 la leligion, d une providence particulière. IblJ.
o è r l'/ ' ^ “1"’ ° “ '' I'“ " I» " t l'autre, l’amour des
1 cre pour y . r s enfms , cette pitié dont nous lommes nais
f i n ' " ' f»” ' 'rou' piiiffans moyens par Icfqucls
m l L '°",', i <■ « fins. Uiet. b. Méthode
fort finplc de prouver l’exiftence de Dieu, par celle d’une
providence. Examen des difficultés qu’on élève contre le
,‘ ïnfiêÜ plnfieiiisf ld'e’f/or' d?r'e s bien des chofes inutilyes & niiifi‘bcl es".» "I<bi1e=l.
dd téé ddee cchbonffe s, ’/&t" ,f’'t s’ ffo'’™iif!t'r a.t, par conféque<n■ t", à l’emq«p»ir"einie
V ' ^ ‘''P™ '' >1“ cires
n e .gens, ne far.ro,t être affiijetti à la providence. IHrb. b.
Dieu ne peut embraffer la connoiffiince & le foin de tant
.1= chofes à la fois. II eft indigne de Dieu d’entrer dans
in’comi'"f h f ''° ' ’ <•''’-'>■<>” 5 des gens de bien font
incompatibles avec le gouvernement cî’im Dieu fage & iiifte •
p L h f b T ; n 'n ’ .P^PP"-“ ! & demeurem in,:
piinis. Ibtd. 317. 4. Reflexions )uclicieules qu’on trouve con-
vrac-P T obieélion dans un poème de Claiidien. Ouvrage
de Sen e^ e fur ce fujet. Ibid. b.
f e r v a S f j . " . ' providence dans la coueivation
& le gouvernement des créarures, III. 826. Euar-
euherement dans leur confervation. IV. 38. a La nrôvi-
o ro r id c "''" " r ’' Penchainement des caiifcs. 'VI. 414. » .V e t te
S u x ' X,‘ ' ' a r ' f >” dont e l t to iirr i. les
en faveur de fa^' ^ ^ e S l
tué de s'diirér'îmefd‘uté'rs''3 e Tr'^'^Se d*^’ '!
o b f e v a l r o r f t V « " ; .^
É 2 " , e n cli.tit de mciifonge
PRO 533
pour croire I erreur. XIII. 46a. b. Moyens que les pbilo-
foplics ont employés pour accorder la providence avec l’i-
negaie diliribiitioii des biens & des maux , I. at t é. & avec
■ e Iftmme P™vid=..c’e ’ juftiK e f S
lexilluice du mal. IX. 916. b. ikc. X. 12 4 ^ & c Non«
lés v,TeT’ x v i% f ‘’ ' “ ' N r ■ ' “PP'-ofcndft
■ ' r e lies
fiir la providence. Celle d'Ariftote, 1 , 634, 4 i 0V9
U. celle des Pharificns , cher, les Juifs, IX. , b d S
Kiirs juifs 45 i. Efpece de providence qu’admcitoiem les
Grecs Sc les Romains. X IV . 8c. u , A Ln,-.™,. ,i,. p „ „
ponace for la providence. I. 666. b. Dm%inc d J h fe fl“
des Jabayahites chez les Miifoluians fu, le même fuie, V l l f 40.6. ç. D e la providence felon Lcib.iitr , IX. , 7 7 „ b
;:ov"id':mm"x'^':v"’ r t - ^ y - S c d ; i»
( .% ' ’'» '.) Commeut les Romains repré-
fento.cnt la deeffe a laquelle ils donnolcni ce nom. XIII.
Obfervations fur quel-
qiies médaillés cl Augufte Si de Tibère , où fe trou-ve le
provtdentu. XIII. 3.7. b. La fl.itierie prodigua a u rp r ii!
ces tout es atlnbuts des d ieux, dont le p lL iiuéreffant
pour les liommes eft la providence. Ibirl eiH v
P R O V IG N E R , ( / m i l . ) façon de „ .„ l’.i L ; ' l a vigne,
râ ttm f“ - “ 1'^-
„ 7 o " u " f “ ' “l™ ' ‘I parlé. XVII . 569.
P n o v iG N ïR ,p „ ,vm r .( / w ; „ .) Obfervations fur l.i ,.,ame‘''
b” “ T ' " ' ■ " OS- relie de marco- ÈiL. r " ‘’"“’°"' °“
P R O V IN C E , (Géogr.) Origine de ce nom. XIII. t ,8 b
rrovmce Regror,, Combe, DiflrrB, Pars: différentes figni-'
vviinl cee . Jbid. a. Fo°ye'’^- Pî i ko■ v^i'nPc' ia ‘1“
n o S f T ' " “ - i?“ ’ )Maei<lrl.ts aiuiiiels qui gouverno.
ent les provinces. Comment ils étoient élus. Cortege
qu ils trainoient avec eux. Lieux où ils afferabloient les communes
de la provuncc. XIII. , ,8 . b. Loix félon Icfqi,elles
ils traitoicnt les affaires. Différentes manières dont ils pro-
nonçoieut. I.es peuples avoient la permiffion de demander
un (Ugemem conforme aux formalités & coutumes de leur
pays , ou de dio.fir la pirifiliflion du préteur; les Grecs
ur-tout, joniffoient de ce privilege. Tribunaux auxq.iell
les gmivcrneiirs des provinces renvoyoient les caufes em-
barraffecs, ou dime dilcuflion critique. Juges fouverains
qiie ivS cmpeicurs établirent dans les provinces. Ibid.
Provhee. G o iiv c rn c r s des provinces. XIII. 316. A. 4O7. b. 4 ° 9 - é- ÎÇZ. />. .Gouverneurs des provinces dé/lg.iés foils
I empereur Adrien par les noms de comités & JucesAX 91
b. Double pouvoir que recevoii celui qu’on envoyoit pour
gouverner une province. VUI. 59 ,. a , b. Somme accordée
par le fenat a ce magiftrat. XVII. aao. A. Chanceliers
OU greffiers des magiftrats des provinces, fil. io6 a O n e f
murs des provinces. XIII. 70 ,. u , A. Honneur qu’on fai-
loit a Komc a un magiftrat revenant de fa province X V l f
235- b. Les particuliers à Rome s’occupoient bcaucotiô
(lu gouvernement des provinces. Ibid. Siihfiftance que
les Romains tiroicnt des provinces les plus feniles. Suppl.
1 . 214. b. Sur les gouverneurs des provinces . voyez G o u v ern eu r . ^ j \
Pr o v in c e emfuUire, {H iß. rom.) xm . t ,9 . b.
_ PrOVINCES-Un ie s , (Géogr.)Origine de ce nom donné
a la république des fept provinces des Pavs-Bas. Villes incorporées
dans les Provinces-Unies, & que l’on appelle le
pays de la généralité. Le pays de Drentlie fait auffï partie
de la république. Places où les Provinccs-Uiiies entretiennent
garnifon depuis la paix d’Urrccht. Etendue & bornes
de ces provinces. Leurs principales rivieres. Digues élevées
dans ce pays pour fe préferver des inondations. XIII. 319.
b. Les arts & les fciences cultivés, la population nombreiife
dan.s^ les Provinces-Unies. Religion des liabitans. Taxes &
impôts qu’on y levé. En quoi confifteiu les revenus ordinaires
de la république. Forces de l’état. Sources de fon
commerce. Ibid. 320. 4. Ces provinces en s’uniffmu, ont con-
fervé chacune fa fouveraineté & fou indépendance. Détails
fur l’aflcmbiée des états généraux , fur les députés & les
principaux officiers qui la compofenr, & fur le pouvoir de
cette affemblée. Ibid. b. Autre affemblée extraordinaire nommée
la grande affemblée. Du confeil d'état. Ibid. 321. 4.
Chambre des comptes de la généralité. Chambre des finances
de la généralité. D e la monnoic qui a cours clans les Pro-
vinces-Unies. Colleges dont l'amirautc tft compofée. Ibid,
b. Pays de la généralité. Dettes de la province üe Hollujide
T T T t t t