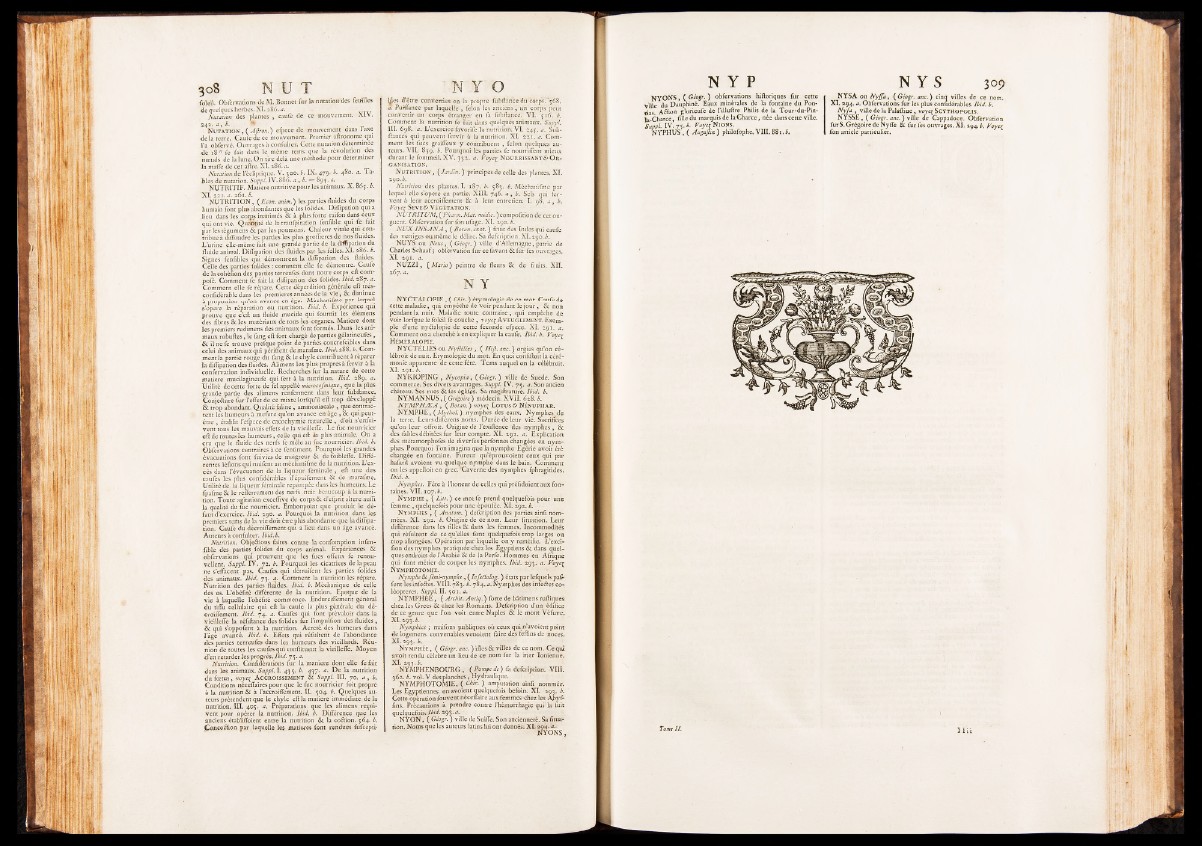
1 '
!l!"
i' i
1 II
1 ! ■ ^ ■
1 II
' l ’ i I,
308 U T
fo k il. Obfervations tic M. Bomict fur la mitatioM des fcirillcs
de quelques licrbcs. X I. 286.
A'uution des plantes
342-
caille de ce niouvcincm. X IV .
Nutation , ( yy/^ro/j.) efpccc de mouvement dans 1 axe
de la terre. Caulc de ce mouvement. Premier aftronomc qui
l’a oblervé. Oiivrai;es à confuher. Cetre nutaiion déterminée
de 18 " fe fait dans le même tems que la révolution des
noeuds de la Urne. O n tire delà une méthode pour déterminer
la malfe de cet aflrc. X L 286.-:. ^
Nut.ition de l’écliptique. V. 300. b. IX. 479. b. 480. a. 1 afclcs
de nutation. 5///'/’^-IV .886. .2, i . — 893.
NU TRITIF. Matière nutritive pour les animaux. X . 865. b.
X L 221. 261./-.
N U T R IT IO N , {Econ.anim.) les parlies fluides du corps
liumain font plus abondantes que les folides. Diflipation qui a
lieu dans les corps inanimés Si à plus forte raifon dans ceux
qui ont vie. Quantité de la tranfpiration Icnfible qui ie fait
par les tégumens Sc par les poumons. Chaleur vitale qui contribue
à dilToudre les parties les plus grolLiercs de nos fluides.
L ’urine elle-même fait une grande partie de la diflipation du
fluide animal. Dilfipation des fluides par les ielles. X L 286. b.
Signes fenfiblcs qui démontrent la diflipation des fluides.
Celle des parties folides : comment elle ie démontre. Caule
de la cohéfion des parties terreufes dont notre corps eft com-
pofé. Comment fe fait la diflipation des folides. Ibid, 287. rf.
Comment elle fe répare. Cette déperdition générale efl trés-
confidérable dans les premieres aimées de la v ie , & diminue
à proportion qu’on avance en âge. Mcchanifme par lequel
s’opère la réparation ou nutrition. IbiJ. b. Expérience qui
prouve que c ’efl un fluide imicide qui fournit les élémens
des fibres & les matériaux de tous les organes. Matière dont
les premiers rudimens des animaux font formés. Dans les animaux
robufles, te fang efl fort chargé de parties gélatineules,
& il ne fe trouve prefque point de parties concrefcibles dans
celui des animaux qui periflént de marafme. Ibid. 288. />. Corn-
mentla partie rouge du fang & le chyle contribuent à réparer
la diflipation des fluides. Alimens les plus propres à fervir à h.
confervaiion individuelle. Recherches fur la nature de cette
matière imicilagineufe qui fert à la nutrition. Ibid. 289. n.
Utilité de cette forte de fel appelle microcofrnique, que la plus
grande partie des alimens renferment dans leur üibflance.
Conjeflure fur l’effet de ce mixte lorfqu’il efl trop développé
& trop abondant. Qualité faline , ammoniacale , que contractent
les humeurs à mefure qu’on avance en âge , &_qui peut-
être , établit l’efpcce de cacochymie naturelle , d'où s’enlui-
vent tous les mauvais effets de la vieillcflé. Le fuc nourricier
efl de toute.sles humeurs, celle qui efl la plus animale. On a
cru que le fluide des nerfs fe mêle au fuc nourricier. Ibid. b.
Obfcrvations contraires à ce fcntinient. Pourquoi les grandes
évacuations font fuivies de maigreur & de foiblefle. Difté-
rentes léflons qui nuifeiit au méchanifme de la nutrition. L’excès
dans l’évacuation de la liqueur féminale , efl une des
caufes les plus confldérablcs d’épuifemeni & de marafme.
Utilité de la liqueur féminale repompêe dans les humours. Le
fpafme & le refTerroment des nerfs nuit beaucoup à la nutrition.
Toute agitation exceflive de corps & d’efprit altéré aulTi
la qualité du fuc nourricier. Embonpoint que produit le défaut
d’exercice. Ibid. 290. a. Pourquoi la nutrition dans les
premiers tems de la vie doit être plus abondante que la diflipation.
Caufe du clécroifTemenc qui a lieu dans un âge avancé.
Auteurs à confuher. Ibid. b.
Niurition. ObjeéUons faites contre la confomption infen-
fjble des parties folides du corps animal. Expériences 8c
obfcrvations qui prouvent que les fucs ofToiix fe renouvellent.
Suppl. IV. 72. b. Pourquoi les cicatrices delapeau
ne s’effacent pas. Caufes qui détruifent les parties folides
dos animaux. Ibid. 73. a. Comment la nutrition les répare.
Nutrition des parties fluides. Ibid. b. Méchaniqiie de celle
des os. L’obéflté différente de la nutrition. Epoque de la
vie à laquelle l’obéfité commence. Endurciflement général
du tiffu cellulaire qui efl la caufe la plus générale du dé-
croiiTemcnt. Ibid. 74. a. Caufes qui font prévaloir dans la
vieilleffe la réfiftance des folides fur l’impulfion des fluides ,
& qui s’oppofent à la nutrition. Acreié dos humeurs dans
l'âge avancé. Ibid. h. Effets qui réfulcent de l’abondance
des parties terreufes dans les humeurs des vieillards. Réunion
de toutes les caufes qui confliiuent la vieilleffe. Moyen
d’en retarder les progrès. Ibid. 7 ^
Nutrition. Confidérations fur la maniéré dont elle fe fait
dans les animaux. Suppl. \. 435. b. 437. a. D e la nutrition
du foetus, voye^^ ACCROISSEMENT 8c Suppl. III. 70. a , b.
Conditions nécelTaires pour que le fuc nourricier foit propre
à la nutrition & à l’accroiflement. II. 504. b. Quelques auteurs
prétendent que le chyle cft la matière immédiate de la
nutrition. III. 405. a. Préparations que les alimens reçoivent
pour opérer la nutrition. Ibid. b. Diflércnce que les
anciens établiffoient entre la nutrition Sc la coélion. 364. b.
Çoncûélion par laquelle les matiejes font rendues fufcepti-
N Y O
l^les d’être converties en la propre fubftr.nce du corps. 368.
,1. Purflimee par laquelle , felon les anciens, un corps peut
convertir un corps étranger en fa fubilancc. V I . 516. b.
Comment la nutrition fe fait dans quelques animaux. Suppl.
III. 698. n. L’exercice favüiife la nutrition, V I. 243. ,2. Sub-
flaiices qui peuvent fervir à la nutiiiion. XL 221. a. Comment
les flics graifl'eux y contribuent , felon quelques auteurs.
V i l, 839. b. Pourquoi les parties fe noinriirem mieii.x
durant le fommeil. X V . 332. a. Voye^ No u r r is s a s t É 'O r-
GANtS.ATlON.
Nutrition, (/.27.6V;. ) principes de celle des plantes, Xf.
390. b.
Nutrition des plantes. 1. 187. b. 383. b. Méchanifme par
lequel elle s’opère en partie. X I ll. 746. a , b. Sels qui ler-
vent à leur accroiffement £c à leur entretien. I. 98. .2, b.
Voyc:^ SEVEéV VÉGÉTATION.
NU TR ITUM , {^Phurm.Mut. nui.lie. )compofition de cet onguent.
Obfervation fur fon ufage. XL 290. b.
N U X IN S X N A , ( Botan. exot. ) fruit des Indes qui caufe
des vertiges ou meme le délire. Sa defer iption, X L 290. b.
N U YS ou A ’tv«, ( ) ville d’Allemagne, patrie de
Qiarles Schaaf ; obfervacion fur ce favanc 8c fur fes ouvrages,
XL 291. U.
N Ü Z Z I , (^Murio) peintre de fleurs 8c de fruits. XII.
267. J.
N Y
N Y C T A L O P IE , ( Chir. ) étymologie de ce mot. Caufe de
cette maladie, qui empêche de voir pcmiatu le jour , 6c non
pendant la nuit. Maladie toute contraire, qui empêche de
voir lorfque le foleil fe couche , voye^ A veuglement. Exemple
d’une nyéinlopie de cette fécondé cfpece. XL 291. a.
Comment on a cherché à en expliquer la caufe. Ibid. b. Voye-^
Héméralopie.
NY CTÉ L IE S ou Nydclées , ( Hiß. une. ) orgies qu’on cé-
lébroit de nuit. Etymologie du mot. En quoi confifloit la cérémonie
apparente de cette fête. Tems auquel on la céLébroit.
X L 291. b.
N Y K IO P IN G , Nycopin, (Geb^r. ) ville de Suede. Son
commerce. Scs divers avantages. Suppl. IV . 73. a. Son ancien
château. Ses mes 8c fes églifes. Sa magiflranire. Ibid. b.
N YM AN N U S ,(G 2 ïÿ vr rO médecin. X V II . 628. b.
N YM PH Æ A , ( Botan. ) voyrç Lotus & Nénuphar.
NY.MPHE, ( Myr/to/.) nymphes des eaux. Nyniphes de
la terre. Leurs diffêi'cns noms. Durée de leur vie. Sacrifices
qu’on leur oftroit. Origine de î’exiflcnce des nymphes , Sc
des fables débitées fur leur compte. XI. 292. a. Explication
des métamorpliofes de ciiverfes perfonnes changées en nymphes.
Pourquoi l’on imagina que la nymphe Egérie avoit été
changée en fontaine. Fureur qu’éprouvoiem ceux qui par
hafard avoienc vu quelque nymphe dans le bain. Comment
on les appelloit en grec. Caverne des nymphes fphragitides.
Ibid. b.
Nymphes. Fête à i’honeur de celles qui préfidoient aux fontaines.
"VIL lOj.b.
Nymphe , ( Lin. ) ce mot fe prend quelquefois pour une
femme , quelquefois pour une époufée. XI. 292. h.
Nymphes , ( A/mtom. ) defeription des parties ainfi nommées.
XI. 292. b. Origine de ce nom. Leur fituation. Leur
différence dans les filles 8c dans les femmes. Incommodités
qui réfultcni de ce qu’elles font quelquefois trop larges ou
trop allongées. Opération par laquelle on y remédie. L’exci-
fion desnyanphes pratiquée chez les Egyptiens 8c dans cpiel-
ques endroits de l’Arabie 8c de la Perfe. Hommes en Afrique
qui font métier de couper les nymphes. Ibid. 293. a. Voyct^
Nymphotomie.
Nymphe 8c fémi-nymphe , ( Hfeflolog. ) états par lefqiiels pat-
fent lesinfeéles. V III. 783. b. 784. a .Nyjnphes des in fefles coléoptères.
Suppl. IL 301. a.
N YM PH É E , ( Archit. A ntiq.) forte de bâtimen,s rufliqnes
chez les Grecs Sc chez les Romains. Defeription d’un édifice
de ce genre que l’on voit entre Naples 8c le mont Véfuve.
X L 293. i.
Nymphics ; maifons publiques où ceux qui n’avoient point
de logemens convetiables venoient faire des feftins de noces.
XL 293. b.
Nymphée, ( Géogr. anc. ) ifles Sc villes de ce nom. Ce qui
avoit rendu célébré un lieu de ce nom fur la mer Ionienne.
XI. 293. b.
N YM PH EN B O U R G , ( y’ o//2jpc/e) fa defeription. V IIL
362. b. vol, V des planches, Hydraulique.
NYM PH O TOM IE , ( Chir. ) amputation ainfl nommée.
Les Egyptiennes en avoient quelquefois befoin. XI. 293. h.
Cette opération fouveiit néceflairc aux femmes chez les Abyf-
fms. Précautions à prendre contre l’héniorrhagie qui la fuit
quelquefois. Ibid. 293.<7.
N Y O N , ( Géogr. ) ville de SuilTe. Son ancienneté. Sa fituation.
Noms que les auteurs latins lui ont donnés. XI. 294. a.
' N Y O N S ,
N Y P N Y S
N Y O N S , ( Géogr. ) obfervations hiftoriques fur cette
Ville du Dauphiné. Eaux minérales de la fontaine du Pon-
tias. Aiflion glorieufe de l’illuftre Philis de la Tour-du-Pin-
la-C!iarce, fille du marquis de laC har c e , née dans cette ville.
Suppl IV. 73. b. Nions.
NVPHUS , ( JugujUn ) philofophe. V IIL 881.
309
N Y SA ou NyjJ'a, {Géogr. anc.) cinq villes de ce nom.
XI. 294. a. Obfervations fur les plus conhdérables. Ibid. b.
Nyfa , ville de la Paleftiue , voye^ Scythopolis.
N Y S S E , ( Géogr. anc.) ville de Cappadocc. Obfervation
fur S. Grégoire de Nyffe & fur fes ouvrages. X L 294. f’. Loye^
fon article particulier.