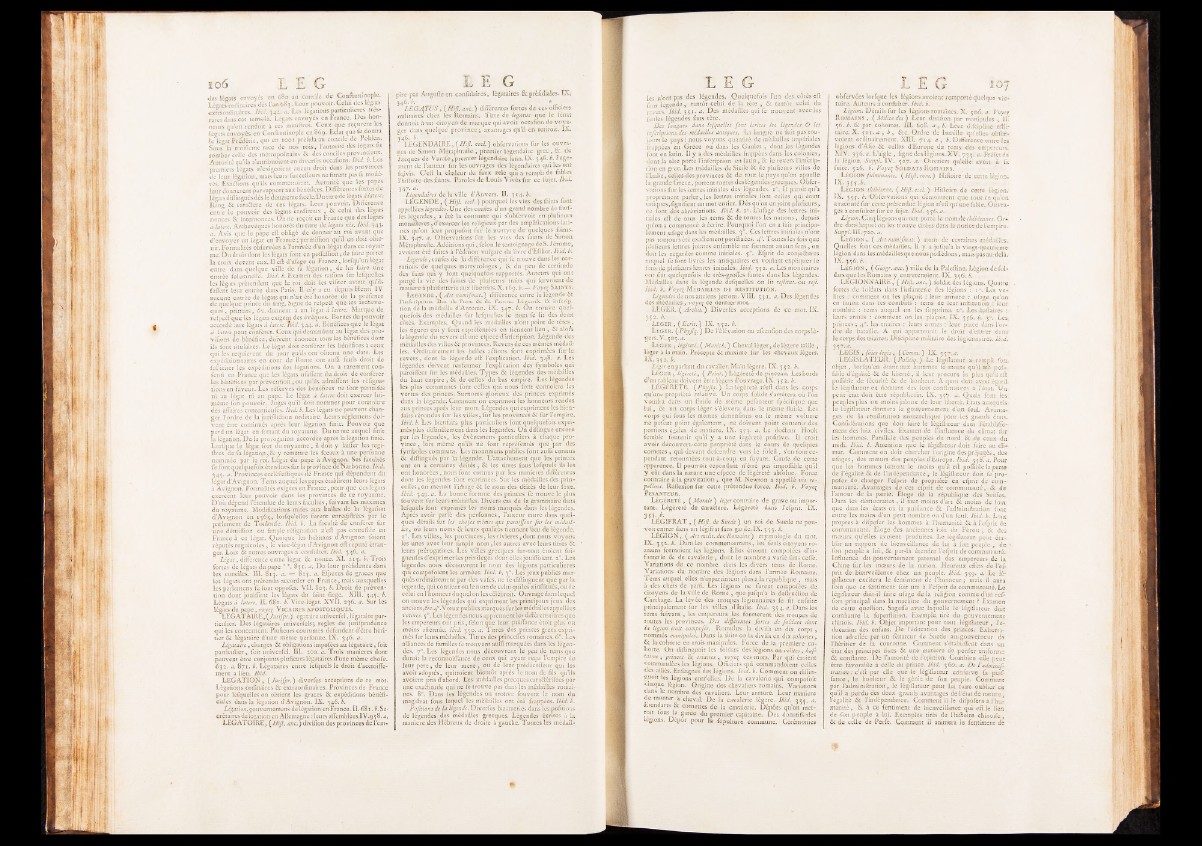
L EG
1 li .
^ I
Ï06
des lésnt« envoyas en 680 an concile de Conflainmople.
L'-çnts’ oi 'i: ) dies dès l'.m b ^ . Lenr [loiivoiv. Celui des légats
cxnaord niir.s P 342. Les légations particulières très-
rares dans ces lems-là. Légats envoyés cnl'ranco. iJcs lion-
nems (l’j ’on rendoit à ces minillres. Ceux que reçurent les
légats envoyés en CmilLuniiiople en 869. Eclat cpic le donna
le légat Frédéric, qui en 1001 prclidaau concile de Polden.
Sous la troiliemc race de nos vois, raiitorité des légats lit
tomber celle des métropolitains & des conciles provinciaux.
Antoriié qu'ils s'attribuolcin en divcries occalions. Ibid. b. Les
prcniieis légats n'exigeoient aucun droit dans les provinces
de leur légation, mais leurs fticceireurs ne furent pas fi modelés.
Exaélions qu'ils commenoient. _ Autorité que les papes
leur donnèrent par rapjion au.x bénélices. Dlirérenics lortes do
légats dirtingués dès le douzième fteclc.Du titre de légats ù/arerr.
Rang & caraéfere de ces légats. Leur pouvoir. Diilétence
cmi'e le pouvoir des légats cardinaux , & celui des légats
jionces & intcrnonccs. On ne reçoit en France que des légats
à ir.cTc. Arebevéques lionorcs du titre de lésais nés. Ibid. 343.
ti. Avis que le pape cil obligé de donner an roi avant que
d'envoyer tin légat en France ; peimiflion qu'il en doit obtenir.
Formalités obfcrvées à raniv ée d’iin légat dans ce royaume.
Du druii donc les légats font en poirefi'ion, de faire porter
la croix devant eux. 11 eft d’ufage en France , lorfqu un légat
entre dans quelque ville de la légation , de lui faire une
entrée lülcmnolle. Ibid. b. Examen des raifons fur ielqiidlcs
les légats [irctendent que le roi doit les vifitcr avant qu’ils
falTcnc leur entrée dans Paris. 11 ii'y a eu depuis Henn IV
aucune entrée de légats qui n’ait été honorée de la prelence
de quelque prince du fang, üigne de refpcfl que les archevêques,
primats, 6v. donnent à un légat .) Liure. Marque de
icfpccl que les légats exigent des évêques. Bornes du i>ouvoir
accordé aux légats à Liu'rc. Ibid. 344. u. Bénciiccs que le légat
Il hicrc peut conférer. Ccu.x qui dcmandciu au légat des pro-
vilions de bénéfice, doivent énoncer tous les bénéfices dont
ils font titulaires. Le légat doit conl'ércr les bénéfices à ceux
qui les requièrent du jour qu'ils ont obtenu une date. Les
expéditionnaires en cour de Rome ont aulîi fa ils droit de
follicitcr les expéditions des legations. On a rarement con-
fontl en France que les légats ufalTent du droit de conférer
les bénéfices par prévention , ou qti ils admilTent les réligna-
tionscn faveur. L .s réferves des bénéfices ne fontpermilés
ni au lé‘'at ni au pape. Le légat à Lucre doit exercer lui-
mèinc Ion pouvoir. .Liges qifil doit nommer pour coimoitrc
des affaires contentieufes. Ibid. b. Les légats ne i)euvenc changer
l’ordre de la jiirildiétion ordinaire. Leurs réglemens doivent
être continués après leur légation finie. Pouvoir que
jierd un légat en ibrtant du royaume. Du terme auquel finit
la légation. D e la prorogation accordée après la légation finie.
Lorl'que le légat fort du royaume, il doit y lailfcr les regi-
ftres de fa légation,& y remetue les fceaux à uue perfonne
nommée par le roi. Légat du pape h Avignon. .Ses facultés
fe fontquelquefois étendues fur la province dcNarbonne. Ibid.
343, U. Provinces eccléfiaftiques de France qui dépendent du
légat d’A vignon. Tems auquel les papes établirent leurs légats
à Avignon. Formalités exigées en F rance, pour que ces légats
exercent leur pouvoir dims les provinces de ce royaume.
D ’où dépend rétendue de leurs facultés, fuivant les maximes
du royaume. Modifications miles aux bulles de la légation
d'Avignon en 1365, lorfqu’elles furent enregiftrées par le
parleincnt de Touloiil'e. Ibid. b. La faculté de conférer fur
une dèmifiion ou fimplc réfignation n’clf pas contellee en
F'rance à ce lésât. Quoique les babitaiis d'Avignon l'oient
réputés rcgnicoles , le vice-légat d'Avignon eft réputé étranger.
Loix de autres ouvrages à confuher. Ibid. 346. a.
Lsÿ.u, différence entre légat éc nonce. XL 213. b. Trois
fortes de légats du pape 831. J. D e leur préfidence dans
les conciles. 111. 813. u. — 813. j . Efj)eccs de graces que
les légats ont prétendu accorder en France, mais auxquelles
les parlemens le font oppofés. V IL 803. b. Droit de prévention
dont jouifi'eiu les légats du faint liege. XIII. 343. b.
Légats à Lucre. II. 681. b. Vice-légat. X V ll. 236. <1. Sur les
légats du pape, ViCAlRES APOSTOLIQUES.
LE G A T A IR E , egataire univcrlél, légataire particulier.
Des légataires univerl'els; regies de jurilprudence
qui les concernent. Pluficiivs coutumes défendent d’étre héritier
& légataire d'une même perfonne. IX. 346. ti.
Légataire, cluirgcs ÔC obligations impofées au légataire, foit
particulier, foit univcrfcl. 111. 200. a. Trois maniérés dont
peuvent être conjoints plufieurs légataires d’une même ebofe.
<532, a. 871. b. Légataires entre lefquels le droit d’accroifl'e-
ment a lieu. Ibid.
L E G A T IO N , {Jurifpr.') diverfes acceptions de ce mot.
Légations ordinaires & extraordinaires. Provinces de France
pour lefquelles on obtient les graces & expéditions bénéfi-
cialcs dans la légation d’Avignon. IX. 346.
£t?g:rtfio/2,gouvernemcns délégation en France. IL 681. /'.Secrétaires
délégation en Allemagne rieurs airemblées.IV.938.rt.
LE G A TÜ IR E , {^Hifl, a/ic.) divifion des p rovinces de l’cm-
L E G pire par Au gu lle cn confulaircs, légataires & préfidiales. IX .
34Ö./>. >' ,
L E G .4J 'U S , {Hid. cue. ) difierentes fortes de ces olbciers
militaires cbe/. les komains. Titre de legntiis que le Icmu
donnoit à un cicoveii de marque qui avoir occafion de v o y a ger
dans quelque province j avantages qu’il en retiroit. iX .
346.
LEG EN D A IR E , {Hiß. ecd.) obfervations fur les ouvrages
de .Simon Métapbraile , premier légendaiie grec , 6c de
Jacques de Va ra fe , premier légendaire latin. IX. 346. b. Jugement
de rameur fur les ouvrages des légendaires qui les ont
fipvis. C ’eft la chaleur du faux zele qui a remjdi de fables
l’hiltoire des faints. Paroles de Louis Vive s fur ce Uijet. Ibid.
347. a.
Légendaires de la ville d’Anvers. II. 3M'^-
LEGENDE , ( Hiß. ecet. ) pourquoi les vies des faints font
a p p e l l e e s Une descaufes d’un grand nombre de fauf-
fes légendes, a été la coimime qui s’obfervolt en plufieurs
monalleres, d’exercer les religieux par des amplifications latines
qn'on leur propofoit l'ur le martyre de quelqtics faints.
IX. 347. a. Oblcrvations fur les vies des faints de Simon
Métaplitailc. Additions q u i, felon le témoignage tie S. Jérome,
avoient été faites à l’édition vtilgatc dti lii re d’Efilicr. Ibid. b.
Zfgr/2</e,caufcs de la différence qui fc trouve dans les narrations
de quelques martyrologes , & du peu de certitude
des faits qui y ibnt quelquefois rapportés. Auteurs qui ont
purgé la vie des faims de plulieurs traits qui fervoient de
mattere à plailnmerie au.x libertins.X. 169. b. — l 'oyc{ Saints.
Legende , ( d n numifm.it.') différence entre la légende &.
l’infcription. But de l’une ik. de l'autre. Légende ik inferip-
lion de la médaille d’Antonin. IX. 347. b. Ün trouve quelquefois
des médailles fur lefquelles le nom fc lit des deux
côtes. Exemples. Quand les médailles n’ont point de têtes ,
les figures qui y font repvéfcntécs en tiennent lien , & aloi’s
la légende du revers eft une cfpece d’ inl'cription. Légende des
médailles des villes & provinces. Revers de ces mêmes médailles.
Ordinairement les belles aiftions font exprimées fur le
rev e r s, dont la légende eft l’explication. Ibid. 348. a. Les
légendes doivent renfermer l'explication des fymbolcs qui
paroifibnt iur les médailles. Types & légendes des médailles
du haut empire , ik de celles du bas empire. Les légendes
les plus communes font celles qui nous font connoître les
vertus des princes. Surnoms glorieux des princes exprimés
dans la légende. Comment on exprimoit les honneurs rendus
aux princes après leur mort. Légendes qui expriment les bienfaits
répandus fur les ville s, fur les provinces & fur l’empire.
Ibid. h. Les bienfaits plus particuliers font quelquefois exprimés
plus diftinftement dans les légendes. On diftingue encore
par les légendes, les événemens particuliers à du q u e province
, lors même qu’ils ne font rcpréfeniés que par des
fymboles communs. Les monumens publics font aufi'i connus
ik diftingués par la légende. L’attachement que les princes
ont eu à certaines déités, 6c les titres fous lefquels ils les
ont honorées , nous font connus par les maniérés différentes
dont les légendes font exprimées. Sur les médailles des prin-
ccires,on mcttolt rUltage Sc le nom des deités de leur fexe.
Ibid. 349. a. La bonne fortune des princes fe trouve le plus
fotivent fur leurs médailles. Divers cas de la grammaire dans
lcrquets font exprimés les noms marqués dans les légendes.
Après avoir parlé des perfonnes, l’auteur entre dans quel-
([ues détails fur /es clwjes memes qui puroijfent fur les méd.iil-
les, où leurs noms & leurs qualités tiennent lieu de légende,
i ”. Les villes, les provinces, les rivieres, dont nous voyons
les unes avec leur fimplc nom,les autres avec leurs titres &
leurs prérogatives. Les villes grecques fur-tout ctoienc foi-
gneufes d'exprimer les privileges dont clics jouiffoient. 2'’. Les
légendes nous découvrent le nom des légions particulières
qtii compolbient les armées. Ibid. b. 3“ . Les jeux publics marqués
ordinairement par des vafes, ne fc diftiiigucnt que par la
légende, qui comiont ou le nom de celui quilcs ainftitués, ou de
celui en l’Iionneurdnquelonlescélébroit. Ouvrage dans lequel
on trouve les légendes qui exprimont les principaux jeux des
anciens,6’e.4‘'.Voeux pubtiesmarques furies médaillesr.ppcllées
voiivcs. 3". Les légendes nous apprennent les diftérens titres que
les empereurs ont pris, felon cjtie leur ptiiffunce étoic plus ou
moins affermie. Ibid. 330. <1. Titres des princes grecs exprimés
lur leurs médailles. Titres des princeffes romaines. 6". Les
alliances de familles fc trouvent aiiffi marquées dans les légendes.
7®. Les légendes nous découvrent le peu de tems que
diiroic la rcconnoiffancc de ceux qui ayant reçu l’empire do
leur pere, de leur mere , ou de leur préclécefi'eur qui les
avolt adoptés, quittoicm bientôt aptes le nom de fils qu’ils
avoient pris d’abord. Les médailles grecques caraélérifées par
une exactitude qui ne fe trouve pas dans les médailles romaines.
8®. Dans les légendes on trouve fouvent le nom du
magillrat fous lequel les médailles ont été frappées. Ibid. b.
Pofitions de la légende. Diverfes bizarreries dans les pofitions
de légendes des médailles grecques. Légendes écrites à la
manière des Hébreux de droite à gauche. Toutes les mcd«ùl-
LEG les n’ont pas des légendes. Quelquefois l’un des côtés eft
iLis ie^eride , tantôt celui de l.t tète , & tantôt celui du
leecrs."Ibid. 331. a. Des médailles qui fe trouvent aveeles
lüulcs légendes fans tête.
Des Lint^iies dans lefquelles font ésr'ucs les Ugcr.-les O les
inferiptians des médailles antiques. La langue ne fuit pas tou-
'n-ors le pays: nous voyons quantité de médailles impériales
fi.qtpécs en Grèce ou dans les Gaules , dont les légendes
font en latin. Il y a dos médailles frappées dans les colonies,
dont la tête porte l’infcription en latin , & le revers rinteri])-
lion en grec. Los médailles de Sicile ék de plufieurs villes de
l’Italie, celles des provinces & de tout le pays qu’on appelle
î.i grande Grece,|)ortent toutes des légendes grecques. Ofifet-
vations fur les lettres initiales des légendes, i". Il paroit qu’;t
proprement parler, les lettres initiales font celles qui étant
uniques,fignifiein iin mot entier. Dés qn’on en joint plufieurs,
ce loin des abréviations. Ibid. b. 2". L ’ufagc des lettres initiales
eft de tous les tems & de tontes les natioiîs, depuis
iju'on a commencé à écrire. Fourquoi l’on en a fait jnàncipa-
lement tifage dans les médailles. 3“. Ces lettres initiales n'onc
pas toujours été exaéiementponéluées. 4” . T outes les fois que
jdiifieuis lettres jointes eiifembic ne forment aucun fens, on
floit les regarder comme initiales. 3“. Elprit de conjoéhircs
tiuqiiel fefont livrés les antiquaires en voulant expliquer le
f.ms de plufieurs lettres initiales. îbid. 332. <7. Les monétaires
<'iit fait quelquefois de très-groffes fautes dans les légendes.
Médailles dans la légende dcfquelles on lit rejliiut. ou reß.
Ibid. b. MÉDAILLES DE RESTITUTION.
Z.c'gi.7it/a do nos anciens jettons. V III. 531. .7. Des légendes
des médtiillcSj voye^ ce dernier mot.
LEGEil. ( Archit. ) Diverfes acceptions de ce mot. IX.
332. b.
L e g e r , {E crit.) IX. 332. b.
L eger. {Phyßq. ) De l’élévation ou afeenfion des corps légers.
V. 303.^7.
L eger , légèreté. ( Muréch. ) Cheval léger, de legere taille ,
léger à la main. Précepte ôe maxime f ur les chevaux légers.
Léger en parlant dn cav.alier. Mam légère. IX. 332. b.
L éger , légérctc, { Peint.) Légèreté de l'inceau. Les bords
d’n 11 tableau doivent être légers d’ouvrage. IX. 33 2.
LtlGÉRETÉ. ( Phyßq. ) La légércté n’eff dans les corps
qu’une propriété relative. Un corps folide s’arrêtera où l’on
voudra dans un fluide de même pefanteur (pécifiqite que
lu i , & tin corps léger s’élèvera dans le même fluide. Les
corps qui fous les memes dimenfions ou le même volume 31C pefent point également, ne doivent point contenir des
jiortions égales de matière. IX. 333. u. Le doéleur I-Iook
fcmble foiitcnlr qu’il y a une légércté pofuivc. Il croit
ttvoir découvert/cette propriété dans le cours de quelques
cometes , qui devant defeendre vers le fo lc il, s’en font cependant
retournées touc à-coup en fuyant. Cntifc de cette
apparence. Il pourroic cependant n’êtrc pas impofiible qu'il
y eût dans la nature une cfpece de légércté ablblue. F'orce
contraire à la gravitation , que M. Newton a appelle vis re-
pelleris. Réflexion fur cette prétendue force. Ibid. b. Voye:^
P esanteur.
L é g è r e té , {Morale) contraire de grave ou important.
Légércté de caraétere. Légércté dans l'cfprit. IX.
353' A
LÉ G IF R A T , ( Hiß. de Snede ) un roi de Snede ne pouvoir
entrer dans un légifratfans gard c.IX. 333./..
LÉ G IO N , {A r t milit. des Romains) étymologie dn mot.
IX. 332. b. Dans les commencemens, les feals citoyens romains
formoient les légions. Elles étoient compofées d’infanterie
& de cavalerie , dont le nombre a varié fans celle.
Variations de ce nombre dans les divers tems de Rome.
Variations du nombre des légions dans rarmee Romaine.
Tems auquel elles n'appartinrent pins à la république , mais
à des chefs de parti. Les légions ne furent compofées de
citoyens de la vill-e de Rome , que juftpi’à la deftruiftion de
Carthage. La levée des troupes légionnaires fe fit enfuite
principalement fur les villes d’Italie. Ibid. 354. .7. Dans les
tems fuivans , les cmpercins les formèrent des troupes de
toutes les provinces, Des dif'ércntes Jones de foLLits dont
Li légion étoii compojee. Romulus la divifa en dix corps ,
nommés m.uiipules. îôans la fuite on i;i divifa en dix cohortes,
6c la coiiorie en trois maiiiputes. Force de la liremiere cohorte.
On dillingtioit les lüldats des légions en ve/riej, éu/-
tahes , princes & triaires , voyr^ ces mots. Par qui étoient
commandées les légions. Üificiers qui cominandoient celles
ocs alliés. Enfeignes des légions. Ibid. b. Comment on dillin-
gqoit les légions entr’elles. D e la cavalerie qui compol'oit
tnaque légion. Origine des chevaliers romains. Variations
<ians le nombre des cavaliers. Leur armure. Leur maniéré
de monter k cheval. D e la cavalerie légère. Ibid. 333. u.
Etendans Sc cornettes de la cavalerie, Dépôts qu’on met-
toit fous la garde du premier capitaine. Des tlonatifs des
legions. Depot pour la fépulturc commune. Cérémonies
E G Î07
obfervées lorfqtic les légions avoient remporté quelque v ic toire.
Auteurs k confulier. Ibid. b.
Légion. Détails fur les légions romaines. X. 506. <7. Hoye^
RoaiAiNS , {Milice des) Leur divifion par manipules , iT
36. b. ik par cohortes, i l l . 608. a , b. Leur diftipline inîli-
niire. X. 5 11. u , b , &c. Ordre de bataille qu’elles obfcr-
voicm ordinairement. XIII, 714. a , /•. Différence entre iss
légions d’A fie ik celles d’Enrope du tems des empersurs.
X IV . 336../. L’aigle , figue des légions. X V . 733. a. Préfet de
la légion. Suppl. IV. 327. a. Ouvriers qu’elle avoit à fa
fuite. 326. b. So ld a t s Rom a in s .
hi-ClOV fidminanie. {Hiß. rom.) Hiftoire de cette lésion.
IX. , 5 , . 4.
L égion thcbeer.ne. { Hiß. eecl. ) Hiftcirc de cette légion.
IX. 333. b. Oblcrvations qui démontrent que tout ce qu’en
a raconté fur cette prétendus légion ii’cft qu’une fable. Ouvrages
à confniter fur ce l'ujet. Ibid. 336. a.
Légion. C inq légions qui ont porté le nom de thébéennes. O r dre
dans lequel on les trouve citées dans la notice de l’empire.
Suppl. III. 720. il.
L égion , ( A n numlfm.tt. ) nom de certaines méd.iillcs.
Quelles font ces médailles, il y a jufqu’à la vingt•quairieme
légion dans les médailles que nous pofiédons, mais pas au-delà.
IX. 336. b.
L égio n , ( Géogr. une. ) v ille de la Paleftins. Légion de fol-
dats que les Romains y cntreicnoient. IX. 336. b.
LEGION N.'\iRE, ( Hiß. ane. ) loldat des légions. Quatre
fortes de foldacs dans rinfamerie des légions : i", Les ve-
litcs : comment on les plaçoit ; leur armure ; ufage qu’on
en faifoit dans les combats : tems de leur inîtitution : leur
nombre : tems auquel on les ftipprima. 2®. Les liaftahes :
leurs armes : comment on les |d.içolr. iX . 336, b. y . Les
j'rinces ; 4®. les triaires : leurs armes : leur place dans l’ordre
de bataille. A qui appartenoit le droit d'entrer dans
le corps des triaites. Diftipline militaire des légionnaires. Ibtd.
35m m
ld£.G\S , ßoies legis , {Comm.) IX. 337. <7.
LÉGI8LATEUU. {P o liiiq .) Le lég-lflatenr a icinpii Ton
objet , loifqii’cn ôtant aux hommes le moins qu’;l aft. pof-
fti)lc d'égalité ÖC de liberté, il leur procure le plus qu’il eft
poffiblc de fécuriic ôc de bonheur. A quoi doit avoir é-’ ard
le légiftateiu-eu donnant des loix conftitiiiives à l’état. Un
petit état doit être républicain. IX. 337 Quels font les
peuples ])lus ou moins jaloux de leur liberté. Lcats auxquels
le légiftatcur donnera le gouvernement d’un feul. Avantages
de la conftitiition nionarcliique pour les grands états,
Gonfulcraiions que doit faire le légiflueur dans l’établiffe-
menc des loix civiles. Examen de l'influence du climat f'ur
les hommes. ParalLle des peuples du nord 6c de ceux du
midi. Ibid. b. Attention que le Icgillatciir doit faire au cli-
mar. Comment on doit chercher l’origine des préjugés , des
ulagcs, des moeurs des peuples d’Europe. Ibid. 338. a. Pour
que les hommes fenteiu le moins qu’il efl pofiîblo la perte
de l’égalité ék de l'indépendance , le îcgiflaccur doit fo pro-
pofer de changer l’efpric de propriété en efprit de communauté.
Avantages de cet efprit de communauté, 6c de 1 amour de la patrie. Eloge do la république des Suiffes.
Dans les démocraties , il taut moins d’art & moins de foin
que dans les états où la puilTancc & radfniniftration lont
entre les mains d’un petit nombre ou d’un feul, IbiJ. b. Lr>ix
propres k ditpofer les hommes k l’humanité & i l ’efptit de
communauté. Eloge des anciennes loix du Pérou , ik des
moeurs quelles avoient produites. Le iégiflaceur peut établir
un rat)porc de bienveillance de lui à fou peuple , de '
Ion peuple à h i i , ik par-là étendre l’elprit cic communauté.
Influence du gouvernement paternel des empereurs de la
Chine fur les moeius de la nation. Heureux effets de l’ef-
prit de bienveillance chez un peuple. Ibid. 339. a. Le lé-
gillatciir excitera le fentlment de l'honneur; mais il aura
loin que ce ientiment foit uni à l’efprit de communauté. Le
léglllateur doit-il l'aire iiliige de la religion comme d'un ref-
lort principal dans la maclnne du gouvernement ? Examen
de cette queftion. Sagelî'e avec laquelle le légiftatcur doit
combattre la fupcrftition. E.xempic tiré du gouvernement
chinois. Ibid. b. Objet important pour tout légiflateur , l’éducation
des enfans. D e l'éducation des princes. Exhortation
adrefiée par un fénatenr de Snede au.gouverneur de
l’héritier de la couronne. Comment s’étabhjTent dans un
état des principes fixes & une maniéré de penfer uniforme
6c confiante. De l’autorité de l’opinion. Combien elle peut
être favorable à celle du prince. Ib'id. 360. a. De 1'adminiß-
tration : c ’eft par elle que le légiflateur conferve fa pmft
ftuice , le boniieur 6c Je génie de fon peuple. Comment
par l’adniinilhatlon , le légiftatcur peut lui faire oublier ce
qu'il a perdu des deux grands avantages de l'état de nature,
l'égalité ik l’indépendance. Comment il le difpofera à l’hu-
manité, 8c à ce feniiment de bienveillance qui eft le lien
de fou peuple à Uii. Exemples tirés de i’hiftoire chinoife,
6c de celle de Perfe, Comment il animera le fentimein ds