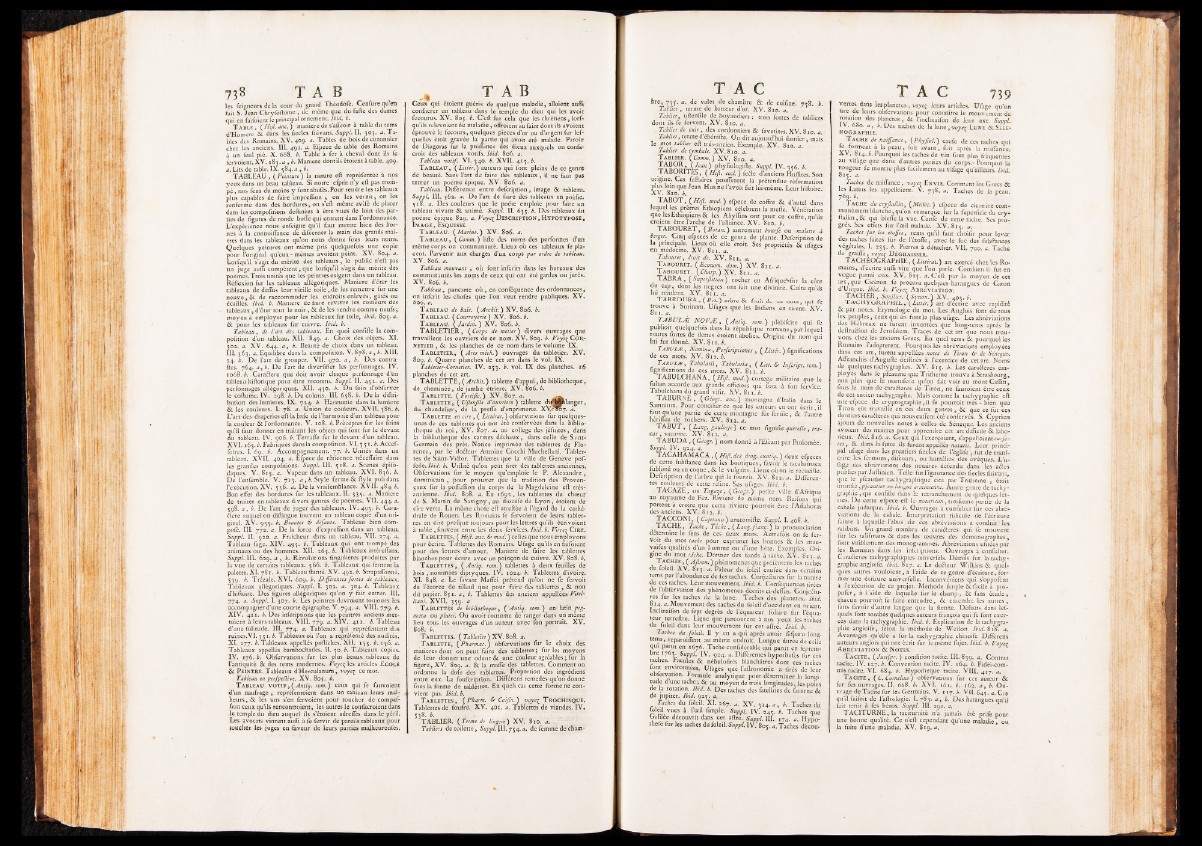
i; !i'thill
?
■j Ticf «i t t i . ' î t t
ii - 'f. -,,' ' !li?
v- t " t
' U
738 T A les feigiieurs Je la cour chi grand Théodofe. Cenfurequ?t\
fait S. Jean Clirylb/lonie , dc même que du forte des daines
qui en foifoient le principal ornement. Ibid. b.
T a b l e , {H ijl.jn c .) manière de s’alleoir a table du tems
d'Honici-c’ bc dans les fieclcs l'uivans. IL 303. a. T a bles
des Romains. X V.40 9 . a. Tables de bois de citronnier
chez les anciens. III. 491. ‘i. Efpece de table des Romains
à un ieiil pié. X. 668. b. Table à fer à cheval dont ils le
lervoiem. X V. 18 3 .^ ,^ . Maniéré dont ils étoient àtable. 409.
a. Lits de table. IX. 384. a , b.
T A ü L E A U , {Pcmiure) la nature eft repréfentée à nos
yeux dans un beau tableau. Si notre efprit n'y eft pas trompé
, nos lens du moins y font abufés. Pour rendre les tableaux
pins capables de foire imprelfton » on les v ernit, on les
renferme dans des bordures, on s’eft même avifé de placer
dans les compofitions deftinées à être vues de loin des parties
de figures de ronde bolTe qui entrent dans l’ordonnance.
L ’expérience nous enleigne qu’il faut mettre bien des bornes
à la connoilTance de difeerner la main des grands maîtres
dans les tableaux qu’on nous donne fous leurs noms.
Quelques peintres ont même pris quelquefois une copie
pour l’original qu’eux - mêmes avaient peint. X V . 804. a.
Lorfqu’il s’agit du mérite des tableaux, le public n’eft pas
un juge auli'i compétent, que lorfqu’il s’agit du mérite des
poèmes. Trois unités que les peintres exigent dans un tableau.
Réflexion fur les tableaux allégoriques. Maniéré d’ôter les
tableaux de delTus leur vieille to ile , de les remettre fur une
neu v e, & de raccommoder les endroits enlevés, gâtés ou
écaillés. Ibid. b. Maniéré de faire revivre les couleurs des
tableaux , doter tout le n o ir , & de les rendre comme neufs;
moyen à employer pour les tableaux fur toile, ibid. 805. a.
6c pour les tableaux fur cuivre. Ibid. b.
TjkUau, de l'an des tableaux. En quoi confifte la com-
pofition d'un tableau. XII. 849. a. Choix des objets. X L
30a. a. X V . 644. a , b. Beauté de choix dans un tableau.
III. 363. a. Equilibre dans la compofiiion. V. 878. a , b. XIII.
24. b. De l’art de grouper. V IL 970. a , b. Des contra-
ftes. 764. a, b. De l’art de diverfifier les perfonnages. IV.
1068./>. Caraélere que doit avoir chaque p^rfonnage d'un
tableau liiftorique pour être reconnu. Suppl. 11. 432. a. Des
perfonnages allégoriques. XII. 430. b. Du foin d’obfcrver
le coftume. IV . 298. i>. Du coloris. III. 638. b. D e là diftri-
bution des lumières. IX. 724. b. Harmonie dans la lumière
6c les couleurs. I. 78. a. Union de couleurs. XVII. 386. b.
L ’art des draperies eft la bafe de l’harmonie d’un tableau pour
la couleur Sc l’ordonnance. V . 108. b. Préceptes fur les foins
qu’il fout donner en traitant les objets qui font fur le devant
dn tableau. IV. 906. b. TerrafTe fur le devant d’un tableau.
X V I . 163. â. Fabriques dans la compofiiion. VI. 3 31. Accef-
foires. I. 69. b. Accompagnement. 77. b. Unités dans un
tableau. XVII . 404. a. Efpece de réticence 'néceffaire dans
les grandes compofitions. Suppl. III. 318. a. Scenes épifo-
diqiies. V . 813. a. Vapeur dans un tableau. X V I. 836. b.
D e l’enfemble. V . 713. a , i. Style ferme Seftyle poli dans
l’excciuion. X V . 3 36. a. D e la vraifemblance. X V l î . 484. b.
Bon effet des bordures fur les tableaux. IL 333. a. M.miere
de traiter en tableaux divers genres de poèmes. V IL 444. a.
398. J , b. D e l’arc de juger des tableaux. IV. 493. b. Cara-
iftere auquel on diftingue ibnvem un tableau copie d'un original.
X V . 935. b. Beautés & défauts. Tableau bien com-
pofé. III. 772. a. De la force d’expreflîon dans un tableau.
Suppl. II. 920. a. Fraîcheur dans un tableau. V IL 274. a.
Tableau foge. X IV . 493. b. Tableaux qui ont trompé des
animaux ou de.s hommes. XII. 263. b. Tableaux intéreffans.
Suppl. III. 629. a , b. Révolue ons fingulieres produites par
la vue de certains tableaux. 366. b. Tableaux qui fentent la
palette. X L 781. b. Tableau ftanté. X V . 492. StrapalTonné.
339. b. Trézale. X V I. 609. b. Dfférenics fortes de t.ibU.eux.
Tableaux allégoriques. Suppl. I. 302. a. 304. b. Tableaux
d’hiftohe. Des figures allégoriques qu’on y fait entrer. III.
774, a. Suppl. I. 507. b. Les peintres dovroienc toujours les
accompagner d’une courte épigraphe. V . 794. a. VIII. 779. b.
X IV . 4 11. /i. Des infcriptions que les peintres anciens met-
toient à leurs tableaux. VIII. 779. a. X IV . 41 1 . b. Tableau
d’une folitude. III. 774. a. Tableaux qui repréfeiuent des
rulnes.VI. 3 31. Tableaux oh l’on a reprélemé des nudités.
XI. 277. Tableaux appelles poftiches. XII. 133. b. 136. a.
Tableaux appelles bambochades. IL 30. Tableaux copies.
IV . 176. b. Obfervations fur les plus beaux tableaux de
l ’antiquité 8c des tems modernes. Fuyc^les articles Ecole
& Peintre. Tableaux d’Herculanum, voyei^ ce mot.
Tableau en perfpeHive. X V . 803. b.
T a bleau \ o t if ,(Antiij. rom.) ceux qui fe faiivolent
d’un naufrage , repréfentoient dans un tableau leurs malheurs,
& les uns s'en fervoient pour toucher de compaf-
fion ceux qu’ils rencontroient, les autres le cunfacroient dans
le temple du dieu auquel ils s’étoient adreffés dans le péril.
Les avocats vinrent aurti à fe fervir de pareils tableaux pour
loucher les juges en foveur de leurs parties majheureufes.
. . 4 T A B Ceux qui étoient guéris de quelque maladie, alloient aiifTi
confacrer un tableau dans le temple du dieu qui les avoir
fecourus. XV. 803. b. C ’eft fur cela que les chrétiens, lorf-
qn’ils relevoleiu du maladie, offfoiem au faim dont ils avoient
éprouvé le fecours, quelques pieces d’or ou d’argent fur lef-
quelles étoit gravée la partie qui avoir été malade. Parole
de Diagoras l'ur la piiiflance des dieux auxquels on confa-
croit des tableaux votifs. Ibid. 806. a.
Tableau votif. VI, 340. b. XVII . 413. b.
T ableau, ÇLiiiér.) auteurs qui font pleins de ce genre
de beauté. Sans l’art de foire des tableaux , il ne fout pas
tenter un poème épique. XV. 806. a.
Tableau. Différence entre defeription, image & tableau.
Suppl. 111. 362. a. D e l’art de faire des tableaux en poéfie.
318. a. Des couleurs que le poète emploie pour faire im
tableau vivant & animé. Suppl. IL 633. é. Des tableaux du
poeme épique 829. a. DESCRIPTION, HYPOT-ypoSE,
Image, Esquisse.
T ableau. {Marine.) X V . 806. a.
T ableau, {Comm.) lifte des noms des perfonnes d’un
même corps ou communauté. Lieux où ces tableaux fe placent.
Parvenir aux charges d’un corps par ordre de tableau,
XV. 806.
Tableau mouvant , où font inferits dans les bureaux des
communautés les noms de ceux qui ont été gardes ou jurés.
X V . 806. b.
Tableau, pancarte où , en conféquence des ordonnances»
on inferit les chofes que l’on veut rendre publiques. X V .
806. b.
T ableau de baie. {Archh.) X V . 806. b.
T ableau. ( Courroyer« ) X V . 806. é.
T ableau. ( Jardin. ) X V . 806. b.
T A B L E T IE R , {Corps de métier) divefs ouvrages que
travaillent les ouvriers de ce nom. X V . 809. b. Fbyc:^ CoR-
NETiER, & les planches de ce nom dans le volume IX.
T abletier, {A n s méch.) ouvrages du labletier. X V .
809. b. Quatre planches de cet art dans le vol. IX.
Tabletier-Cornetier. IV . 233. b. vol. IX des planches. 16
planches de cet art.
T A B L E T T E , ( Archh.) tablette d’appui, de bibliothèque,
de cheminée, de jambe étriere. X V . 806. b.
T ablette. {Fortifie.) X V . 807. a.
T a b le t te , ( Ujlenfüe d’ouvriers ) tablette dtiÉjBilanger,
du chandelier, de la prefte d’imprimerie. XVr^roy. à.
T ablette en cire , ( Lïnérat. ) obfervations fur quelques-
unes de ces tablettes (|ui ont été confervées dans ia bibliothèque
du r o i, XV . 807. a. au college des jéfuites, dans
la bibliothèque des carmes déch.iux, dans celle de S.iint-
Germain des prés. Notice iiiiprimée des tablettes de Florence,
par le doéleur Antoine Cocchi Muchellani. Tablettes
de Saim-Viélor. Tablettes que la ville de Geneve pof-
fecle. b. Utilité qu’on peut tirer des tablettes anciennes.
Obfervations fur le moyen qu’emploie le P. Alexandre ,
dominicain , pour prouver que la tradition des Provençaux
fur la pofteflîon du corps de la Magdeleine eft très-
ancienne. Ibid. 808. a. En 16 92 , les tablettes du choeur
de S. Martin de S a v ig iiy, an diocéfe de L y o n , étoient de
cire verte. La même chofe eft atteftée à l’égard de la cathédrale
de Rouen. Les Romains fe fervoient de leurs tablettes
en cire prcfque toujours pour les lettres qu’ils écrivoient
à table , fouveiir entre les deu.x fcrvices. Ibid. b. Fove{ CiRE.
T ablettes, ( H fi. auc. & mod. ) celles que nous employons
pour écrire. Tablettes des Romains. Ufage qu’ils en foifoient
pour des lettres d’amour. Maniéré de foire les tablettes
blanches pour écrire avec un poinçon de cuivre. XV, 808. b.
T ablettes, {Amiq. rom.) tablettes à deux feuilles de
bois , nommées diptyques. I v . 1024. b. Tablettes d’ivoire.
XI. 848. a. Le favant Maffci prétend qu’on ne fe fervoit
de l’écorce de tilleul que pour foire des tablettes, & non
du papier- 851. a, b. Tablettes des anciens appeliées Fiiel-
liani. XVII . 339. a
T ablettes de bibliothèque, { Antiq. rom.) en latin peg.
mata ou pluiei. Ou avoir coutume de ranger dans un même
lieu tous les ouvrages d’un auteur avec fon portrait. X V .
808. b.
T ablettes. ( Tabletier) X V .808. a.
T ablette, {Pkarmac.) obfervations fur le choix des
matières dont on peut foire des tablettes; fur les moyens
de leur donner une odeur 8c une couleur agréables ; fur la
figure, X V . 809. a. & la marte des tablettes. Comment on
ordonne ia dofe des tablettes. Proportion des ingrèdiens
entre eux. La foufcrlprion. Différens remedes qu’on donne
fous la forme de tablettes. En quels cas cette forme ne convient
pas. Ibid. b.
T ablettes, {Phami. Cuifin.) voyr^; T rochisque.
Tablettes de foufre. X V . 401. a. Tablettes de viandes. IV .
338. é.
TABL IER. {Termed-: Itngcre) X V . 810. ,7.
Tabliers de toilette, Suppl. III. 734. a, de femme de cliafli-
T A C b re, 733. a. de valet de chambre & de cuifme.' 738. b.
Tablier, terme de batteur d’or. X V . 810. a.
Tablier, uftenfile de boyaudiers ; trois fortes de tabliers
dont ils fe iervent. X V . 810. a.
Tablier de cuir, des cordonniers & fovetiers. X V 810 a
Tablier, terme d’ébénifte. On dit aujourd’lnii damier, mais
le mot tablier eft très-ancien. Exemple. X V . 810. a.
Tablier de tymbale. XV, 810. a.
T ablier, {Comm.) X V . 810. a.
T A B O R , {Jca/i) phyfiologiftc. Suppl. IV. arfi. b.
T A BO R IT E S , ecc/. )fe(fte d’anciens Huffites. Son
origine. Ces feélaires pouffèrent la prétendue réformation
plus loin que Jean Hus ne l’avoit fait lui-même. Leur hiftoire
X V . 810. b.
T A B O T , { f f f i . mod.) efpece de coffre & d’aiitcl dans
lequel les prêtres Ethiopiens célèbrent la méfié. Vénération
que les Ethiopiens & les Abyffms ont pour ce coffre, qu’ils
croient être l’arche de ralliancc. X V . 810. b.
T A B O U R E T , {Bocan.) autrement bourfe ou maletie à
ierger. Cinq efpcces de Ce genre de plante. Defeription de
la principale. Lieux où elle croit. Ses propriétés Ôc ufoges
en médecine. X V . 8 1 1. a. ®
Tabouret, droit de. X V . Si i . a.
T abouret. {Æconom. dom.) X V . 811. a.
T abouret. {Ckarp.) X V . 811. a.
T A B R A , {Superflition) rocher en AfriqiieMur la côte
élu cap, dont les nègres ont lait une divinité. Culte qu'ils
lui rendent. X V . 811.^7.
T A B R O U B A , {B o t.) arbre & fruit de ce nom, qui fe
trouve à Surinam. Ufages que les Indiens en lirenr. XV ,
O 1 I. tf.
T A E U LÆ N O V Æ , {Antiq. rom.) plébifcitc qui fe
piiblioit quelquefois dans la république romaine, par lequel
toutes fortes de dettes étoient abolies. Origine du nom oui
lui fut donné. X V . 811. />.
Ta b v l æ , Nomina, Perferiptiones , f ZÙ7i;r. I fignifications
de ces mots. X V . 811. b.
Ta b u l æ , Tabularii, Tabularia , { L it t .& Infcri.pt. rom.)
figmhcations de ces mots. X V . 811. b.
T A B ü L CH A N A , {H f i . mod.) cortege militaire que le
lultan accorde aux grands officiers qui font à fon fervice.
Tabulchana du grand \-ifir. X V . 8 1 1. é.
TABU Rh'E , {Géogr. anc.) moniagne d’Italie dans le
Samnium. Pour concilier ce que les auteurs en ont é c r it , il
faut qu une partie de cette montagne fût fertile , 8c l’autre
hériffée de rochers. X V . 812. a.
T A B U T , {L.mg. gaulotje) ce mot querelle , tracas
, vacarme. X V . 812. a.
T A B Ü D A , (Géugr. ) nom donné à l ’Efeaut par Ptolomée.
Suppl. IV. 924. a.
T A C A H AM A C A , ( Hiß. des drog. exotiq. ) fieux efpeces
de cette fubftance dans les boutiques, favoir le tacahamaca
fiiblimé ou en co q u e ,S : le vulg.airc. Lieux oùon ie recueille.
Defeription de l’arbre qui le fournit, X V . 812. a. Differentes
couleurs de cette réfine. Ses ufiges. Ibid. b.
T A C A Z E , ou Taga^e, (Géo^r.) petite ville d’Afrique
au royaume de Fez. Riviere de même nom. Rnlfons qui
portent à croire que cette riviere pourroic être l'Aftaboras
des anciens. X V . 812. b.
T A C C O N I , ( Cüjctano ) anatomifte. Suppl. I. 408. b.
T A C H E , Tache, Tâche , {Lang, fa n q .) \tk prononciation
détermine le fens de ces deux mots. Autrefois on fe fci-
Voic du mot tache pour exprimer les bonnes & les mau-
vaifes qualités d’un 1 omme ou d’une bâte. Exemples. Origine
du mot lâche. Donner des fonds à tâche. XV . 813. a.
T aches , ( Ajhon. ) phénomènes que préfcntcin les taches
du foleil. X V . 813. a. Pâleur du foieil caufée dans certains
icms par 1 abondance de les taches. Conjcélures fur la nature
de ces taches. Leur mouvement. Ibid. b. C o n flu en c e s tirées
de l’obfcrvation des phénomènes décrits ci-defliis. ConjeiTut-
res fur les taches de ia lune. Taches des planetos. Ibid.
814. a. Mouvement des taches du foleil d’occ’denr en orient.
Inclinaifon de lèpt degrés de l’équateur folaire fur l’éqtia-
teur terreftre. Ligne que parcourent à nos yeux les taches
du foleil dans leur mouvement fur cet aftre. Ibid. b.
Taches du foleil. Il y en a qui après avoir difparu long-
tems, reparoiffent au même endroit. Longue durée do ccilo
qui parut en 1676. Tache confidérablo qui parut en fei'ccm-
bre 1763. Suppl. IV . 924. a. Différentes liypothcfos fur ces
taches. Facules 8i nébulofitcs blanchâtres dont ces taches
font environnées. Ufages que raftronomie a tirés de leur
obfervation. Formule analytique pour déterminer la longitude
d’une tache; 8i au moyen de trois longitudes, les potes
w la rotation. Ibid. b. Des taches des fatellhes de foturne Sc
de jupiter. Ibid. 923. a.
Taches du foleil. XL 267. XV. 314.17, b. Taches du loleil vues à l’oeil Ample. Suppl. IV. 243. b. Taches que
Gahiee découvrit dans cet aftre. Suppl. IIl. 174, a. Hypo-
ihelè fur les taches du foleil. IV. 803. <7. Taches décou-
T A C 7 3 9
vertes dans les planètes, leurs articles. Ufage qu’on
lire de leurs oblèrvations pour connoître le mouvement de
planètes , 8c rincliiiaifon de leur axe. SuppL
IV. 680. a , b. Des taches de la lune , vt>yif;- LuNe 8cSele-
■ i^OGRAPHlE.
T ache de n.tijfance, {Phyfiol.) caufe de ces taches qui
le torment a la peau, foit avant, foit après la n.dffance.
X V . 814. h. Pourquoi les taches de vin font plus fréquentes
an Vilage que dans d’autres parses du corps.- Pourquoi la
rougeur le montre plus focilemeni au vifoge qu’ailleurs. Ibid
813. a.
T.iches de naiffancc , voyei Envie. Comment les Grecs 8:
les Latins les appelloiem. V. 738. a. Taches de la peau.
769. b.
T ache duayJlalUn, {Médec.) efpece de cicatrice communément
b lanche, qu’on remarque ftir la fupcrficiedu cry-
ftaliin, 6c qui bleffc ia vue. Caufe de cette tache. Ses progrès.
Scs effets fur l’oeil malade. X V . 813.
Taches fur les éiojfes, teins qu’il faut choifir pour Ic'^cr
des taches faites fur de l’étoffe, avec le fuc des fubftances
végétales. 1. 233. b. Pierres à détacher. V IL 700. .1. Tache
de graiffe, voye:^ DÉGRAISSER.
TA CH ÉÜ G R APH IE , {Littéral.) art exercé chez les Romains,
d'écrire aurti vite que l’on parle. Combien il fut en
vogue parmi eux. XV. 813. <7. C ’ell par le juoyen de cet
art,que Cicéron fe procura quelques harangues de Caton
d’Uiiqiie. Ibid. b. l'oye^ ABREVIATION.
T A C H E R , Souiller. {Synon.) X V . 403. b.
T A C H Y G llA PH IE , ( Zùtér. 9 art d’écrire avec repidité
Sc par notes. Etymologie dn mot. Les Anglais font de tous
les peuples, ceux qui en fonde plus ufage. Les abréviations
des Hebreux ne furent inventées que long-tcms après la
dertruélion de Jeriifalem. Traces de cet art que nous trouvons
chez les anciens Grecs. En quel tems 8c pourquoi les
Romains l’adoptere.nt. Pourquoi les afarcviat'ions employées
dans cet art, furent appellees notes de Tiron & de Séneque,
Affranchis d’Aiigufte delHnés à l’exercice de cetarr. Noms
de quelques tachygraphes. XV. 813. b. Les caraéleres employés
dans ie pfeaunie que Tritheme trouva à Strasbourg,
non plus que le mamifcnt qu’on fait voir au montCaffm,
fous le nom de carafleres de T iron, ne fauroient être ceux
de cct ancien tachygraphe. Mais comme la tachygraphie eft
une efpece de cryptographie, il fe pourroit très - bien que
Tiron eut travaillé en ces deux genres , 8l que ce fût ces
derniers caraéteres qui nous eufiém été confervés. S, Cyprien
ajouta de nouvelles notes à celles de Séneque. Les anciens
avoient des mnitres pour apprendre cct art difficile 6c laborieux.
Ibid. 8 î6. a. Ceux qui i’exerçoient, s’appel'oientciir/i/-
res, 8c dans la fuite ils furent appellés Leur principal
ufage dans les premiers liecles de l’églilé , fut de iranf-
crire les fermons, dilcours, ou homélies des évêques, L ’tt-
fage des abréviations des notaires défendu dans les aélus
publics par Juftinien. Telle fut l’ignorance des fiecies fuivani,
que le pfeautier tachygraphique cité par Tritheme , étoit
iiuitiilc ,pjcuuiier en Lingue arménienne. Autre genre de taehy-
grapliie , qui confiile dans le retranchement de quelques lettres,
De cette efpece eft L notaricon, noifieme partie de la
cabale judaïque. Ibid. b. Ouvrages à confultcr fur ces abréviations
de la cabale. Interprétation ridicule de récrituie
lainte à laquelle l’abus de ces abréviations a conduit les
rabbins. Un grand nombre de caraéteres qui le trouvent
fur les taüfmans 8c dans les oeuvres des dèmonograplies,
font vifiblemcm des monogrammes. Abréviations ufiices par
les Romains dans les infcriptions. Ouvrages à confuher.
Cmaiteres tachygraphiques univerfels. Détails fur latachy-
graphic aiigloife. ibid. 817. Le doaeur Wilkins 8c quelques
autres vou lo ien t ,à l’aide de ce genre d’écriture, former
une écriture iiniverfelle. Inconvéniens cjui. s’oppofent
à l'exécution de ce projet. Méthode fuitple & facile à pro-
pofer, à l'aide de laquelle fur le champ, Sc fans étude,
chacun pourroiî fe faire entendre, 8c entendre les autres,
fans lavoir d’autre langue quo la fienne. Défauts dans !el-
qiiels font tombés quelques auteurs françois qui fe font exercés
dans la tachygraphie. Ibtd. b. Explication de la tachygraphie
angloife, lelon la méthode de Weflon Ibid.^iZ. a.
Avantages qu’elle a fur la tachygraphie chinoife Différens
auteurs anglois qui om écrit fur le même fujet. Ibid. b. Foye^
A bréviation 8c Notes.
T ac ite, {Jurijpr.) condition tacite. III. 839. a. Contrat
tacite. IV. 127. b. Convention tacite. IV . 164. b. Fidéi-coni-
niis tacite. VI. 684. b. Hypotheque tacite. 'VIII. 417. a.
T ac ite , {C . Cornélius ) oblèrvations fur cct auteur &
fur fes ouvrages. II. 668. b. X V I. 161, b. 162. a , b. O uvrage
de T acite fur les Germains. V . 1 17. b. V d . 643. a. Ces
qu’il foifoit de I’aftrologic. I. 783. a , b. Des harangues qu’ii
foit tenir à fes héros. Suppl. III. 291. a.
T A C ITU R N E , la tadturnité n’a jamais été prife pour
une bonne qualité. Ce n'eft cependant qu’une maladie ou
la fuite d’une maladie, X V . 819.