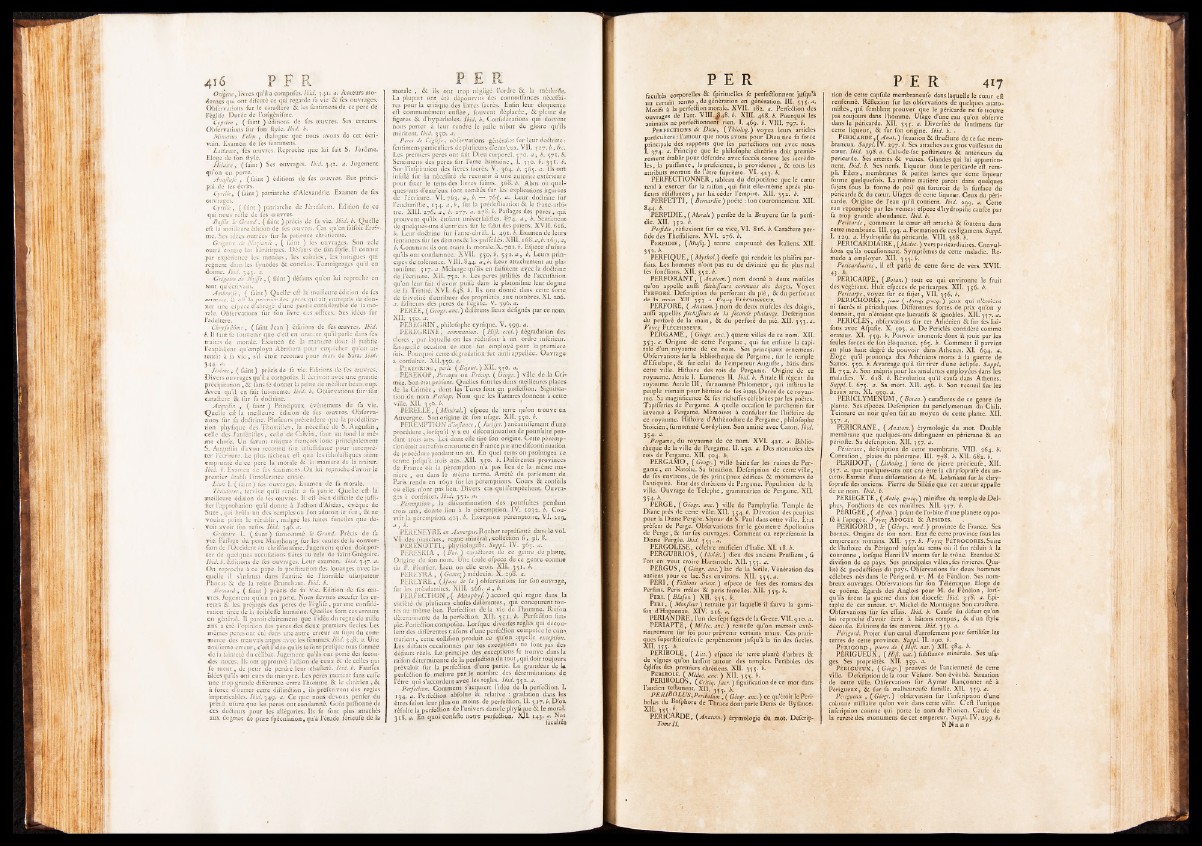
J
il' I l
■ ihr
I* h !
1 !il:
I h . - h r
j''Vl
■' i' ‘ -I
1' Ir
1 i l l
1’ t
416 P F R Üngf/k’ , livres cju’il a compofcs.//’fi/. 34t. *r. Auteurs mo-
<?emes tiiii out difciitc ce qui regarde la vie & les ouvrages.
OhRi vations fur le cara^cre &. les leatimeus de ce peic de
réglife. Durée de rorigénifine.
Cyprlcn , ( faint ) éditions de fes oeuvres. Ses erreurs.
Obfervations fur fon ftylc. h.
Mtntuhu Fdix , dialogue que nous avons de cet écrivain.
E.\amcn de l'es fcntimciis.
L.iH.mce^ lés oeuvres. Rcprodie que lui fait S. Jérome.
Do g e de fon llyle.
HiLurc, ( fa in t ) Scs ouvrages. IbiJ. 342. Jugement
qu'on en porte.
A/ijjhifc , (faint ) éditions de les oeuvres. But principal
de les écrits.
Cyrille, ( fa im ) patriarche d'Alexandrie. Examen de fes
ouvrages.
CyrilU , ( fa in t ) patriarche de Jérufalem. Edition do ce
qui nous relre de fes oeuvres.
le Gnind. ( laine ) précis de fa vie. ïb:J. h. Quelle
cft l.i mejileiiro édition de lés oeuvres. Cas <|u’en failblc Eriri'
me. Scs idées ourrées fur la patience clirétunnc.
Grégoire i/e , ( faim ) fes ouvrages. Son zele
outré coiurc les hérétiques. Défauts de fon llyle. Il comme
par expérience les menées, les cabales, les intrigues qui
régnent clans les fyiiodes & conciles. 1 emoignages tpi'il en
donne. Ibid. 343. .1.
Grepoire de N y jf e ,{ faint) défauts qu'on lui reproche en
ivint qu'écriv.iin.
A.vb/v'de, ( l'aine) Q u elle 'e if la meilleure édition tic fes
oeuvres, il e,'l le pre.riiLr des pcrcs qui ait ciureprb de donner
une efpcce d'abrégé d'une partie conlidérablc de lamorale.
Obl'crvations fur fon livre ces uiHces. Ses idées fur
l'athihcre.
Chryjbfiûme, ( faim Jean ) éditions de fes oeuvres. Ibid,
b. Il fuir lé Ibuvenlr que c’ell en orateur qu'il ]>arlc d.ins fes
traites de morale. Examen de l.i manière dont il juftifie
l ’expédient ([ii'cmploya Abraham pour cmpedicr quon at-
tent.it .'i fa vie , s’d étoir reconian pour man de Sara. ibid.
344. .1.
Jerome, ( film ) précis de fi vie. Editions de fes oeuvres.
Divers ouvrages qu’il a compolés. Il écrivoit avec une grande
précipitation , & fins lé donner la peine de méditer beau eoup.
Aveu qu’il eu fait lui-même. Ibid. b. Obfervations lur-lén
caraéferc &. fur fa doélrine.
Aupiflin y ( faint ) Principaux êvénemens de fa vie.
Quetie cA la meilleure édition de lés oeuvres. Obfevva-
tions fur la doélrine. Piuficurs prétendent cpie la predellina-
îion phyfiquc des Thomilles, la nécellué de S. A ugulîin,
celle dc.s Janféniiles, celle de Ca lvin, font au fond la même
cliolé. L/n lav.un critique l'rançois loue jirincipnlement
S. Augnllin d'avoir reconnu fon inluiniauce pour iiirerpré-
ter l'écriture. Le plus l'àdicu.x eA que les l'cholaftiques aient
emprunté de ce psre la morale & h; maniéré de la traiter.
Ibid. b. Examen de lés l'^ntimens. On lui reprodie d’avoir le
premier établi l'intolérance civile,
Léon I. ( fa im ) lés ouvr.^ges. Examen de fa morale.
Théodoret, lorvicc qu i) icndit à fa partie. Quelle cft la
aneiileure édition de fes oeuvre.s. Il eft bien ditücilc dejufti-
fter I’apjn-obation qu'il donne à l’afftoii d'Abdas, évoque de
Suze , qui brûla un des temples où l’on adoroit le téu , &1 ne
vouhit point le rct .blir, m.ilgré les luiies fiineftes que devoir
avoir fon refus. Ibid. 346, a.
Gtépyiie I, ( fa im ) furiiommé U Grond. Précis de fa
vie. PaiVage du pere Muimboiirg fur les caulcs de la conver-
Jion de l'Occident au chriftianifme. Jugement qu'on doit porter
de quelques accul'aiions faites au zele de faim Grégoire.
Ibid. b. Editioii-s de lés ouvrages. Leur examen. Ibid. 347. a.
On reproche à ce pape la profticution des louanges avec laquelle
il s'infinua dans l'amitié de l'horrible ulutpatcur
Phocas & de l.a reine Brunehaut. Ibid. />.
Bernard , ( faint ) précis de fa vie. Ed'ii'son de fes oeuvres.
Jugemem qu’on en porte. Nous devons exeufer les erreurs
&: les préjugés des pcrcs de l'églilé , par une coiifidé-
raiion tirée de la foiblefté humaine. Quelles loin ces erreurs
en générai, fl paroit clairement que l'idée du règne de mille
ans a été l'opinion des jiercs des deux premiers ftecles. Les
mêmes pcrcs ont été dans une autre cireur au fiijer du commerce
des mauvais anges avec les femmes./éiif 34S. .7. Une
troifieme erreur, c’eft l'idée qu'ils (é font prefqiic cous formée
tic l.i ftiintcté du célibat. Jugemem qu’ils ont porté des fécondés
noces. Ils ont approuvé l'aiftion de ceux & de celles qui
fe tuent , de peur de perdre leur chafteté. Ibid. h. Fauft'es
idées qu’ils ®nt eues du martyre. Les peres mettent fans cclTe
une trop grande différence entre l'homme & le chrétien, 6c
à force d’outrer cette diftinétion , ils prcfcrivciu des regies
impraticables, /i/'t/. 349. a. C e que nous devons penfer du
prêt a ufurc que les pcrcs ont condamné. Goût paffionné de
ces doéleurs pour les allégories. Ils fe font plus attachés
aux dogmes de pure Ipéculation, qu’à l’étude lérieufe de la
P E
morale , S: ils ont trop négligé l’ordre 6c la métiiode.
La plupart ont été dépourvus des connoilîances nécclTainioral
La plupart
res pour la critique des livres facrés. Enfin leur éloquence
eft commimémcm entlée , fouvent déplacée, 6c pleine de
figures 6c d’jiyperboles. Ibid. b. Conftdératious qui doivent
nous porter à leur rendre le jufte tribut de gloire qu’ils
méritent. Ibid. 3 <;o. a.
Pere.i de l'cgUje, oi>fervations générale's fur leur cioélrinc r
fciitimens parcleuliers deplufteurs d'ontr'eux. VIL ^ 17. é , &e.
Les premiers peres ont fait Dieu corporel. 370. a , b. 571. b,
Soiuimens des peres fur l’ame luimaine, i. 330. b. 351. b.
Sur l’inlpiration des livres lacrés. \ . 364. b. 563. n. Ils ont
inlifté l'nr la nocollité de recourir à une autorité extérieure
pour fixer le teins des livres laims. 368. b. Abus oii quelques
uns d’emr’eux font tombés liir les c.xplications figurées
de récriture. V i . 763. u, h. — 76^. a. Leur doftiiiie fur
l’eucliariftie, 134. a ,b , fur la prodcftinatlou 6c le franc-arbitre.
XIII. 276. a , b. 277. a. 278. b. Paffnges des pcrcs , qui
prouvent qu’ils étoient univerlalil'tes. 874. a , b. Seiirimcnt
de quclques-ims d'einr’eiix fur le lahit des païens. X V i l. 6 i6 .
b. Leur doiftrine fur l’ante-chrill. I. 491. b. Examen de leurs
fcntimens fur les démons6c les pollédés. X llI . i68.u,é, 169,«,
b. Comment ils ont traité la morale. X. 701. é. Ef'pecc d’ufiire
qu’ils ont condamnée. XVII. ^50. é. <ÿr^i.a, b. Leurs principes
de toléianee. V lll.8 4 4 . n,b. Leur attachement au pla-
toniline. 517. a. Melange qu'ils en faifoient avec la doéftine
de récriture. X il. 732. b. Les peres jiiftitiés c(c l’accufation
qu’on leur fait d’avoir puii'e dans le platonilme leur dogme
de la Trinité. X V I . 648. b. Ils ont donné dans cette lotte
de frivolité d’attribuer des propriétés aux norabres. X I. 206.
Editeurs des peres de l’églilé. V . 39Ö. .r.
PERÉE, ( Gevgr. une. ) différens lieux défignés par ce nom,
XII. 350. .r.
PEREGRIN , phüofophc cynique. V . 599. a.
PEREGRINE, communion. {Hijl. ecd.) dégradation des
clercs , [i.ir latjiielle on les rédiiifoit à un ordre inférieur.
En-qii.-ile occalion ce mot fut employé pour la ];rcmiere
fois. Pourquoi cette dégradation fut ainli appeüéc. Ouvrage
.à confultcr. Xil.350. u.
PuREGRINi-, perle {ß ijc u t .)X \ l. 33O. a.
PEREKÜP, Fercops OU Piécop. ( Geog/'. ) vOle de la Crimée.
Sou état préi'em. Quelles foin les deux meilleures places
de la Crimée , dont les Turcs font en poffellion. Signirica-
tion du nom Perkop. Nom que les Tarcares donnent à cette
ville. XII. 3 30. b. '
PERELLE, ( Minerai.) cfpecc de terre qu’on trouve en
Auvergne. Son origine Ce fon ufage. XII. 330. b.
PEREMPTiON d’injhmce, ( Jurij'pr. ) anéantllî’emeiu d’une
procédure , iorfqu’il y a eu difconcinuation de poiirl’uite pendant
trois ans. Loi dont elle tire fon origine. Cette péremption
étoir aucrefoisencüiirueen France par une difcontiiiuation
de procédure pendant un an. En quel teins on prolongea ce
terme julqu’à trois ans. XII. 330. b. Différentes provinces
de France oii la péremption n’a pas lieu de la meme maniéré
, ou dans lé meme terme. Arrêté du parlement de
Paris rendu eu 1691 fur les péremptions. Cours 6c confcils
où elles n’ont pas lieu. Divers cas qui l’empêchent. Ouvrages
à confuicer. Ibid. 351. a.
Péremption , la diftoiitinuation des poiirfuites pendant
trois ans, donne lieu à la péremption. IV , 1032. b. Couvrir
la péremption. 423. b. Exception péremptoire. VI. 219.
<1, b.
PERENEYPvE en Auvergne. Rocher icpréfenté dans le voL
V I des olanehes, regne minéral, collection 6 , pl. 8.
P E R EN O T T I , phyliologifto. IV. 363.
PERESKIA , ( ß o t .) caraiftercs de ce genre de plante.
Ofiitine de fon nom. Une feule efpece de ce genre connue
du P. Plumier. Lieu oii elle croîr. XII. 331. b.
P E R c Y R A , (Goz/te^;) médecin. X. 298. a.
P E R L Y R E , {Ifaac de /j ) obfcrvaiioiis fur fon ouvrage,
fur les préadaniites. XIII. 266. a , b.
PERFECTION , ( Métaphyf. ) accord qui regne dans la
variété de pluftours chofes différentes , qui concourent toutes
au meme but. Pcrfeflion de la vie de l’homme. Raifoii
déterminante de la perfciftion. XII. 351. b. Perfoftion ftni-
ple.Pcrfeftioncompofée. Lorfquo diverfes regies qui découlent
des différentes raifons d’une perfeélion compolée fe contrarient
, cette collifion produit ce qu’on appelle exception.
Les défauts occafionnés par les exceptions ne font pas des
défauts réels. Le principe des exceptions fe trouve dans la
raifon déterminante de la perfeélion du tout, qui doit toujours
prévaloir fur la perfcéHon d’une partie. La grandeur de W
perfeélion fe mclure par le nombre des déterminations de
l’être qui s’accordent avec les regies. Ibid. 332. a.
Per/edion. Comment s’acquiert l’idée de la perfeélion, I.
134. a. Perfeflion abfolue & relative ; gradation chuis les
êtres felon leur plus ou moins de perfeftion. II. 3 i7.i>.D ’üù
réfiilte la perfeflion de l ’univers dans le phylique & le moral.
2i 8, a. En quoi coiififtc notre perfeftioö. X ) l 143. a. Nos
^ facultés
P E R
fiicuîtés corporelles & fpirituelles fe perfeâîonnent jufqu’à
un certain terme , de génération en génération. III. 333-
Motifs à la perfeélion morale. X V I l. 182. a. Perfeftion des
ouvrages de l’art. V I I I .^48. b. XIII. 468. b. Pourquoi les
animaux ne perfeiftionnent rien. I. 469. b. VIII, 797. b.
Perfections de Dieu, i^Théotog.) voyez leurs articles
particuliers : l’amour que nous avons pour Dieu tire fa force
principale des rapports que fes perfeélions ont avec nous.
I. 374. a. Principe que le philofophe chrétien doit premièrement
établir pour défendre avec fuccès contre les incrédule
s, la puiffance, la prefcience, la providence , 6c tous les
attributs moraux de l’ètre fuprême. VI. 423. b.
PERFECTIONNER , tableau du defpotil'me que le coeur
tend à exercer fur la raifon, qui finit elle-même après plu-
fieiirs réfiftances, par lui céder l’empire. XII. 352. b.
P ER FE T T I, ( Bernardin ) poète : fon couronnement. XII.
844. b.
PERF ID IE, {^Morale) penfée de la Briiyere fur la perfidie.
XII. 332. b.
, réflexions fur ce vice^. V I . 816. ECaraélere perfide
des Theffaliens. XVI. 276. b.
Perfidie, ) terme emprunté des Italiens. XII.
332. b.
P ERFIQUE , i^Mythol.) déeffe qui rendoic lesplaifirs parfaits.
Les hommes n’ont pas eu de divinité qui fit plus mal
fes fomftions. XII. 332. é.
P ER FO R AN T , [Anatom.) nom donné à deux mufcles
qu’on appelle aulîi fléchijjcurs communs des doigts. Voyez
Perforé. Defeription du perforant d u p ié , 6c du perforant
de la main. XII. 353.^1. Voye^ Fléchisseur.
PERFORÉ, ( Anacom. ) nom de deux mufcles des doigts,
auflî appelles fléchijfeurs de la fécondé phalange. Defeription
du perforé de la main, 6c du perforé du pié. XII. 3 33.<i.
Fléchisseur.
P ERG AM E, ( Géogr. anc. ) quatre villes de ce nom. XII.
333.1;. Origine de cette Pergamc , qui fut enftiire la capitale
d’un royaume de ce nom. Ses principaux ornemeiis.
Obfervations fur la bibliothèque de Pergame , fur le temple
d’Efculape, 6c fur celui de l’empereur Atigiift-c, bâtis dans
cette ville. Hiftoire des rois de Pergame. Origine de ce
royaume. Attale I. Emnenes II. Ibid', b. Attale 11 régent du
royaume. Attale 111, furiiommé Philometor, qui Inftitua le
peuple romain pour héritier de fes états. Durée de ce royaume.
Sa magnificence 6c fes richeffes célébrées par les poètes.
Tapifferies de Pergame. A quelle occafion le parchemin fut
inventé à Pergame. Mémoires à confulter fur l’hiftoire de
ce royaume. Hiftoire d’Athénodore de Pergame , philofophe
Sto'icien, furnommé Cordylion. Son amitié avec Caton. Ibid.
334. a.
Pergame, royaume de ce nom. XVI. 421. a. Bibliothèque
de la ville de Pergame. II. 230. a. Des monnoîes des
roi> de Pergame. XII. 304. b.
P ERG AM O , (Gèagr. ) ville bâtie fur les ruines de Pergame
, en Natolie. Sa fitiiation. Defeription de cette ville ,
<le fes environs, de fes principaux édifices 6c monumens de
l’antiquité. Etat des chrétiens de Pergame. Population de la
ville. Ouvrage de Telephe, grammairien de Pergame. XII.
334. i.
PERGE, ( Gebgr. anc.) ville de Pamphylie. Temple de
Diane près de cette ville. XII. 334. i . Dévotion des peuples
pour la Diane Pergée. Séjour de S. Paul dans cette ville. Etat
préfent de Perge. Obfervations fur le géomètre Apollonius
de Perge , 6c fur fes ouvrages. Comment on repréfeinoic la
Diane Pergée. Ibid. 333. <3.
PERGOLESE, célébré muficicn d’Italie. XI. 18. b.
PERGUBRIOS, {IdolJe.) dieu des anciens PrulTiens, fi
l'on en veut croire Hartsnoch. XII. 333. a.
P E R G ü S , (Géogr. âne.) lac de la Sicile. Vénération des
anciens pour ce lac. Scs environs. XII. 333.-2.
PERI, (Fidions orient.) efpece de fées des romans des
Perfans. Péris mâles 6c péris femelles. XII. 333. b.
Péri. (B la fu n ) XIL 333. b.
Pé r i , ( Morfieur) retraite par laquelle il fauva la garni-
fon d’Haguenaii. XIV. 216.
P ERIANDRE, l’un des fept fages de la Grece. V II. 910. a.
PERIAPTE , (Médec. anc.) remede qu’on inettoit extérieurement
fur foi pour prévenir certains maux. Ces pratiques
fuperftitieufes fe perpétueront jufqu’à la fin des fiecles.
XII. 3Î T h.
PERIBOLE, ( L in . ) efpace de terre planté d’arbres 8c
de vignes qu’on laiffoit autour des temples. Periboles des
églifes des premiers chrétiens. XII. 333. b.
PeriBOLE. ( Médec. anc. ) XII. 333.
PERIBOLOS, (Critiq. Jacr. ) figuification de ce mot dans
l’ancien teftament. XIL 333. b.
PERlBOLUS,Peribolnm , ( Géogr. anc.) ce qu’étoit le Peri-
bolus du Bofphore de Thrace donc parle Denis de Byfance.
XII.
PERIC ARDE , (Anatom.) étymologie du mol. Deferip-
Tome II. / .r 6
P E R 417
tion de cette capfule membraneufe dans laquelle le coeur eft
renfermé. Réflexion fur les obfervations de quelques anato-
miftes, qui femblent prouver que le péricarde ne fe trouve
pas toujours dans l’homme. Ulage d’une eau qu’on obferve
dans le péricarde. X ll. 333. a. Diverfité de fentimens fur
cette liqueur, 6c fur fon origine. Ibid. b. .
PERICARDE , ( Anal. ) fuuation 8c ftruélure de ce fac membraneux.
Suppl. IV. 297. t. Ses attaches aux gros vailTeaux du
coeur. Ibid. 298. a. Culs-de-fac poftérieurs 6c antérieurs du
péricarde. Ses arteres 6c veines. Glandes qui lui appartiennent.
Ibid. b. Ses nerfs. Liqueur donc le péricarde eft rempli.
Filets, membranes 6c petites lames que cette liqueur
forme quelquefois. La même matière paroîc dans quelques
fujets fous la forme de poil qui fortiroit de la furface du
péricarde 6c du coeur. Ufages de cette liqueur. Ceux du péricarde.
Origine de l’eau qu’il contient. Ibid. 299. Cette
eau repompée par les veines: efpece d’hydropilie caufée par
fa trop grande abondance. Ibid. b.
Péricarde, comment le coeur eft attaché 8c foutenu dans
cette membrane. III. 393.-2. Formation de ces ligamens. Suppl.
I. 129. a. Hydropifie du péricarde. V l l l . 368. b.
PERICARDlAIRE,(AL'i/ri:.) verspericardiaires. Convulfions
qu’ils occafionnent. Symptômes de cette maladie. Re-
niedc à employer. XII. 333. i.
Pericardiaires, il eft parlé de cette forte de vers. XVII .
43. b.
PERICARPE, (Botan.) tout ce qui environne le fruit
des végétaux. Huit efpeces de péricarpes. XII. 336. b.
Perica^e ,\ o y s z fur ce fu je t, VII. 356. h.
PERICHORES , jeux (Antiq. gfecq.) jeux qui n’écoient
ni facrés ni périodiques. Différentes fortes de prix qu’on y
doniioit, qui n’éioient que lucratifs 6c ignobles. XII, 357. a.
PERICLÈS, obfervations fur cet Athénien 6c fur l'es liai-
fons avec Afpafie. X. 303. a. D e Pericles conlidéré comme
orateur. XI. 33g. b. Pouvoir iinmenfe dont il jouit par les
feules forces de ibii éloquence. 365. b. Comment il parvint
au plus haut degré de pouvoir dans Athènes. XI. 694. a.
Eloge qu’il prononça des Athéniens morts à la guerre de
Samos. 330. i. Avantage qu’il fut tirer d’une éclipfe. Suppl.
II. 732. b. Son mépris pour les amulettes employées dans les
maladies. V . 618. b. Révolution qu’il cailla dans Athenes-
Suppl.L 675. a. Sa mort. XII. 436. b. Son recueil furies
beaux arts. Xl. 939- a.
PERIC LYMENUM, (Botan.) caraéleres de ce genre de
plante. Ses efpeces. Defeription du peridymenum du Chili.
Teinture en noir qu’on fait au moyen de cette plante. XII.
337- -2.
PERICRANE, (Anatom.) étymologie du mot. Double
membrane que quelques-uns diftinguent en péricrane 8c en
périofte. Sa defeription. X I I . , 57. . .
Péricrane, delcription de cette membrane. VIII. 264. b.
Conuifion, plaies du péricrane. III. 778. b. XII. 682. b.
P E R ID O T , (Litholog.) forte de pierre précieufe, XII.
337. a. que quelques-uns ont cru être la chryfoprafe des anciens.
Extrait d’tine differtation de M. Lehmann fur la chryfoprafe
des anciens. Pierre de Siléfie que cet auteur appille
de ce nom. Ibid. b.
PERIEGETE, (Antiq. grecq.) miniftre du temple de D e lphes.
Fondions de ces minillres. XII. 337. b.
PÉRIGÉE, ( Ajlron.) point de l’o;bite d'une planete oppo-
fé à l'apogée. Voyei Apogée 6c A psides.
PÉR IG O RD , le (Géogr. mod.) province de France. Ses
bornes. Origine de fon nom. Etat de cette province fous les
empereurs romains. XII. 3 5 7 - Ebye^; PétroCORES. Suite
de l’hiftoire du Périgord jul'qu’au tems où il fut réduit à la
couronne , lorfque Henri IV monta fur le trône. Etendue 8c
divifion de ce pays. Ses principales villes, fes rivieres. Qualité
8c produdions du pays. Obfervations fur deux liommes
célébrés nés dans le Périgord. 1°. M, de Fétiélon. Ses nombreux
ouvrages. Obfervations fur fon Télémat^ue. Eloge de
ce poème. Egards des Anglois pour M. de Fenélon , lorf-
qu’ils firent la guerre dans fon diocefe. Ibid. 338. a. Epitaphe
de cet auteur. 2°. Micliel de Montaigne. Son caradere,
Obfervations fur fes elTais. Ibid. b. Caufe du défaut qu’on
lui reprodie d’avoir écrit à bâtons rompus, 6c d’un ftyle
découfu. Editions de fes oeuvres. Ibid. 359. a.
Périgord. Projet d’un canal d’arrofement pour fertilifer les
terres de cette province. Suppl. IL 190. b.
PÉRIGORD, pierre de (Hijl. nat.) XII. 384. b.
PÉRIGU EU X, (Hifl. nat.) fiibftancc minérale. Ses u fj-
gcs. Ses propriétés. XII. 339. a.
PÉRIGUEUX, (Géogr.) preuves de l’ancienneté de cette
ville. Defeription de la tour Véfune. Son évêché. Situation
de cette ville. Obfervations fur Aymar Rançonnée né à
Périgiieux, 6c fur fa malheureufe famille. XIL 3 39. a.
Périgueux , (Géogr.) obfervation fur l’infcriptioii d’une
colonne milliaire qu’on voit dans cette ville. C e ft l’unique
iiifcription connue qui porte le nom de Florien. Caufe de
la rareté des moiuunens de cet empereur. Suppl. IV, 299. b.
N N n n n
m