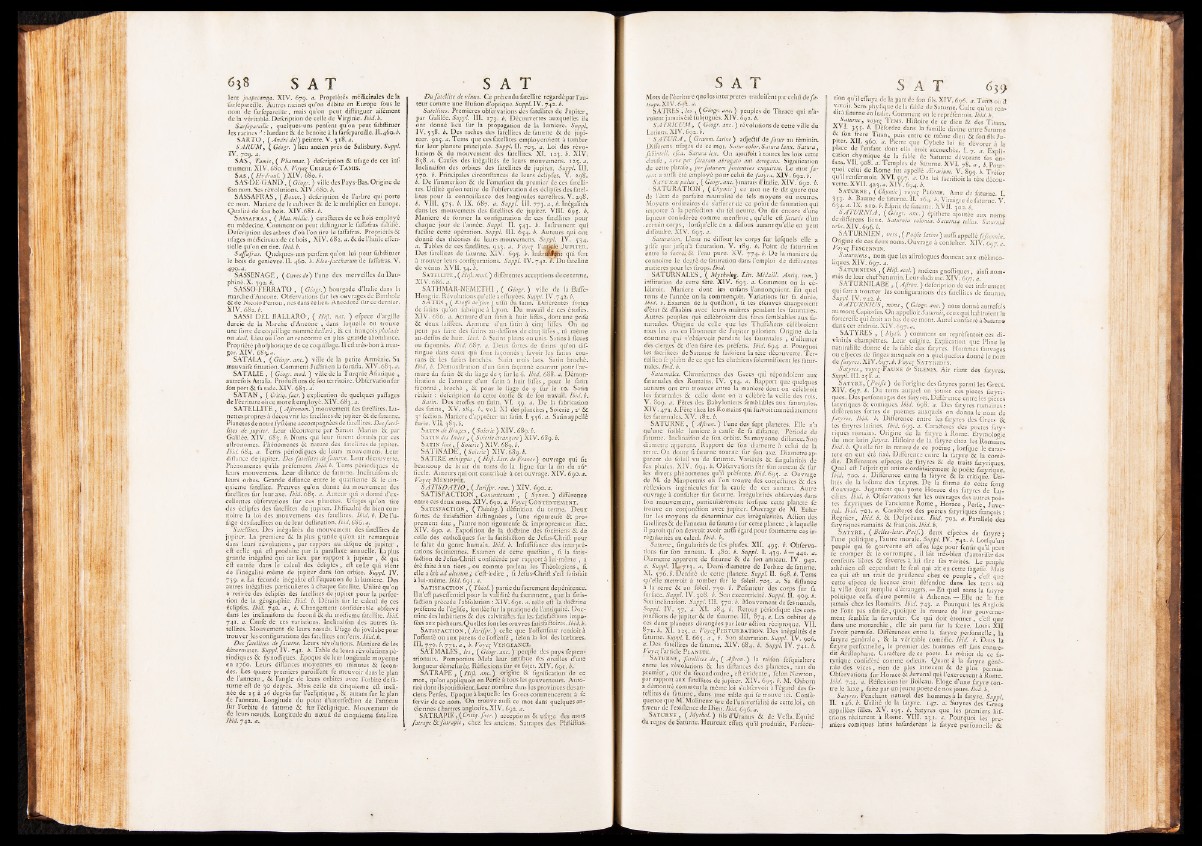
Il' t' 1 ' :
!?'!■ ' I
■i " I l
il
|| '1 , P
638 S A T
lein jujpLxan^a. X IV . 679. a. Propricté» médiciflales d e li
fnr(ep;irei!le. Aun es i-.icincs qii’oii débite en Europe lous le
nom de farfepai e ilic , mais qu'on peut diflinguer aifément
de la véritable. Delcriptioii de celle de Virginie. JinJ. b.
Sjrfepjrd'illc , quelques-uns penfeiu qu’on peut fubftituer
les racines '' bardanede de benoite à h farfepareilic. II.460. b.
S.ARTO , ( j^nJri Jel) peintre. V . 318. a,
S.-IRUM, ( Géo'^r. ) lieu ancien près de Salisbury. Suppt.
r \ '. 709. a.
SAS , Tamis, ( Phannac. ) dcrcriptlon & iiCige de cct inf-
trumem. X IV . 6S0. b. Voyer C rible 6-T amis .
S a s . ( HyJraul. ) X IV . 680. b.
SAS-DE-GAND , ( Geo^'r. ) ville des Pays-Bas. O rigine de
Con nom. Ses révolutions. X lV . 68o. b.
SASSAFRAS , ( Poran. ) delcription de l’arbre qui porte
ce nom. Maniéré de le cultiver & de le multiplier en Europe.
-Qualité de l'on bois. X IV .681. A Sassa fra s, (Mai.meJic.) caraélercs de ce bois employé
en médecine. Comment on peut dillinguer le falTatras f.iliitio.
Delcription des arbres d’où l’on tire le lalTaf'ras. Propriétés &
iifages médicinaux de ce b ois, X IV. 682. a. & d e riuiilo elTcn-
ticlle qu’on en tire. /Aé/. b.
Sj.JJafr.is. Quelques-uns penfent qu’on lui peut rubRituer
le bois de genievre. II. 460. b. Elco-Jaccharum de lalTalras. V.
499. U.
SASSEN.-\GE, (CHverJr) l’ime des merveilles du D auphiné.
X. 392. b.
SA SSO -F FRRA TÜ , {Cco£,r.) bourgade d’Italie dans la
marche d'Ancune. Oblcrv.icions fur les ouvrages de Barthole
& de Nicolo P erroti, nés danscclicti. Anecdote Itii ce dernier.
X IV . 682. A
SASSI DEL B A L L A R O , ( Hijt. nas. ) cCpcce d'argillc
durck; de la .Marche d'Ancone , dans laquelle on trotive
une forte de coquillage nommé b.jlLiri, & en françois p/jü/.j.A
ou d.til. Lieu où l'on en rencontre en plus grande abondance.
Propriété plioiphoiique de ce coquillage. 11 cil très-bon à manger.
X IV . 683,./.
S A T A L A , ( Gcoj^r. anc.) ville de la petite Arménie. Sa
mativaife fimatton. Comment JuRinien la fortiria. XIV.6S3. .7.
SA TA L IE , {Giogr. mod.') ville de La Turquie Aiiatiquc ,
autrefois Attalia. Produélions de l'on territoire. Oblcrvaiion fur
fon porc & fa rade. X IV. 683. u.
SA T A N , ( Critiq. J'jcr.) explication de quelques pafl'ages
de récriture oil ce mot eR employé. X IV . 683. u.
SA TE L L IT E , ( Ajlronom. ) mouvement des fatcUites. L u nettes
propres à découvrir les larelliies de jupiter ôc defatiii ne.
Planètes de notre lyRème accompagnées de laiellites.
iites de Jupiter. Leur découverte par Simon Marius de par
Galilée. X IV. 6S3. A Noms qui leur furent donnés par ces
aRronomes. Phénomènes & nature des faieliites de jttpiter.
/A i/. 684. il. Tems itériodiqties de leurs motivemcns. Leur
dilLmcc de jupiter. Des j'atelL'iics de faiurne. Leur découverte.
Pl'.énomenes qu’ils préfentent. Ibid. b. Tems périodiques de
leurs mouvemens. Leur diRance de faturne. Indinuifons de
leurs orbes. Grande diRance entre le quatrième & le i-in-
quicme fatellitc. Preuves qu’on donne du mouvement des
fatcliites fur leur axe. l'bïi. 683. a. Auteur qui a donné d’excellentes
obfervations fur ces planètes. Ufages qu'on tire
des éclipfes des fatcliites de jupiter. DilKeulté de bien coii-
noitre la loi des mouvemens des latellites. ibid. b. D e l ’u-
fage des fatcliites ou de leur deRination. l'eid. 686, a.
Satellites. Des inégalités du mouvement des fatellites de
jupiter. La premiere & la plus grande qu’on ait remarquée
dans leurs révolutions , par rapport au dilque de jupiter ,
cft celle qui eR produite par la parallaxe aninielle. Lapins
grande inégalité qui ait lieu par rapport à jupiter , & qui
cft entrée dans le calcul des ccliples , eft celle qui vient
de l’inégalité même de jupiter dans fon orbite. Suppl. IV.
739. U. La fécondé inégalité eR l’équation de la lumière. Des
autres inégalités particulières àchaqtie larcHiie. Utilité qu’on
a retirée des éclipiés des fatellites de jupiter pour la perfection
de la geographic. Ibid. b. Détails fur le calcul de ces
éclipfes. Ib'id. 740. a , b. Changement confidérahlc obfervé
dans les indinuifons du fécond <k du troifteme fatdlite. Ibid.
741 . a. Caufe de ces variations. Inclinaifon des autres fa-
leîlites. Mouvement de leurs noeuds, Ufage du jovilabepour
trouver les conftgurations des fat.lliies encr’eux. Jb'id. b.
Des fatellites de faturne. Leurs révolutions. M.iniere de les
déterminer. Suppl. IV'. 741. b. Table de leurs révolutions périodiques
& fynodiques. Epoque de leur longitude moyenne
en 17Ö0. Leurs diftances moyennes en minutes tk. focon-
de.s. Les quatre premiers paroiflem fe mouvoir dans le plan
de l’anneau , & l’angle de leurs orbites avec i’orbitc de faturne
eft de 30 degrés. Mais celle du cinquième eft inclinée
de 1 3 a 16 degrés fur l’écÜptiqtic , & autant fur le plan
de l’anneau. Longitude du point d'iiiterfeélion de l’anne.tu
fur l’orbite de faturne 8c Rtr l’écliptique. .Mouvement de
de leurs noeuds. Longitude du noeud du cinquième fatcliire.
Jb'id. 742. a.
S A T
Du fatdlite dc-i'énus. Ce préiciulii fatcllite regardé par l’auteur
comme une illufion d’optique. Suppl. IV. 742. b.
Satellites. Premieres obfervations des fatellites de Jupiter,
par Galilée. 5'w/’/’L III. 173. b. Découvertes auxquelles ils
ont donné lieu itir la propagation de la lumière. Suptpl,
IV . 538. A Des taches des fatellites de faturne 8: de jupi-
reer. 925. a. Tems qtie ces latellites cmploycroient à tomber
fur leur planere principale. Suppl. II. 703. a. Loi des révolutions
8c du mouvement des fatellites. XI. 123. b. XIV.
838. a. Caufes des incgalitcs de leurs mouvemens. 125. a.
Inclinaifon des orbites des fatellites de jupiter, Suppl. III.
570. b. Principales circonllances de leurs éclipfes. V. 298.
b. D e l’immerfion 8c de rémerfion du premier de ces fatellites.
Utilité qu’on retire de l’obfervation des éclipfes des fatel-
litcs pour la connoilfancc des longitudes terreRres. V . 298.
b. V i l l . 375. A IX. 687. a. Suppl, l i l . 773. .7, A Inégalités
dans les mouvemens des fatellites de jupiter. VÜI. 693. A
Maniéré de former la configuration de ces fatellites pour
chaque jour de l’année. Suppl II, 343. A InRrumeiu qui
facilite cette 0[)érarion. Suppl. III. 634, b. Auteurs qui ont
donné des théories de leurs mouvemens. Suppl. IV. 534.
a. Tables de ces fatellites. 013. a. Poyer l’aimle ju i ’iTER.
Des fatcliites de faturne. XIV. 693. A InRriiWè'nt qui fert
à trouver leurs configurations. Suppl. IV. 742. A Du fatcllite
de venus. X VU . 34. A
Satellite , ( Ehil. mod. ) différentes acceptions do ce terme.
XIV.08Ö.U.
S.ATHMAR-NEMETHI , ( Géogr. ) ville de la Baffe-
Hongrie. Révoimionsqti’clle acffiiyées. Suppl. IVL 742. b.
SA FIN , ( Etoffe de J'oie) tift'tl du faiin. Difiérentes fortes
de fatins qu’on fabiique .'1 Lyon. Du travail de ces étoffes.
XIV . 686. a. Armure d’un fatiii à huit lilî'es, dont une prife
8c deux hiiffées. Armure d’un latin à cinq üffes. On ne
petit pas taire des fatins au dcffoiis de cinq lilies , ni même
au-deifus de huit. Ibid. b. Satins pleins ou unis. Satins à Reurs
oti façonnés. Ibid. 687. a. Deux fortes de fatins qti’on dif-
ringue dans ceux qui font façonnés ; fivoir les fatins cou-
rans 6c les fatins brochés. S.ttiii trois lacs. Satin broché.
Ibid. b. Démonllraiion d’un farin façonné courant pour l’armure
du fatin 8c du liage de 5 fur le 6. Ib'td. 688. u. Démon-
ftration de l’armure d’un fitin à huit liffes , pour le fatin
façonné , broché , 8c pour le li.ige de 9 fur le 10. Satin
réduit : defeription de cette étoft'e Sc de fon travail. Ibid, b.
Satin. Des étoffes en fatin. V L 39. a. De la fabrication
des fatins, X V . 284. A vol. XI des planches, Soierie , 2' 8c
3^^ fcéiion. .Maniéré d’apprêter un fatin. 1. 336. a. Satin appcllé
furie. VU. 383. A
.S.ATIN Je Bruges , ( Soierie ) X IV . 689. A
Satin des lu f s , ( Soierie étrangère) X IV . ÖS9. A
.Satin liné, ( So'ieric) XIV. 689. é.
S A T IN A D E , X IV .6 8 9 .A
S A T I R E , l^Hiß.Litt.de France) ouvrage qui fit
beaucoup de bruit du tems de la ligue fur la fin du 16=
fijcle. Auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. X IV . 690. a.
P'oyei MÉNIPPée.
SA T ISD A T IO , ( Jtirifpr. rom. ) X ÎV . 690. a.
SATISFACT. ION , Contentement , ( Synon. ) différence
entre ces deux mots. X IV . 690. a. Voye^ Contentement.
Sa tis fa c t io n , (^Théolog.) définition du terme. Deu.r
fortes de fatisfaflion diRinguées , l’imc rigoureufe 8c pio-
premeiu dite , l’autre non rigoureufe 8c improprement dite.
X IV . 690. a. Expofirlon de la doilrine des fociniens 8c de
celle des catholiques fur la fatisfaélion de Jcfus-CliriR pour
le falut du genre humain. Ibid. A Infuffilance des interprétations
fücinienncs. Examen de cette qiicRion , fi la fatis-
faélion de Jefus-ChriR confidérée par rapport à lui-même , a
été faite à un tiers , ou comme jjarlent les Théologiens, fi
elle a été ad alteriim; c’eR-à-dire , fi Jcflis-CliriR s’elî fatisfait à lui-même. Ibid. 691. a.
Satisfaction , ( T/icol.) partie du facrement de pénitence.
Il ii’eR pas cffentiel pour la validité du facrement, que la fatis-
faffion précédé l’abfolution : X IV . 691. a. telle cR la doéirine
préfente de l’eglife, fondée fur la pratique de l’antiquité. Doctrine
des luthériens 8c des calviniRcs furies fatisfaélions impo-
fées aux pécheurs. Quelles font les oeuvres fatisfaéloires. Ibid. b.
Satisfaction , (/üWypr. ) celle que l’oftenfeur rendoit à
roffenfé ou atix parens de l’offenfé , felon la loi des barbares.
III. 770. b. J J !, a , b. V engeance.
SA TMALES , A r , ( Gt'ogr. d/ic. ) peuple des pays fepten-
trionati.x. Pomponiiis Mêla leur attribue des oreilles d’une
longueur déniefuréc. Réflexions fur ce lujct. XIV. 691. A
SA TRA PE , ( Hifl. anc. ) origine 8c fignificacion de ce
mot, qu’on-appliquait en Perfe à tous les gouverneurs. Autorité
donc ils jouiflbient.Leur nombre dans les p rovinces des anciens
Perlés. Epoque à laquelle les Grecs commencerem à fe
fervir de ce nom. On trouve aufli ce mot dans quelques an-
ciennes chanres ang!oifes.XlV. 692. a.
SATRAPIE,(^Critiq. fie r .) acceptions Sc ufage des mots
fairape k fit!apte, chez les anciens. Satrapes dus PhiURins.
S A T
Mots de récriture que les interprétés traduifent par celui de fa-
frupt'.Xl V, 69^. a.
SATRES , tes , {Géogr. anc.) peuples de Thrace qui n’a-
voient jamais été luhjugués. X IV. 692. b.
SA ÏR ICU .M , ( Geogr. anc.) révolutions de cette ville du
L a ùum.XiV. 692. A
S A J U R A , ( Gramm, latine ) adjeétif de farur au féminin.
DiRérciis ulages de cc mot. Sarur color. S.itura lanx. .Satura,
fubintell. efea. S.itura lex. ü n ajoufoii à toutes les loix cette
tlaule , neve per fr.turam abrog.ito aut aerog.iio. Signification
do cette phrale, per J'aturam J'entemias exquirerc. Le m o t/ j-
tur.i a auflî été employé pour celui de Jatyi,i. XIV. Gc)z.b.
.SATunÆ p.t!us , ( Grog/-, rt/ic, ) marais d’Italie. XIV. 692. A
SA TU R A T IO N , ( Chymic ) ce mot ne fe dit gucre que
do i'éiat de parfaite neutralité de fels moyens ou neutres.
Moyens ordinaires do s’aftiirer do ce point de fiiniration qui
importe à la perfcillon du fol neuire. On dit encore d’une
liqueur confidérée comme meiiRnie, qu’elle eR firurèc d’un
.certain corps, lovfqu’olle en a diflous autant qu’elle en peut
diffoudre. X lV . 693.
Saturation. L’etiu ne diffoiit les corps fur lefquels elle a
prife que jufqu’à faturaiion. V . 189. b. Point de l'aturation
entre le fucriL'.8c l’eau pure. X V . 774. b. D e la maniéré de
connoicre le degré tic liuuration dans l’emploi do différemes
matières pour l o firops. Ibid.
S A TU R N A L E S , ( Mytholog. Litt. Médailî. Antiq. rom.)
inRitution do cette fête. X IV . 693. a. Comment on la cé-
lébroii. Maniéré dont les eiifans l’annonçoiuit. En quel
tems de l’année on la commençait. Variations fur fa durée.
Ibid. b. Examen de la queRion , fi les elclaves changeoienc
d’état Sc d’habits avec leurs maîtres pendant les faturnaies.
Autres peuples qui célébroient des fêtes fcmblables aux fa-
lurnales. Origine de celle que les Thcffaliens célébroient
tous les ans en l’honneur do Jupiter polorien. Origine delà
coutume qui s’obfervoic pendant les faturnaies , d’allumer
des cierges 8c d’en faire des préfens. Ibid. 694. a. Pourquoi
les facrifices de Saturne fe fiiloient la tète découverte. Ter-
tullion le plaint de ce que les dirétiens folemnifoicnt les fatur-
nalcs. Ibid. b.
Saturnales. Clironieniics des Grecs qui répondoient aux
faturnaies des Romains. IV . 514. a. Rapport que quelques
auteurs ont cru trouver entre la manière dont on célébroit
les faturnaies 8c celle dont on a célébré la veille des rois.
V . 809. a. Fêtes des Babyloniens lémblables aux faturnaies.
X IV . 471, i.F é tc chez les Koinaius qui lu ivo it immédiatement
les faturnaies. X V . 182. b.
SA TU RNE , ( Ajlron. ) l’une des fept planètes. Elle n’a
qu’une foible lumière à caufe de fa diftance. Période do
faturne, Inclinaifon de fon orbite. Sa moyenne diRance. Son
diamètre apparent. Rapport de fon dnimetre à celui de la
tertc. On doute llfaiurne tourne lur fon axe. Diamerroapparent
du foleil vu 'de faturne. Variétés 8c fingularités de
fos phalcs. X lV . 694. A Obfervations fur fon anneau 8c fur
les divers phénomènes qu’il préfente. 693. a. Ouvra"e
de M. de Maupenuis où l’on trouve dos conjeffures 8c clos
réflexions ingenieufes fur lu caufe de cct anneau. Autre
ouvrage à confuker fur faturne. Irrégularités obfervées dans
fon mouvement, parriculiéremeiic lorlque cette planete fe
trouve cil conjonéiion avec jupiter. Ouvrage de M. Euler
iur les moyens de déterminer ces irrégularités. Aéiion des
fatellites 8c de l’anneau de fatum e fur cette planète , à laquelle
il paroit qu’on devroit avoir aiiffi égard pour foumettre ces irrégularités
au calcul. Ibid. b.
Saturne, fingularités de fes phafes. XII. 493. b. Obfervations
fur fon anneau. I. 480. A Suppl. I. 439. b— 441. a.
Dinmctre apparent de faturne 8c de fon anneau. IV. 942.
a- Suppl. Ild>7i3. a. Demi-diamctre de l’orbite de faturne.
XI. 376. A Denfité de cette planete. Suppl. II. 698. b. Tems
qu’elle meirroit à tomber fur le foleil. 703. a. Sa diRance
Il la terre 8c au foleil. 730. A Pcf.inteur des corps fur fa
lutface. Suppl. IV, 308. A Son excentricité. Suppl. II. 909. b.
Son inclinaifon. Suppl. III. 370. é. Mouvement de fes noeuds.
fftppL IV. 57. .J. X L 184. b. Retour périodique des con-
jonélions de jupiter 8c de faturne. III. 874. a. Los orbites de
CCS deux planètes dérangées p.ir leur affion réciproque. V IL
8 71. A XI, 125. <7. J-bye^PERTuaBATiov. Des inégalités de
faturne. Suppl. I. 663. a , b. Son aberration. Suppl. IV . 906.
a. Dos fatellites de faturne. X IV . 684, b. Suppl. IV . 741. A
Fayc^ l’article Planete.
fitsllhes de, { Aflron.) la raifon fefquialtere
entre les révolutions 8c les dlRances dos planètes, ram du
premier, cjiie du fécond o rdre, eR évidente, felon Newton,
par rapport aux fatellites de jupiter. XÎV. 695. A M. Osborn
« domontio comment la meme loi s’obfervoir à l’égard des fii-
tellites de faturne, dans une table qui fe trouve ici. Confé-
quence que M. Mollneux tire de runiverfalité de cette lo i, en
faveur do l’exiRence de Dieu. Ibid. 696. a.
Saturne , ( Mytkol. ) fils d’Uramis 81 de VcRa. Equité
' ..........de Saturne, Heureux effets du qu’il pi oduifit. Periccu-
S A T 639
tion qu'il effnya de la part de fon fils. XÎV. 696. rf. Terift ou il
ViVoit, Sensphylique delà fable de Saturne. Culte qu’on rendu
a lattinie en Italie. Comment on le repréfcntoit. îb'ul. b.
yiturne, voye^ T ems. Hiftoirc de ce dieu Sc des Titans.
• 3 î'i- Défordre dans la famille divine entre Saturne
OC ion freie Titan, puis entre cc meme dieu ÖC fon fils Ju-
pitcr. XII 960. 0. Pierre que Cybelc lui fi: dévorer à la
place de 1 enfant dont elle étoit accoucliéo. I, 7 ^ Explication
chymiqiie de la fable de Saturne dévomm fes cn-
tans. VII. 908. .7. Temples de Saturne. X VI. 78. a , b Pourquoi
celui de Rome fut appelle Æ ’ atium. V . 899. A Trélbr
qu’il renfermoit. XVI. 397. .z, On lui Ihcrifioitla tête découverte.
XVJI. 423.a. X lV . 694. A
Sa t u i in e , {a .y „u r ) Plom». Ai„c iL famnic. I.
333. A Baume de lamme. II. 164. A Vinaieic de faturne-. V .
634. <7. IX. 210. b. Efpiiî de faitiriio. X V ll. 302. b.
1 cpltliete ajoutée aux noms
dodittorens lieux. S.itumia colonia. Suturnia tellus. S.itumiù
urbs.XlV.Gcff.b.
SATUHMIEN, « « , ( Poi/t, ) ai.ffi nppcllé
Origine de cos deux noms. Ouvrage à tonliilter. X lV . 697. a.
Foye^ F escenniN. ''
Saturniens, nom que lesafirologucs donnent aux mélancoliques.
X lV . 697. a.
Saturniens , {Hiß. ecd. ) anciens gnofliques, ainfi nommés
de leur chefSammiii.Leur doffiino, XIV. 697. a.
SATU RNILABE , ( Apron. ) clefoription de cet in.fininicnt
q u ire rtà tio u vc r les configurations dos f.itellices de faturne.
Suppl. IV. 742, b.
SA TU R N IU S , nions, { Géogr. anc. ) nom donné autrefois
au mont Capitolin. On appelloitSuruz/z/z, ceux qui habitoieiu la
fortoreffe qui étoit au bas do ce mont. Autel eonfacré à Saturm*
dans cct ondroic. X IV . 697. a.
_ SA TYR E S , ( Myi.'i. ) comment on repréfentoit ces divinités
cliainpètros. Leur origine. Explication que Pline le
nacuralifte donne de la fable dos fatyrès. Hommes fauvaves
ou efpeccs de fmges auxquels on a quelquefois donné le nom
de fity r cs.X l'V.ô^j.b. Foyc^ Satyj;jdi-s.
Satyres, wyr^ fAUNE & SiLENES, Air riant des fatyros.
Suppl. III. 238. J.
Satyre, {Poèfie ) de l’origine des fatyres parmi les Grecs.
X lV . 697. b. Du tems auquel on joiioit ces pieces latyri-
ques. Des perfonnages des latyres. D ifférence entre les pieces
fatyriques £c comiques. Ib'id. 698. a. Dos fatyres romaines :
différentes fortes de poomes auxquels on donna le nom de
J.iiyrcs. Ibid. A Diftcrcnce entre les fatyres des Grecs 8c
les fatyres latines. Ibid. 699. a. Caraefteres des poètes faty-
riqiies romains. Origine de la facyre à Rome. Etymologie
du mot latin fatyra. Hiftoiro de la liityre chez les Romains.
Ibid. b. Quelle fut la nature de ce poème , lorfque le caractère
en eut été fixé. Différence entre la latyre 8c la comédie.
Différentes efjîoces de fatyres 8c de traits fatyriques.
Q uel eft l’efprit qui anime ordinairement Je poète fatyriqiie.
Ih'iJ. 700. <2. Difference entre la faryre 8c la critique. Utilités
de la Icûure dos fatyres. De la forme de cette forte
d'ouvr.ige. Jugement que porte Horace des fatyres de Lu-
cilius. îbid. b. Obfervadûiis fur les ouvrages des autres poètes
fatyriques de l’ancienne R om e, Horace, Perfe Juvenal.
Ib'id. 701. <7, Caraélercs des poètes fatyriques fraiicois :
Regnier, Ih'td. A 8c Defpréaux. Ibid. 702. <?. Parallele des
fatyriques romains Sc françois. JAA b.
Sa ty r e , { Bdles-letir.'Poèf) deux efpeccs de fatyre ;
l'une politique, l’autre morale. Supjil. IV. 741. A Lorfqu’un
peuple qui fe gouverne eft affez fiige pour feniir qu’il peut
fe tromper 8c fe corrompre, il fait très-bien d’autorifer des
cenfeiirs libres 8c févercs à lui dire fes vérités. Le peuple
athénien eft cependant le fciil qui ait eu cette fageffe. Mais
ce qui eft un trait de prudence chez ce peuple', c’eft que
cette efpece de licence étoit défendue dans les teins où
la ville étoit remplie d’étrangers. — En quel tems la faiyre
politique ceffa d’etre permife à Athènes. — Elle ne le fut
jamais chez les Romains. IbtJ. 743, a. Pourquoi les Anglais
ne l’ont pas admife, quoique la nature de leur goiivcVne-
nient feuiblât la favorifer. Ce qui doit étonner, c'eîl que
dans une monarchie , elle ait paru fur la feene. Louis XII
l’avoit permife. Différences entre la fatyre perfonnolle, la
fatyre générale , 8c la véritable comédie. Jbid. A Dans la
fatyre perfonnclle, le premier des liummes eft fans contredit
Ariftophanc. Caraftcie do ce poete. Le métier de ce fa-
tyriqtie confidéré comme odieux. Quant à la fatyre générale
des v ic e s , rien de plus innocent 8c do plus pomiis.
Obfervations fur Horace k Juvenal qui l’exercerent à Rome.
Ib'id. 744. a. Réflexions fur Boileau. Eloge d’une fatyre contre
le luxe , faite par un jeune poète de nos jours. Ibid. b.
Satyres. Penchant naturel des hommes à la fatyre.
II. 14Ö. A Utilité de la facyre. 147. a. Satyres des Grecs
appellees filles, X V . 195. A Satyres que les premiers liif-
trions récitèrent à Rome. VIII. 231. Pourquoi les premiers
comiques latins hafarderent la facyre perfomiollo^&