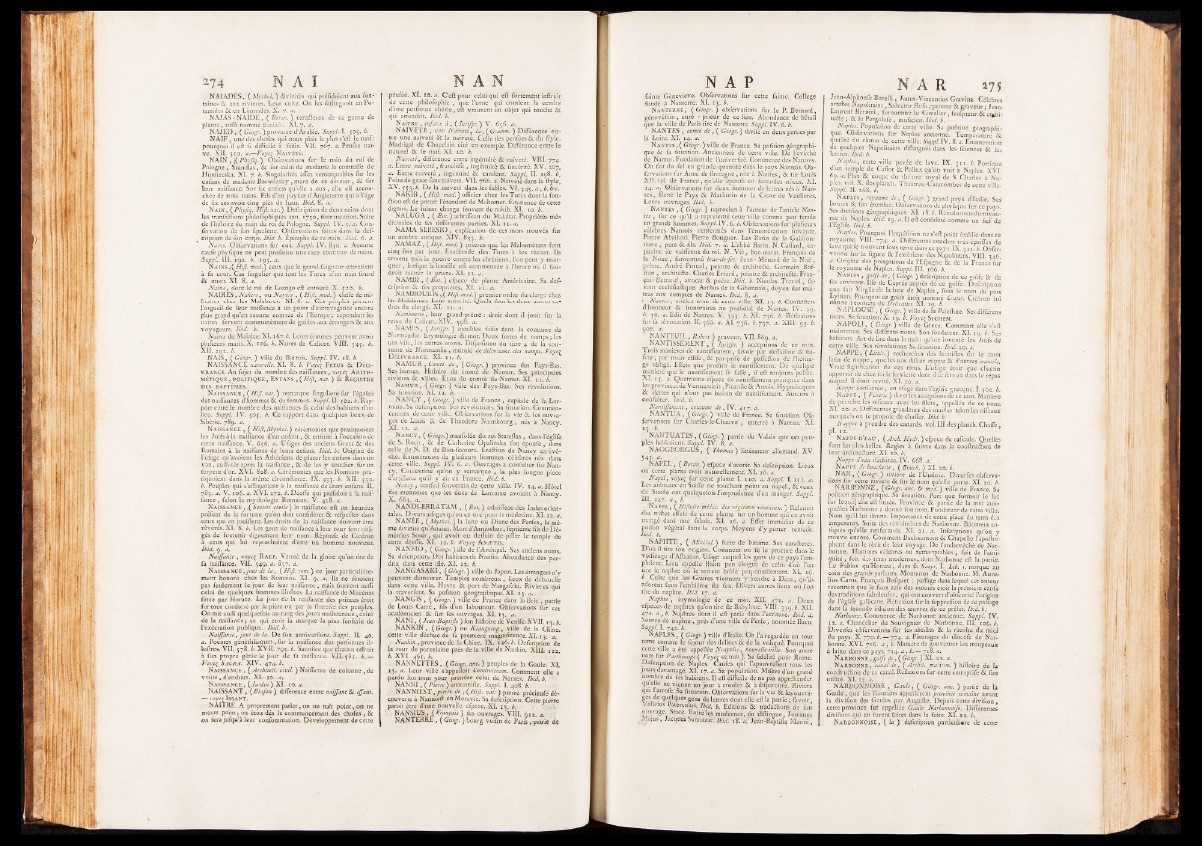
Ul
W l
I I I
-s. i
2 7 4 A I
N A IA D E S , ( Mytitcl. ) divinités qui pieficlalcnt aux fontaines
& aux rivieres. Lern- culte, ü i i les diitinguoit en Po-
lamidcs & en Limnades. X. 7. rj.
N.'VJAS - NAIDE , ( Bor^n. ) carafisres de ce genre de
plante, aulli nommé XI. 7. a.
NAJED , ( Géogr. ) provir.ee d’Arabie. Suppl. 1. ^05. b.
n a ï f , une des choies qui nous plaît le plus c’eÜ le naif :
pourquoi il eil il difRcile à falfir. VII. 767. a. Penléc naïve.
XII. 310. a.— Vùyc-^ N.Vïveté.
N-'^IN , i( P/ji7?ÿ. ) Obiervntions fur le nain du roi de
Pologne , Staniflas, 6c fur celui de madame la comtelle de
Hmuieeska. XI. 7. b. Singularités afiex remarquables fur les
enfans de madaine Borwilasky , mere de ce dernier , 8c fin-
leur naiffance. Sur fix enfans qu’elle a eus , elle ell accouchée
de trois nains. Fils d’un paylim d’Angleterre qui à l'âge
de fix ans avoir cinq pies de haut. Ibid, 8. a.
Na in , (PAy/i'./. Hifl.nat.) Defcriptioii de deux nains donc
les tranlaélions pliilofophiques ami. 1730, font ineiuion. Suite
de l'hiAoire du nain du roi de Pologne. Suppl. IV'. 3. u. Con-
fervation de fon fquclcttc. Ohfcrvations faites dans la def-
^ cription de fon corps. Ibid. b. Épit.tplic de ce nain. Ibid. 6. <t.
Nuins. Obfervations fur eux. Suppl. IV^. 830. c. Aucune
caufe phyfique ne peut produire uns race continue de nains.
Suppl, l i l . 192. b. 193. a.
Na in s , ( Hiß. mod.) ceux que le grand-feigneur entretient
à fa cour. Cas fnigulier que font les Turcs d’un nain fourd
& muet. XI. 8. a.
N.jins, dont le roi de Loango eft entouré. X. 510. b.
NAIRES , N.ihers, ou Nayers , ( Hiß. mod. ) clalTc de militaires
chez les Malabares. XI. 8. a. Ces peuples portent
l’orgueil de leur naiflance à un point d’extravagance encore
plus grand qu’en aucune contrée de l'Europe; cependant les
nnircs fervent communément de guides aux étrangers 8c aux
voyageurs. ]bid. b.
Nuiras du Malabar.Xl. 167. b. Leurs femmes peuvent avoir
plufieurs maris. X . 106. b. Naires de Calicut. VIII. 343. b.
XII, 292. b.
N A IS , ( Gèosr. ) ville du Barrois. Suppl. IV . 18. b.
NAISSANCÈ n.i!urclle. XI. 8. b. Voye^ FÉTUS 8c DÉLIVRANCE.
Au fujec du nombre des naifl'ances, veyrj; A r ith mét
iqu e , POLITIQUE, Enfans ,{H iß . nue. ) Sc R egistre
DES BAPTÊMES.
N.mssance , ( rtiif. ) remarque fmguliere fur l'égalité
des naifl’ances d’hommes 8c de femmes. Suppl. II. 302. h. Rapport
c.itre le nombre des naillances 8c celui des habicans d’un
lieu. Suppl. IV'’. 503. b. Ce rapport dans quelques lieux, de
Sibérie. 7S9. a.
Na isSAN'CE , ( Hiß. Mythûl. ) cérémonies que pratiquoient
les .^uifs à la naiifance d’un enfant, Sc enfuite à l’occafion do
cette iiaifTance. V . 636. a. Ufages des anciens Grecs 8c des
Romains à la naiifance de leurs enfans. Ibid. b. Origine de
l'ufage qu’avoient les Athéniens de placer les enfans dans un
v an, aulîi-tüt après la naiifance , Sc de les y coucher fur un
ferpent d’or. X V I . 828. a. Cérémonies que les Romains pra-
tiquoiem dans la même circonflance. IX. 433. b. XII. 332.
b. Peuples qui s’affligeoient à la nnilTance de leurs enfans. il.
7S3. a. V . 106. a. X V I . 272. b. Déefle qui préficloit à h naiffance
, felon la mythologie Romaine. V. 418. a.
Na is san c e , ^(5od;V!’ civile') la naiifance eft un heureux
préfent de la fortune qu’on doit confidérer Sc refpeéler dans
ceux qui en joiûiîenc. Les droits de la naiifance doivent être
révérés. XI. 8. b. Les gens de naiifance à leur tour font obligés
de fontenir dignement leur nom. Réponfe de Cicéron
à ceux qui lui reprochoient d’etre un homme nouveau.
Ibid. 9. a.
Naiffance , voyc:^ R a c e , Vanité de la gloire qu’on tire de
fa naiflance. VIL 549. a. 837. a.
Na is s a n c e , jour u'.t la , {Hiß. rom.') ce jour particuliérement
honoré chez les Romains. XL 9, a. Ils ne fétoient
pas feulement le jour de leur naiflance , mais fouvent aufli
celui de quelques hommes illuflres. La naiifance de Mécénas ;
fêtée par Horace. Le jour do la naiifance des princes étoit
fur-tout confacré par la piété ou par la flatterie des peuples.
On mit aulfi quelquefois au rang des jours malheureux, celui
de la naiifance; ce qui étoit la marque la plus fenfible de
l’exécration publique. Ibid. b.
Naffance, jour de la. D e fon anniverfaire. Suppl. IL 40.
a. Poèmes généthüaques, fur la naiifance des perfonnes il-
kiflres. VII. 378. b. XVII . 793. b. Sacrifice que chacun olFroit
h fon propre génie le jour de fa naiifance. VJI. 581. b. —
/ oyfç S a c r a . X IV . 474. b.
N aissance , ( dvï/. ) Naiifance de colonne, de
v o û te , d’endnirs. XI. 10. a.
Naissance , {Jardin ) XI. 10. a.
NAISSANT , {Blufon ) dilTérence entre naffant & ffant.
— voyer IsSANT.
NAITRE. A proprement parler, on ne naît point, on ne
meurt point; on étoit dès le commencement des chofes , 8c.
on fera jiifqu’à leur confoiuniatlon. Développement de cette
N A N
pSiilee. XI. lô . a. C e ll pour celui qui efl fortement inflriuc
de cette plûlofophie , que l’urne qui contient la cendre
d’une pcrfonne chérie, eil vraiment un objet qui touche Sc
qui attendrit. Ibid. b.
NaItre , enjans à , {Jurifpr.) V. 636. a.
N A lVOE iÉ , une. Naiveté, h , {Gramm. ) Différence entre
une naïveté & la naïveté. Celle des penfées 8c du flyle.
Madrigal de Chapelain cité en exemple. Différence entre la
naturel 8c le naïf. XI, 10. b.
Naivaé, différence entre ingénuité Sc naïveté. VIII. 774.
a. Entre naïveté , francliife , ingénuité 8c fincorité. X V . 207.
a. Entre naïveté , ingénuité 8: candeur. Suppl. II. 198. ï_
Point de grace fans naïveté. V IL 766. a. Naïveté dans le flyle.
XV. 333. é, De la naïveté dans les fables. VI. 343. æ , i. 6’c.
NÄKIB , ( Hifi. mod. ) officier chez les Turcs dont la fon-
élion efl de porter l’étendard de M.iliomet. Éminence de cette
dignité. Le liiltan change fouvent de naklb. XI. 10. b.
N A LU G A , ( .ßoA ) arbrilfeau du Malabar. Propriétés médicinales
de fes differentes parties. XI. i i . a.
NAM A SEBESIÜ , explication de ces mots trouvés fur
un marbre antique. XIV. 833. b.
^ N AM A Z , { Hiß. mod. ) prières que les Mahometans font
cinq fois par jour. E.xaélitiide des Turcs à les réciter. Ils
croient qu’.'i la guerre contre les dirétiens , l’on peut y manquer
, lorfque la bataille eft commencée à l'heure où il l'au-
droit réciter la pricre. XL
NAMBI , ( Bot. ) cfpece de plante Américaine. Sa def-
cription 8c fes propriétés. XI. 11. a.
NAlViBOViilS , { Hiß.mod.) premier ordre du clergé chez
les Malabares. Leur autorité. Quels font les deux autres ordres
du clergé. XI. 11. a.
N.imbouris, leur grand-prêtre ; droit dont il jouit fur la
reine de Caiieur. X IV . 398. a.
NAMES, {Jurijpr.') meubles faifis dans la coutume de
Normandie. Etymologie du mot. Deux fortes de namps;les
uns vits, les autres morts. Dilpofiiion du titre 4 de la coutume
de Normandie, intitulé de délivratsce des namps. Foyer
D é liv r an c e . XL i i . b.
NAMÜR , Co/tJZi;' d e , {Gèogr.j province des Pays-Bas.
Ses bornes. Hiiloire du comté de Namur, Ses principales
rivieres 8c villes. Etats du comté de Namur. XI. i i . b.
Na n c y , ( Glogr. ) vllle de France , capitale de la Lorraine.
Sa del’cripcion. Scs révolutions. Sa fituaiion. Commen-
ccmcns de cette v ilL . Obiervations fur la vie 8c les ouvrages
de Louis 8c de Théodore Naimbourg, nés à Nancy.
XI. 12. a.
Na n c y , ( Gèogr.) niaufolée du rçi Staniflas , dans l’églife
de S. R o ch , Sc de Catherine Opalinska fon époufe , dans
celle de N. D. de Bou-l'ecours. Ereélion de Nancy en évêché.
Enumération de plufieurs hommes célébrés nés dans
cette ville. Suppl. IV. 6. a. Ouvrages à confulter fur Nancy.
Coulevrine qu’on y remarque , la plus longue piece
d’arüllerie qu’il y ah en France. Ibid. b.
Nancy y confcil feuverain de cette ville. IV. 14. <î . Hôtel
des moniioies que les ducs de Lorraine avoient à Nancy.
X . 663. a.
N A N D l-ER R AT AM , {Bot.') arbrilfeau des Indes orientales.
Divers ufages qu’on en me pour la médecine. XL 12. a.
NANÉE , {Mythol. ) la lune ou Diane des Perfes, la même
divinité qu’Anaïtis. Mort d’Antiochus, feptieme fils de D é-
métrius So ter, qui avoit eu delfein de piller le temple de
cette deeffe. XI. 12. b. Voyer;^ A nÆTIS.
NANF IO , ( Géogr. ) ifle de l’Archipel. Scs anciens noms.
Sa defeription. Des habitans de Nanfio. Abondance des perdrix
dans cette ifle. XI. 12. b.
N A N G A S A K I , (^cogr. ) ville du Japon. Les étrangers n’y
peuvent demeurer. Temples nombreux , lieux de débauche
dans cette ville. Havre 6c port de Nangafaki. Rivieres qui
la traverfent. Sa pofition géographique. XL 13.
NANGIS , ( Géogr. ) ville de France dans la Brie , patrie
de Louis Carré , fils d’un laboureur. Obfervations fur cet
académicien 8c fur fes ouvrages. XI. 13. a.
NA N I , ( Jean-Baptiße ) fon hifloire de V enifc.XV II. 13. A
N A N K IN , {Géogr.') ou Kiangningy ville de la Chine,
cette ville déchue de fa premiere magnificence. X I. 13, a.
Ah/tAï« , province de la Chine. IX. J aé. Defeription de
la tour de porcelaine près de la ville de Nankin. XIII 122
X V I , 461. é.
NANN ET TES , {Géogr. anc.) peuples de la Gaule. XL
13. a. Leur ville s’appelloit Condivienum. Comment elle a
perdu fon nom pour prendre celui de Nantes. Ibid. b.
NANNI , ( Pierre) anatomifle. Suppl. 1. 408. b.
N A N N IE ST , pierre de , ( Hiß. „at. ) pierre précieufe découverte
à Naiiniefl en Moravie. Sa delcrjption. Cette pierre
paroit être d’une nouvelle cfpece. XI. 13,-^.
N AN S IU S , {François) fes ouvrages. VIII. 912. a.
N A N T E R R E , ( Géogr. ) bourg voifln de Paris , pa^ie de
N A P
faîntc Génevieve. Obfervations fur cette fainte. College
fondé à Nanterre. XI. 13. b.
N an t er r e , {Géogr. ) obfervations fur le P. Bernard,
génovéfain , curé - prieur de ce lieu. Abondance de bétail
que h ville de Paris tire de Nanterre. Suppl. IV. 6. b.
NANTES , comté de , ( Géogr. ) divilé en deux parties par
la Loire. XI. 14. a.
N antes , ( Géogr. ) ville de France. Sa pofition géographique
8c fa litiiation. Ancienneté de cetre ville. D e l’èvéché
de Nantes. Fondation de l'univcriité. Commeice des Namois.
On fait du fel en grande quantité dans le pays Nantois. Ob-
Icrvations fur Anne de Bretagne , née à Nantes, 8c fur Louis
XI!. roi de France, qu’elle époufa en fécondés noces.
14. a. Obiervations fur deux liommes de lettres nés à Nante
s , René le Pays 8c Matliurin de la Croze de Vcifliercs.
Leurs ouvrages. Ibid. b.
Nantes , ( Géogr. ) reproches à l’auteur de l'article Nantes
, fur ce qu’il a reprêïémé cette ville comme peu fertile
en grands hommes. Suppl.lV. 6. b. Obfervations fur plufieurs
célébrés Nantois rentermés dans l’ciuimération J'uivamc.
Pierre Abailard. Pierre Bougiicr. Les Barin de la GalilFon-
iiierc , pere 8c fils. Ibid. 7. a. L’abbé Barin. N. Caffard, capitaine
de vaiffeaux du roi. N. V ié , bon marin. François de
la Noue , furnomnié bras-de-fer. Jean - Ménard de la Noc ,
prêtre. André Portail, peintre 8c arebiteéle. Germain Bof-
fran , aichitcéle. Charles Errard , peintre 8c arcliitefte. François
Betraiid, avocat 8c poète. Ibid. b. Nicolas Traveé , fa-
vanr cedéfiaflique, Arrliiis de la Gibonnais, doyen des maîtres
aux comptes de Nantes. Ibid. 8. a.
t Nantes y ancien nom de cetre ville. XI. 13. b. Confeillcrs
d’iionncur 8c honoraires au préfidial de Nantes. IV, 20.
h. 30. a. Édit de Nantes. V . 393. b. XI. 736. b. Réflexions
fur fa révocation. II. 566. a. XI. 736. L 7 3 7 . a. XIII, 03. b.
$07. .t.
N A N 1 E ü IL , Robert ) graveur. VII. 869. a.
_ N A N 1 ISSEiMENT , { Jurijpr. ) acceptions de cc mot.
I ro ls maniérés de naniifl'ement, favoir par delîaiflne 8c fai-
fin e , par main aflife , 6c par prife de poffcflîon de riicriia-
ge obligé. Eflets que produit le nantilTement. De quelque
maniéré que le nantilTement fe fafl’e , il efl toujours public.
XI. 13. a. Quatrième cfpece de nantilTement pratiquée dans
les provinces de Vermandois, Picardie 8c Artois. Flypotlicques
&. dettes qui n’ont pas bdoin de nantillcment. Aut«-urs à
confulter. Ibid. b.
Nantffement y coutume de, IV. 417. iZ.
N A N T U A , ( Gfo^r. ) ville de France. Sa fituatlon. Ob-
fervafions fur Charles-le-Chauve , enterre à Namua. XL
N AN TU A T E S , {Géogr.) partie du Valais que ces peuples
habitoient. Suppl. IV . 8. a.
N A O G EO R G Ü S , ( Thomas) littérateur allemand. XV .
.54Î: -î-
_ NAPEL , ( 50:^/;. ) efpecc d’aconit. Sa defeription. Lieux
où cette plante croît naturellement. XL 16. a.
Napel, voyci fur cette plante I. i io . a. Suppl. L 15 !. a.
Les animaux en Suifie ne touchent point au napel, 8c ceux
dc_ Suede ont quelquefois l’imprudence d’en manger. Suppl.
lII. 247, a y b.
Na p e l , {Hipohe médcc. des végétaux vénéneux. ) Relatioli
des trilles effets de cette plante Uir un homme qui en avoit
mangé dans une falade. XL 16. a. Effet immédiat de ce
poifon végétal dans le corps. Moyens d’y porter remede.
Ibid. b.
NAPHTE , ( Minéral.) force de bitume. Ses caraéleres.
D ’où il tire fon origine. Comment on fe le procure dans le
voifinagc d’AJiracan. Ufage auquel les gens de ce pays remploient.
Lieu appelle Baku peu éloigné de celui d'üii l’on
tire le naphte où le tenein brûle perpétuellement. XL 16.
b. Culte que les Gaines viennent y rendre à D ie u , qu’üs
adorent fous l’cmblême du feu. Divers autres lieux où l'on
tire du naphte. Ibid. 17. a.
Naphte , étymologie de ce mot. XII. 471. Deux
efpeccs de naphres qu’on tire de Babylone. VIH. 339. b. XII.
471. a y b. Napbtês dont il efl parlé dans l’écriture. Ibid. a.
Source de naphte , prés d’une ville de Perfe, nommée Bacu.
Suppl. 1. 7^2. l).
N APLES, ( Géogr. ) ville d’Italie. On Ta regardée en tout
lems comme le fejour des délices 8c de la volupté. Pourquoi
cette ville a été appellee Af/z/jo/à, nouvelle ville. Son autre
nom fut Parthénope ( Foyer cc.mot). Sa fidélité pour Rome.
Defeription de Naples. Caufes qui l’apauvriffent tous les
jours davantage. XI. 17. a. Sa population. Mifpre d'un grand
nombre de fes habitans. 11 eft difficile de ne pas appréhender
qu e le ne vienne un jour à crouler 8c à difparoître. Riviere
qui 1 arrofe. Sa fiuiation. Obfervations fur la vie 8c les ouvra-
^1 - de lettres dont elle efl la patrie ; favoir
\ ellciiis IhitercuUis. Ibid. b. Editions 8c traduélions de fun
ouvrage. Stace. Entre les modernes, dn diftingue, Junianus
j-u ju s , Jacques Sannazar, Ibid. 18. a. Jean-Baptifl« Marini,
N A R 275
I Jean-Alpliohfe Bo re lli, Jamis-Vinccntius Gravlna. Célèbres
j artifles Napolitains , Salvator Rofa ,-peimre 8c graveur ; Jean-
Laurent Bernini, furnommé le Cavalier , fculptcur 6c ar^Ju-
teéle ; 8c le Pergolcfe , mnficien. Ibid. b.
Az/z/rr, Population de cette ville. Sa pofition gco<’ rapIû-
qiic. Obfervations fur Naples ancienne. Temperature 8c
qualité (lu climat de cette wWc. Suppl.lW. 8. a .Emmùrmon
de quelques Napolitains diflingiiés dans les fciences 8c les
lettres. Ibid. b.
N.:plcs y cette ville pavée de lave. IX, 5 11. b. Portique
d un reinplc de Caftor 8c Pollux qu’on voit à N.iples. X V I
6 9 . Flan 8c coupe (liij,héatre royal de S, Charles à Naples.
vol. X, (les plandi. 1 hcaires,-Catacombes de cette ville.
Suppl. Il, 268. b.
Na p l e s , royaume de, ( Géogr.) grand pays (l’Italie. Ses
bornes & Ion étendue. Obfcrvacions'dc phyfujuc fur ce pays.
Ses dtvilions gé(;graphiqiics. XI. i8 , i . Rêvoliiiionsdu royaume
de Naples. Ibid. 1 9 . Il eft confidéré comme un fief de 1 Eghfe. Ibid. b.
Pourquoi Tinquiflrion ne s’efl point établie dans ce
royaume, VIII. 774. a. Diftérentes couches très-épaifles de
lave qui le trouvent fous terre dans cc pays. IX. 311./-, Obfer-
vacion fur la figure 8c rexterieur des Napolitaias, VU I. 346.
a. Origine des prétentions de l’Efpagne 8c de la France fur
le royaume de Naples. 6’«pp/. III. 166. b.
Nap le.s , golfe de, ( Géogr. ) defeription de ce golfe 8c de
fes environ«. Ifle de Caprée auprès de ce golfe. Defeription
que fait Virgile de la baie de Naples, fous le nom du port
Lybien. Pourquoi ce golfe étoit nommé Cr.uer. Cicéron lui
donne î’épirliere de Delicatus. XL 19, b.
Nz-iTLÜÜSE, ( Geog:. ) ville de la Palefline. Ses différens
noms. S.a fituation. X. 19. b. P'oyei SiCHEM.
N A PO L I , ( Géogr.) ville de Grece. Comment elle s’efl
maintenue. Ses différens noms. Son fondateur. XI. 19, h. Ses
habitans. A»rt de lire dans la main qu’ont inventé les Juifs de
cette ville. Scs révolutions. S.i fliuation. Ibid. ^o. a.
N A P P E , {Linér.) recherches des latinifles fur le nom
latin de nappe , que les uns difenr m.ippa Sc cTaiitrcs mantile.
\ raie fignificution de ces mois. L’ulage étoit que chacun
apportât de chez foi la ferviette dont il te fervoit dans le repas
auquel il étoit invité. XI, 20. a.
Nappe conlacrée, en ufage dans réglife grecque. I. 302. b.
Na p p e , ( Fencrie ) diverlès acceptions de ce mot. Maniéré
de prendre les oifeaux avec les filets, appelles de cc nom.
XL 20. a. Différentes grandeurs des m.aiHes lelon les oifeaux
auxrqucls on fc propofe de clualTer. Ibid. b.
Nappes à prendre des canards, vol, III des pbneh. Chaffe ,
pl. 12.
N ap pe-d ’eau , ( Àrck. Hydr. ) cfpece de cafeade. Quelles
font les plus belles. P,.egles à fuivre dans la conftruflioii de
leur aiciiitcflure. XI. 20. b.
Nappe-d'eau déchirée. IV. 668. a.
N ap pe de boucherie , ( Boiich. ) XI. 20. h.
N A R , {Geogr.) nviere de rümbric. Diverfes obfervations
fur cette riviere 8c fur le nom qu’elle porte. XI. 20. b.
NA R BO N N E , {Géogr. anc. S' mod.) ville de France. Sa
jjoflticn géograpliique. Sa fituation. Porc que forraoir le lac
fur lequel elle efl fitiiée. Province 8c partie de la mer aux-
([iielles Narbonne a donné fon nom. Fondateur de cette ville.
Nom qu’il lui donna. Importance de cette place du tems des
empereurs. Suite des révolutions de Narbonne. Bàcimens antiques
qu’elle renfermoit. XI, 21. a. Infcriptions qu’on y
trouve encore. Comment Bachaumonc 8c Chapelle l’apoflri;-
plient dans le récit de leur voyage. D e l’archevêclié de Narbonne.
Hommes célèbres ou remarquables, foit de l’antiquité
, foit des tems modernes, dont Narbonne efl la patrie.
Le Fabius qu’Horace, dans fa Satyr. I. Lib. 1. marque au
coin des grands parleurs. Montanus de Narbonne. M. Aurelius
Carus. François Bofquet : paffage dans lequel cet auteur
rcconnoît que le faux zaic des moines étoit la premiere caiife
des traditions fabuleufes, qui ont couvert d’obfcurité l’origine
de l’églife gallicane. Reflexion fur la fuppreflion de ce paffage
dans la fécondé édition des oeuvres de ce prélat. Ibid, br
Narbonne. Commerce de Narbonne ancienne. Suppl. IV .
12. a. Chancelier du Souvignier de Narbonne. III. 106. b.
Diverfes obfervations fur les abeilles 8c la récolte du miel
du pays. X. 770. i . — 774. a. Pâturages du diocefe de Narbonne.
X V I . 716. a , b. Manière de gouverner les troupeaux
à laine dans ce pays, yia,- a ,b . — 718. a.
Narbonn e , golj'c de, ( Géogr. ) XL 22. a.
N a r b o n n e , canal d e, {Archu. madtim. ) hifloire de la
conrtruétion de ce canal. Réflexions fur cette emreprife Sc fon
utilité. XI. 22. a.
NARBONNOISE , G.iule y ( Géogr. anc. ) partie de la
Gau le , que les Romains appellcrent province romaine avant
la divifion des Gaules par A.ugnfte. Depuis cette diviflon,
cette province fut appellee Gaule Narbonnoife. Différentes
divifions qui en furent faites dans la fuite. XL 22. h.
Na RSONKOISE , { U ) defeription particulière de cette