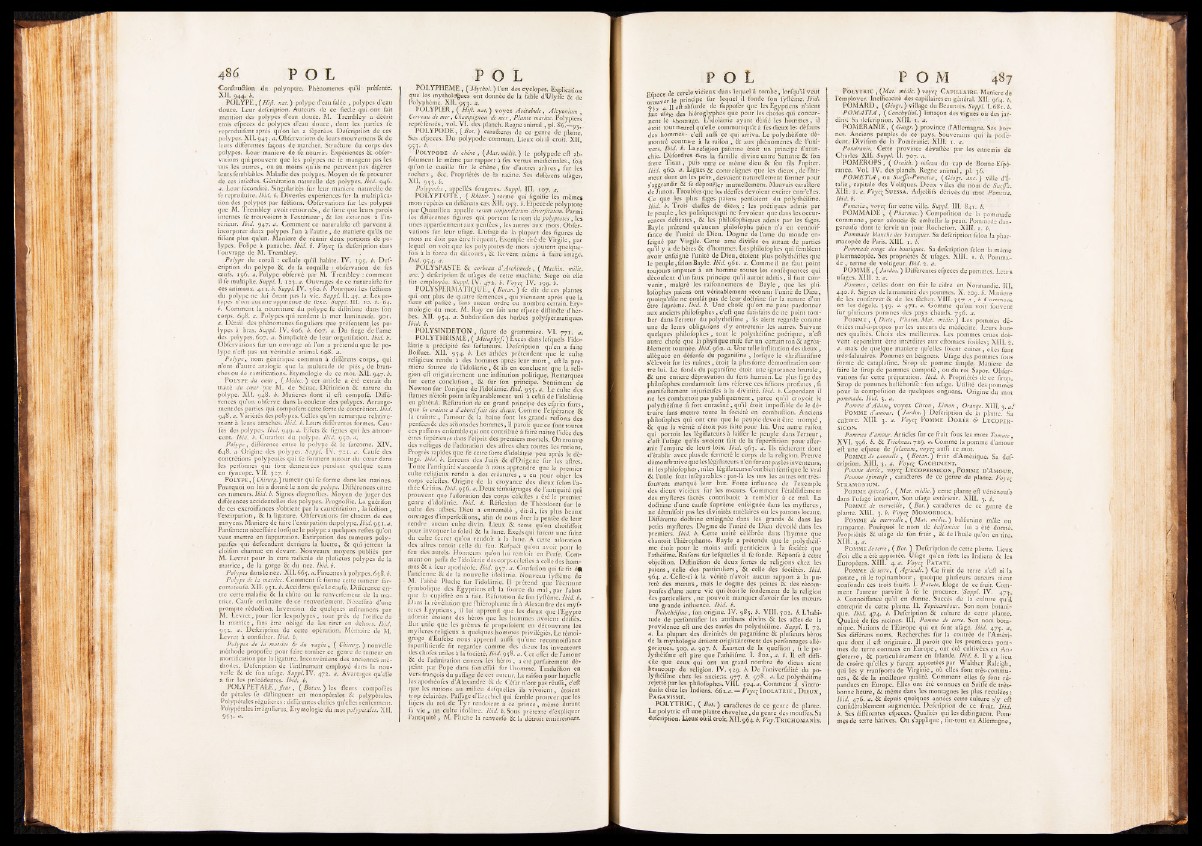
Il 1, ♦
i f f ! "I ' 48 6 P O L P O L
jiff
r- ;!«"
i I
M I i'lii ’
ij!" :l.
'if-l
I < 1 1
Conilruiîlion <lii polyoptrc. Phciiomenes qu'Il préfente.
X ll. 944. b.
P O L Y P E , 'id!. ) polype d'eau falée , polypes d’ eau
douce. Leur defeription. Auteurs dc ce fiecla qui out tait
uieiition des poly])cs d'eau douce. M. Treiubley a décrit
trois efpece.s de polypes d'eau douce, dont les parties fe
reproduifent après qu'on les a féparées, Defeription de ces
polypes. X il. 945. a. Obfervanons de leurs mouvemeus & de
leurs différentes fui^oiis de marcher. Struèhire du corj)S des
polypes. Leur manière de fe nourrir. Expériences &. obfer-
vaiions qui prouvent que les polypes ne le mangent pas les
uns les autres, ou au moins qu’ils ne peuvent pas digérer
leurs foiublables. Maladie des polypes. Moyen de le procurer
de ces infeéfes. Génération naturelle des polypes. Ib'ui. 946.
J. Leur fécondité. Singularités fur leur maniéré naturelle de
fe reproduire. Ibll. b. Diverfes expériences fur la multiplication
des polypes par feéVions. Übfcrvations fur les polypes
qite M. Trciiibley avoir retournés , de forte q\ie leurs parois
internes le tvouvoient à l’extérieur , & les externes à l’intérieur.
Ibid. 947. Comment ce naturalise eS parvenu à
incorporer deux polypes l’un à l’autre, dc manière qu'ils ne
filfciu plus qu’un. Maniéré de réunir deux portions de polypes.
Polipe à panache. Ibid. b. Voyc^ fa defeription dans 1 ouvrage do M. Trembley.
Polype du corail : cellule qu’il habite. IV . 195. b. D e feription
du polype Sc de fa coquille : obfervation do fes
oeufs. 196. U. Polype obfervé par M. Trembley ; comment
il le multiplie. Suppl. I. 1 13. a. Ouvrages de ce naturalise fur
ces animaux. i. b. Suppl. IV . 360. Pourquoi les ferions
du polype ne lui ôtent pas la vie. Suppl. II. 43. a. Les po-
lyj)es n’oiK aucune apparence de fexe. Suppl. III. 10. b. 64.
h. Conimciu la nourriture du polype fe diSribue dans fou
corps. (198. Polypes qui rendent la mer liimineufe. 901.
a. Détail des phénomènes fingiiliers qtie préfentent je s polypes
à bras. Suppl. IV . 606. b. 607. <1. Du fiege de l’ame
des polypes. 607. Simplicité de leur org^;inifation. Ibid. b.
Oblcrvaiions fur un ouvrage oti l’on a prétendu que le polype
n’eS pas un véritable animal. 608. a.
Polype, nom générique commun à diS'érens corps, qui
n’ont d’.autre analogie que la nuiliitude de ])iés, de brandies
ou de rainilications. Etymologie de ce mot. XII. 947. b.
PoLVPH du caur, {Mcdec.) cet article a été extrait du
tr.iité du coeur par M. de Sénac. Définition & nature du
polype. X ll. 948. b. Matières dont U eS compofé. Diftc-
rence.s qu’on obfcrvc dans la couleur des polypes. Arrangement
(les parties qui compofent cette forte de concrétion. Ibid.
948. x2. Variétés (les polypes. Celles qu’on remarque rclativc-
ir.ent à leurs attaches. Ibid. />. Leurs differentes formes. Cau-
fes des polypes. Ibid. 949. j . Effets tk lignes qui les amion-
ceiit. Ibid. b. Curation du polype. Ibid. 930../.
Polype, didérence entre le polype & le farcoine. XIV.
648. ,i Origine des polypes. Suppl. IV. y i i . .i. Caufe des
concrétions polypculès ((ui lé forment autour du coeur dans
les perlonnes qui loot demeurées pend.!ur quelque cenis
eu lyncope. \'JI. 327. b.
PoLYPt, ( C'/u>«rg.) tumeur qui fe forme dans les narines.
Pourquoi on lui a donné le nom de polype. Dilférences entre
ces tumeurs. Ibid. b. Signes diagnoflics. Moyen de juger des
dilférences accidentelles des polypes. Prognofiic. Lu guérifon
de ces excroilTances s’obtient par la cautérifaiion , la feélion ,
l’extirpation, & la ligature, übfcrvations fur chacun de ces
moyens. Maniéré dc faire l’extirpation du polype. Ibid. 9 5 1.
Panfement nccelfairc lorfquc le polype a quelques relies qu’on
veut mettre en fuppuration. Extirpation des tumeurs poly-
peufes qui defeendent derrière la luette, & qui jettent la
clüifon charnue en devant. Nouveaux moyens publiés par
M. Levret pour la cure radicale dc plufieurs polypes de la
matrice, dc la gorge & du nez. Ibid. b.
Polypes dans le nez. XII. 663. «. Pincettes a polypes. Ô38. b.
Polype de l.i matrice. Comment fe forme cette tumeur far-
coin.!ceufe. XII. ij’^i.b. A ccidens qu’elle caufe. Différence entre
cette maladie & la chute ou le renverlémcnt de la matrice.
Caufe ordinaire de ce renverfement. Nécelllté d’uns
jiromiite icduélion. Invention dc quelques inArumens par
M. Le v re t, potir lier les polypes, totit près de l’orifice tic
la matrice , fans être obligé de les tirer en dehors, Ibid.
931. .1. Defeription de ccice opération. Mémoire de M.
Levret à confulter. Ibid. b.
Polypes de Li m.irrice & du vapin , ( C/iiriirp. ) nouvelle
méthode propofée pour faire tomber ce genre de ttuneiir en
mortification par la ligature. Inconvénicns des anciennes nié-
tlindes. Defeription de rinllrument employé dans la nouvelle
6c de fon ufage. Suppl. V I. 472. a. Avam.iges qu’elle
a fur les précédentes. Ibid. b.
POL YPETALR., j?c’Kr, (^Botan.^ les fleurs conipofées
de pétales fe dlflingueiit en mouopétales & pulypétalcs.
Polypétales régulières : (lilférentes clalfes qu’elles renferment.
Polypétales irrégulières. Etymologie du mot polypii.iles. X il.
PO L Y PH EM E , {M yihol.) l’tm dcscyclopes. E.xplicatioii
que les mytholc^ues ont donnée de la fable d’Ulylfe 6c de
Polyphénie. XII. 933. a.
PO L Y P IER , ( Uijl. nul.) voyez Acétabuk, Akyonium ,
Caveau de tuer, Uuimpipnon dc mer, Plante marine. Polypiers
leprefbntés, vol. VI. des planch. Regne animal , pi. 86.— oa
P Ü L Y P O D E , ( 5 (j/. ) caraéferes (le ce genre de plante.
Scs cfpeces. Du polypode commun. Lieux oit il croit. XII.
933. b.
I^OLYPODE de chêne , mèdic.') le polypcdc efl abfolumcnt
le même par rapport à fes vertus médidnales, Ibit
qti’on le cueille ftir le chêne, fur d’autres arbres, fur les
rochers , 6cc. Propriétés dc la racine. Ses différens ufages.
XII. 933. é.
/•’ci/V'y’OiA'5 , aiîpclles fougcies. Suppl. III. 107. a.
P O L Y P T O T E , ( /é/icxer. ) terme qui Agnifle les mêmes
mots répétés en diflerens cas. XII. 933. é. Elpecede polyptote
que Quiutilien appelle rerum conjuniïarum diverJltatemA^armi
les difléremes rigiires qui poriciu le nom d e /.’e/y/ryrrj , les
mies appartiennent .aux pcnlces , les autres aux mots. Obfcr-
vations fur leur ufage. L’ufagé do la plupart des figures de
mots ne doit pas être fréquent. Exemple tiré dc Virgile, p;ir
leqtiel on volt que les polyptotes de mots ajoutent qitelque-
fois à la force dtt diUours, 6c lcrvent même à faire image.
Ibid. 934. a.
POLV SPASTE & corbe,iu d'Archirnede, ( Machin, milit.
nnc. ) defeription 6c iifages de cette machine. Siege où elle
fut employée. Suppl. IV. 472. b. J'oyc? IV. 199. b.
PO L YSPERM .VTIQU E, {B o u n .) fe dit de ces plantes
qui ont plus de quatre lemences, qui viennciu après que la
fleur cfl paflée , fans aucun ordre ou nombre certain. Etymologie
du mot. M, Ray eu l'ait une efpece diflinéle d'herbes.
X ll. 934. a. Subdivifion des herbes polyfpcrmatiqucs.
Ibid. h.
POL Y.SIN DETON , figure do grammaire. V I . 7 7 1 . a,
^ PO L Y TH É ISM E , ( Mêiaphyf. ) Excès dans Icfqucls l’ido-
làtrie a précipité fes léélatcurs. Defeription qu’en a faite
BolTuet. XII. 934. b. Les athées prétendent que le culte
religieux rendu à des hommes après leur m o rt, efl la premiere
foiircc de l'idolâtrie , 6c ils en concluent que la religion
efl originairement une inflitution politique. Remarques
lur cette conclullon , 6c fur fon principe. Sentiment dc
Newton fur l’origine de l’idolâtrie. Ibid. 933. a. Le culte des
ftacues n’étoit point inféparablement uni à celui de l’idolâtrie
en général. Réfutation (le ce grand principe des cfpriis forts,
que la crainte a d'abord fait des dieux. Comme l’efpérance &
la crainte , l'amour 6c la haine font les grands reflbrts des
penfees6c des aélionsdes hommes, il paroic que ce font toutes
CCS pallions enl'emblc qui ont contribué à faire naître l'idée des
êtres l'upéricurs dans l’elprit des premiers mortels. On trouve
des voltiges de l’adoration des aflres diez toutes les nations.
Progrès rapides que fit cette forte d’idolâtrie peu après le déluge.
Ibid. b. Erreurs des Juifs 6c d'Origene fur les aflres.
Toute I’anriquite s’accorde à nous apprendre que le premier
culte religieux rendu à des cré.atures , a eu pour objet les
corps célefles. Origine de la croyance des dieux felon l’a-
tliee Cririus. Ibid. 956. a. D eux témoignages dc l’antiquité qui
prouvent que i’.idoration des corps célefles a été le premier
genre d’idolâcrie. Ibid. b. Réflexion de Theodoret fur le
culte des aflres. Dieu a entremêlé , dit-il, fes plus beaux
ouvrages d’impcrfefHons, afin dc nous ôter la penfee de leur
rendic aucun culte divin. Lieux 6c tems qu'on choililToit
pour invoquer le foleil 6c la lune. Excès qui furent une liiite
du culte leeret qu'on reiuloit à la lime. A cette adoration
des aflres tenoit celle du feu. Refpect qu’ou avoir pour le
feu des autels. Honneurs qu’on lui rendoit en Perfe. Comment
on paffa de ridohiirie des corps célefles à celle des hommes
6c a leur apoiliéofe. Ibid. 9 3 7 - Confufion ({ni fe fit dS
I’anciciiiic 6c de la nouvelle idolâtrie. Nouveau lylléme de
M. labbé Piiichc lur ridolàtrie. II prétend que l’écriture
fymbotiqiie des Egyptiens cfl la l'mirce du ma! , par l’abus
que la cupidité eu a fait. Réfutation de Ibn fyllème./Ni/, é.
Dans la révélation que l’hiérophante fit à Alexandre des myf-
tercs Egyptiens, il lui apprend que les dieux que l’Egypte
adoroïc étoient des héros que les hommes avoient déifiés.
But utile que les prêtres fe propolbicnc en découvrant les
myfleres religieux à quelques hommes privilégiés. Le témoi-
gnage cl’Eufcbe nous apprend aulii qu’une reconnoilîancc
liiperflitieufe fit regarder comme des dieux les Inventeurs
des choies utiles à là fociété. Ibtd. 938. a. Cet elTet dc l’amour
&_dc l’admiration envers les héros, a été parfaitement dépeint
par Pope dans fon ciTai fur 1 homme. Traduélion eu
versfrançois du paRage de cct auteur, La raifon pour laquelle
les apothéofes d’Alexandre 6c de Ccf.ir n’ont pas reufll, c’efl
que les nations au milieu del'quelles ils v iv o icm , étoient
trop éclairées. PalTage d’Ezechiel qui fembie prouver que les
fujets du roi dc T y r reiulolcnt à ce prince, même durant
fa vie , un culte idolâtre. Ibid. b. Sous prétexte d'expliquer
l’antiquité , M. Pludie la renverfe 6c la détruit eutiércmertt.
P O L
F fo ’ ce de cercle v icieux dans Ictpicl il tombe, lorfqti’il veut
orouver le principe fur lequel il fonde fon fyllcmc. Ibid. 93> A II efl abfurde de fuppofer que les Egyptiens n’aient
fait ulafg des liiéroglyphes que pour les choies qui concernent
le Kbourage. L’idolâtrie ayant déifié les hommes, il
étoic tout n>tnrel qu’elle communiquât à fes d ieux les défauts
des liomines • c’efl aufli ce qui arriva. Le polythéifme démontré
contrai-e à la raifon , 8c aux phénomènes de l’univers.
Ibid. b. La religion païenne étoit un principe d'anarchie.
Défordres d.ns la famille divine entre Saturne 6c fon
frere T itan , puis mtre ce même dieu 6c fon fils Jupiter.
Ibid. 960. a. Ligues & comretigues que les dieux , de l’hu-
ineur dont on les peim, dévoient naturellement former pour
s’aggrandir 6c fe dépou^ler imuiiellemcnt. Mauvais caraélere
de Junon. Troubles que Im déelTes dévoient exciter cntr’elles.
Ce que les plus fages païens penfoient du polytliéifinc.
}bid. b. Trois clafles de dieox, : les poétiques admis par
le peuple , les politiques qui ne fcrvoieiu que dans les occurrences
délic.atcs, 8c les philofophiqxies admis par les fages.
Bayle prétend qu'aucun philofophe pa'ïen n'a eu connoif-
fance de l’iinlté de Dieu. Dogme do l’ame du monde en-
feigné par Virgile. Cette aine divifée en autant de parties
qu’il y a de bêtes Sc d’hommes. Les pliilofoplics qui femblent
avoir enfeigné l’imité de Dieu, étoient plus polytliéifles que
le peuple, félon Bayle./N/. 961. A.C omm cil ne faut point
toujours imputer à un homme toutes les conféquences qui
découlent d’un faux principe qu’il auroit admis, il faut convenir
, malgré les raiConnemens dc B a y le , que les piii-
lolbphes païens ont véritablement reconnu l’imité de Dieu ,
quoiqu’elle ne coulât pas dc leur doflrine fur la nature d’un
être fupréme. Ibid. b. Une chofe qu’on ne peut pardonner
aux anciens philofophes, c’efl que fatisfaiis dc ne point tomber
d.ms l’erreur du polythéifme , ils aient regardé comme
une de leurs obligafions d’y entretenir les autres. Suivant
quelques pliilofophes , tout le polytliéifme poétique, n’efl
autre chofe que la phyfique mile fur un certain ton 6c agréablement
tournée. Ibid. Cj(>z. a. Une telle inflitution des d ieux,
alléguée en défenfe du paganifme , lorfque le chriflianifinc
s’élevoit fur fes ruines , étoit la plus forte démonflraticn contre
lui. Le fonds du paganifme ctoir une ignorance brutale,
& une entière dépravation du feus humain. Le plus fage des
philofophes condaninoit fans réferve ces fiftions profanes , fi
iiianifeuemenc itqurieufes à la divinité. 7N/. é. Cc‘pcmlant il
ne les combattoit pas publiquement, parce qu'il croyoit le
polythéifme li fort enraciné, qu’il étoit impolTiblc dc le détruire
fans mettre toute la fociété en combiiflion. Anciens
philofophes qui ont cru que le peuple clevoit être trompé,
6c que la vérité n’éioit pas faite pour lui. Une autre raifon
qui portoic les légiflatcurs h laifler le peuple dans l’erreur,
c ’eft l’ufage qu’ils avoient lait dc la fuperflition pour aft'er-
aiiir l’empire de leurs loix. Ibid. 963. a. Ils ràcliercnt donc
d’établir avec plus de fermeté le corps dc la religion. Preuve
démoiiflrativequeleslégiflaccurs n’en furent pas les inventeurs,
ni les philofophes, ni les légillntairs n’ont bien l'cnti que le vr.ii
& l’iiiile font inféparables : pai -lâ les mis les autres ont très-
fouvenc manqué leur but. Forte influence de l’exemple
des dieux vicieux fur les moeurs- Comment l’établilTcnicnt
des myfleres facrés contribiioit à remédier à ce mal. La
doéirine d’une caufe fupréme enfeignée dans les my fleres,
ne détruifoit pas les divinités tutélaires ou les patrons locaux.
Différente doêlrine enfeignée dans les graïuJs 6c dans les
petits myfleres. Dogme de l’unité de Dieu dévoilé dans les
premiers. Ibid. h. Cette unité célébrée dans riiymne que
cliaiuoit l’hiérophante. Bayle a prétendu que le polytliéif-
me étoit pour le moins aiiffi pernicieux à la fociété que
l’athéifme. Raifons fur lefquelles il fe fonde. Réponfc à cette
objeftion. Diflinélion de deux fortes de religions chez les
païens, celle des particuliers, ' 6c celle des fociétés. Ibid.
964. a. Celle-ci à la vérité n’avoit aucun rapport à la pureté
des moeurs, mais le dogme des peines 6c des récom-
penles d’une autre vie qui étoit le fondement de la religion
des particuliers , ne pouvoir manquer d’avoir fur les moeurs
une grande influence. Ibid. b.
Polythéifme, fon origine. IV . 983. b. VIII. 302. E L'habitude
de perfonnificr les attributs divins 6c les aéles de la
providence efl une des caufes du polythéifme. Suppl. I. 72.
a. La plupart des divinités du paganifme 6c plufieurs héros
de la mythologie étoient originairement des perfonnages allégoriques.
300. a. 307. b. Examen de la queflion , Il le polythéifme
efl pire que l’athéifme. I. 8 0 1, a. b. Il efl dilH-
cile que ceux qui ont un grand nombre de dieux aient
beaucoup de religion. IV . 329. />. D e l’iiniverfalité du polythéifme
chez les ancie.ns. 977. b. 978. <7. Le polythéifme
rejetté par les philofophes. V i l l . 304. u. Comment II s'intro-
duilit chez les Indiens. SSz.a. — Voyet^ Id olatril' , D ieux
Pa g a n is .me.
P O L Y T R IC , ( Bot.") caméleres de ce genre de plante.
Le pi^lytric efl une plante chevelue , du genre des moufles. Sa
defeription. Lieux où il croît. X il, 964. b. /^oy.TuiCHOiMANÈs,
P O M 4 8 7
POLYIIUC , (Mat. tnèdic. ) voyci C apiu.aire. Manière de
l'employer. Ineificacité des capillaires en général. X ll. 964. b.
P ( )M A R D , (G/üg’r. ) village du Beaunois. I .6 8 i.é .
P OM A T IA , ( Canchyliol.) limaçon des vignes ou des jardins.
Sa defeription. XUI. i . a.
POM ÉR AN IE , ( Gêogr. ) province d’Allemagne. Scs bor*-
nos. Anciens peuples de ce pays. Souverains qui la polfe-
dent. Divifton de la Poméranie. XIII. i . a.
Poméranie. Cette province dévaflée par les ennemis de
Charles X ll. Suppl. 11. 707. .2.
POM E R O P S , ( Or/u'té. ) olfeaii du cap de Bonne-Efpé-
rance. Vol. IV . des planch. Régné animal, pl. 36.
POM E T IA , ou Suejfii-Pornctta, (Grog/', anc.) ville d’Italie,
capitale des Voliques. Deux villes du nom de Sue[fd.
X l l i . I. a. SUESSA. Adjeftifs dérivés du mot Pometia.
Ibid. b.
Pometia, voyei fur cette ville. Suppl. III. S41. b.
P OM M A D É , {Phannac.') Conipofition de l,i pommade
commune, pour adoucir 6c embellir la peau. Pomm.ide dan-
gereufe dont fe fervit un jour Rocheforr. XIII. i. b.
Pommade blanche des boutiques. Sa defeription félon la uliar-
maco[)éede Paris. X lll. i. b.
Pommade rouj'e des boutiques. Sa defeription felon la même
pharmacopée. Ses propriétés 8c ufages. XUI. t. b. Pommade
, terme dc voltigeur. Ibid. 2. a.
POM.ME, ( Jardin, ) Difléreiite.s efpcccs dc pommes. Lcuis
ufage.s. XIII. 2. a.
Pommes, celles dont on fait le cidre en Normamlie. III.
440. N Signes de la maturité des pommes. X. 209./. Maniéré
de les coiil'erver 8c de les fécher. VKI. 337. « , b. C,omnicnt
on les dégele. 339. a. 471. a. Gomme qu’oii voit fouvent
lur plufieurs pommes des pays chauds. 736. a.
Pomme, {^Diete, Pharm. M.tt. médic.) Les pommes décriées
mal-a-propos par les auteurs dc médecine. Leurs bonnes
qualités. Choix des meilleures. Les pommes crues doivent
cependant être interdites aux eflomacs foibles; XUI. 2.
a. mais de quelque manière qu’elles ibient cuites , elles Ibnt
très-l'alutaircs. Pommes en beignets. Uihge des ponimcs Ions
forme dc cataplafme. Sirop de pomme liniple. Manière dc
faire le firop de jiommes comjioi'é , ou du roi Sapor. Obfcr-
vations fur cette préparation. Ibid. b. Propriétés de ce llro').
Sirop dc pommes hcUéborife : fon ufage. Utilité des pommes
pour la compoficion de quelques onguens. Origine du mot
pommade. Ibid. 3. a.
Pomme d’Ad.vn, voye?. Citron, Limon , O/awge. XIIî, 3. .j,'
Pomme d'.imour. ( Jardin. ) Defeription de la plante. Sa
culture. XIII. 3. a. Voyc:^ PoMME OORÉE & Ly COPER-
SICON.
Pommes d'amour. Articles fur ce fruit fous les mots Tomate .
X V I . 396. b. 6c Triclintis. 729. a. Comme la pomme d’amour
efl une efpece de folanum,voyc^:i\.\ff\ ce mot.
de cannelle , {Botan.) fruit d’Amérique. Sa defeription.
XIII. 3. Poye^ CaCHIMENT.
Pomme dorée, voyei^ L ycopersiCON, Pom.vje d’Amour.
Pomme epineufe , Carafleres de ce genre de pflinre. Voye^
Stramonium.
Pomme epineufe, ( M.:i. médic. ) cette plante efl venéneufe
dans l’ufage intérieur. Son ufage extérieur. XIII. 3. b.
PoM.ME de merveille, {^Boi.) caraéteres de ce genre de
plante. XUI. 3. b. Foye^ MomordiCA.
Pomme de merveille, (M.rf. médic.) balfainlne mâle ou
rnmpante. Pourquoi le nom de b.ilfamine lui a été donné»
Propriétés 6c ufage dc fon fru it , éi. de l'huile qu’ou en tire.
XIII. 4.
Pomme de terre, ( Bot. ) Defeription de cette plante. Lieux
d'oîi elle a été apportée. Ufage qu’en font les Indiens 6c les
Européens. XIII. 4. n. Voye^ Patate.
Pomme de terre, ( Agrieuh. ) Ce fruit de terre n’efl ni la
patate, ni le topinambour, quoique plufieurs auteurs aient
confondu ces trois fruits. I- Pai.itc, Eloge de ce fruit. Comment
rameur parvint à fe le procurer. [Suppl. IV, 473,
b. Connoiflânee qu’il en donne. Succès dc la culture qu'il
entreprit de cette plante. II. Topinambour. Son nom botanique.
Ibid. 474. b. Defeription 6c culture dc cette plante.
Qualité de fes racines. III. Pomme de terre. Son nom botanique.
Nations de l’Europe qui en font uflige. Ibid. 473.
Ses différens noms. Recherches fur la contrée de l’Amérique
dont il eft originaire. Il paroit que les premieres pommes
de terre connues en Europe, ont été cultivées en A ngleterre,
6c particuliérement en Irlande. Ibid. b. Il y n lien
de croire qu'elles y furent apportées par 'V 'althcr Raleigh,
qui les y rranfporta de Virginie, où elles font très-communes,
ôc dc la meilleure qualité. Comment elles fc font ré-
p.in(lues en Europe. Elles ont été connues en Suiffe de très-
bonne heure, 6c même dans les montagnes les plus reculées :
Ibid. 4j 6. a. 6c depuis quelques années cette culture s’y cfl
confidérablement augmentée. Defeription dc ce fruit. Ibid,
b. Ses différentes cfpeces. Qu.alités qui les diflinguent. Pommes
de terre lûtivcs. Ou s’applique, fur-tout en Allemagne,
1 i‘