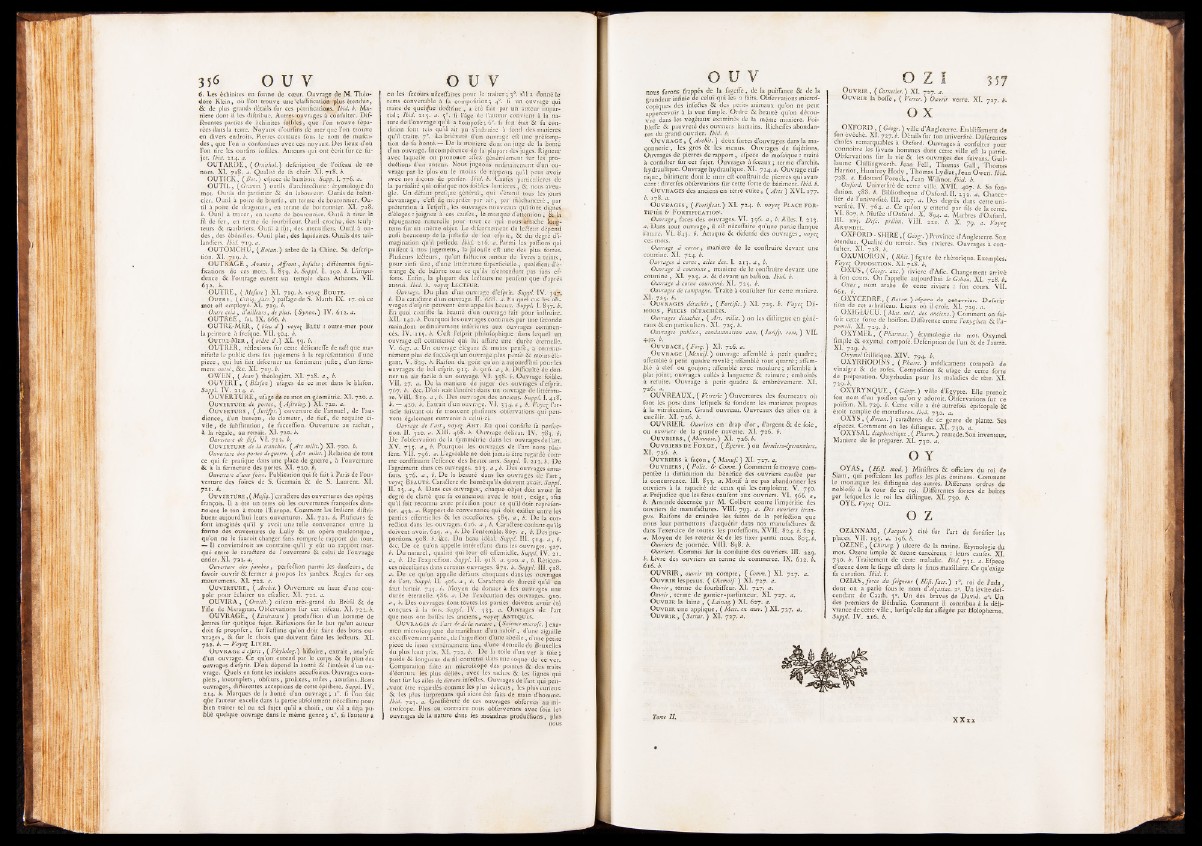
, > n r ^ i..
'■ il
' 1 3 1 ' :(1 '.I ! ! i
ft ‘ I
356 O U V
6. Les éehinifcs en forme de coeur. Ouvrage de M. Théodore
Klein, où l'on trouve une clairitication plus étendue,
8c de plus grands détails fur ces pctrifie.itioiis. i. Manière
dont il les diftrii'uo. Autres ouvrages à confiiltcr. Dit-
fèrentes parties de cchinites folfiles, que l’on trouve réparées
dans la terre. Noyaux cl’ourfins de nier que l’on trouve
en divers endroits. Pierres connues fous le nom de mufc.i-
d e s , que l’on a confondues avec ces noyaux. Des lieux d’où
l'on tire les ourfins l'olliics. Auteurs qui ont écrit fur ce fu-
|et. //’Jii. 214.
O U T A R D E , {Oni'ahoi.) defcrlption de l’oifeau de ce
nom. XL 718. Qualité de fa chair, XL 718. b.
O U T IC K , ( Ooi. ) efpccc de bambou. Supp. l. 776. *2.
O U T IL , {Oi,imm.) outils d’archiieéiure ; étymologie du
mot. Outils du jarejinier & du laboineur. Outils de balancier.
Outil à poire de bourfe, en terme de boutonnier. O util
à poire de dragonne, en terme de botitonmer, XI. 718.
b. Outil à tracer, eu terme de boutonnier. Outil à tirer le
fil de fe r , eu terme de fourbilTeur. Outil crochu,des Iculp-
teurs & marbriers. Outil à fût, des mcmiifiers. Outil à ondes
, des ébenides. Outil plat , des lapidaires. Outils des taillandiers.
Ibid. 719. J.
O U TOM CH U , {Bocjn.) arbre de la Chine. Sa deferip-
tion. XL 719. b.
O U T R A G E , j4vjn k , Jffront, Infultc ; différentes figiii-
ficrttions de ces inotâ. I. S59. b. Suppl. I. 190. b. L'impudence
5 c l’oinrage eurent un temple dans Athènes. VIL
632. b.
O U T R E , i^Mcfurc) XI. 719. b. voyrç BoUTE.
O utre , ( Cnuq. Jiicr. ) padage de S. Macth. IX. 17. où ce
mot ed einployé. XI. 719. b.
Outre cch , d'dUUurj, de plus. (Sy/ie/?.) IV. 612. J.
OUTRÉE , loi. IX. 666. b.
OUTRE-MER, {^bUu d") voyrç Bleu : outre-mer pour
la peinture à frefque. V i l . 304. b.
O ü TRE-Me r , {ordre d'.) XL 39. b.
O U T R ER , reflexions fur cette dclicatc/Te de taél que ma-
nifede le public dans fes jugemens à la repréfentation d’une
piece , qui lui fait difeerner un Icntimcn: ju lle , d’un fenti-
meiu outré, &c. XL 719. b.
Ow e n , {Jear.) théologien. XI. 728. a , b.
O U V E R T , {BLtfon) ufages de ce mot dans le blafon.
Suppl. iV . 214. J.
Ô U V E R TU R E , ufage de ce mot en géométrie. X L 720. a.
O uverture de portes, {Ajlrolog.) XL 720. a.
O uverture, {Juri/pr.) ouverture de l'annuel, de l’audience,
d'un bureau, de clameur, de fief, de requête civ
i le , de fubltitution, de fuccelTion. Ouverture au rachat,
à la régale, au retrait. XL 720. b.
Ouve>iii’e de f.ef. VI. 712. b.
O uverture de U tr,mchée. {A n mi/it.) XL 720. b.
Ouverture des portes de guerre. ( A n ritilii. ) Relation de tout
ce qui fe pratique dans une place de guerre, à l’ouverture
Ôc à la fermeture des portes. XI. 720. b.
Oiivenu'C d'une foire. Publication qui fe fait .à Paris de l'ou-
vertore des foires de S. Germain 6c de S. Laurent. XI.
721. b.
Ouverture , ( Mufq. ) caraélerc des ouvertures des opéras
françois. Il a été un ceins où les ouvertures françoil'es don-
noieiit le ton à route l’Europe, Cooiment les Italiens diftri-
buent aujourd’hui leurs ouvertures. XI. 721. b. Piuiieurs fe
font imaginés qu’il y avoit une telle convenance entre la
forme des ouvertures de Lutly 8c un opéra quelconque,
qu’on ne le fauroit changer fans rompre le rapport du tour.
— Il conviendroit au contraire qu’il y eût un rapport marqué
entre le caraélere de l’ouverture 8c celui de l'ouvrage
entier. XL 722. a.
Ouverture des jambes, perfeélion parmi les danfeurs, de
favoir ouvrir & fermer à propos les jambes. Regies fur ces
mouvemens. X L 722. a.
O uverture, {A rchit.) Ouverture au haut d’une coupole
pour éclairer un efcalier. XI. 722. a.
O U V IR A , {Orriith.) oifcau très-grand du Brcfil 8c de
rule de Maragnan. Oblervations fur cet oifcau. XL 722.
O U V R A G E , ( Littérature ) prodiiélion d’im homme de
Retires fur quelque fujet. Réflexions fur le but qu’un auteur
doit fe propofer, fur l’cllime qu’on doit faire des bons ouvrages
, 5 c fur le choix que doivent faire les Icéleurs. XI.
722. b. — Voye^ Livre.
Ouvrage a ejprit, ( Phylolog.') liiftoire , extrait , analyfe
d’un ouvrage. C e qu’on enrend par le corps Sc le plan ties
ouvrages d’cfprit. D ’où dépend la bouté 6c l’intérêt d’un ouvrage.
Quels en font les incidens acceflolres. Ouvrages complets
, incomplets, obfcurs, prolixes, utiles , amufans.Bons
ouvrages, diftérentes acceptions de cette épiibcte. Suppl. IV.
2t4. b. Marques de la bonté d’un ouvrage; l'L fi l'on fait
que l’auteur excelle dans la partie abfolument nécclfaire pour
bien traiter tel ou tel fujet qu’il a clioifi , ou s’il a déjà pu-
bbé quelque ouvrage dans le même genre; 2“. fi l’auteur a
O U V
eu les fccours nécefl’aires pour le traiter; 3“. s’il a donné le
teins convenable à fa compofition; 4” . li un ouvrage qui
traite de queit^ie doéirine , a été f.iit par un auteur im()ar-
tial ; Ibid. 215. a. 3". fi l'âgo do rauccur convi;.nr à la nature
de l’ouvrage qu’il a Compofé ; 6”. li fen état & fa condition
Ibnt tels <|u'il ait pu s'inflruiie à fond des matières
qu’il traite. 7 “. La brièveté d'un ouvrage ell une jiréfomp-
tion de la bonté.— De la manière dont on juge de la bonté
d’im ouvrage. Incompétence de la plupart des juges. Rigueur
avec laquelle on proiioace alfcz générnIemeiK lur les pro-
duflions d'un auteur. Nous jugeons ordinairement d’un ouvrage
par le plus ou le moins cio rapports qu’il peut avoir
arec nos façons de penier. Ibid. b. Caufes particulières de
la partialité <[ui ofiiitqiie nos foibles lumières , 8c nous aveugle.
Un défaut prefque général, qui s’éccnci tous les jours
davantage, c’eft de nuprifcr par a ir , par méchanceté , par
piétention à l’elprit, les ouvrages nouveaux qui font dignes
d'cloges : joignez à ces caufes , ic manque d'attention , & la
répugnance naturelle pour tout ce qui nous attache long-
tcms fur un même objet. Le elilecrncmcnt du loéleur dépend
aulfi beaucoup d e là julicfle de fon cl'piic, 8c du degré d’imagination
qu'il polTede. Ibid. 216. u. Farmi les palfions qui
nuifein à nos jugemens, la jaloufie cll une des plus fortes.
Pluficurs lecteurs, qu’un talhicux amour do livres a teints,
pour aiiifi dire, d'une littérature fuperficieilc , qualifiem-d’étrange
5 c de bü'arre tout ce qu’ils n’entcndcnt pas fans efforts.
Enfin, La plupart des leéteurs ne penllnt que d’apiès
autrui. Ibid. b. voye^ Lecteur,
Ü/;v;v7^v. Du plan d’uii ouvrage d'efpiit. Suppl. IV. 397,
b. Du caraétere d’un ouvrage. IL 668. a. En quel cas les ouvrages
d'efpiit peuvent êite appelles beaux. Suppl. I. 837. b.
En quoi conliile la beauté d’un ouvrage fait pour infiruire.
X ll. 142. b. Pourquoi les ouvrages continués par une fécondé
main .font ordinairemenc inférieurs aux ouvrages commences.
IV. 115. b. C ’efI l'ofprit philofopbiqne dans lequel u-n
ouvrage efi commencé qui lui affiirc une durée éternelle.
V. 647. a. Un ouvrage élégant 6c moins penfé, a coniniu-
nément plus de luccès qu'un ouvrage plus pcnlé & moins élégant.
V . 829. /'. Rait'oii du goût qu'on a aujourd'hui pour les
ouvrages de bel cl'prir. 915. b. 916. a , b. Diliiculté de donner
un air facile à un ouvrage. VI. 338. b. Ouvrage foible.
V IL 27. ri. De la maniéré de juger des ouvrages d’efprir.
767. b. 8cc. D'où naît l’intérêt dans un ouvrage de littérature.
V i l l , 819. U, Des ouvrages des anciens. Suppl. I. 418.
h. — 420. b. Extrait d'un ouvrage. Vf. 334. « , b. Foye^ l’article
fuivant où le trouvent plnfieurs oblervations qui peuvent
également convenir à celui-ci.
Ouvrage de L'art, voycç A k t . En quoi confifie fa perfection.
IL 320. a. X llI . 46b'. b. Ouvrage délicat. IV. 783. h.
D e l’obfervation d e là (ymmétrie clans les ouvrages de l ’art.
XV . 735. a , b. Pourquoi les ouvrages de l’art nous plai-
fent. VIL 796. a. L’agréable ne doit jamais être regardé comme
confiituant l'efience des beaux arts. Suppl. I. 23 2. é. De
l’agrément dans ces ouvrages. 213. a ,h . Des ouvrages amu-
fans. 376. a , b. D e la beauté dans les ouvrages de l’a r t ,
voye^ Beauté. Caraélere de bonté qu’ils doivent avoir. Suppl.
IL 13. a, b. Dans ces ouvrages, chaque objet doit avoir le
degré de clarté que fa connexion avec le to u t , e xige , afin
qu’il foit reconnu avec précifion pour ce qu’il doit repréfen-
ter. 432, a. Rapport de convenance qui doit exiller entre les
parties efientieiles & les accefibires. 583. <2, b. De la cor-
reélion dans les ouvrages. 616. a , b. Caraélerc coulant qu’ils
doivent avoir. 629. a , b. D e renlcmblc. 807. a, b. Des proportions.
908. b. Sec. Du beau idéal. Suppl. Ill, 314. . j , b.
6cc. De ce qu'on appelle intérclTunc dans les ouvrages. 327.
b. Du naturel, qualité qui leur efl eircmldle. Suppl, IV. 21.
a, b. De l’expreliioii. Suppl. IL 918. 920. u , b. Réticences
néceifaires dans certains ouvrages. 871. b. Suppl. III. 318.
a. De ce qu'on appelle défauts choquaiis dans les ouvrages
de l'art. .‘>uppl. II. 406. a , b. Caraétere de dureté qu’il en
faut bannir. 743. b. Moyen de donner à l'es ouvrages une
durée éternelle. 386. a. De rexécution des ouvrages. 910.
a , b. Des ouvrages dont toutes les parties doivent avoir été
conçues à la lois. Suppl. IV. 333. a. Ouvrages do l’art
que nous ont laiffos les anciens, voy<^ A ntiques.
O u v r a ge s Je l'an fie delà nature , microfe. ) examen
miciolcopiquc du tranchant d’ un rafoir , d’une aiguille
exc-.lfivemem petite, de l'aiguillon d’une abeille , d'une petite
piece de linon cxiréuiement hn, d’une dentelle de Bruxelles
du plus haut prix. XL 722. b. D e la toile d’un ver à Ibie ;
poids 8c longueur du fil contenu d.ms imc toque do ce ver.
Comparailon faite au microfeope des pointes & des traits
d’écriture les plus déliés, avec les taches 5 t les lignes qui
font fur les ailes de divers infeftes. Ouvrages de l’art qui peii-
.v c iit être regardés comme les plus délicats, les plus curieux
& les plus furprenans qui aient été faits de main d’homme.
Ibid. 723. a. Grofliéreté de ces ouvrages obfcrvés au mi-
crolcope. Plus au contraire nous obfervcrons avec foin les
ouvrages de la nature dans lès moindres produétions, plus
uid
O U V
nous ferons frappés de la fagclTe, de la puilfance & de I.a
grandeur infinie de celui qui les a. faits. Obfei vations microf-
copiques des infeéles 5 c des petits animaux qu'on ne peut
appercevoir à la vue fimplc. Ordre 5 c beauté qu’on découv
re dans les végétaux examinés de ta même maniéré. Foi-
bielTe 8c pauvreté des ouvriers humains. Riclielîes abondantes
du grand ouvrier. Ibid. b.
O uvrage , ( Archit. ) deux fortes d’ouvrages d.ms la maçonnerie
, les gros 5 c les menus. Ouvrages de l'ujétions.
Ouvrages de pierres de rapport, cfpece de mofatquc : tr.iité
à confuher fur cet fujet. Ouvrages à fceaux ; ternie d’archit.
Jiydraulique. Ouvrage hydraulique. XL 724. a. Ouvrage ruf-
tique, bâtiment dont le mur ell conftruit de pierres qui avancent
: cliverfes obfervations fur cette forte de bàtlincnt. Ib'td. b.
O uvrages des anciens en terre cu ite , ( Arts ) X V I. 177.
b. 178. a.
O uvrages, {Fortifiait.') XI. 724. b. voye^ Place fortifiée
6» Fortification.
Ouvrage, faces des ouvrages. V I. 336. a , b. Ailes. L 213.
a. 'Dans tout ouvrage, il ell nécelTalre qu’une partie flanque
faiure. VI. S43. b. Attaque 5 c défenle des ouvrages, voye{
ces mots.
Ouvrage corne, maniéré de le confiruirc devant une
courtine. XI. 724. b.
Ouvrages a corne, a'iles des. I. 213. ii , é.
Ouvrage à couronne, maniéré de le confiruire devant une
courtine, XI. 723. a. 8c devant un bafiion. Ib'td. b.
Ouvrage à corne couronné. XI. 723. b.
Ouvrages de campagne. Traité à confulcer fur cette matière.
XI. 723. b.
O uvrages détachés, {Fortifie.) XI. 723. b, f'oyc:j_ Dehors
, Pieces détachées.
Ouvrages détachés, ( Art. mtl'it. ) on les difiinguc en généraux
Sc en particuliers. X L 723. b.
Ouvrages publics, condamnation aux. {Jiir'ifp. rom.) VU.
440. b.
O uvrage, {Forg.) X L 726. a.
O uvrage {Menu'tJ.) ouvrage afiemblé à petit quadre;
allcmblé à petit quadre ravalé ; alTeiublé tout quarré ; .'iircm-
blé à clef ou goujon; nlTemblé avec mouline; alfcmblé à
plat joint; ouvrages collés à languette 5 c rainure; emboîtés
à reliiite. Ouvrage à petit quadre 5 c embrèvement. XI.
726. a.
O U V R E A U X , ( P'errerie ) Ouvertures des fourneaux où
font les pots dans icfquels fe fondent les matières propres
à la vitrification. Grand ouvreau. Ouvreaux des ailes ou à
cueillir. XL 726. b.
OUVRIER. Ouvriers en drap d’o r , d’argent Sc de fo ie ,
ou ouvriers de la grande navette. XL 726. b.
O uvriers, (A/yn/;oie.) XL 726.é.
O uvriers DE Forge, {Eperon.) o u lormicrs-éperonnicrs.
X I. 726. b.
O uvriers à façon , ( M.muf. ) XT. 727. a.
O uvriers , ( Polu. & Comm. ) Comment fe trouve com-
penlée la diminution du bénéfice des ouvriers caiifée par
la concurrence. III. 833. a. Motif à ne pas abandonner les
ouvriers à la rapacité de ceux qui les emploient. V . 730.
a. Préjudice que les fêtes caufent aux ouvriers. V I . 366. a,
h. Amende décernée par M. Colbert contre l’iraperirie des
ouvriers de manufaélures. VIII. 793. a. Des ouvriers étrangers.
Raifons de craindre les fuites de la perfeiflion que
nous leur permettons d’acquérir dans nos manufaiTures Sc
dans l'exercice de toutes les profdfions. X V II . 804. k. 803.
a. Moyen de les retenir 8c de les fixer parmi nous. 803. b.
Ouvriers de journée. VIII. 898. b.
Ouvriers. Commis fur la conduite des ouvriers. III. 229.
b. Livre des ouvriers en terme de commerce. IX. 612. b.
é i6 . b.
O U V R IR , ouvrir un compte, {Comm.) XI. 727. a.
O uvrir iespeaux. ( Chamo'if) XL 727. a.
Ouvrir, terme de fourbilTeur. XI. 727. a.
Ouvrir, terme de gantier-parfumeur. XI. 727. a.
O uvrir la laine , {Lainag.) XL 627. a.
O uvrir une applique, {Mett. en ceuv. ) XI. 727. a.
O u v r ir , {Serrur.) XI. 727.*!.
O Z î 3 5 7
O u v r ir , {Cornci'ur.) XI. 727. u.
O u v r ir la bolTe, ( Ferrer. ) Ouvrir verre. XL 727. è.
O X
O X FO RD ( Géogr. ) ville d’Angleterre. Etablifi’cment d«
Ion cveche. XI. 727. b. Détails fur Ion univerlité. Différentes
chofes_ remarquables à Oxford. Ouvrages à confiiltcr pour
connaître les lavans hommes dont cette ville ell la patrie.
Obfervations lur la vie 5 c les ouvrages des fuivans. Guillaume
Qiillingw-crth. Jean F e ll, Thomas G a ll, Thomas
Harriot, Humfrey H o d y , Thomas Lydiat, Jean Owen. Ibid.
728. a. Edouard Pocock, Jean Wilmot. Ibid. b.
Oxford. Uiiiverfité de cette ville. XVII . 407. b. Sa fondation.
388. b. Bibliothèque d'O xford. IL 232. a. Cliance-
107- Des degrés dans cette uiii-
yerlite. IV . 764. Ce qu’on y entend par fils de la terre.
V L 807. b. Mufée d’Oxford. X. 894. a. Marbres d’Oxford.
III. xvj. Difc. prélirn. VIII. 221. b. X. 79. a. Voyez
A rundel. ^ ^
^ O X FO RD - SHIRE , ( Géogr. ) P rovince d’Angleterre. Son
étendue. Qualité du terroir. Ses rivieres. Ouvrages à con-
lulter. XL 728. b. ^
O X U MORON ', ) figure de rhétorique. Exemples. Voyei O p po s itio n . XI. 728. b.
^ O X Ü S , {Géogr. anc.) riviere d’Afie. Changement arrivé
a fon cours. On l’appelle aujourd’hui le Gihou. XL 728. b.
O xus, nom arabe de cette rivière : fon cours. V IL
661. b.
O XY CED RE j_(.5 orj/t.) efpece de genévrier. Deferip-
tion tic cet aibriiîeau. Lieux oit il croît. XI. 729. a.
Ö XIG LUCU. ( Mat. méJ. des anciens.) Comment on fai-
füic cette forte de boifl’on. Différence entre i'oxyglucu Sc l’.i- poméli. XL 729. b.
O XYM F .L , {P!:arm.tc.) étymologie du inot. O xymel
fimple 5 c oxyinei compofé. Defeription de l'un 6c de l’autre-
XI 729. b.
Oxymel fciliitiqiie. X IV . 794. b.
_ ^;^ YRH0 DINS , {Pharm .) médicament compofé de
vinaigre 5 c de rofes. Compofition 6c ufage de cette forte
de préparation. Oxyrhodin pour les maladies de tête. X L
729. L
O X Y R 'YN Q U E , {Géogr.) ville d’Egypte. Elle prenolt
fon nom d’iiii poilTon qu’on y adoroit. Obfervations fur ce
poiffon. XL 729. b. Cette ville a été autrefois épifcopale Sc
étoit remplie de monafieres. Ib'td. 730. a.
O X Y S , {Botan.) caraélercs de ce genre de plante. Ses
efpcces. Comment on les difiingue. XL 730. a.
O X Y SA L d'iaphorciique , ( Pharm. ) remede. Son inventeur.
Maniéré de le préparer. XI, 730. a.
O Y
O Y A S , {Hifi. m od.) Minifircs 8c officiers du roi de
Siam, qui poffedent les pofics les plus éminens. Comment
le mon.trque les diffingiie des autres. Différens ordres de
nobleiîc à la cour de ce roi. Diflérentes fortes de boîtes
par lefquelles le roi les difiingue. XI. 720. b.
O YE . O ie. O Z
O Z AN N AM , {Jacques) cité fur l’art de fortifier les
places, VII, 193. a, 196. b.
O Z EN E , {Chirurg.) ulcere de la narine. Etymologie du
mot. Ozene fimple 5 c ozene cancéreux : leurs caufes. XI.
730. b. Traitement de cette maladie. Ibid. 731. a. Efpece
d’ozeiie dont le fiege efi dans le finus maxillaire. Ce qu’exit^e
fa curation. Ib'td. b. °
O Z IA S , force^ du feigneur { Hifi. facr. ) ï *. roi de Juda ,
dont on a parlé fous le nom A'Aq^arias. 2®. Un lévite def-
cendant de Caath. 3®. Un des braves de David. 4®. Un
des premiers de Béthulie. Comment il contribua à la délivrance
de cette ville , lorfqu’elle fut afilégée par Holopherne, Suppl. IV . 216. b.
Ill