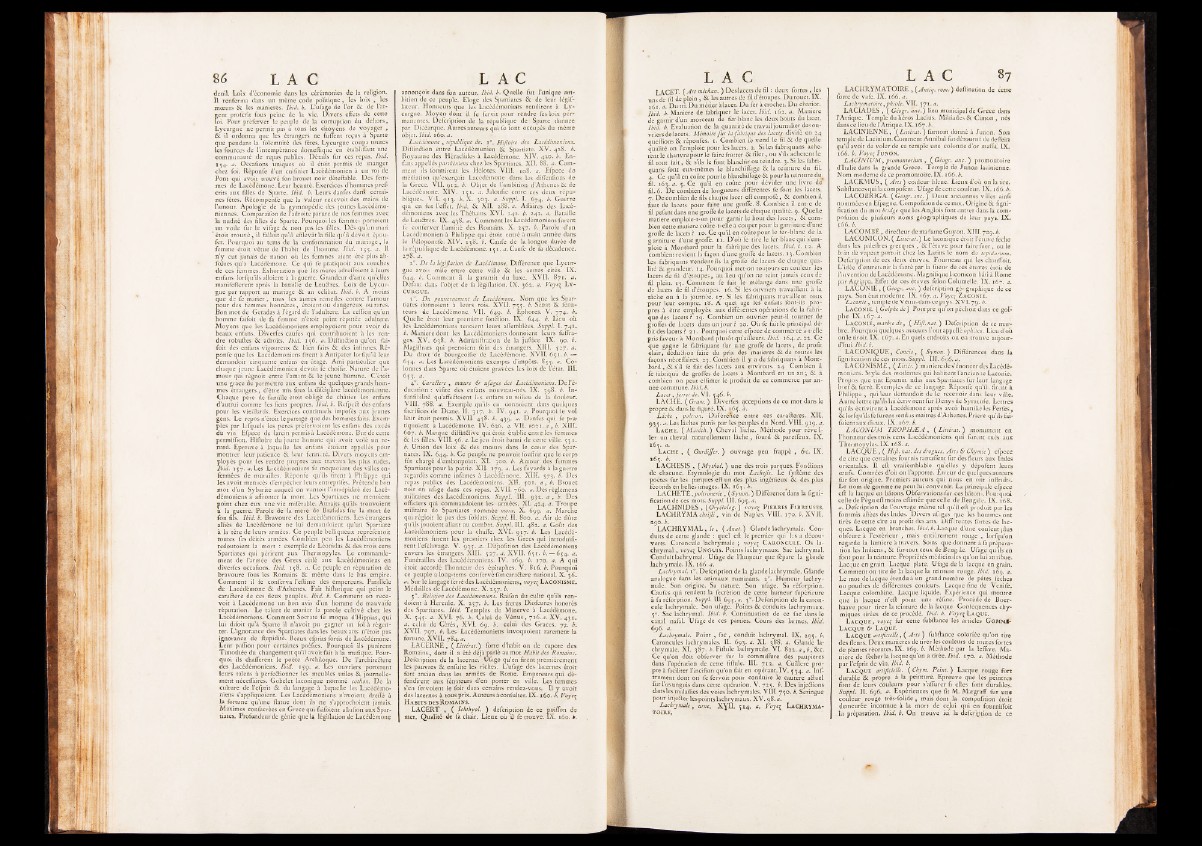
! ‘ 86 LAC LAC
iâ #
i
! II.
deuil. Loiv d’éconoiHie dans les cérémonies de la religion,
il renfenun dans un même code poVuique , les loix , les
moeurs & les manières. IbU. b. L’ ulage de l'or & de l'ar-
cent ])rofcrit fous peine de la vie. Divers eftets de cette
foi. Pour préferver Ij peuple de la corrupiioii du deliors,
Lycurgue ne permit pas à tous les citoyens de voyager ,
& il ordonna que les étrangers ne fiilîent reçus à S[iarte
que pendant h l'olemnité des fêtes. Lycurgtic coupa toutes
les fources do rintcmpérance doinefliquo en ctabliliaut vmc
comiminamé de repas publics. Détails fur ces repas. IbiJ.
1^4. Occafions uniques où il cioit permis de manger
cliez foi. Réponfe d'un cuifmier Lacédémonien à un roi de
Pont qui avoit trouvé fou brouet noir dcteflable- Des femmes
de Lacédémone. Leur beauté. Exercices d'hommes pref-
crits aux filles de Sparte. Ibid. b. Leurs danfes tIanS certaines
fêtes. Récompenfe que la Valeur recevoir des mains de
l’amour. Apologie de la gymnopédie des jeune'» Lacédémo-
niennes. Cornparaifou de l’adroite parure de nos femmes avec
la nudité des filles de Sparte. Pourquoi les femme* porioient
un voile fur le vifage éc non pas les filles. Dès qu’ un mari
étoit trouvé, il falloir qu’il enlevât la tille qu’il devoit épou-
fer. Pourquoi au tems de la confommation du mariage, la
femme éioit vêtue de l’babit de l’bomme. Ibid. 15^. U
n'y eut jamais de nation où les femmes .dent été plus ab-
fcjucs qu'à L.acédémoue. Ce qui lé pratiquoit aux couches
de ces femmes. Exhortation que les meres udrdToient à leurs
eiifans lorfqu’ils alloient .à la guerre. Grandeur d’amc <|u’elles
inanifcRerent après la bataille de Leuéfres. Loix de Lycurgue
par rapport au mariage & au célibat. Ibid. b. A moins
que de fe m.trier, tous tes autres remede,s contre l’amour
pour des femmes honnêtes, étoient ou dangereux ou rares.
Bon mot de Geradas à l'égard de l’adultete. La ccllion qu’un
homme faifoic de la femme n’étoit point réputée adultéré.
Moyens que les Lacédémoniens employoient pour avoir de
beaux enfans. Diverfes caufes qui comribuoient à les rendre
robuftes & adroits. Ibid. 156. a. Diüinélion qu’on fai-
foit des enfans vigoureux & bien faits &. des infirmes. Ré-
ponfe que les Lacédémoniens firent à Antipnter loifqii'il leur
demaiuloit cinquante enl'ans en otage. Ami patticuli^r que
chaque jeune Lacédémonien devoit le choifir. Nature de l’amour
qui régnoit entre l'am.nu 8c le jeune homme. C ’iitoii
une grâce de permettre aux enfans de quelques grands liom-
mes étrangers, d’être mis fous la difciplinc lacédémoni;.nne.
Chaque pere de famille étoit obligé de châtier les enfans
d’autrui comme les fiens propres. Ibid. b. R<.fpijél des enfans
pour les vieillards. Exercices continuels Impofès aux jeunes
gens. Le repos n'écoit le partage que des hommes faits. Exemples
par Ivfquels les peres préfervoient les enfans des excès
du vin Efpece de larcin permis à Lacédémone. But de cctce
permillion. Hifioire du jeune homme qui avoit volé un renard.
Epreuve à laquelle les enfans ctoient appelles pour
montrer leur patience 8c leur L rm .tc. Divers moyens employés
pour les rendre propres aux travaux les plus rudes.
Ibid. 1^7. .3. Les Lacédémoniens fe moquoient des villes enfermées
de murailles. Réponfe qu’ils rirent à Philippe qui
les avoit menacés d’empéclKr leursentreprifes. Prétendu bon
mot d’un Sybarite auquel on vantoit l’intrépidité des Lacédémoniens
.à affronter la mort. Les Spartiates ne meiioient
point chez eux tme vie miférable. Attraits qu’ils trouvoient
à la guerre. Parole de la mere de Brafidas lur la mort de
fon fils. Ibid. b. Bravoure des Lacédémoniens. Les étrangers
alliés de Lacédémone ne lui demandoient qu'un Spartiate
à la tète de leurs armées. Ce peuple belliqueux repréfentoit
toutes fes déicés armées. Combien peu les Lacédémoniens
redoutoietn la mort : exemple de Léonidas 8c des trois cens
Spartiates qui périrent aux Thermopyles. Le commandement
de l’armée des Grecs cédé aux Lacédémoniens en
diverfes occafions. Ibid. 1^8. a. Ce peuple en réputation de
bravoure fous les Romains 6c même dans le bas empire.
Comment il fe conferva l’cfiime des empereurs. Parallèle
de Lacédémone 6c d’Atlienes. Fait hifloriqiie qui peint le
caraélere de ces deux peuples. Ibid. b. Comment on recevoir
à Lacédémone un bon avis d’un homme de maiivaife
réputation. Le talent de manier la parole cultivé chez les
Lacedérnoniens. Comment Socrate fe moqua d’Hippias, qui
lui clifoit qu’à Sparte il n’avoit pu gagner tm fol à régenter.
L’ignorance des Spartiates dans les beaux arts n’étoit pas
ignorance de flupiditc. Beaux efprits fortis de Lacédémone.
Leur pafiion pour certaines poéfies. Pourquoi ils punirent
Timothée du changement qu'il avoit fait à la mufique. Pourquoi
ils chalferent le poète Archiloque. D e rarchiteélure
des Lacédémoniens. Ibid. 159. «j. Les ouvriers portèrent
leurs talcns à perfeélionncr les meubles utiles 8c journellement
nccelTaires. Gobelet laconique nommé cothon. D e la
culture de l’efprit 8c du langage à laqueUe les Lacédémoniens
s’appliquoient. Les Lacédémoniens n'avoient drejTé à
la fortune qu'une llatue dont ils ne s’approchoient jamais.
Maximes confacrées en Grece qui faifoient alliifion aux Spartiates.
Profondeur de génie que U légifiaùon de Lacédémone
annonçoit dans fon auteur. Ibid. b. Quelle fut l’iinique ambition
de ce peuple. Eloge des Spartiates 8c de leur légif-
latcur. Honneurs que les Laccdcmonic*is rendirent à L y curgue.
iVloycn dont il fe fervit pour rendre fes loix per-
manentes. Dclcripiion de la république de Sparte donnée
par Dieéarque. Autres auteurs qui fe font occupés du tnème
objet. Ibid. 160. a.
L.icldiimone , rcpiibliijiie de. 1°. Hifioire des Liicédânoniens.
IDUlinélion entre Lacédémonien 8c Spartiate. X V . 428. b.
Royaume des Hcraclides à Lacédémone. XIV. 420. b. Enfuis
appelles y.tnhèniens chez les Spartiates. X ll. 88. a. C omment
ils foumireiu les Héloces. V l l l . 108. u. Efpece de
médiation qu’exerçoit Lacedémone dans les düTcnilons de
lu Grece. V IL 91a. b. Objet de l'ambition d'A riiciics 8c de
Lacédémone. X IV . 151. .n J.ilüufie entre ces deux répu-
blique,^. V I. 913. b. X. 303. u, Suppl. 1. 674. b. Guerre
qui en fut l'eft'et. Ibid. 8c XII. 288. u. Affaires des Lacédémoniens
avec les Thébains. XVI. 241. b- 242, a. Bataille
de Leuéfres. IX. 438. a. Comment le» Lacédémoniens furent
le conferver l’aminé des Romains. X. 237. b. Parole d’un
Lacédémonien à Philippe qui étoit entré à main armée dans
le Polopoiicfe. X IV . 138. b. Caufo de la longue durée de
la république de Lacédémone. 1 31. u. Caufe de là décadence.
2". De i l lé"i(ljiion de L.iccdèmone. Dllfércnce que Lycurgue
avoii mil'e entre cette ville 8c les autres cités. IX.
644. b. ComiiKiu il la garantit du luxe. XVII . 871. a.
Déf.uiî dans l’objet de fa léglll.uion. IX. 362. u. Voye^ Ly curgue.
3''. Du pouvenicmenl de L.icèdcmonc. Nom que les Spartiates
donnoicnt .'i leurs rois. XVU. 753. b. Sénat Sc féna-
teurs de Lacédémone. \ ’I1. 649. b. Epbores. V. 774. b.
Quelle éroit leur première fonélion. IX. 644. b. Lieu où
les Lacédéinonieiis tenoient leurs alTemblées. Suppl. 1, 741.
b. M.iniere dont les Lacedémoniens donnoienc leurs lulfra-
ges. X V . 638. b. Adiniinfiration de la juflicc. IX. 90. b.
Magillrats qui prenoiem foin des étrangers. XIII. 527. a.
Du droit de boiiigeoilie de Lacédémone. XVII . 631. é .—
6^4. J. Les Lacédémoniens exempts d'impôts. 83^. a. C o lonnes
d.ins Sparte où étoient gravées les loix de l'éiar. III.
<>r>-
4°. Ciirablcre , maurs & iifei^es des Lacédémoniens. D e l’éducation
: vifice des enfans nouveau-nés. IX. 398. b. In-
lenfibilité qu’alîeéloiem Ls enfans nu milieu de la tiniileur.
V l lL 788. d. Exemple qu'ils en uonuoicni dans quelques
facrifices de Diane. II. 317. b. IV. 941, ,7. Pourquoi le vol
leur étoit permis. XVII . 438. b. 439. a. Danfes qui fe pra-
tiqiioient à Lacédémone. IV. 626. u. V i l. ro21. u , i. XIII.
607. b. Marque diftinélivc qui étoit établie entre les femmes
8c les filles. VII I. 36. a. Le jeu étoit banni de cette ville. 53 i .
b. Union des loix 8c des moeurs dans le coeur des Spartiates.
IX. 644. b. Ce peuple ne pouvoit foulfrir que le corps
fût chargé d’embonpoint. XL 500. b. Amour des Rmrnes
Spartiates pour la patrie. XII. 179. a. Les fuyards à la guerre
regardés comme infâmes à Lacédémone. XJII. 573. b. Des
repas publics des Lacédémoniens. XII. 5O!. a , b. Brouet
noir en ufage dans ces repas. XVII. 760. u. Des rcglemens
militaires des Lacédémoniens. Suppl. III. 932. .1 , b. Des
officiers qui commandoient les armées. XI. 424. a. Troupe
militaire de Spartiates nommée mora. X. 699. a. Marclie
qui régloic le pas des foldats. Suppl. 11. 800. a. Air de tlùis
qu'ils jouoient allant au combat. l l l . 482. a. Goût des
Lacédémoniens pour la cbalTe. X V I . 917. b. Les Lacédémoniens
furent les premiers clie?. les Grecs qui introduifi-
rent l’efclavage. V . 935. Dilijofition des Lacédémoniens
envers les étrangers. XIII. 327. .1. XV II . 651. b. — 654. a.
Funérailles des Lacédémoniens. IV . 169. b. 170. a. A qu?
étoit accordé l’honneur des épitaphes. V . 816. b. Pourquoi
ce peuple a long-tcms confervè fon caraétere national. X. 36.
a. Sur le langage ferré des Lacédémoniens, voyci^ Laconisme.
Médailles de Lacédémone. X .2 57 . b.
3°. Religion des Lacédémoniens. Raifon du culte qu’ils ren-
doient à Hercule. X. 237. b. Les freres Diofeures lionorés
des Spartiates. Ibid. Temples de Minerve à Lacédémone.
X. 543. a. X V I . 76. b. Celui de V én u s , 716,.7. X V . 431.
a. Ci.hii de Gérés, X V I. 69. b. celui des Grâces. 77. b.
XVII . 797. b. Les Lacédémoniens invoquoiem rarement la
fortune. X VU . 784. ,7.
L A C E R N E , {Littéral.) forte d'irabit on de capote des
Rom.ains, dont il a été déjà parlé au mot ILabit des Romains.
Defeription de la laceime. Ufage qu’en firent premièrement
les pauvres 8c enfuite les riches. L’ufage des lacernes croit
fort ancien dans les armées de Rome. Empereurs qui défendirent
aux fénateurs d’en porter en ville. Les femmes
s’en fervoient le loir dans certains rendez-vous. Il y avoit
des lacernes à tous prix. Auteurs à confulter. IX. 160. b. Voyc^
Habits des Romains.
LA C E R T , ( Ichthyol. ) defeription de ce poilfon de
mer, Qualité de fa chair. Lieux où U fe trouve. IX. 160. >.
LAC LACE T, (yî/rt meVA.w. ) Des lacets de fil : deux fortes, les
uns de lil de plein , 8c les autres de lild'étoupes. Du rouet. IX.
161. J. Du cri. D u métier.à lacet. Du fer à crochet. Du cliariot.
Jhid. L Maniéré de fabriquer le lacet. Ibid. 162. a. M.iniere
de garnir d’un morceau de fer blanc les deux bouts du lacet.
Jbi'd. b. Evaluation de la quantité de travail journalier desou-
vilers de lacets. Mémoire fur Lifabriijiie des Liccis divifj 61124
quellions 8c réponlès. i. Combien fe vend le fil 8c de quelle
qualité on l’emploie pour les lacets. 2. Si les tabriquans achètent
le chanvre pour le faire frotter 8c filer, ou s’il, aclieteiu le
fil tout fait, 8c s’ils le font bl.mchir ou teindre. 3. Si les fabri-
quans font eux-mêmes le blaiicbillage 8c la teinture du fil.
4. Ce qu’il en coûte pour le blanchilTage 8c pour la teinture du^
fil. 163. J. 3. Ce qu’il en coûte pour dévider une livre de
fil. 6. De combien de longueurs dilférentes fe font les lacets.
7. De combien de fils cliaque lacet cflconmo fé, 8c combien il
faut de lacets pour faire une groffe. 8. Combien il ent e de
fil pefam dans une grolfede lacets de chaque qualité. 9. Quelle
matière emploic-t-on pour garnir le bout des lacets, 8c combien
cette matière coûte-t-elle a couper pour la garriture d’une
grolTe de lacets ? 10, Ce qu’il eu coûte pour le fer-blanc de la
garniture d’une grolTc. 11 . D ’oii fe tire le fer blanc qui s’emploie
.1 Montbard pour la fabrique des lacets. Ibid. b. i i . A
combiem revient l.i façon d’une groJe de lacets. 1 3. Coinbi'en
les fabilqu ins VGiuleiu ils lagroilè de lacets de chaque qualité
8c grandeur. 14. Pourquoi met-on toujours en con cur ics
lacets de fil d'étoupes, au lieu qu’on ne teint jamais ceux de
fil plein. 15. Comment fe fait le mélange dans une grolfe
de lacets de fil d’étoupes. 16. Si les ouvriers travadleiu à 1.2
lâche ou à la journée. 17. Si les fabriquans travaillent tous
pour leur compte. 18. A quel âge les enfans font-ils propres
à être employés .aux diffé.entes opérations de la fabrique
des lacets.^ 19. Combien un ouvrier peut-il tourner de
grolTes de Licets dans un jour? 20. Où fe tait le princip.il débit
des Lacets ? 21. Pourquoi cette efpece de commerce a t-clle
pris faveur à Montb.ird plutôt qu’allleurs. Ibid. 164. a. 21. Ce
que gagne le fabriquant fur uiie grolTc de lacets, de profit
clair, dédulilion faite du prix des matières 8c de toutes les
façons nécell’aires. 23. Combien il y a de fabriquans à Montbard
, Sc s’il le fait des lacets aux environs. 24. Combien il
fe fabriqua de grofl’es de lacets à Montbard en un an; 8c à
combien on peut ellimcr le produit de ce commerce par année
commune. IbU. b.
Lacet, jenct de.V l. 346.
LA CH E. {Gram. ) Diverfes acceptions de ce mot dans le
propre 8c dans le figuré. IX. 163. ù.
L.i:he , pjlt'on. DiiFérefice entre ces caraélcres. X ll.
933. a. Les ladies punis par les peuples du Nord. VIII. 919. a.
Lâche. {M.iréch.) Cheval lâche. Méthode pour r e v e l ler
im cheval naturellement Lâche , lourd 8c parelfeux. IX.
165. a.
Lâche , ( Ourdiffer. ) ouvrage peu frappé , &c. IX.
163. b.
L.ACHESIS , {Mythol. ) une des trois parques. Fonétions
de chacune. Etymologie du mot Lachefis. Le fyfléme des
poètes fur les parques efl un des plus ingénieux 8c des plus
féconds en belle.» images. IX. 163. b.
LÂ CH E T É , pü/r/oz/mr, {Synon. ) Différence dans la llgnl-
fication de ces mots. Suppl. 111. 693. j .
LACH NID ES , {Oryélolog.) voyc^ PiERRES Fibreuses.
L.ACHRYM A c/mj/fi , vin de Naples. V l l l . 170. i . XVII .
290.
LA CH R YM A L , le , { Anat. ) Glande lachrymalc. Conduits
de ceicc glande : quel ell le premier qui l.s a découverts.
Caroncule lachrymaie ; vuyt^ Caroncule, Os lachrymal
, Unguis. Points iaclirymaux. Sac laclirymal.
Contluitlaclirymal. Ufage de l'iuinicur que féparc la glande
lachrjmule. IX. 166 a.
L.idvymaL. t ” . Defeription de la glande lachrym.ile. Glande
analogue dans les animaux ruminans. 2“. Humeur lach.ry-
male. Son origine. Sa mature. Son ufage. Sa réforption.
C.aufes qui rendent la fecrétion de cette Inimcur fiipérieure
à fa réforption. Suppl. Ill 693. a. 3". Defeription de la caroncule
Lichrymale. Son ufage, Points 8c conduits lachrymaux.
3". Sac lachrymal. Ibid. b. Continuation de ce fac dans le
canal nalàl. Ufage de ces parties. Cours des larmes. Ibid.
6<)6. a.
Lachrymaie. Point , fa c , conduit lachrymal. IX. 295. b.
Caroncules lachrymales. II. 693. a. XL 388. a. Glande lachrymaie.
XI. 387. é. Fifiule lachrymaie. VI. 822. j , é ,S c c .
C e qu’on doit obferver fur la commilfure des paupiere.s
dans l’opération de cette rifiule. III. 712. a. Cuillère propre
à faciliter l’incifion qu’on fait en opérant. IV . 334. a. Inf-
trument dont on fe fei voit pour conduire le cautere aéluel
fur l’ü sunguis dans cette opération. V. 723. b. Des injeéHons
dansles maladies des voies lachrymales. VIII 730. b. Seringue
pour injeéler les points lachrymaux. X V . 98. a.
Lachrymaie, urne. X y iE 514. Voye:^ La CHRYMA-
TOiRE,
LAC 87
L A CH R YM A TO IR E , {Antiq. rom. ) deflinat'ion de cette
forte de vafe. IX. 166. a.
L.ii hrym.iioirc, phiole. V IL 371. a.
L A C IA D L S , ( Géogr. a/ic.) lieu municipal de Grece dans
l’Atrique. Temple du liéros Lacius. Miltiade-» 8c Cimon , nés
dans ce lieu <lc l'Attique.IX. 167. b.
LA C IN IEN N E , (iùrcVj/. ) furnom donné à Junon. Son
temple do Laclnium. Coinmoiu Aimibal fut détourné du delTein
qu’il avoit de voler de ce temple une colonne d'or mulTil’, IX.
i66. b. Foyct^ Ju.NON.
L A C IN IU M , piomoniorium , {Géogr. anc.) promontoire
d'Italie dans la grande Grece. Temple de Junon laUnicnnc.
Nom moderne de ce promontoire. IX. 166. b.
L A CK V IU S , ( Arts) couleur bleue. Lieux d'où on la tire.
Subllancesqui Licompofent. Ufage de oette couleur. IX. 166. b.
LACOBRIG.A. ( Gc'üg-r. ,;/7c. ) Deux anciennes villes aiufi
nommées en Efpague. Compofition de ce mot. Origine 8c fignl-
fication du moi bndge que les Anglois font outrer dans la com-
polition de plufieurs noms géogr.aphiques de leur pays. IX.
166. b.
LA COM BE , direéleur de madame Guyon. X fîl. 709. b.
LA CO N ICO N , ( Lhtér.it.) Le laconique croit l’éttivc fcche
dans les palefires grecques , 8crétiivc pour faire fiicr, ou le
b .in de vapeur portoit diez les Latins le nom do tepidarium.
Defcrijjiion de ces deux étuves. Fourneau qui les ch uilfoir.
L’idée d’entretonlr la lanté par la fueur de ces étuves éioù de
l’iiivention de Lacédémone. Magnifique l.iconicon bâti à Rome
par Agrippa. Eft'ec de ces étuves felon Columcllc. IX, 16“ . a.
L.ACÛNIE, ( Geogr. .me. ) dcfcri|)tion géographique de ce
pays. Son état moderne IX. '67. u. Zaconie.
Laconie, temple de Vémi»dans ce pays. XVI. 79. b.
L aconie, {Golphe Je) Pourpre qu’on pécboit dans ce gol-
phe IX. 167. a.
hKCOtillL, marbic de, {H iß .n at.) Defcripiion de ce marbre.
Pourquoi quelques auteurs l’ont appollé Lieu d'où
on le tiroit. IX. 167. ./.En quels endroits on en trouve aujourd’hui.
Ih'd. b.
L A C O N IQ U E , Concis, ( Synon. ) Différences dans la
fignification de ces mots. Suppl. III. 6v.6. a.
L A CO N ISM E , ( Ltnér. ) rn.miere de s’énoncer des Lacédé-
monioiis. Style des modernes t[ui liabitent l’ancien.le Laconie.
Propos qite tint Epamin nd.is aux Spaitiate.s fur leur lang.ige
b-efSc ferré. Exemples de ce langage. Réponfe qu'il- fiiviu à
Philippe , qui leur demandoit de le recevoir dan» leur ville.
Autre lettre qu’il» lui écrivirent fur Deny» de Syraeufe. Lettres
qu’ils écrivirent à Lacédémone aprè.» avoi: humilié les Perles,
Ôclorfqu’iLl’crureiu rendus maîtres d'Athenes. Prière qu’ils fai-
füieiuaux dieux. IX. 16 7 ./>-
L.4 CONU.A TR O PHÆ .4 , {Litiérat.) monument en
riionneiir des trois cens Lacédémoniens qui furent tués aux
Thermopyles. IX. 168. a.
L A C Q UE , ( Hiß. nat. des drogues. Arts & Chymie ) efpece
de cire que certaines fournis ramufi’ent fur des fleurs aux Indes
orientales. Il eft vraifembLibie qu’elles y dépofent leurs
oeufs. Contrées d’où 011 l’apporte. Erreur de quelques auteurs
fur fon origine. IVcmicr» auteurs qui nous en ont iufiruhi.
Le nom de gomme ne peut lui convenir. La pnnci|iale efpece
cfi la lacque en bâtons. Obfervations fur ces bâton-. Pourquoi
celle de Pégu efl moins efUmée que celle de Bengale. IX. 168.
a. Defeription de l’ouvrage même tel qu’il efl produit par les
founnis ailées des Indes. Divers uf.-ges que les homme» ont
tirés de cette cire au profit des arts. Dilflrcntes fortes de lac-
ques. L icque en branches. IbiJ. b. L.tcque d'une couleur plus
obfcure à l'extérieur , mais entièrement rouge , lorfqu’on
reg.irde la lumière à travers. Soins que donnent à fa jzrcpara-
tion le» Indiens, 8c fur-tout ceux de iicng.-le. Ufage qu’ils en
font pour la teinture. Propriétés médicin.iles qu’on lui am ibue.
Lacque en grain L.icque pUte. Ui'age de la lacque en grain.
Comment on tire de la lacque la teinture rouge. Ibid. 169. a.
Le mot de lacque étendu à un grand nombre de pâtes f'eches
ou poudres de différentes couleurs. Lacque fine de Venife.
Laci[ue colombine. Lacque liquide. Expérience qui montre
que la lacque n’cfl point tine refine. Procède de Boer-
liaave pour tirer la teinture de la lacque Confcqiiences chy-
miques tirées de ce procédé. IbiJ- b. /fiaytq; Laque.
Lacque, voyeç fur cette fubfiaiice les articles GommI-
Lacque & L aque.
L a c q v e arrißaelle,{Aris) fubfiance coloriée qu’on tire
des fleurs. Deux m.inieres de tirer les couleurs de toutes fortes
de plantes récentes. IX. 169. b. Méthode par la leffivc. Maniéré
de fécher la lacque qu’on a tirit.lb id. 170. a. Méthode
par l’efprit de vin. IbiJ. b.
Lacque artificielle. { Chym. Peint. ) Lacque rouge fort
' durable & propre à la peinture. Epreuve que les peintres
font de leurs couleurs pour s’alfurer fi elles font durables.
Suppl. IL 696. d. Expériences que fit M. Margraff fur un«
couleur rouge très-folide , mais donc la compofition étoit
demeurée inconnue à la mort de celui qui en fournilfoit
la prépamion. Ibid. b. On trouve ici la defeription de ce