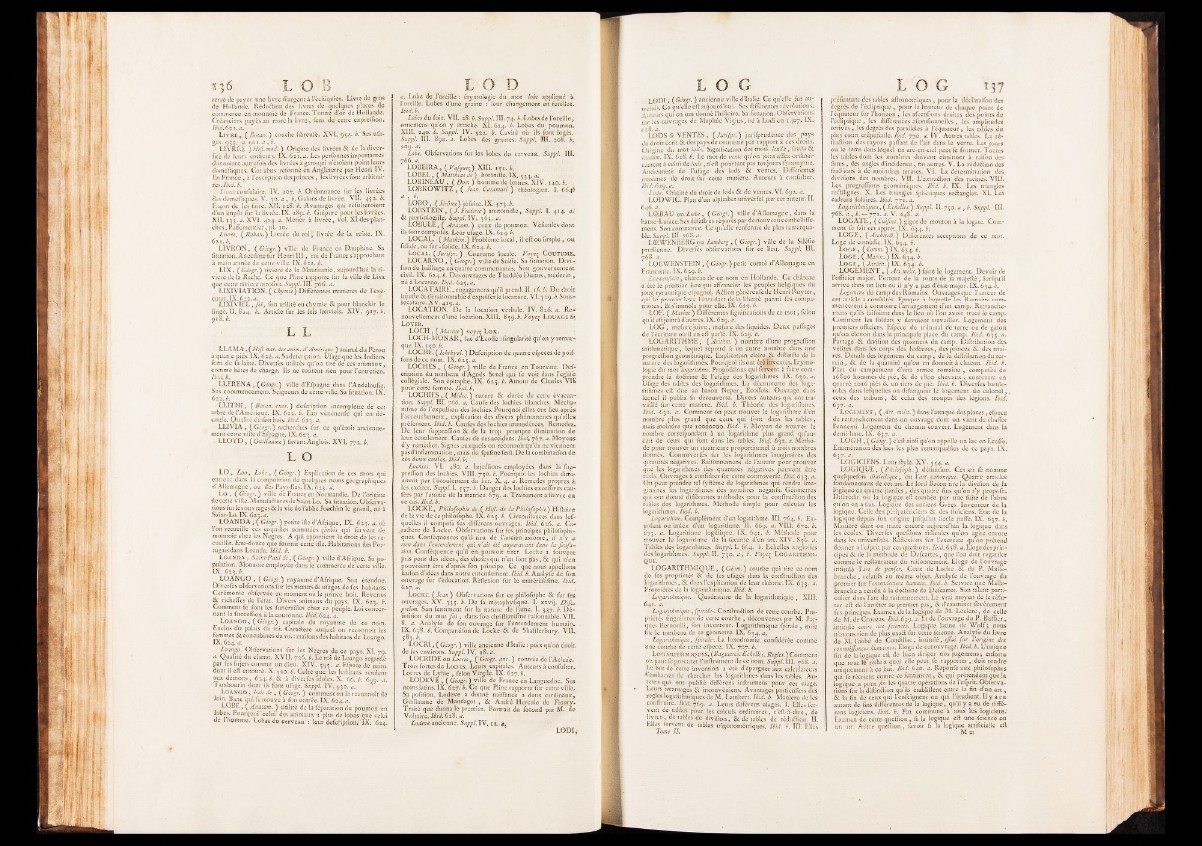
H
il. sr-^
'■ ii " f
’ ..il V
;.r
Ï36 LOB rcrrc <lc payer imc livre d’argent à l’échiquier. Livre de gros
de Hollatidc. Réduction des livres de quelques places de
coiuniercc en uionuoie do Fnncc. Tonne d’or de Hollande.
Créanciers payés au marc la liv re , lens de cette cxprcinon.
JbiJ.6%i.ii.
LiVKE , ( ) couche l'ibrenfe. X V I . 954. b. Scs ufagcs.
955. ,t. 961../ , b.
LIVRÉE. ) HijL mod. ) Origine des livrées & de la diver-
Tué de leurs couleurs. IX. 621../. Les perfonnes importantes
donnoient autrefois des livrées à gens qui n’écoiem point leurs
domcAiques. Cor abu.s réformé eu Angleterre par Henri IV.
En France , à l'c-xception des princes , les livrées font arbitraires.
Ibid. b.
Z/wâ-coufuhirc. IV . 107. b. Ordonnance fur les livrées
des domefliqucs. V . 30.12, i. Galons de livrée. V i l . 452./».
Façon de les faire. XII. 128. b. Avantages qui rcfultcroient
tl'un impôt fur la livrée. IX. 289. b. Guipure pour les livrées.
XII. 133. .2. XVI, 424. a. Métier à liv ré e, vol. X I des planches,
PaiTcmcntier, pl. 10.
Livrée. ( Livrée du ro i, livrée de la reine. IX.
C i i .b .
L IV R O N , (G é o jr .) ville de France en Dauphiné. Sa
fituation. Anecdote fur Henri I I I , roi de France s’approchant
à main armée de cette ville. IX, 621. b.
L IX , {Géogr.) riviere de ha Maurhaiiic, aujourd’hui la riviere
de la Radie. Ce que Pline rapporte fur la ville de Lixn
que cette riviere arrofoit. Suppl. III. 766. a.
LIXIVLATION. ( Chymic) Différentes maniérés de l'exé-
enter. IX. 622. a.
L IX IV IE L , fd, fon utilité en chymie & pour blancliir le
linge. IL 824. b. Article fur les fels tixiviels. X IV . 917. b.
918. b.
L L
LL.AMA ,{Hip . mit. desanim. d'AuUriquc ) animal du Pérou
à quatre pies. IX, 622. .1. Sadefeription. Ufageqiie les Indiens
font de fa laine. Diverfes utilités qu'on tire de ces animaux,
comme bêtes de charge. Ils ne coûtent rien pour l'entretien.
Ibid. b.
LL E R EN A , (Géogr.) ville d’Efpagne dans l’Andaloufie.
Scs commenccmens. Seigneurs do cette ville. Sa fituation. IX.
622, b.
L L ITH I , exot.') defeription incomplecte de cet
arbre de l’Amérique. IX, 622. b. Eau vénénenfe qui en découle.
Qualité deü)n bois. Ibid. 623. d.
L L IV IA , ( Gceg’,-. ) reclierches fur ce qu’étoit anciennement
cette ville d'Efpagne. IX. 623. a.
L L O Y D , ( Guillaume ) favant Anglois. XVY. 772, b. L O
L O , Loo, L o in , {Gêogr.) Explication de ces mots qui
entrent dans la cojupolition de qiieiques noms géograpJiiques
d'Allemagne , ou des Pays-Ras. IX. 623. rf.
L o , ( Grégr. ) ville de France cn Normandie. De l’origine
dccettc ville. ^Iamlfa61n1•esdeSailu•Lo. Sa fituailon.Obferva-
tions fur les ouvrages & la vie de l’abbé Joachim le grand, né à
Saint-Lo. IX, 623. û.
L O A N D A G é o g r . ) petite ifle d'Afrique, IX. 623. <2.011
l’on recueille ces coquilles nominees ^iuibis qui fervent de
monnoie chez les Negres. A qui appartient le droit de les recueillir.
Eau-douce que fournit cette ifle. Habitations des Portugais
dans Loanda. Ibid. b.
LOANOA , Saint-Paul de, ( Géogr. ) ville d’Afrique. Sa population.
Monnoie employée dans le commerce de cette ville.
IX. 623. E
LO AN G O , {Géogr.) royaume d’Afrique. Son étendue.
Diverfes obfcrvations fur les moeurs & ufages de l'es habirans.
Cérémonie obfervée au moment où le prince boit. Revenus
& Ticlieffes de l’état. Divers animaux du pays. IX. 623. b.
Comment fc font les funérailles chez ce peuple. Loi concernant
la fucceflion à la couronne. Ibid. 62a,. a.
L o a n g o , (Gc'egr.) capitale du royaume de ce nom.
Enclos du palais du roi. Caraâere auquel on reconnoit les
femmes 8cconcubines du roi : maifonsdes liabitans de Loanzo
ÏX.624.<2. ^
Lo.mgo. Obfcrvations fur les Negres de ce pays. XI. 79.
<2. Qualité du climat. X VII , 726. b. Le roi de Loango ie<^ardc
par fes fiijets comme un dieu. X IV . 593. <?. Efpece de nains
dont il eft entoure. X. 520. b. Culte que les habirans rendent
aux dcjnons, 624. b. & à diverfes idoles. X. 66. b. 699, a.
Tambourin dont ils font ulage. Suppl. IV , 930. .7. ’
Lo a n g o , baie de , {Géogr.) comment on la reconnoit de
loin. Banc oui fe trouve -à fon entrée. IX. 624. a.
^ ) utilité de la féparation du poumon en
lobes. Pourquoi celui des animaux a plus de lobes que celui
de 1 Jiomme. Lobes du cerveau : leur defeription. IX. 624.
L O D a. Lobe de l’oreille : ctymol»g!e du mot lobe appliqué à
l'oreille. Lobes d’une graine : leur changement cn feuilles.
Ibid. b.
Lobes du foie. VII, 28./). Suppl. III. 74. E-Lobesde l’oreille,'
oruemens qu'on y attaclic, XL 614. b. Lobes du poumon.
XIII. 240. b. Suppl. IV. 322. b. Cavité où ils fout logés.
Suppl. III. 890. a. Lobes des graines. Suppl. III. 208. b.
209. a.
Lobe. Obfcrvations fur les lobes du cerveau. Suppl. IlL
766. a.
LO R E IR A, ( Vafjuci) XIII. 131.
LOREL , {^Aîatthias Je') bntauillc. IX. 5 33. <7.
LOBINE.'VU’ , ( Dotn ) homme de lettres. X IV . i i o . b.
LO R K OW IT Z , ( Jean Caramud ) theolo gieu. I. 6643
a , b.
LO BO , {Jérôme') jéfuite. IX. 373-
LÜBSTE IN , {J.Frédcric) anatomifte, Suppl. 1. 414. <2;
& pliyfiologÜlc. Suppl. IV . 363. a.
LO BU L E , ( ceux du poumon. Véficiilcs dont
ils font compofés. Leur ufage. IX. 624, b.
LO C A L . ( M.ithérn. ) Problème local, il eff ou fimple , ou
folule,ou fur-folide. IX. 624. b.
L o c a l . {Jurifpr.") Coutume locale. C o u t u m e .
L O C A R N O , (Géogr.) ville de Suiffe. Sa fituation. Divi-:
fion du bailliage eu quatre communautés. .Son gouvernement
civil. IX. 624. b. Des ouvrages de Tliaddée Duinis, médecin ,
né àLocanio. Ibid. 623. <7.
LO C A T A IR E , ongagemens qu’il prend. IL i6. b. Du droit
injuffe & dérailbunable d’expulferle locataire. V I .319. /».Sous-
locataire. XV.419..7.
LO C A T IO N . D e la location verbale. IV. 826. .7. Re-
nouvellement d’une location. X l l l . 859.E Foyf^; Louage 6*
Loyer.
LO CH , ( Marine ) voye^ LOK.
LO CH -M O N A R , lac d’Ecoffe : fmgularité qu’on y remar-,
que.IX. 130. b.
LOCHE, ( Ichthyol. ) Defeription de quatre efpeces de poif-
fûiisde ce nom. IX.623.rf.
LOCHE S , ( Géogr. ) ville de France en Touraine. Dcf*
cription du tombeau d’Agnès Sorel qui fe voit dans l’églife
collégiale. Son épitaphe. IX. 623. b. Amour de Charles VIE
pour cette femme. Ibid. b.
LO CH IE S , {Médec.') nature St. durée de cette évacuation.
Suppl. III. 766. rf. Caufe des lochies blanches. Méclia-
nifme de l'c-xpulfion des locliies. Pourquoi elles ont lieu après
raccoiichcmenr, explication des divers phénomènes qu’elles
préfeiueni. Ibid. b. Caufes des lochies immodérées. Remedes.
D e leur fuppreffiou Sc de la trop prompte diminution de
leur écoulement. Catifes de ccsaccidetis. Ibid. 767. a. Moyens
d’y remédier. Signes auxquels on reconnoit qu’ils ne viennent
pasd’infiammation , mais du fpafmefeul. D e la combinaifon de
ces deux caufes. Ibid. b.
Lochies. V I . 480. <2. Injeélions employées dans la fup-
preffion des lochies. VIII. 730. b. Pourquoi les lochies dimL-
nuent par récoiilemeiit du lait. X. 4. a. Remedes propres à
les exciter. Suppl. I. 3 37. b. Danger des lochies exceffives cau-
fées par l’atonie de la matrice. 679. <2. Traitement à fuivre en
ce cas. Ibid. b.
L O C K E , Philofophle de.{ Hiß. de la Philofophie) Hiffoire
de la vie de ce piiilofophe. IX. 623. E Circonffances dans Icf-
queiles il coni[)ofa fes différens ouvrages. Ibid. 626. a. Ca-
raéferc de Locke. Obfervations fur fes principes philofophi-
ques. Confcquenccs qu’il tira de l’ancien axiome, il n'y a
rien dans Ventendement qui n’ait été auparavant d.ms la jenfa-
lion. Conféquence qu’il en pouvoir tirer. Locke a fouvent
pris pour des idées, des diofes qui n’en fout pas , & qui n’en
pouvoient être d’après fon principe. C e que nous appelions
liaifon d’idées dans notre entendement. Ibid. b. A ualyfe de font
ouvrage fur l’éducation. Réflexion fur le matérialifmc. Ibid.
627. a.
L o c k e . (J ea n ) Obfcrvations fur ce philofopho & fur fes
ouvrages. X V . 333. b. D e fa métapltyfique. 1. xxvij. D ije.
préltm. Son fciuiment fur la nature de l’ame. I. 337. b. D é finition
du mot f o i , dans fon chriftianifmc raifounablc. V IL
8. rf. Aualyfe de fon ouvrage fur l’entendement humain,
IX. 638. b. Compar.aifon de Locke & de Shafllcrbury. V IL
383,6.
L O C R I , ( Géogr. ) ville ancienne d’Italie : poix qu’on tiroic
de fes environs. Suppl. IV . 18. a.
LO CRID E ou Locris, ( Géogr. anc. ) contrée de l’Aclia'ie.
Trois fortes de Locres. Leurs capitales. Auteurs à confulter.
Locres de Lybie , felon V irgile. IX. 62-/. b.
LO D E V E , ( Géogr. ) ville de France en Languedoc. Ses
noms latins. IX. 627. b. C e que Pline rapporte fur cette ville.
Sa pofition. Lodeve a donné naiffance à deux cardinaux,
Guillaume de Mandagot , & André Hercule de Fleury.
Traité que donna le premier. Portrait du fécond par M. de
Voltaire. Ibid. 628. <7.
Lodeve ancienne. Suppl. IV. 12. <t.
L O D I .
L O G O G 137
L O D I , {Géogr. ) ancienne ville d’Italie. Ce qu’elle fut au-
tretbi.^- Ce qu’elle cfl aujourd'hui. Ses differentes iévolutions.
A u t e u r s oui eu ont donnél’hiffoire. Sa lituation. Obfervations
jiir les ouvrages de Maphéc Vig iu s , hé à Lodi en 1407. IX.
028. .7.
LODS (S'VENTES , {Jurifpr.) jurifprudencc des pays
de droit écrit & des pays de couiume par rapport à ces duoits.
Origine du mox lods. Signification des mots leud.t, l.tuda Si.
Lu.ium. IX. 628. b. Le mot de vente qu’on joint affc'Z orclinai-
reiucnt à celui de lods, n’eff pourtant pas toujours iVnouymc.
Ancienneté de l’ufage des lods & ventes. Differentes
maximes de droit fur cette matière. Auteurs à confulter.
Ibid. 629. rf.
Lods. Origine du droit de lods & de ventes. VI. 692. a.
L O DW IC . Plan d’un alphabet uuivcrfel par cet auteur, IL
646. a.
LGSBAU ou Liebc , ( Géogr. ) ville d’Allemagne , dans la
liauie-Luface.Scs défaill es réparés par de nouveaux einbelliffe-
inciis. Son commerce. Ce qu’elle renferme de plus remarquable.
5/7/’p i III. 768.
LCENt'ENRÉRG eu Lemberg , ( Géogr.') ville de la Siléfie
prufficune. Diverfes obfervations fur ce lieu. Suppl, l i l .
768. .2.
LOEWEN STEIN , ( Géogr.) petit comté d’Allemagne eu
Franconic. IX. 629.6.
Loeu-enfein, ciiatcau de ce nom cn Hollande. C e château
a été le premier lieu qui affranchit les peuples bclgiques du
joug tyrannique elpagnol. Aélion généreufede Henri Ruyter,
q u fle premier leva l'éteudart do la liberté parmi fes compa-
irioies, & s’immola pour elle. IX. 629. 6.
LOF. ( M.zrine ) Différentes figuifications de ce m o t , félon
qu'il eft joint à d’autres. IX. 629. 6.
L O G , mefurejuive, mefure des liqifidcs. Deux paffages
de récriture où il ou eft parlé. IX. 629. 6.
LO G A R ITH M E , {Arithm.) nombre d’une progrcfTion
arithmétique , lequel répond à un autre nombre dans une
progrefî'iou géométrique. Explication claire & cliftinélc de la
nature dos logaritlimcs. Pourquoi ils ont été inventés. Etymologie
du mot logarithme. Propofitions qui fervent à faire comprendre
la doélrinc & l’iifage des logarithmes. IX. 630. a.
Ufage des tables des logarithmes. La decouverte des logarithmes
eft (lue au baron Neper, Ecoffois. Ouvrage dans
lequel il publia fa decouverte. Divers auteurs qui ont travaillé
fur cette maticre. Ibid. b. Théorie des logarithmes.
Ibid. 631. rf. Comment on peut trouver le logarithme d’un
nombre plus grand que ceux qui font dans les tables,
mais moindre que 10000000. Ibid. b. Moyeu de trouver le
nombre correfpondant à un logarithme plus grand qu’aucun
de ceux qui font dans les tables. Ibiil. 632. rf. Méthode
pour trouver un quatrième proportionnel à trois nombres
donnés. Coutroverfes fur les logarithmes imaginaires des
ipiautltes négatives. Raifouneinens de rauteur pour prouver
que les logarithmes des quantités négatives peuvent être
réels- Ouvrages à confulter fur cette controverfe. Ibid. 633. rf.
On peu: prendre tel fyftcme de logarithmes qui rendra imaginaires
les logarithmes des nombres négatifs. Géomètres
qui ont donné différentes méthodes pour la couftruiTiiou des
tables des logarithmes. Méthode fimple pour calculer les
logarirlimes, Ibid. b.
Logarithme. Complément d’un logarithme. III. 764. 6. Ex-
polânt on index d’un logarithme, i l. 669. rf. VIII. 672. 6.
673. rf. Logarithme loglftiquc. IX. 641. 6. Méthode pour
trouver le logarithme de la fécante d’un arc. X IV . S36. a.
Tables des logarithmes. Suppl. I. 664. 6. Echelles angloifes
des logarithmes. Suppl. \l. 730. a , b. Foyci^ L o g a r i t h m i q
u e .
LO G A R ITH M IQ U E , {Géom.) courbe qui tire ce nom
de fes propriétés & de fes ufages dans la conftrufUou des
logarithmes, ik. dans l’explication de leur théorie. IX. 633. a.
Propriétés de la logaiithiuique. Ibid. 6.
Logarithmique. Quadrature de la logarithmique , XIII.
641. a.
Logarithmique , fptrale-. ConftruéUon de cette courbe. Propriétés
fingulicres de cette courbe , découvertes par M. Jacques
Bernoulli, (bu inventeur. Logarithmique fpirale , mile
fur le tombeau de ce géomètre. IX. 634. a.
Logarithmique, fpirale-. Lti loxodromie confidérée comme
une courbe de cette efpece. IX. 707. 6.
L o g a r i t h m i q u e s , {Baguettes. Echelles. J?r^/w.)Com:r.ent
ou peut fe procurer l’iiiftiumeiit de ce nom. Suppl. III. 768. a.
Le but de cette invention a été d’épargner aux calculateurs
d embarras de chercher les logarithmes dans les tables. Auteurs
qui ont publié différens inftrumeus pour cet ufage.
Leurs avantages Si iuconveuiens. Avantages particuliers des
règles logarithmiques de M. Lambert. Ibid. 6. Maniéré de les
conftruire. Ibid. 769, a. Leurs différens ufages. L Elles fervent
de tables pour les calculs ordinaires, c’eft-à-dire, de
liv r e t, de tables de divifion, &. de tables de réduaion. II.
Elles lervcnt de tables trigonométriques. Ibid. b. III, ElUs
Tome II.
préfement des tables aftronomiques, pour la déciinaifon des
degrés de l’écliptique, pour la iiautcur de chaque point de
l’équateur fur l’horizon , les afeenfions droites des points de
l’écliptique, les différences afcenfionuelles, les amplitudes
o r iiv es , les degrés des parallèles à l’équateur, les tables du
])lus coi:rt crépufcide. Ibid. 770. a. IV. Autres tables. La lé-
fraélion des rayons paffnnr de l’air dans le verre. Les jours
ou le tems dans lequel un arc-eu-ciel peut le former. Toutes
les tables dont les nombres doivent diminuer à raifon des
fuuis, dc.s angles d’incidence , ou autres. V . La réduélion des
fractions à de moindres termes. VI. La déiermlnaiion des
divlfions des nombres. VII. L’extraélion des racines. VIII.
Les progreffions géométriques. Ibid. b. IX. Les triangles
rcftiligues. X. Les triangles fphérujucs reélangles. XL Les
cadrans folaircs. Ibid, j - j i .a .
Lügarithmtqucs, {Echelles) Suppl. W.je^o. a , b. Suppl. IlL
768. rf , 6. — 77 1 . rf. V . 248. rf.
L O G A T E , ( Cuifne. ) gigot de mouton à la iogato. Comment
fe fait tec apprêt. IX. 634. 6.
LO G E , {Architeéî.) Dlftéreutes acceptions de ce mot.
Loge de comédie. IX. 634. 6.
L o ge , ( Comm. ) IX. 634. 6.
L o g e , ( Marin. ) IX. 634. 6.
L o g e , {Jardin.) IX. 634. 6.
L O G EM E N T , {A r t milit.)(Mxt le logement. D evoir de
l’officier major. Porteur de la route de fa mnjefté , lorfqu’il
arrive dans un lieu où il n’y a pas d'état-major. IX. 634. 6.
ieg-c/rfc/« du camp des Romains. Ouvrages que l'auteur de
cet article a confultés. Epoque à laquelle les Romains commencèrent
à connoitre l’arrangement d'un camp. Retranche-
mens qu’ils failoieni dans le lieu où l’on avoit tracé le camp.
Coimneut les foldats y devoient travailler. Logement des
premiers officiers. Efpece de tribunal de terre ou de gafon
qu’oD élevoic dans la principale place du camp. Ibid. 633. <7.
Partage 8c divifion des quartiers du camp. Diftributiou des
véiites cl.aus les corps des haftaires, des princes 8c des triai-
res. Détails des logeinens du camp , de la diftributiou du ter-
rein, 8c de la quantité qu’on eu donnoit à chacun. Ibid. b.
Plan du campement d’une armée romaine , compofee de
16800 hommes de p lé, 8c de 1800 chevaux , contenant en
quarré 2016 piés 8c un tiers de pié. Ibid. 6. Diverfes banderoles
dans lefquelles on diftinguoit le logement du colonel, .
ceux des tribuns, 5c celui des troupes des légions. Ibid,
637. rf.
L o g e m e n t , ( A n . mil::. ) dans l’attaque des p laces, efpece
de retranchement dans un ouvrage dont on vient de chaffer
l’eunemi. Logement du cliemin couvert. Logement dans la
demi-lune. IX. 637. a.
LO GH , ( Géogr. ) c’eft ainfi qu’on appelle un lac en Ecoffe.
Enumération des lacs les plus remarquables de ce pays, IX.
637. rf.
LOGICIENS. Leur ftyle. X V . 334. rf.
L O G IQ U E , {Phtlûjoph. ) définition. Ce t art fe nomme
quelquefois dialeüïquc, ou ï’art canonique. Quatre articles
Ibndameiuaux de cet art. Le lord Bacon tire la divifion de Ja
logique en quatre parties, des quatre fins qu’on s’y propofe.
Dilcrcdit oit la logique eft tombée par une fuite de l’abus
qu’on cn a fait. Logique des anciens Grecs. Inventeur de la
logique. Celle deslpéripatéticiens 8c des fto'iciens. Etat de la
logique depuis fou origine jufqu'aii fiecle paffé. IX. 637. 6.
Maniéré dont ou traite encore aujourd'hui la logique dans
les écoles. Diverfes quefiious ridicules qu’on agite encore
dans les imiverfitcs. Reftexions fur l’exercice qu’on prétend
donner à l’dp rit par ces queftions. Ibid. 638. rf. Eloge des principes
8c (le la méthode de Defeartes, que l’on doit regarder
comme le reftauratetir du raifounement. Eloge de l’ouvrage
intitulé l'art de penfer. Ceux de Locke & du P. Malle-
branche , relatifs au même objet. Aualyfe de l’ouvrage du
premier fur Y entendement humain. Ibid. b. Service que Malle-
branche a rendu à la doiffriiie de Defeartes. Son talent particulier
dans l’art du raifonneiucnt. Le vrai moyen de le réfuter
eft de l’arrêter au premier pas, 8c d’examiner févércment
fes principes. Examen de la logique de M. Leclerc, de celle
do M.de Crouzas./6/i.639. a. Et de l’ouvrage du P. Buffitr,
.intitulé cours des fciences. Logique latine de 'Wolf ; nous
n'avons rien de plus exaél fur cette fcience. Aualyfe du livre
de M. l’abbé de Condillac, iiniiulc, efai fur l ’origine des
connoiffanees humaines. Eloge de cet ouvrage. Ibid. 6. L’unique
fin de la logique eft de bien diriger nos jugemens ; enforte
que tout Ic"l efte à quoi elle peut fe rapporter , dcïit tendre
uniquement à ce but. Ibid. 640. a. Réponfe aux philofophês
qui fe récrient contre ce femiment, 8c qui prétendent que la
logique a pour fin les quatre opérations de I’efprit. Obferva-
ti(?us fur la diftinftion qu’ils établiffent entre la fin d’un art ,
Sc la fin de ceux qui l’enfeignenc ou qui I’ctudient. Il y a eu
aiitam de fins différentes de la logique, qu’il y a eu de diffé-
reiis logiciens. Ibid. b. Fin commune à tous les logiciens.'
Examen de cette queftion , fi la logique eft une fcience ou
un art. Autre queftion, favoir ft la logique artificielle eft
M m