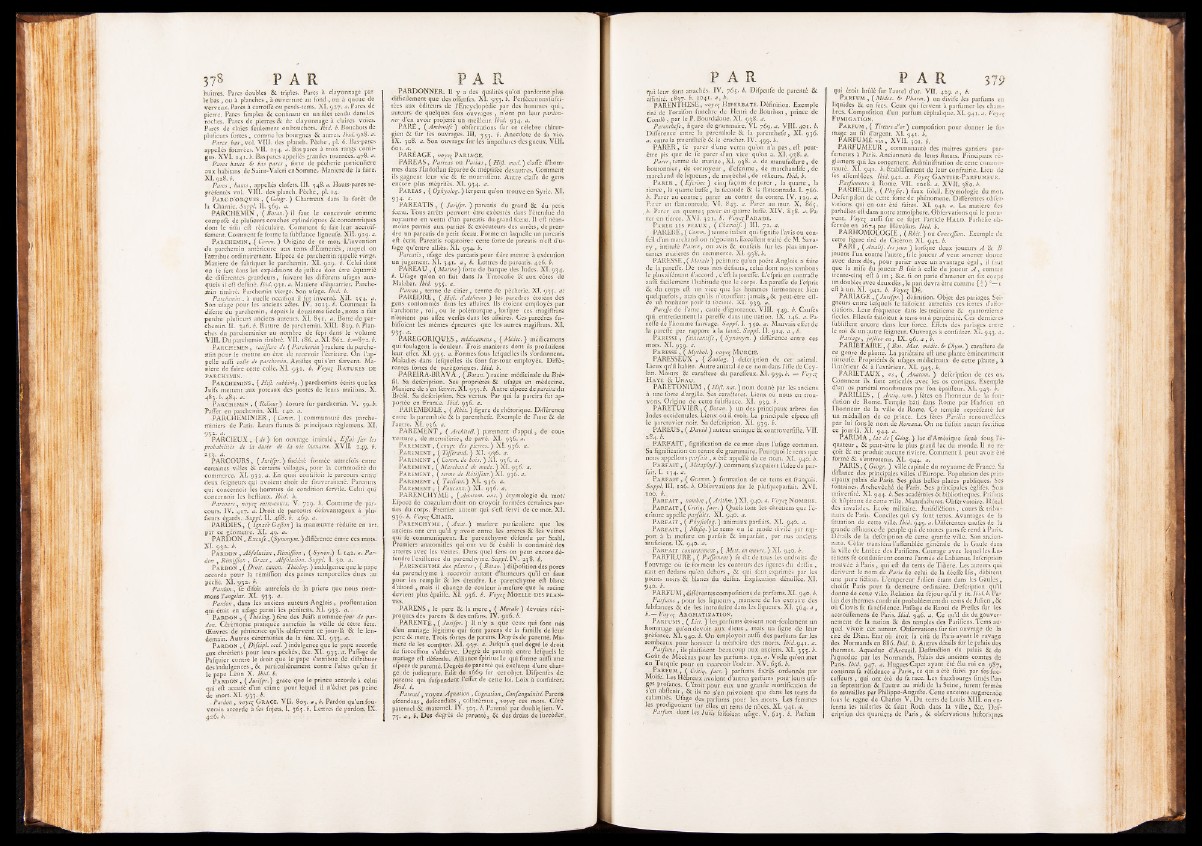
t ü ^
i ! »
l i i i i
'Ï s ' I
r : I
!!'Jlt !
378 P A R
huîtres. Parcs doubies & triples. Parcs n clayonnage par
le bas , on à planches , à ouverture au fund , ou à (jucue (le
verveux. Parcs à carrolTc ou peicls-ienis. XI. c^iy. Parcs de
pierre. Parcs fimples ik conlinaiu en un filet tendu dans les
roches. Parcs de picrrc.s & de clayotmage à claires voies.
P.rrcs do claies feulement ou bouchots, ibid. Bouchots de
pluficurs fortes, comme les bourgnes & autres, //vj". 928-‘t.
/^;rcj l) js , vol. VIII, des pinneh. Pêche , pi. 6. B.is-parcs
ajipellés fourrées. VII. 2^4. o. B.is parcs à trois rangs conii-
gus. X VI. 141. b. Bas p.iics appelles grandes tournées. 478. .1.
Paires h.ju!s & bas p.ms , forte de pêcherie particulière
aux habitaus de Saint-Vakri enSomme. Maniéré de la faire.
XI. 928. b.
Parcs , hauts, appelles clofets. III. 548.^. Hauts-parcs re-
préfentés vol. V l l l . des plancli. Pèche, pl. 14.
Parcd’orques , {Géogr. ) Chartreux dans la forêt de
la Chaniie. Suppl. 11. 369. a.
P AR CH EM IN , (Éotan.) il faut le concevoir comme
compofé de plufieurs couches cylindriques & concentriques
dont le tiiru cll réticulaire. Comment fe fait leur accroif-
fement. Comment fe forme la fubilancc ligneufe. XII. 929. a.
P a RCHEMîn , (Co.r:m.) Origine de ce mot. L’invention
du parchemin antérieure aux tems d'Eumeuès, auquel on
l'attribue orciimiiretnent. Elpece de parchemin appelle r/erç«’.
Maniéré de fabriquer le parchemin. X L 929. b. Celui dont
on fe iert dans les expéditions de jiiftice doit être équarrié
de clifïércntes grandeurs, fiiivant les diftérens ufages auxquels
il cA dcAiné. Ibid. 931. a. Maniéré d’equarrier. Parchemin
timbré. Parchemin vierge. Son ufage. Ibid. b.
Parchemin , à quelle occalion il fut inventé. X il. 334. a.
Son ufage pour les anciens aéles. IV. 1023. b. Comment la
difette du parchemin, depuis le deuziems Aecle,nous a fait
perdre pluAeurs anciens auteurs. XI. 831. a. Botte de parchemin.
II. 346. /a Rature de parchemin. XIII. 829. k Plan-
cites (lu pnreheminier au nombre de fept dans le volume
VIII. Du parchemin timbré. ^'1I. 186. a. X I. 862. b.— 872. b.
Parchemin , raiijuie de ( P.irchcmin ) raclure (lu parchemin
peur le mettre en état de recevoir récriture. On l'appelle
aiiAi colle de parchemin. ArciAcs qui s’en fervent. Maniéré
de faire cette colle. X L 931. l>. Voye^ Ratures de
PARCHEMIN.
Parchemins, {Hifl. rabbiniq.) parchemins écrits que les
Juifs mettent aux poteaux des portes de leurs mailbns. X.
483. b. 484. a.
Parchemin , ( Relieur) dorure fur parchemin. V . 39. b.
PaAer en parchemin. XII. 140. a.
PARCHEMINIER , {Coinm. ) communauté des parche-
ininiers de Paris. Leurs Aamts bc principaux réglemctts. XL
932. a.
PARCIEÜX , { d e ) fon ouvrage intitulé, PJfai fur tes
probabilités de ta durée de la vie humaine. X V ll. 249. b.
233. a.
PA R CO U R S , {Jurifpr.) fociété formée autrefois entre
certaines villes & certains villages, pour la coinmoilité du
commerce. XI. 932. a. En quoi confiAoic le parcours entre
(leux feicneurs qui avoient droit de fouveraineté. Parcours
qui concernoic les hommes de condition fcrvile. Celui qui
conccrnoic les beAianx. Ibid. b.
Parcours., voyc^ entre-cours. V . 729. b. Coutume de parcours.
IV. 417. a. Droit de parcours dél'avantageux à pluAeurs
égards. Suppl. II. 468. b. 469.
PARDIES, ( Ignace Gajîon) la manoeuvre réduite en art.
par ce géomètre. XI. 49. a.
P A R D O N , Exciife ,{Synonym. ) différence entre ces mots.
X L 93 2. h.
Pardon , Abfolucion , Rèmijfon , ( Synoné) 1. 142. a. Pardon
, Rérnijfion , Grace , Abfoluùon. Suppl. 1. 30. .a.
P.ARDON , ( Droit, canon. Théolog. ) indulgcncequele pape
accorde pour la rémlflion des peines temporelles dues au
péché. X L 932. b.
Pardon, fo difoit autrefois de la prier« que nous nommons
XI. 933. a.
Pardon , dans les anciens auteurs Anglois , proAernation
qui écoit en ufage parmi les pénitens. XL 933. a.
P a r d o n , ( 77i«o/og. ) fête des Juifs nommée 70«^ de pardon.
Cérémonie pratiquée autrefois la veille de cette fête.
OEuvres de pénitence qu’ils obfervent ce jour-lâ & le lendemain.
Autres cérémonies de la fê te .XL 933. a.
P a r d o n , ( Difeipt. ccd. ) indulgence que te pape accorde
aux chrétiens pour leurs péchés, ikc. X L 933. a. Paffage de
Pafquier contre le droit que le pape s’attribue de diAribuer
des indulgences , & particuliérement contre l’abus qu’en At
le pape Léon X. Ibul. b.
P a rd o n , ( Jurifpr.) grace que le prince accorde à celui
qui cA acculé d’un crime pour lequel il n’écliet pas peine
de mort. XL 933. b.
Pardon , voye^ G r a CE. V II . 803. a , b. Pardon qu’un fou-
vevain accorde à tes l'ujets. L 363. b. Lettres de pardon. IX.
426. b.
P A R
PARDONNER. 11 y a des qualités qu’on pardonne pît*
difficilement que des oAénfes. XL 933. é. Peiféciiricnsfulci-
tées aux éditeurs de l’Encyclopédie par des hommes qui ,
auteurs de quelques fots ouvrages , u'onc pu leur pardonner
d’en avoir projette un mcillenr. Ibid. 934. a.
PARÉ , ( Ambrvije ) obfcrvations fur ce célébré cliinir-
gien ik fur fes ouvrages. lU. 333. b. Anecdote de fa vio.
iX . 308. a. Son ouvrage furies impoAuics des gueux. V III.
601. a.
PA R É A G E , %’oyci Pariage.
P A R L A S , Parreas ou Patias, ( Hifl. mod. ) claffe d’hommes
dans rindoAan féparée & méprjféc des aim es. Comment
ils gagnent leur vie ék le noiirnlTent, Autre dalle de gens
encore plus inéprifés. XI. 934. a.
Pareas , ( Opiiyolog. ) ferpent qu’on trouve en Syrie. XL
934. a.
P.4.REATIS , ( Jurifpr. ) parentis du grand & du petit
fceau. Tous arrêts peuvent être exécutés dans l’étendue du
royaume en vertu d’un pareatis du grand fccau. Il cA néanmoins
permis aux parties &; exécuteurs des arrêts, de prendre
un pareatis du petit fceau. Forme en laquelle un pareatis
eA écrit. Pareatis rogatoire; cette forte de pareatis n'ell d’u-
lage qu’entre alliés. XI. 934. b.
Pareatis des pareatis pour faire mettre à exécution
un jugement. XI. 341. a , b. Lettres de pareatis. 426. h.
PAREAU , {Marine) forte de barque des Indes. XI. 934.
b. Ufage qu’on en fait dans la Tutocofie & aux cotes de
Malabar. Ibid. 933. .3.
Parcau , terme de cirier , terme de pêcherie. XL 933. a:
P A R ED R E , ( Hijl. d'Athènes ) les paredres étoient des
gens confommés dans les affaires. Ils croient employés par
l'archonte , roi , ou le polémarque , lorfque ces magiArars
n’étoient pas alfez verles dans les afffiires. Ces paredres fii-
biffoient les mêmes épreuves que les autres magiArats. XL
933. rf.
PAREGORIQUES , médicamens , ( Médec. ) médicamens
qui foulagent la douleur. Trois manières dont ils produifent
leur effet. XI. 933. a. Formes fous Icfquelles ils s’ordonnent.
Maladies dans Icfquelles ils font fur-tout employés. Diffé-,
rentes fortes de parégoriques. Ibid. b.
PAR EIRA -BRA V À , ( Botan. ) racine médicinale du Bré-
fil. Sa defeription. Ses propriétés & ufages en médecine.
Maniéré de s’en fèrvir. XI. 953. é. Antre efpece ù.tpareira du
Brcfil. Sa defeription. Ses vertus. Par qui la parctra fut apportée
en France. Ibid. 936. a,
PAREMBOLE , ( Rhét. ) Agure de rhétorique. Différence
entre la parembole ik la parenthefe. Exemple de l’ane 8c de
l’autre. XI, 936. a.
P A R EM EN T , { ArdiitcR.) parement d’appui, de cou-,
veriure , de meiniifcrie, de pavé. XI. 936. a.
Pa RE.MENT , ( coupe des pierres. ) XI. 936. a.
Parement , {Tijj'crand. ) XI. 936. a.
Parement , ( Comm. de bois. ) Xi. 936. a.
Parement, { M.trch.and de mode. ) XL 93(1, a.
Parement , ( terme de Rôtijfcur.) XL 936. a.
Parement , ( Tailleur.) XI. 93b. a.
Parement, {Fauconn.) XI. 936. a.
PAR ENCHYME , {Anaiom. anc.) étymologie du mot,'
Eipece de coagulnm dont on croyojt formées certaines parties
du corps. Premier auteur qui s’cA fervi de ce mot. X L
936./’. Jbyfj Chair.
Parenchyme , ( An.u. ) matière paifkcuUere que les
anciens ont cru qu’il y avoir entre les artères & les veines
qui fe communiquent, Le parenchyme défendu par Stahl.
Premiers anatomiffes qui ont vu & établi la coiuinuité des
ancres avec les veines. Dans quel fens on peut encore défendre
l’exiAcnce du parenchyme. S'«/?;)/. IV . 238. b.
P.xrenchyme des pLinies , ( .SoMn. ) dilpofition des pores
du parenchyme à recevoir autant d’humeurs qu’il en faut
pour les remplir 8c les étendre. Le parenchyme eA blanc
d’abord , mais il change de couleur à mefure que la racine
devient plus épaiffe. XI, 936. b. Voyc^ Moelle des plantes.
PAR EN S, le pere &. la mere , ( Morale ) devoirs réciproques
des jiarens & desenfans. IV. 916. b.
PAR EN T É , ( Jurifpr. ) Il n’y a que ceux (jiii font nés
d’un ntariage légitime qui font parens de la famille de leur
pere 8c inere.Trois fortes de parens. Degrés de parenté. Maniéré
de les compter. X L 937- a. Jufqu’à quel degré le droit
de fucceflîon s’obferve. Degré de parenté entre lefquels le
mariage cA défendu. Alliance fpirituclie qui forme aulTiunc
efpece de parenté. Degrés de parenté qui excluent d’une charge
(le judicature. Edit de 1669 fur cet objet. Difpenfes de
parenté qui fufpcndenc l’effet de cette loi. Loix à confiilter.'
Ibid. b.
Parenté , v o ye z Agnation , Cognation, Confanguinitc. Parens
afeendans, defeendans , collatéraux , ces mots. Coté
paternel & maternel. IV. 303. b. Parenté par doublejien. V .
73. a , b. Des degrés de parenté, 8c des droits de fuccéder
P A R
qui leur font attacliés. IV . 763. b. Difpcnfe de parenté &
affinité. 1837- f’-
PARENTHESE, voyc^ Hiperbate. DéAnicion. Exemple
tiré de l’oraifon fiinebre de Henri de Bourbon , prince de
Cou dé , par le P. BoiirdrJoue. XL 938. a.
Parenthefe, Agure de grammaire. V L 769. a. VIII. 401. b.
Différence entre la parembole & la parentliefe, XL 936.
a. entre la parenthefe 8c le crochet. IV. 499. b.
P A R E R , fc parer d’une vertu qu’on n’a pas , eA peut-
être pis que (le fc parer d’un vice qu’on a. XI. 938. a.
Parer, terme de marine,XL 938. n. de manufaélure, de
bouionnier, de corroyeur, d’efcriinc, de imrchandife , de
marchand de liquenirs, cio marédial,de relieurs. Ibid. b.
Parer , { Ejirime ) cinq façons de parer , la quarte , la
tierce , la quarte baffe , la l'econdc & la Aanconnacle. I. 766.
b. Parer au contre; parer au contre du contre. IV. 12g. a.
Parer en Aancoiinadc. VI. 843. a. Parer au imir. X. 863.
, Parer en quarte; parer en quarte baffe. X IV . 858. «. Parer
en tierce. XVI. 321. b. Parade.
Parer les peaux, {Chamoif.) III. 72. a.
PARERE, ( Comm. ) terme italien qui AgniAc l’avis ou con-
foil d'un maichund ou négociant. Excellent traité de M. Sava-
r y , intitulé IKirere, ou avis & confeiis fur les plus importantes
matières du commerce. XL 938. é.
PARESSE, ( .’IL'm /i; ) peinture qu’un pocre Anglois a faite
(le laparefl'e. De tous nos défauts, celui dont nous tombons
le plus aifémem d’accord , c’eA la pareffe. L’efprit en coinraéle
atilU facilement l'habitude que le corps. La pareffe de i’efprii
8c du corps cA un vice que les hommes furmontent bien
quelquefois, mais qu'ils n’étüufi'ent jamais , Sc peut-être d i ce
un honliciir pour h fociété. X L 939. a.
PareJJ'e de l’amc, caufe d’ignorance. VIII. 349. b. Cniifes
qui entreiiemienc la pareffe dans une nation. IX. 146. a. Pareffe
de l’homme fauv.age. Suppl. I. 3 30. a. Mauvais effet do
la pareffe par rapport à la fauté. Suppl. II. 914. a , b.
Pa r e s se^ faincantife, {Synonym.) diA'érence entre ces
mots. XI. 95g. a.
Paresse , ( Mythol. ) voycr Murcie.
PARESSÉUX , ( Zoolog. ) ciofeription de cet animal.
Lieux qu’il habite. Autre animal de ce nom dans riffe de Ccy-
lan. Moeurs 8c caraéfore du pareffeux. XI. 939./». — Voy::;
Haye 8c Unau.
PAR ETONIUM , ( ITif. nat. ) nom donné par les anciens
à une forte d’argillc. Ses carafleres. Lieux oit nous en trouvons.
Origine de cette fiibAancc. XI. 939. b.
P AR E T ü V IE R ,( .^ c?m/i. ) ui Il des principaux arbres des
Indes occidentales. Lieux où il croit. La principale efpece eA
le paretuvicr noir. Sa defeription. XI, 939. b.
PAR EUS, ( David ) auteur critique 8c controveifiAc. VU .
284. b.
P A R F A IT , ffgniAcation de ce mot dans l'ufage commun.
Sa ffgniAcation en terme de grammaire. Pourquoi le tems que
nous appelions parfait, a été appelle de ce nom. XL 940. b.
Parfait , ( Mèr.iphyf ) comment s’acquiert l’idée du parfait.
I. 134. a.
Parfait , ( Gramm. ) formation de ce tems en françois.
57ip/?/. III, 126. />. Oblcrvations fur le plufqucpatfait. XVI.
100. h.
Parfait , nombre , ( Arirhm.)!^. 940. a. Voyc^ NOMBRE.
Parfait , ( Critiq. facr. ) Quels font les chrétiens que l'écriture
appelle parfaits. XI. 940. a.
Parfait , ( Pkyfiolog. ) animaux parfaits. XI. 940. a.
Pa r fait , ( Mufq.) le tems ou le mode divifé- pur rapport
à la mefure en parfait Sc imparfait, par nos anciens
miificiens. IX. 940. a.
Parfait contentement, { Jtlett. en anvre. ) XL 940. b.
PARFILURE , ( Pajement) fe dit de tous k s endroits de
l'ouvrage où fe Airmcnt les contours des ngurcs du dcllln ,
tant en dedans qu’en dehors , 8c qui font exprimés par les
points noirs 8c blancs du dcfiin. E.xplication détaillée. XI.
940. k.
PARFUM , différentes compoAtions de parfums. X I. 940. b.
Parfums , pour k s liqueurs , manière de les extraire des
AibAances 8c de les introduire dans les liqueurs. XL 364- a ,
b .~ V o y e i A rOM.\T1ZATION.
Parfums , ( Lut. ) les parfnms étoient non-feulement un
Iiomnuige qn’on devoir aux dieux , mais un figue de leur
préfence. XL 940. b. On employoit aiilTi des parfums fur les
lombeaux pour honorer 1a mémoire des morts. Ibid.^^t. a.
Parfums , ils plaifoieiK beaucoup aux anciens. XI. 353. b.
Goût de Mécénas pour les parfums. 192. a. Voile qu’on met
en Turquie pour en recevoir l’odeur. X V . 636. b.
Parfum , ( Critiq. facr. ) parfums facrés ordonnés par
Moife. Les Hébreux avoient d'autres parfums pour leurs itfa-
ges profanes. C ’étoii pour eux une grande mortiAcation de
sen abAenir, 8c ils ne s’en privoient que dans les tems de
calamites. Ufage des parfums pour les morts. Les femmes
les priadigiioient fur elles en tems de nuccs.XI. 941. a.
Parfum dont les Juifs faifoietu ufage. V . 615. b. Parfum
P A R
qui étoit brillé fur raiitcl d’or. VII, 429. a , b.
P a r fu m , {Médec. &■ Pharm.) on divife les parfums en
liquides Sc en fees. Ceux qui fervent à parfumer les cham bres.
Compofition d’un parfum céphalique. X L 941. «. yoyer
F u m ig a t io n .
P a r f u m , ( Tireurs d'or) compofition pour donner le fu mage
au fl! d’aigcnt. XI. 041, b.
Pa r f u m é vm , x v i i . 301. b.
PARFUMEUR , communauté des maîtres gantiers parfumeurs
à Paris. Ancienneté de leurs ffatuts. Principaux rc-
gkincns qui les concernent. Adminiffration de cette communauté
X L 941, b. Établiffemcnt de leur confrairie. Lieu de
fes affcmblées. Ibid.^)^,^. a. G a n t ie r -Pa r fu m e u k .
Parfumeurs à Rome. VII. io i8 . 4. X V ll. 380. b.
PARHELIE, {Phy fiq.) faux foleil. Etymologie du mot.
Defeription de cette forte de phénomène. Différentes obfer-
vaiions qui en ont été faites. XL 942. a. La matière des
parliélies eff dans notre atmofphere. Ohfervations qui k prouvent.
Foye:^ auffî for ce fujec l’article H a lo . Parliélie ob-
fervée en 1674 par Hévélius. Ibid. b.
PARHOM OLOGIE , {Rhét.) ou Concejfon. Exemple de
cette Agure tiré de Cicéron. XL 942. b.
P A R I , {AnaliJ. des jeux ) lorfque deux j oucurs A Sc B
jouent l’iin contre l’autre , A le joueur A veut amener douze
avec deux dés, pour parier avec un avantage é g a l, il f.iuc
que la mife du joueur B foit à celle du joueur A , comme
trente-cinq eff à un ; 8cc. A on parie d’amener en Ax coups
un doublet avec deux dés , le pari devr.a être comme ( ^ ) l
eff à un. XI. 942. b. Voyc^ DÉ.
PAR IAGE , {Jurifpr.) déAnition. Objet des pariages. Seigneurs
entre lefquels fe faifoient autrefois ces fortes d’affo-
ciaiions. Leur fréquence clans k s treizième 8c quatorzienie
Aecles, Elles fe failoieut à tems cm à perpétuité. Ces dernières
fubfiffein encore dans leur force. Eff'cts dc.s pariages tinte
le roi Sc un autre feigneur. Ouvrages à confulier. XI. 943. a.
Pa.'i.igc, jujîice en, IX. 96. a , b.
PARIÉTAIRE , ( Mat. rnédic. & Chym.) caraélere de
ce genre do plante. La pariétaire eff une plante éminemment
nitreufe. Propriétés 6c ufages médicinaux de cette plante, à
l’intérieur 8c à l’extérieur. XL 943. b.
P A R IE T A U X , Os, ( Anatom. ) defeription de ces os.
Comment ils font articulés avec les os contigus. Exemple
d’un os pariétal monftrueux par fon épaiffeur. XL 943. b.
PAPlILIES , ( Amiq. rom. ) fêtes en l’honneur de la fondation
de Rome. Temple bâti dans P«.omc par Hadrien en 1 honneur de lu ville de Rome. Ce temple reprefemé fur
un médaillon de ce prince, Les féte.s P.iriUa rcnouvellées
par lui fous le nom de Roman.i. On ne f-iifoit aucun facriAce
ce jour-Ià. XI. 944. a.
P A R IM A , lac de ( Géog. ) lac d’Amérique Acué fous l’équateur
, Sc peut-être le plus grand lac du monde. Il ne reçoit
6c ne produit aucune riviere. Comment il peut avoir été
formé Sc s’entretenir. XI. 944. a.
PAR IS, {Géogr. ) ville capitale du royaume de Franco. Sa
diffance des principales villes d’Europe. Population des principaux
palais de P.-tris. Ses plus belles places publiques. Ses
fontaines. Archevêché de Paris. Ses principales églifes. Son
univerlitc. XL 944. b. Scs académies 8c bibliothèques. Prifons
8c hcipitaiix de cette ville. Manufaéiures. Obfervatoire.
cle.s invalides. Ecole militaire. JurifdiéVions, tours Sc tribu-
luiiix de Paris. Conciles qui s'y font tenus. Avantages de la
fiaiation do cette ville. Ibid. 943. a. Différeiues caiifes de la
grande affluence de peuple qui de toutes parts fe rend à Paris.
Détails de la defeription de cette grande ville. Son ancienneté.
Céfar transféra l’aff'emblée générale de la Gaule dans
la ville de Lutcce des Parifiens. Courage avec lequel les Lu-
icticns fc conduillrcnt contre l'année de Labienus. Infcription
trouvée à Paris, qui eff du tems de Tibcre. Les aurems qui
dérivent le nom de Paris de celui de la cléeffe Ifis, débitent
une pure Aélion. L ’empereur Julien étant dans k s Gaules ,
clioifit Paris pour fa (Icmeure ordinaire. Defeription qti'il
donne de cette ville. Relation du féjour qu’il y ht. Ibid. b. Palais
des thermes conffruit probablement du tems de Julien , Sc
où Clovis Ai fa réfidence. Paffage de Raoul de Preffes fur les
accroiffemens de Paris. Ibid. 946. a. C e qu’il dit du gouvernement
de la nation Sc des temples des Parifiens. Tems auquel
vivoit cet auteur. Obfcrvations fur fon ouvrage de la
cité de Dieu. Etat où étoit la cité de Paris avant le ravage
des Normands en 886. Ibid. b. Autres détails fur le palais des
thermes. Aqueduc d’Arcueil. DellruéHon du palais 8c de
raqucduc par les Normands. Palais des anciens comtes de
Paris. Ibid. 947. a. Hugiies-Capct ayant été élu roi en 987,
continua fa réfidence à Paris, ce qui a été fuivi par fes fiic-
ceffeurs , qui ont été de fa race. Les fauxbourgs Atués Tun
au feptemrion 8c l'autre au midi de la Seine, furent fermés
de murailles par Philippc-Aiiguffe. Cette enceinte augmentée
fous le régné de Charles V . Du tems de Louis XIII. on en-
fonna les tuileries 8c fiint Roch dans la v ille , 8cc. D e feription
des quai'ciçrs de Paris, Sc obfervaùons hiftoriqties