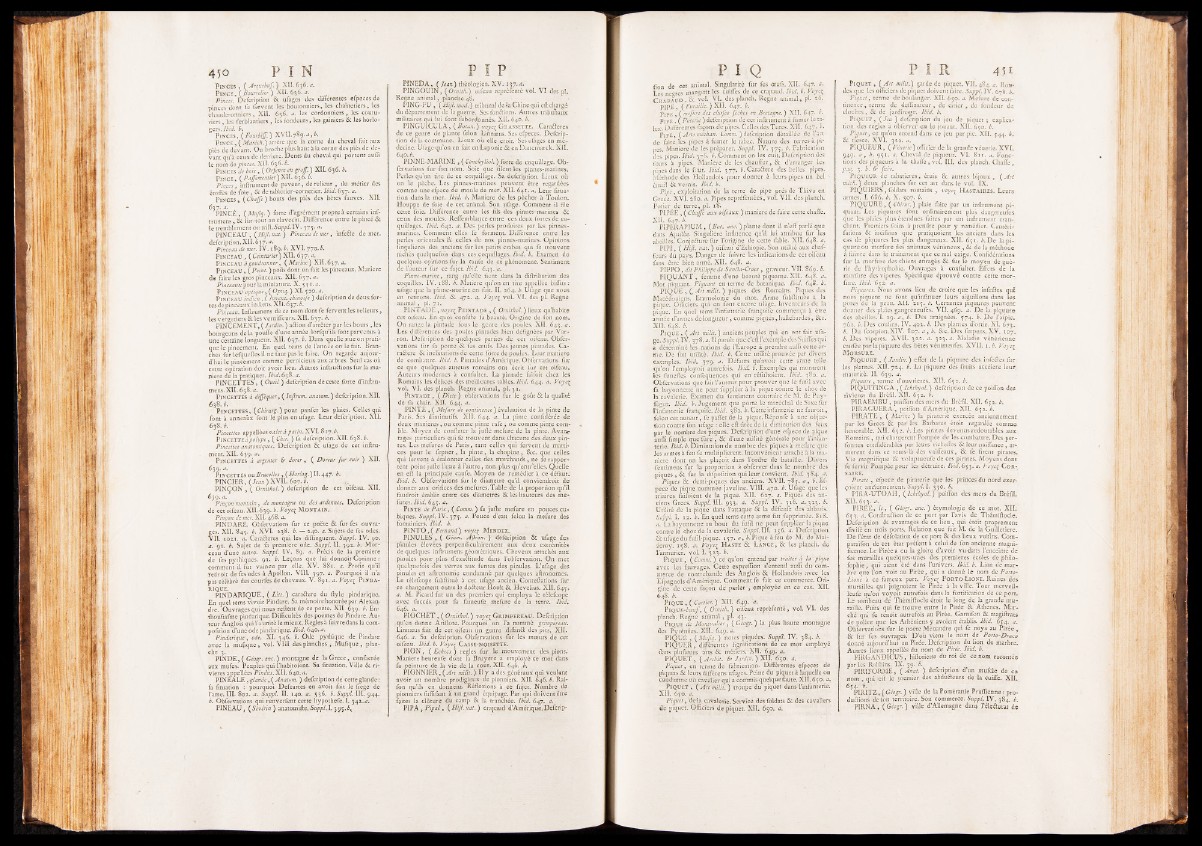
if .
j; î
nil
ä I
1' ■ i,!|
ii i:i r . H
I ‘ f I
1-^ 1
ili 1'
'Si'
450 P Î N Pinces , ( A'^ueb/f.) X ll. 6-1,6. a.
P ince , ( 636, j .
Pinces. Di.'fcnption 6c ulagcs des diftérentcs efpeces de
pinces dont le fervent les bouionniers, les chainetiers, les
clianderonniers , XII. 636. J. les cordonniers, les couturiers
les feiblamiers , les fondeurs, les gainiers ëc k sh o ilo -
cers. Il’-'J. b.
Pinces, {Fourbi]]'.) X V I I .789..2,é.
P ince , (iWjrccA.) arrête que la corne du cheval fait aux
piés de devant. On broche plus haut à la corne des pics de devant
qu'à ceux de derrière. Dents du cheval qui portent aula
le nom de pf2jfr.o X ll. 6 3 6 . . , ,
Pinces de bois , ( Or/evre en groff. ) XII. 636.
Pince, ( P.t]]einentier)XU. 636. b.
Pinces indriimenf do paveur, de relieur , du métier des
étoffes de foie , üc de tabktier-cometier. Ibid. 637- a.
Pinces, {Ch.-i!}c) bouts des pics des bêtes fauves. XII.
V iN C É , ( Mufiq. ) forte d’agrément propre à certains inf-
trumens, & liir-tout tut clavecin. Différence entre le pincé &
le tremblement oit trill. 5t2/-p/. îV . 375. a.
PINCEAU , (//{/?.«.2£.) Pince.iudemer, mfcéte de mer.
clefcrintion. X ll. 637-
Pince.:u de mer. IV . 189. i. X V I. 770. é.
Pinceau , {Ceimurier) XII. 637. <2._
Pinceau .2 gouiironnrr , {AÎJrine) X I I .637.^.
Pinceau , { Pci/i/.) poils dont on fait les pinceaux. Manicre
de faire k s gros pinceaux. XII. 637. n.
Pincenuxpon: la miniature. X. 5 5 i.c .
Pinceau oi'iiquc,{ Opiiq.) XI. 520. .2.
Pinceau indien , ( Invent, chinoije ) dcfcrlption de deuxfor-
tes de pinceaux indiens. X îl. 6 37. é.
Pinceou. Inffrumens de ce nom dont fe fer\ ent les relieurs,
les vergetiers & k s verniiTcurs. XII. 637. h.
PIN'CEMENT, (/trtfi«. ) a£hon d'arrêter par les bouts ,le s
bourgeons de l.i pouffe d’une année lorfqii’ils font parvenus à
une c^ertaine longueur. XII. 637. b. Dans quelle vue on pratique
le pincement. En quel tems de raniiéc on le fait. Branches
fur lefquvlks il ne faut pas le f.,ire. On regarde aujourd'hui
le pincement comme pernicieux aux arbi es. Seul cas où
cette opération doit avoir lieu. Autres inllruffions lur la maniéré
de la pratiquer. lb:d.6iZ. a.
P IN C E T T E S , {O u t il) defeription deeewe forte d'inffru-
men5.X l I ,638..2.
Pincettes à diJJ'iquer, {Injîrum. anatom. ) defcription.XIÎ.
638. é.
Pincettes, ( C/tirurg.) pour panfer les plates, Celles qm
font à anneaux font k plus en ufage. Leur defcrlption. XII.
638. é.
Pincettes appellees Viî/et .2p a n n .X \ I. 817.A
PiNCETTEùpolype, { Chir. ) fa defcription. XII. 63 8. b.
Pincettes anatomiques. Defeription & ufage de cet inftru-
ment. XII. 639-.2.
Pincettes .2 argenter & dorer , ( Doreur fur cuir ) XII.
639. a.
Pincettes ou Brucelles , {Hor!og.)l\.44,j. b.
P INC IER, ( 7e<2/2 ) X V ll. 607. é.
PINÇON , ( Ornithol. ) dcfcrlption de cet oifeau. XII.
630. a.
Pinçon montain, de montagne ou des ardennes. Defeription
de cet oifeau. XII. 639. é. Montain.
Pinçon de mer. XII- 468. a.
PINDARE. übfervations fur ce poète & fur fes ouvrages.
XII. 843. b. X VI. 238. b. — 240. a. Sujets de fes odes.
VU . 1021. a. CaraReres qui k s diAinguent. Suppl. IV. 90.
a. 91. b. Sujet de fa premiere ode. Suppl. Il, 392. b. Morceau
d’une autre. Suppl. IV . 89. a. Précis de la premiere
de fes pythiques. 91. b. Leçons que lui doiinoit Corinne :
comment il fut vaincu par elle. XV. 881. a. Profit qu’il
retiroit de fes odes à Apollon. V lll. 397. a. Pourquoi il n’a
pas célébré des courfes de chevaux. V. 891. a. Voye^ Pinda-
r iq u e .
P IN D A R IQ U E , ( i-’ff. ) caraélere du ffylc pindarique.
En quel tems vivait Pindare. Sa mémoire honorée p«r Alex.m-
dre. Ouvrages qui nous reffent de ce poète. XII 639. h. En-
thoufiafme pindarique. Difficultés des poemes de Pindare. A u teur
Anglois qui l'a imité le mieux. Pvcgles à fuivre dans la com-
pofitioii d’une ode pindarique. Ibid. 640. a.
Pindarique, ode. XI. 346. b. Ode pythique de Pindare
avec la mufique , vol. VII I des planches, Mufique, planche
3.
PIND E , ( Géogr. <2.2c. ) montagne de la G r e c s , confacrée
aux mufes. Peuples qui l'habitoient. Sa fftuation. Ville & rivieres
appellees Pindus. XII. 640. a.
PINÉALE 5 glande, ( Anatom. ) defeription de cette glande :
fa fituanon : pourquoi Defeartes en avoir fait k ficge de
l’aine. III. 802. a. Suppl. II, 140, a. 336. b. Suppl.Wl.
b. Obfervations qui renvcrfenc cette hypothefe. I. 342.<j.
P INEAU, {Sévirin) anatomiffe. ■ St//’/'/. I. 395.^,
P î P P îN E D A , {Jean) théologien. X V . t']’j.a .
PINGOUIN , ( Ornith.) oifeau rcpiéfcmc vol. V I des p!.
Règne animal, planche 48.
i'ING-PU , ( Hiji.rnod.) tribunal de la Chine qui eff chargé
du département de la guerre, Scs fonctions. Autres iribimaux
militaires qui lui font fubordonnés. XII. 640. b.
P IN G U ICU LA , {Botan.) voyei Gsassette. Caraéleres
de ce genre de plante felon Liniiæus. Ses cfpeces. Defeription
do la commune. Lieux où elle croît. Ses ufages en médecine.
Ufage qu’on en fait en Laponie & en IDancmarck. XII.
640. é.
PINNE-MARINE , ( Co/ic/iy/k/. ) forte de coquilhage. Ob-
fervatioris lur fon nom. Soie que filent k s pinnes-marines.
Perles qu’on tire de ce coquillage. Sa defeription. Lieux où
on k pèche. Les pinnes-marines peuvent être regardées
comme une efpecc de moule de mer. XII. 641. a. Leur fitua-
tion dans la mer. Ibid. b. Manicre de les pécher à Toulon.
Houppe de foie de cet animal. Son ufage. Comment il file
cette foie. Différence entre les fils des pinnes-marines Se
ceux des niouks. Reffembhmce entre ces tleux loues de coquillages.
Ibid. 642. a. Des perles produites par k s pinnes-
marines. Comment elles fe forment. Différence entre les
perles orientales & celles de nos pinnes-marines. Opinions
fmgulieres des anciens fur les petits crabes qui fe trouvent
nichés quelquefois dans ces coquillages. Ibid. b. Examen de
quelques opinions fur la caufe de ce phénomène. Sentiment
de rameur fur ce fujet. Ibid. 643. a.
Pinne-marinc, rang qu’elle tient dans la dlffributioii des
coquilles. IV. 188. b. Matière qu’on en tire appellee biffus :
ulagc que la pinne-marinc en fait. II. 264. b. Ulage que nous
en retirons. Ibid. Si. 472. a. Voycç_ vol. VI. des ph Rogne
anima! , p!. 71.
PINT AD E , voyci Peintade , ( Ornithol. ) lieux qu’habite
cct Oifeau. En quoi confiile f.i beauté. Origine de ion nom.
On range ta pintade foin-- k genre des poules. XII. 643. a.
Les différences des poules pintades bien dêfigtiées par Var-
ron. Defetiption de quelques parties de cet oiseau. Oblêr-
vations fur fa ponte Sc fes oeufs. Des jeunes pintades. Ca-
raiiere & inclinations de cette forte de poides. Leur maniéré
de combattre. Ibid. b. Pintades d'Amérique. Obfervations fur
ce que quelques auteurs romains ont écrit fur cet oifeau.
Auteurs modernes à confultcr. La pintade faifoit chez k s
Romains les délices des meilleures tables./é/i/'. 644. a. Voycrç_
vol. V l. des planch. P.egne animal, ph 31.
Pintade, {D ic te ) obfervations fur k goût ôc la qualité
de fa cliair. XII. 644. <2.
PINTE , ( Mefure de cintr/ne/’ce ) évaluation de la pinte de
Paris. Scs diminutifs. XII. 644. a. La pime confidérée de
deux maniérés, ou comme pime rafe , ou comme pinte comble.
Moyen de confiater la jullc mefure de la pince. Av.atv
tages paiticuliers qui fe trouvent dans chacune des deux pintes.
Lesmefures de Paris, tant celles qui fervent de matrices
pour le fepticr, la pinte, la choplne, &c. que celles
qui fervent à étalonner celles des marchands, ne fe rapportent
point juffe l’une à l’autre, non plus qu’entr’elks. Quelle
en efi la principale caufe. Moyen de remédier à ce défaut.'
Ibid. b. Obfervations fur le diamètre qu’il convlendroit de
donner aux orifices des mefures. Table de la proportion qu’il
faudroit établir entre ces diamètres & k s hauteurs des me-,
fures. Ibid. 643. a.
Pinte de Paris, ( Comm.) fa juffe mefure en pouces cubiques.
Suppl. IV . 373. a. Pouce d’eau felou la mefure des
fontainiers. Ibid. b.
P l'N T O , { Fernand) voyc{ MendeZ.
PINÜLES , ( Géom. Aftron. ) defeription 8e ufage des
pillules élevées perpendiculairement aux deux extrémités
de quelques inffrumens géométriques. Cheveux attachés aux
pinnies pour plus d’exaffitiide dans Tobfervation. On met
quelquefois des verres aux fentes des pinuks. L’iifage des
pillules en affronomie coiidaniiic par quelques affronomes.
Le télcfcopc fubftitué à cet ufage ancien. Conteftations fut*
ce changement entre k dofteur Hook Se Hevelius. XÏT. 643.
a. M. Picard fut un des premiers qui employa le télefeope
avec fuccés pour fa faiiieufe mefure de la terre. Ibid.
646. <2.
P IÜ C H E T , ( Ornithol.) C rimpereau. Defeription
qu’en donne Ariffote. Pourquoi 011 l’a nommé grimpereau.
Limioeus fait de cet oifeau un genre diftinél des pics. XII.
646. a. Sa defeription. Obfervations fur k s meeurs de cet
oifeau. Ibid. h. Voycç_ Casse-noisette.
P IO N , ( Echecs } regies fur k mouvement des pions.
Maniéré heureufe dont la Brnyere a employé ce mot dans
fa peinture de la vie de la cour. XII. 646. b.
PION NIER, miiu. ) Il y a des généraux qui v euknt
avoir un nombre prodigieux de pionniers. XII. 646./>. Rai-
fon qu’ils en donnent. Réflexions à ce fiijcc. Nombre de
pionniers fuffifant h mi grand équipage. Par qui doivent être
faites la clôture du camp 8e la tranchée. Ibid. 647. a.
V IŸ A , P ip a i, {H if .n a i.) crapaud d'Amérique.Defcrlp-
P I Q fion de cct animul Singularité fur fes oeufs. XII. 647- et.
Les nevres mangent les cuiffes de ce crapaud. Ibid. b. Voyei
C rapaud . Sc vol. VI. des planch. Regne anima!, ph a6.
PIPE, {Fut.ùlle.'jXW. 647. b.
P ipe , ( mefure des c/tofes feches en Bretagne. ) XII. 647. b-
Pipe , ( Poterie ) defeription de cct inffrument à fumer le tabac.
IDifféremcs façons de pipes. Celles des Turcs. XII. 647- / •
pjpE, { Arts mée/ian. t'u/w.vi. ) defcrijition détaillée de l’art
de faire les pipes à fumer le tabac. Nature des terres à pipes.
Maniéré de les préparer. Suppl. IV . 375. b. Fabrication
des pipes./éit/. 376. />. Comment on les cuit. Defeription des
fours à pipes. Maniéré de les chaulier, & d'arranger k s
pipes dans k four. Ibid. 377. b. Caraftere des belles pipes.
Méthode des Hollandois pour donner à leurs pipes un bel -
émail 8e vernis. Ibid. b.
Pipe, exploitation de la terre de pipe près de Tlùva en
Grèce. XVI. 280. a. Pipes repréfemées, vol. V i l. des plancli.
l'oticr de terre, pl. 18.
PIPÉE , ( Clmfe aux oifeaux ) manière de faire cette chaffe.
X ll. 647. b.
PIPERAiffUM , {Bot. anc. ) plante dont il n'eff parlé que
dans Apulée. Singulière influence qu’il lui attribue fur k s
abeilles. Coujeélurc fur l’origine de cette fable. XII. 648. a.
P IP I, ( Hiß. nul. } oifeau d’Ethiopie. Son utilité aux cliaf-
fairs du pays. Danger de fuivre les indiciuions de cet oilcau
fans être bien armé. X ll. 648. a.
PIPPO , dit Philippe de SanHa-Crocc , graveur. "V IT. 869. b.
P IQ U A N T , femme d’une beauté piquante. X ll. 648. a.
Mot piquant. Piquant en terme de botanique. Ibid. 648. b.
P IQU E ,(.2 2 22 /2 / . ) piques des Romains. Piques des
Macédoniens. Etymologie du mot. Anne fiibffituée à la
pique. Officiers qui en font encore ufage. Inventeurs de la
qùque. En quel tems riiifanterio françoife commença à être
armée d'armes de longueur, comme piques, hallebardes, 8ec.
XII. 648. b.
Piq ue , { A n mi/it.) anciens peuples qui en ont fait iifa-
gc. Suppl. IV. 378. a. Il paroit que c ’effl’exemple des Suiffes qui
a déterminé les nations de l’Europe à prendre auffi cette arme.
De fon luilité. Ibid. b. Cette utilité prouvée par divers
exemples. Ibid. 379. a. Défauts qu’avoit cette arme telle
qu’on l'cmployoit autrefois. Ibid. b. Exemples qui montrent
les funeffes conféquences qui en réfultoienr. Ibid. 380. a.
Obfervations que fait l’auteur pour prouver que k fufil avec
fa bayonnette ne peut fiippker à la pique contre le choc de
la cavalerie. Examen du fentiment contraire de M. de Puy-
fégur. Ibid. b. Jugement que porte le maréchal de Saxe fur
l’infamerie françoife. i/’if/. 382. i. Cette infanterie nefauroit,
d o n cet auteur, fe paffer de la pique. Reponfe à une objection
contre fon ufage : elle eft tirée de la cUmiinition des feux
par le nombre des piques. Defeription d’une efpece de pique
auffi fimple que ITive , 8c d’une utilité générale pour l’infanterie.
Ibid. b. Dimiiuuion du nombre des piques à mefure que
les armes à feu fe muUipÜerenc. Inconvénient attaché à ia lua-
jiiere dont on les plaçoit dans l'ordre de bataille. Divers
fentimens fur la proportion à obferver dans k nombre des
piques , 8c fur la difpofitlon qui leur convient. Ibid. 384. a.
Piques 8c demi-piques des anciens. XVII . 783. a , b. El-
pecc de pique nommée javeline. VIII. 470. b. Ufage que les
triaires failoient de la pique. XII. Ö27. a. Piques des anciens
Grecs. Suppl. Ill- 933. a. Suppl. IV . 316. .2. 323. b.
Utilité de la pique dans l’attaque SÊ la défonfe dos abbatls.
Sufpl. I. 12. b. *En quel tems cette arme fut fupprimée. 810.
22. La bayonnette au bout du fufil ne peut fuppléer la pique
contre le choc de la cavalerie. Suppl. Ilf. 1 36. a. Defeription
SEufagedu fiifil-pique. 137. a, /'.Pique à feu de M. de Mai-
zeroy. 138. a. l'oycç_ Haste 8e Lance, 8e k s planch, de
l'armurier, vol. I. 323. b.
Piq u e , {Comm.) ce qu’on entend par traiter à la pique
avec k s fauvages. Cette cxpreffion s’entend aiiffi du commerce
de contrebande des Anglois 8c Hollandois avec les
Efpagnols d’Amérique. Comment fc fait ce commerce. O rigine
de cette façon de parler , employée en ce cas. XII.
648. b.
Pique , ( Cjrr/Vr.) XII. 649. a.
PiQUE-éoe/*/, ( G;722f/2. ) oifeau reprefenté, vol. 'V I. des
planch. Regne animal , pl. 43.
Pique de Monivalicr, { Géogr. ) la plus haute montagne
des Pyicnées. X ll. 649. .2.
P K ^ U É , {Muß.;. ) notes piquées. Suppl. IV . 384. b.
P IQ U E R , différentes figmfications de ce mot employé
d.ans plufiettrs arts 8e métiers. XH. 649. a.
P IQ U E T , {Archil. & J.U din.) X ll. 6^0. a.
Piquet, en terme de fabrication. Dift'crenies efpcces de
piquets Scieurs dift'érens ufages. Peine du piqueta laquelle on
condamne un cavalier qui a commis quelque faute. X II. 630. a.
Piquet , ( A n mi'd I troupe du piquet dans l’infanterie.
X ll. 650. a.
Piquet, delà cavalerie. Service des foldats 8c des cavaliers
de piquet. Officiers de piquet, XII. Ö50. a.
F 1 il 45 î
Piquet , ( A n rnilit. ) garde de piquet. V i l . 484. a. Rondes
que k s oilicicrs do piquet doivent faire. Suppl. IV. 678. b.
Piquet, terme de boulanger, XII. 630. .2. Mefure de continence
, tenue de doffuiateur , de ciricr , de fondeur de
cloches, Sc do jardinage. Ibid. b.
Piquet, {Jeu ) defiripiion du jeu de piquet ; explication
des règles à obferver en le jouant. X ll. 630. b.
Piquet, ce qu’on entend dans ce jeu par pic. X ll, 544, b.
Sc tferce. X V I . 322. a.
PIQU EU R, ( /V/2cr2£) officier de la grande vénerie. X V L
949. .2, b. 931. a. Cheval de piqueur. VI, 811. a. Fonctions
des piqueurs à la th j f ïe ,v o l. III. des planch. Chaffe,
p.ig. 3. ê. 6’ fuiv.
Piqueur do tabatières, étuis 6c autres b ijo u x , {A r t
inéch.) doux planches fur cet ait dans le vol. IX.
P IQ U IER S , foldats romains , voyeç^ Hastaires. Leurs
armes. I. 6Sf. b. X. 307. b.
P IQ U U R E , ( Chirur.) [)laie faite par un inffiument piquant.
Les piqiiures font ordinairement plus dangeieulcs
que k s plaies plus étemiiics faites par im inffrument tranchant.
Premiers foins à prendre pour y remédier. Cautérif.
iiions 8c incifions que pratiquoient les anciens dans k s
cas de piquiires les plus dangereux. X ll. 631. é. De la pi-
qmircou morfute des animaux vénimeux , 8c de la métliotie
à fuivre dans k traitement que ce mal exige. Confidérations
fur ta morfure des diiens enragés 8c fur k moyen de guérir
de l’hydrophohie. Ouvrages à confulter. Èft'ets de la
morfure des viperes. Spécifique éprouvé contre cette mor-
ftirc. Ibid. 632. a.
Piquures. Nous avons lieu de croire que les Infcéles qui
nous piquent ne font qu’infinuer leurs aiguillons dans les
porcs de la peau. X ll. 213. b. Certaines piquures peuvent
donner des plaies gangreneufes. V i l . 469. a. D e la piquure
des abeilles. I. 19. a, b. Des araignées. 374. b. D e I'afpic.
761. /’. Dos confins. IV . 402, b. Des plames d'ortie. XI. 673.
b. Du fcüipion.XIV. 8 0 7 .21,/'. &c. Des ferpeiis. XV . 107.
é, De.s viperes. XVII . 322. a. 323. a. Maladie vénérienne
caiifée par la piquure des bêtes vénimeufes. XVII , 1. b. Voyeç_
Morsure.
Piquure , {Jardin.) effet de la picjuurc des i'ifeéles fur
les plantes. X ll. 724. b. La piquure des fruits accélère k u r
maiurité. il. 639. a.
Piquure , terme d’ouvrieres. XII. (232. b.
PIQ U IT IN G A , ( Ichtkyol. ) defeription de ce poiffon des
rivieres du Bréfil. XIT. 632. b.
PiRAEMBU , poiffon des mers du Bréfil. XII. 632. b.
P IR A G U E R A , poîflbn d'Amérique. XII, 6>;2. b.
P IR A T E , {Murin e) la piraieik exercée .aneiennemenc
par les Grecs 8c par k s Barbares éioit regai-dée comme
honorable. XII, 632. / .Les pirates devenus redoutables aux
Romains, qui charge-'-ent Pompée de k s combattre. Des per-
fonnes confldérablcs jiar leurs riclieffes Sc leur naiffance , armèrent
dans ce lems-L’i des vaiffeaux, 8c fe fiieni pirates.
V ie magnifique 8c vohipiueufe de ces pirates. Moyens donc
fe fervit Pomjice pour les détruire. Ibid. 6^^. a. f oye^ CoR-,
SAIRE.
Pirate , efpecc de pinrerle que les princes du nord exer-
çoient andennement. Suppl. 330. b.
P IR A -U TO AH , {ichihyoi.) poiffon des mers du Bréfil.
X I I -633--^-
PIRÉE, le , ( Géogr. anc.) étymologie de ce mot. XII.
633. a. ConftruiVion de ce port par l’avis de Thémiffocle.
Defeription 8c avantages de ce lieu , qui étoit proprement
divifé en trois ports. Relation que fait M. de la Guilletiere.
D e l’état de défolation de ce port 8c des lieux voifins. Com-
parnlfon de cet état préfent à celui de fon ancienne magnificence.
Le Pirée a eu la gloire d’avoir vu dans l’enceinte de
fes murailles quelques-unes des premieres écoles de philo-
fophie, qui aient été dans l'univers. Ibid. b. Lion de marine
cnie l’on voit au Pirée, qui a donné k no;n de Porto-
Lionc k CS fameux port. Peyer PoRTO-LlONE. Ruines des
murailles qui joignoient k Pirée à la ville. Tour jnerveil-
leufe qu’on voyoit autrefois dans la fortification de ce port.
Le tombeau de Thémiffocle ctoit le long de la grande muraille.
Puits qui fe trouve entre le Pirée 8c Athènes. Marché
qui fe tenoit autrefois au Pirée. Garnifon Sc magiftrats
do police que k s Athéniens y avoient établis. Ibid. 834. j .
Obfervnrions fur le poète .Ménandre qui fe noya au P ir é e ,
8c fur fes ouvrages. D ’où vient k nom de Pono-Draco
donné aujourd’hui au Pirée. Defeription du lion de marbre.
Autres lieux appelles du nom de Pirée. Ibid. b.
F îR G AN D ICU S , hlftoriette du roi de ce nom racontée
par k s Rabbins. IX. 39. b.
P lR irO RM E , {Anat. ) defeription d’un mufcle de ce
nom , qui cit k uremier des ahduéleurs de la cuiffe. XII,
634. b.
P IR IT Z , ( Géogr. ) ville de la Poméranie Pruffienne : produirions
de fon territoire. Son commerce. Suppl. IV. 384. b.
PIRNA , ( Géogr. ) ville d’Allemagne dan« l’élerorat de
ft.