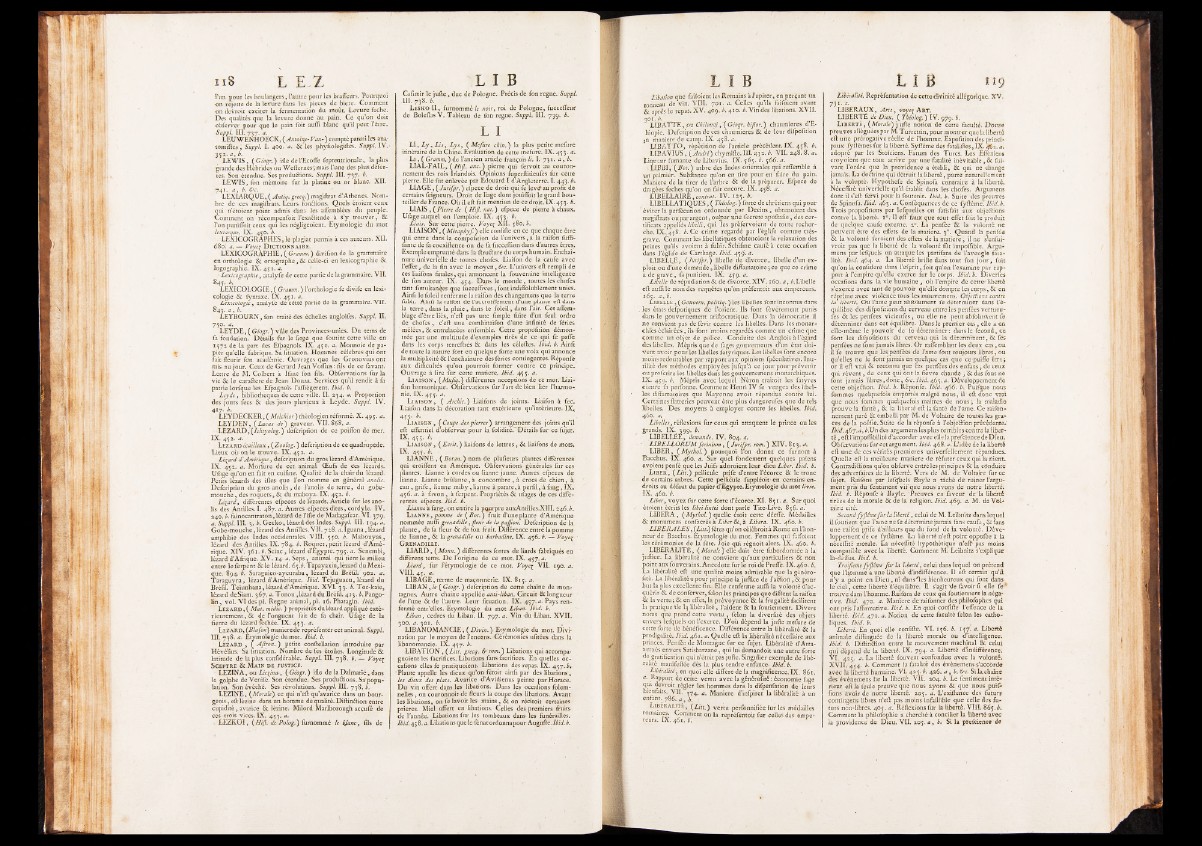
î i8 L E Z L I B
■ i ” i
l »''*
î'iin pour les boulangers, l’autre pour les bi'aflcurs. iPourquoi
on rejette de la levnire dans les pièces de biere. Comineiu
on devroit exciter la fermentation du moût. Levure lechc.
Des qualités que la levure donne au pain. C e qu’on doit
obfervcr pour que le pain loit aufli blanc qu'il peut l’être.
Suppl. III. 737. a.
LEUWENHOE CK , (y^/2/ei/V-Tu«-) compté parmi les ana-
tomiftes, Suppl. 1. 400. rf. 6c les phyfiologiAes. Suppl. IV.
332. -Z, b.
L EW IS , {Geo^r.') if le d e l’Ecofle feptcntrionale, lapins
grande des Hébrides ou Weilerncs; mais I’une des plus délor*
tes. Son étendue. Scs produélions. Suppl. III. 737. b.
L EW IS , fon mémoire fur la platine ou or blanc. XII.
741 . a , b. <S’c.
L E X IA R Q U E ,( y^/zZfr;. grcc<y_.) maglArat d’Atlicncs. Nombre
de ces magillrats. Leurs fonctions. Quels étoient ceux
q^ui n'étoient point admis dans les aficmblées du peuple.
Comment on récompenfoit l’exaflitude à s’y trouver, &
l ’on punilToit ceux qui les nègligeoient. Etymologie du mot
Icxiiinjue. IX. 45O. b.
LEXICOG R APHE S, le plagiat permis à ces auteurs. XII.
680: U. — Voyc^ D ic t io n n a ir e .
LEXICOG R APHIE , ( Grj7!/n.) divifton de la grammaire
en ortbologie 8c ortographe, Sc celle-ci en lexicographie 6c
logograpliie. IX. 4 5 i - ‘Z.
Lexicographie, analyfe de cette partie de la grammaire. VII.
S45. b.
LE X ICO L O G IE , ( Gramm. ) l'orihologie fe divife en lexicologie
& fyntaxe. IX. 451. u.
Lexicologie, analyfe de cette partie de la grammaire. VII.
843. a,b .^
L E Y BO U R N , fon truité des échelles angloifes. Suppl. II.
750. a.
L E YD E , ( Giogr. ) ville des Provinces-unies. D u tems de
fa fondation. Détails fur le fiege que foutint cette ville en
1372 de la part des Efpagnols. IX. 431. a. Moiinoie de papier
qu’elle fabriqua. Sa licuation. Hommes célébrés qui ont
fait fleurir fem académie. Ouvrages que les Gronoviiisont
mis au jour. Ceux de Gerard Jean Voflius : fils de ce favanr.
Lettre de M. Colbert à Ifaac fon fils. Obfervations fur la
vie Sc le caraftere de Jean Douza. Services qu'il rendit à fa
patrie lorfque les Efpagnols l’alTiégereiit. Ibid. b.
Ley de, bibliothèques de cette ville. IL 234. a. Proportion
des jours fees 8c des jours pluvieux à Leyde. Suppl. IV.
417. b.
L E Y D E C K E R ,( AL-.Wier) théologien réformé. X. 493. a.
L E YD E N , i^Lucas de) graveur. V l l . 868. rf.
LEZARD,(/e/jzyo/og.) defeription de ce poilTon de mer.
IX. 43 2. a.
L ézard écailleux, {Zoolog. ) defeription de ce quadrupède.
Lieux oil on le trouve. IX. 432. a.
Lenard d'Amérique, defeription du gros lézard d’.Amérique.
IX. 432. a. Mori'ure de cet animal (Eufs de Ces lézards.
Ufage qu’on en fait en cuifme. Qualité de la chair du lézard.
Petits lézards des ifles que l’on nomme en général anolis.
Defeription du gros anolis, de l’anolis de terre, du gobe-
mouche, des roquets, & du maboya. IX. 452. b.
Lézard, différentes efpeces de lézards. Article fur les anolis
des Antilles. I. 487. <z. Autres efpeces dites, cordyle. IV .
240. b. fainocantraton, lézard de l’ifle de Madagafcar. VI, 379.
a. Suppl. 111. 3. b. G e c k o , lézard des Indes. Suppl. III. 194. a.
Gobe-mouche,lézard des Antilles. V II . 728. a. Iguana, lézard
amphibie des Indes occidentales. VIII. 350. b. Mabouyas,
lézard des Antilles. IX. 784. b. Roquet,petit lézard d’Amé rique.
X IV. 361. b. Seine , lézard d’Egypte. 793. a. Senembi,
lézard d’Afrique. X V . 14. a. Seps , animal qui tient le milieu
entre ieferpent Scie lézard. 63.^.Tapayaxin,lézarcl duMexi-
que. 894. b. Saraguico-ayeuraba, lézard du Bréûl. 902. a.
Ta raguyra, lézard d’Amérique. Tejuguacu, lézard du
Bréfil. ’Teiunhana, lézard d’Amérique. X VI. 33. L Toc-kaie,
lézard de Siam. 367. a. Tonou , lézard du Bréfil. 413. L Pangolin
, vol. V I des pi. Regne animal, pl. 16. Phatagin. Ibid.
L é z a r d , ( Mat. rnédic. ) propriétés du lézard appliqué extérieurement,
6c de ronguent fait de fa chair. Ùfage de la
fieme du lézard féchée. IX. 433. a.
L é za r d , {Blafon) manierede repréfenter cet animal. Suppl.
III. 738. a. Etymologie du mot. Ibid. b.
L é zard , ( Aflron. ) petite conflellation introduite par
Hévélius. Sa utuation. Nombre de fes étoiles. Longitude &
latitude de la plus confidérablc. Suppl. III. 738. b. — Foyf{
Sceptre & M a in de ju st ice.
LE ZIN A , ou Liciina, {Géogr.) iile de laDalmatie, dans
le golphe de Venife. Son étendue. Scs produfHons. Sa population.
Son évêché. Ses révolutions. Suppl.Wl. b.
LE ZINE, {Morale) ce qui n’eft qu’avarice dans un bourgeois
, eft lézine dans un homme de qualité. Diftinélion entre
cupidité, avarice 6c lézine. Milord Marlborough aceufé de
ces trois vices. IX. 433. a.
■ LE ZKO I , {Hijl. Po/og.) furnommé le bjanc, fils de
Cafimlr le jufte, duc de Pologne. Précis de fon regne. Suppl.
111. 738. b.
L esko I I , furnommé/tf noir, roi de Pologne, fucceffeur
de Boleüas V . Tableau de fon regne. Suppl. 111. 739. b.
L I
L I ,£ y ,X ih , Ly s , { Mefure chin.) la plus petite mefure
itinéraire de la Chine. Evaluation de cette mefure. IX. 433. a.
L i , ( Gramm. ) de l'ancien article françois li. L 731. a , b.
L IA L -FA IL , {Hifi. ‘»'IC.) pierre qui fervoit au couronnement
des rois Irlandois. Opinions fuperftiiieufes fur cette
pierre. Elle fut enlevée par Edouard I d’Angleterre. I. 443. b.
L IA G E , ( Jurifpr. ) efpece de droit qui fe Icvtf au profit de
certains feigneurs. Droit de liage dont jouiffoic le grand bou-
teiller de France. Oii il cA fait mention de ce droit. IX. 433-
LIAIS , ( J ’ierrc; iJcr {H iß .n at.) efpece de pierre à chaux.
Ufage auquel on l’emploie. IX. 433. b.
Liais. Sur cette pierre. Voye^ XII. 380. b.
LIA ISO N , {Mécaphyf.) elleconfiAe en ce que chaque être
qui entre dans la compofition de l’univers,a la raifon fuffi-
fante de fa cocxiAence ou de fa AicceAion dans d’autres êtres.
Exemple emprunté dans la Aruéluré du corps humain. Enchai-
nure univerfelle de tontes chofes. Liuifon de la caufe avec
l’e flet, de la fin avec le mo yen, iS'c. L’univers eA rempli de
ces liaifons finales,qui annoncent la fouveraine intelligence
de fon auteur. IX. 434. Dans le monde, toutes les chofes
tant fimultaiiqes que fucccflîves ,font indiffolublement unies.
Ainfi le foleil renferme la raifon des changemens que la terre
fubit. Ainfi la raifon de l’accroilTcment d’une plante eA dans
la terre , dans la pluie , dans le fo le il, clans l’air. Cet alfcm-
blage d’être liés, n’eA pas une fimple fuite d’un feul ordre
de chofes, c’eA une combinaifon d’une infinité de fériés
mêlées, & entrelacées enfcmble. Cette propofition démontrée
par une multitude d’exemples tirés de ce qui fe patfe
dans les corps reneAres Sc dans les céleAes. Ibid. b. AinA
de toute la nature fort eu quelque forte une v o ix qui annonce
la multiplicité & l’enchainure des fériés contingentes. Réponfe
aux dirflcultés qu’on pourroic former contre ce principe.
Ouvrage à lire Air cette matière. Ibid. 433. a.
Lia i s o n , {Mußq.) différentes acceptions de ce mot. Liai-
fon harmonique. Obfervations fur l’art de bien lier riiaz-mo-
nie. IX. 433. a.
L ia i s o n , ( Archit.) Liaifons de joints. Liaifon à fee.
Llaifon dans la décoration tant extérieure qu’intérieure. IX,
455. 4,
L ia ison , ( Coupe des pierres) arrangement des joints qn’il
cA eiTentiei d’obferver pour la folidité.'Détails fur ce fujet.
IX. 433. h.
L ia ison , ( Ecrit. ) liaifons de lettres, & liaifons de mots.
IX. 433. L
LIANNE , {Botan.) nom de plufieurs plantes différentes
qui croiffent en Amérique. Obfervations générales fur ces
plantes. Lianne à cordes ou lianne jaune. Autres efpeces de
lianne. Lianne biûla!ue ,à concombre , à crocs de chien, à
eau , grife, lianne m ib y , lianne à patate,<à perfil, à fang, IX .
43Ö. a. à fiivon , à ferpent. Propriétés Sc ufages de ces différentes
efpeces. Ibid. b.
Lianne îk fang, on en tire la pQurpre auxAn tilles.XIII. 246. i.
L ia n n e , / lOTTJWtf de {B o t.) fruit d’une plante d’Amérique
nommée aulTi grenadille, fleur de la pajßion. Defeription de la
plante, de fa fleur Sc de fon fruit. Différence entre la pomme
de lianne, Sc la grenadille ou barbadine. IX. 436. b. — Voye^
G renad ille.
L IA R D , ( Monn. ) différentes fortes de liards fabriqués en
différens tems. D e l’origine de ce mot. IX.
Liard, fur l’étymologie de ce mot. Voyez V IL iqo. a.
VIII. 43. *»•
L IB A G E , terme de maçonnerie. IX. 813. a.
LIB AN , /e ( Gehg"?-. ) defeription de cette chaîne de montagnes.
Autre chaîne appellee anti-liban. Circuit & longueur
de l’une & de l’autre. Leur fuuaiion. IX. 437. *». Pays renfermé
entr’elles. Etymologie du mot Liban. Ibid. b.
Liban, cedres du Liban. IL 797. a. Vin du Liban. X V I I .
300. a. 301. b.
L IB A N OM AN C IE , ( ZîiVi/2. ) Etymologie du mot. D iv ination
par le moyen de l’encens. Cérémonies ufjiées dans la
libanomancie. IX. 437. b.
L IB AT IO N , {Litt, grecq. S’ rom. ) Libations qui accompa-
gnoienc les facrifices. Libations fans facrifices. En quelles oc-
cafions elles fe pratiquoient. Libations des repas. IX. 437.
Plaute appelle les dieux qu’on fètoit ainfi par des libations,
les dieux des plats. Avarice d’Avidienus peinte par Horace.
Du vin offert dans les libations. Dans les occafions folem-
nelles, on couronuoir de fleurs la coupe des libations. Avant
les libations, on fe lavoit les mains, & on récitoit certaines
prières. Miel offert en libations. Celles des premiers fruits
de l ’année. Libations fur les tombeaux dans les funérailles.
Ibid. 43 8. a. Libations que le fénat ordonna pour AuguAe. Ibid. b.
Libation que failoîent les Romains à Jupiter, en perçant un
tonneau de vin. VITI. 701. a. Celles qu’ils faifoicm avant
& après le repas. X V . 409. 410. /'.Vin des libations. XVII.
301. b.
r^yTY., ow Chllongt, {Géogr. htflor.) chaumières d’E-
htO])ie. Defeription de ces chaumières Sc de leur difpofuion
jn maniéré de camp. IX. 438. a.
L IB A T T O , répétition de l’article précédent. IX. 438. b.
L ID A V I 'J S , {André) chymiAe. III. 43^- b. VII. 248. 8. a.
Liqueur fumante de Libavius. IX. 363. b. 366. a.
LIB BI, {B o t.) arbre des Indes orientales qui reffeinble à
un p.'.lmicr. SubAancc qu’on en tire pour en faire du pain.
Maniéré de la tirer de l’arbre & de la prénarcr. Efpece de
dragées feches qu’on en fait encore. IX. 438. a.
JllBELLAIRE , re/i/rrtz. IV . 123. b.
LIB E L L A T IQ U E S , ( Théolog. ) forte de chrétiens qui pour
éviter la perfécution ordonnée par Decius , ohtenoient des
magiArats ou par argent, ouîpar une fecrete apoAafic, des certificats
appelles libelli, qui les préfervoient de toute recherche.
IX.. 438. b. C e crime regardé par l’églife comme très-
grave. Comment les libcllatiqucs obtenoient la relaxation des
peines qu’ils avoient à fubir. Schifme caufé à cette occafion
dans l’églife de Carthage. Ibid. 439'. a.
LIBELLE, {Jurifpr.) libelle de divorce, libelle d’un exploit
ou d’une denwnde, libelle diffamatoire ; ce que ce crime
a de grave , fa punition. IX. 439. a.
Libelle de répudiation Sc de divorce. X IV . 160. a, A Libelle
eA auffï le nom des requêtes qu’on préfentoit aux empereurs.
163. a, b.
L ibelle , ( Gouvern. politlq. ) les libelles font incomnis dans
. les états defpociques de l’orient. Ils font fevérement punis
dans le gouvernement ariAperntique. Dans la démocratie il
ne convient pas de févir contre les libelles. Dans les monarchies
éclairées , ils font moins regardes comme un crime que
comme un objet de police. Conduite des Anglois à l’égard
des libelles. Mépris que de fages gouverneurs d’un état doivent
avoir pour les libelles fatyriques. Les libelles font encore
moins redoutables par rapport aux opinions fpéculatives. Inutilité
des méthodes employées jufqu’à ce jour pour prévenir
ou proferire les libelles dans les gouvernemens monarchiques.
IX. 439. />. Mépris avec lequel Néron traitoit les fatyres
contre fa perfonne. Comment Henri IV fe vengea des libelles
diffamatoires que Mayenne avoir répandus contre lui.
Certaines flatteries peuvent être plus dangereufes que de tels
libelles. Des moyens à employer contre tes libelles. Ibid.
460.
réflexions fur ceux qui attaquent le prince ouïes
grands. IX. 399. b.
LIB ELLÉE, demande. IV . 804. a.
L IB E L LO RUM ferinium, ( Jurifpr. rom. ) X IV . 8t 3. <t.
LIB ER , {Mythol.) pourquoi l ’on donna ce furnom à
Bacchus. IX. 460. a. Sur quel fondement quelques païens
avoient penfé que les Juifs adoroiem leur dieu Liber. Ibid. b.
L ib e r , {là tt.) pellicule prife d’entre l’écorce & le tronc
de certains arbres. Cette pellicule fuppléoit en certains endroits
au défaut du papier d’Egypte. Etymologie du mot livre.
IX. 460. b.
Liber, voye z fur cette forte d’écorce. XI. 831. <z. Sur quoi
étoient écrits les libri lintei dont parle Titc-Live. 836. a.
L IB E R A , (AfyMo/.) quelle étoit cette déeffe. Médailles
& monumens confacrés à Z/'/cr 6i. à Libéra. IX. 460. b.
LIBERALES,{Litt.)(ètei<\\\'on célébroità Rome en l'iion-
ncur de Bscchus. Etymologie du mot. Femmes qui faifoient
les cérémonies de la fete. Joie qui régnoit alors. IX. 460. b.
LIB ÉR A L IT É , ( A/er<î/«) elle doit être fiibordonnèc à la
juAice. La libéralité ne convient qu’aux particuliers Sc non
point aux fouverains. Anecdote fur le roi de Priifle. IX. 460. b.
La libéralité eA une qualité moins admirable que la généro-
lité. La libéralité a pour principe la jiiAice de i’aftion, Sc pour
but la plus excellente fin. Elle renferme auffi la volonté d’acquérir
6c de coiifcrvcr, félon les principes que diflent la raifon
Sc In vertu ; & en effet, la prévoyance Sc la frugalité facilitent
la pratique tic I.3 libéralité, l’aident & la fouticnnent. Divers
noms que prend cette vertu , félon la diverfité des objets
envers Icfquels on l’cxcrce. D ’où dépend la juAc mefure de
cette forte de beneficence. Différence entre la libéralité Sc la
prodigalité. Ibid. 461. d. Quelle eA la libéralité néceffaire aux
princes. Penfée de Montagne fur ce fujet. Libéralité d’Ai ta-
xerxcs envers Satisbnrzane, qui lui demandoie une autre forte
de grntitication qui n’étoit pas jiiAe. Singulier exemple de libéralité
inaiiifeAce dès la plus tendre enfance- Ibid. b.
Libéralité, en quoi elle différé de la magnificence. IX. 861.
a. Rapport de cette vertu avec la générofité: économie Cage
qui devroit régler les liommes dans la difpenfation de leurs
bienfaits. VII. 374. a. Maniéré d’infpircr la libéralité à un
enfant. 786. û , t.
LiBÉKALj^É, {L in .) vertu perfonnifice (ur les médailles
roniaincis. Comment on la repréfentoii fur celles des empereurs.
iX. 461. A ‘
L î B »9
Lihéralhè. Repréfentation de cette divinité allégorique. XV .
7 3 1 .m
L IB ER A U X , A n s , A rt .
L IB ERTÉ de Dieu. ( Théolog.) IV. 979. b.
L ib e r t é , {Morale) j uAe notion de cette faculté. Douze
preuves alléguées par M.Turrctiin.pour montrer que la liberté
cA une prérogative réelle de riiommc. Expofition des principaux
fyüènies fur la liberté. S yAême des fatallAes, IX. 462. a.
adopté par les Stoïciens. Fatum des Turcs. Les Effeniens
croyoienr que tout arrive par une fatalité inévitable ,& fui-
vant l’ordre que la providence a établi, Sc qui ne change
jamais. La doiÂrine qui détruit la liberté, porte naturellement
à la volupté. Flypothcfc de Spinofa contraire à la liberté.
Néceffité uiiiverlellc qu’il établit dans les chofes. Argumens
dont il s’cA fervi pour la foutenir. Ibid. b. Suite des preuves
de Spinofa. Ibid. 463. a. Conféquenccs de ce fyAéme.’ Ibid. b.
Trois propofitions par Icfqucllcs on fatisfair aux objections
contre la liberté. 1°. 11 eA faux que tout effet fuit le produit
de quelque caufe externe, a". La penfée Sc la volonté ne
peuvent être des eff'cts de la matière. 3“. Quand h penfée
Sc la volonté lcroient des effets de la matière, il ne s’enfui-
vroit pas que la liberté de la volonté fût impoffible. Argumens
par Icfquels on attaque les partifans de l’aveugle fatalité.
Ibid. 464. a. La liberté brille dans tout fon jo u r, foil
qu’on la confidere clans l’efprit, foit qu’on l’examine par rapport
à l’empire cju’eüe exerce Air le corps, Ibid. b. Diverfes
occafions dans la vie humaine , oîi l’empire de cette- liberté
s’exerce avec tant de pouvoir qu’elle dompte les corps, & en
réprime avec violence tous les mouvemens. ObjcÜions contre
la Liberté. Ou l’aiue peut abfolumcnt fe déterminer dans l’équilibre
des difpofitions du cerveau entre les penfées vertueu-
fes 6c les penfées vicieufes , ou elle ne peut abfoliiment fe
déterminer dans cet équilibre. Dans le premier ca s, elle a en
elle-même le pouvoir de fe déterminer : dans le fécond, ce
font les difpofitions du cerveau qui la déterminent, 8e fes
penfées ne font jamais libres. O r raffemblant les deux ca s, ou
il fe trouve que les penfées de l’ame font toujours libres, ou
qu’elles ne le font jamais en quelque cas que ce puiîTe êtrei
or i! eA vrai Sc reconnu que les penfées des enfans , de ceux
qui rê v en t , de ceux qui ont la fievre chaude , 6c des fous ne
font jamais libres, d onc, d-c./f/4. 463..t. Développement de
cette objefUon. Ibid. b. Réponfe. Ibid 466. b. Puifque nous
fouîmes quelquefois emportés malgré nous, il eA donc vrai
que nous foinmes quelquefois maîtres de nous ; la maladie
prouve la famé , 6c la liberté cA la fantc de l’ame. Ce ralfon-
nement paré Sc embelli par îvî. de Voltaire de routas les graces
de la poéfie. Suite de la réponfe à l’objeéfion precedente.’
Ibid.ajoy.a, LUn des argumens les plus terribles contre la liberté
, eA l’impollibilité d'accorder avec elle la prefcience de Dieu.
Obfervatioua fur cet argument. Ibid. 468. a. L’idée de la liberté
cA une de ces vérités picmieres univerfellemcnt répandues.
Quelle cA la meilleure manière de réfuter ceux qui la nient.
ComradiAions qu’on obfcrve entre les principes & la conduite
des adverïàires de la liberté. Vers de M. de Voltaire fur ce
fujet. Raifons par iefqtiels Bayle a taché de ruiner l’argument
pris du fentiment v i f que nous avons de notre liberté.
Ibid. b. Réponfe à Bayle. Preuves en faveur de la liberté
tirées de la morale 6c de la religion. Ibid. 469. a. M. de V ol*
taire cité.
Second fyflcmc fur la liberté, celui de M, Leibnitz dans lequel
il füucieni que l’ame ne fe détermine jamais fans caufe , & i'ans
une raifon prife d’ailleurs que du fond de la volonté. D é v e loppement
de ce fyAéme. La liberté n’eA point oppofée à la
néceffité morale. La néceflîté liypothétique n’e ff pas moins
compatible avec la liberté. Comment M. Leibnitz s’explique
lù-(leffus. Ibid. b.
Troifieme fyflcme fur la liberté, celui dans lequel on prétend
que l’homme a une liberté d’indifférence. 11 eA certain qu’il
n’y a point en Dieu , ni dans'Aes bienheureux qui font dans
le c ie l, cette liberté d’équilibre. Il s’agit "de favoir fi elle f e '
trouve dans l’homme. Raifons de ceux qui fouticnnent la négative.
Ibid. 470. a. Manière de raifonner des phiiofophes qui
ont pris l’affirmative. Ibid. b. En quoi confiAe l’cffcnce de la
liberté. Ibid. 471. a. Notion de cette faculté félon les catholiques.
Ibid. b.
Liberté. En quoi elle confiAe. V I . 136. b. 157. a. Liberté
animale diAinguée de la liberté morale ou d'intelligence.
Ibid. b. DiAinéHon entre le mouvement machinal 6c celui
qui dépend de la liberté. IX. 794. a. Liberté d’indifl'érence.
VI, 423. a. La liberté fouvent confondue avec la volonté.
XV II . 434. b. Comment la fatalité des événemens s’accorde
avec la liberté humaine. VI. 423. i. 426. a , b. &>c. SI lachaj'ne
des événemens lie la liberté. \TI. 204. b. Le fentiment intérieur
eA la feule preuve que nous ayons Sc que nous puif-
fions avoir de notre liberté. 203. a. L’exlAencc des futurs
comingens libres n’cA pas moins infaillible que celle des futurs
non-libres. 403. a. Réflexions fur la liberté. VIH. 863.é.
Comment la philolophie a cherché à concilier la liberté avec
la providence de Dieu. V IL 203. a , b. Si la prdcience de
V