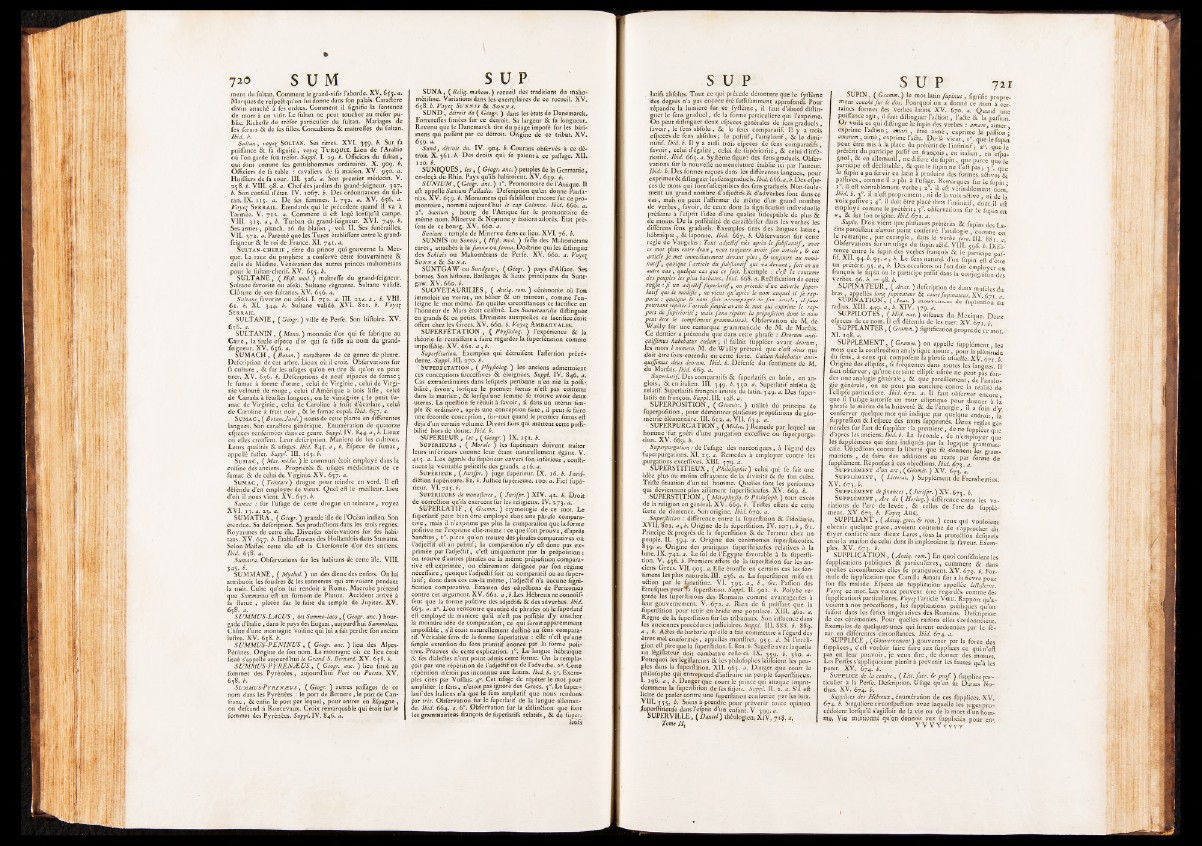
7 2 0 SUM SU P
■ ' ■
I trsj .! ‘ ■ !!
ment du fultan. Comment Icgrand-vifir I’aborcle. XV. 65ç. a.
Marques de refpeft qu’on lui donne dans fbn palais. Caraftere
divin attaché à fes ordres. Comment il fignifie la fentence
de mort à un vifir. Le (ultan ne peut toucher au tréfor public.
Kicherte du trélbr particulier du fultan. Mariages de
fes foeurs ÖC de fes filles. Concubines & maîtrelTcs du fultan.
b.
Su lu n, voye{ SOLTAN. Ses titres. X V I . 359. h. Sur fa
puilTance & fa dignité, voyi^ TvRQUiE. Lieu de l’Arabie
où Ton garde fon tréfor. bt/pp/. I. 29. b. Officiers du fultan,
qui font comme fes gentilshommes ordinaires. X. 909. b.
Officiers de fa table : cavaliers de fa maifon. X V . 950. a.
Huifliers de fa cour. 111. 326. a. Son premier médecin. V.
238. é. VIK . 98. a. Ch e f des jardins du grand-feigneur. 327.
h. Son confeil d’état. IV. 1067. b. Des ordonnances du lul-
lan. IX. 115. ti. D e fes femmes. a. X V . 656. a.
yoyc^ SiRRAiL. Etendards qui le precedent quand il va à
l ’armée. V. 712. a. Comment il eft logé lorfqu’il campe.
VIII. 313. a , b. Turban du grand-feigneur. X V I. 749-
Ses a rmes, planch. 16 du blalon , vol. ü . Ses funérailles.
V II . 372. ^j. Parenté que les Turcs établilTent entre le grand-
feigneur 8c le roi de France. XI. 741 . a.
SuLTAN-CHERiF , titre du prince qui gouverne la Mecque.
La race du prophète a confervé cette fouveraineté &
celle de Médine. Vénération des autres princes mahométans
pour le fukan-chcrif. X V . 635. b.
SUL TANE , ( Hiß. mod. ) maîtrelîe du grand-feigneur.
Sultane favorite ou afeki. Sultane régnante. Sultane validé.
Clôture de ces fultanes. X V. 656. a.
Sultane favorite ou afeki. I. 732. a. III. 224. a , b. VHI.
61 . b. XI. 344. b. Sultane validé. XVI. 821. b. Voye\
S errail.
SULTANIE , ( Oco^r. ) ville de Perfe. Son hifloire. XV.
636. a.
SUL TANIN , ( Monn. ) monnoie d’or qui fe fabrique au
Caire , la feule efpece d’or qui fe falfc au nom du grand-
feienenr. X V . 656. a.
SUMACH , ( Satan. ) caraéleres de ce genre de plante.
Defeription de cet arbre. Lieux où il croit. Obfervations fur
fa culture , & fur les ufages qu’on en tire 8c qu'on en peut
tirer. X V . 656. b. Deferiptions de neuf efpeces de fumac ;
le fumac à forme d’orme , celui de Virginie , celui de Virginie
velouté de rouge, celui d’Amérique à bois lilTe, celui
tie Canada à feuilles longues, ou le vinaigrier ; le petit fu-
inac de Virginie, celui de Caroline à fruit d’écarlate, celui
de Caroline à fruit noir , 8c le fumac copal. Ibid. 657. a.
S um a c , ( Butan. Jard. ) noms de cette plante en différentes
langues. Son caraélere générique. Enumération de quatorze
efpeces renfermées dans ce genre. Suppl. IV. 844. a , b. Lieux
oil elles croiffent. Leur defeription. Maniéré de les cultiver.
Leurs qualités 8c ufages. Ibid. 843. a , b. Efpece de fumac ,
appelle fiirtei. Suppl. III. 163. i.
Sumac , ( Mat. médit. ) le commun éioit employé dans la
cuifine des anciens. Propriétés 8c ufages médicinaux de ce
fumac 8c de celui de Virginie. X V . 637- a.
Su m a c , ( Teinture) drogue pour teindre en verd. Il eft
défendu d’en employer de vieux. Q uel eft le meilleur. Lieu
d’où il nous vient. X V . 637. b.
Sumac : fur l’ufagc de cette drogue en teinture, voye z
X V I . 13.«. 23. a.
SUM ATR A , ( Géogr. ) grande ifte de l’Océan indien. Son
étendue. Sa defeription. Ses productions dans les trois régnés.
Royaumes de cette ifte. Diverfes obfervations fur fes habl-
tans. X V. 637. b. EtablilTemens des Hollandois dans Sumatra.
Selon Maffæi cette ifte eft la Cherfonefc d’or des anciens.
JbiJ. 638. a.
Sumatra. Obfervations fur les habitans de cette ifte. VIII.
343. b.
SUM.MANE, ( Mythol. ) un des dieux des enfers. On lui
attribuoit les foudres 8c les tonnerres qui arrivoient pendant
la nuit. Culte qu’on lui rendoit à Rome. Macrobe prétend
que Summanus eft un furnom de Pluton. Accident arrivé à
fa ftatue , placée fur le faite du temple de Jupiter. X V .
638. «.
SUM MVS-LACUS , ou Summo-laco , ( Géogr. anc. ) bourgade
d’Italie , dans le pays des Eugani, aujourd’hui Sammoleco.
Chute d’une montagne voifine qui lui a fait perdre fon ancien
luftre. X V . 658. b.
SUM MUS-PENINU S , ( Géogr. anc. ) lieu des Alpes-
Pénines. Origine de fon nom. La montagne où ce lieu étoit
fitué s’appelle aujourd’hui U Grand S. Bernard. X V . 638. b.
SUM M US-PyREd dÆ US, ( Géogr. anc. ) lieu fitué au
fommet des Pyrénées, aujourd’hui Pon ou Puerto. X V .
658. b.
Su.MMUS-Pi'REttÆUS, ( Gc'ogT. ) uutres partages de ce
nom dans les Pyrénées : le port de ßernere , le port de Can-
franc , Sc enfin le porc par lequel, pour entrer en Efpagne ,
on defeend à Roncevaux. Croix remarquable qui étoit fur le
fommet des Pyrénées. Suppl. IV. 846. a.
S U N A , {^Relig.mahom.) recueil des traditions du ittalio-
métifme. Variations dans les exemplaires de ce recueil. X V .
638. é. Voye^ St/st^is &, SoffNA.
SU N D , détroit du { Géogr. ) dans les états de Danemarek.
Forterefles fituées fur ce détroit. Sa largeur 8c fa longueur.
Revenu que le Danemarek tire du péage impofé fur les bâti-
mens qui patfent par ce détroit. Origine de ce tribut. X V .
639. a.
Sundy détroit du. IV. 904. b. Courans obfervés à ce détroit.
X. 361. b. Des droits qui fe paient à ce partage. XII.
120. b.
SUNIQUÊS y les y { Géogr. anc. ) peuples de la Germanie,
en-deçà du Rhin. Pays qu’ils habitoient. X V . 639. b.
S U N IU M , ( Géogr. anc. ) 1°. Promontoire de l’Attique. Il
eft appellé Sunium Palladis. Defeription qu’en donne Paufa-
nias. X V . 639. b. Monumens qui fubfiftem encore fur ce promontoire,
nommé aujourd’hui le cap Colonne. Ibid. 660. a.
Sunium , bourg de l’Attique fur le promontoire de
même nom. Minerve 8c Neptune y étolent adorés. Etat pré-,
fenc de ce bourg. X V . 660. a.
Sunium : temple de Minerve dans ce lieu. XVI. 76. b.
SUNNIS ou Sonnis, ( Hift. mod. ) fefte des Mahométans
turcs , attachés à ia funna ou fonna. D oftrine qui les diftingue
des Schiais ou Mahométans de Perfe. XV. 660. a. Voyc^
SOSSA 8c SvNA.
S U N TG AW ou Sundgow , ( Géogr. ) pays d’Alfacc. Ses
bornes. Son hiftoire. Bailliages 8c lieux principaux du Sunt-
gaw. X V . 660. b.
S U ü V E T A ü R IL IE S , ( Antitj. rom. ) cérémonie où l’on
immoloit un verrat, un bélier 8c un taureau , comme l’en-
feigne le mot même. En quelles circonftauces ce facrifice en
l’honneur de Mars étoit célébré. Les SuovetauriUa diftingués
en grands 8c en petits. Divinités auxquelles ce facrifice étoit
offert chez les Grecs. XV, 660. b. Voyetç^ A m b a r v a le s .
SUPER FÉTATION , ( Phyfiolog. ) l’expérience 8c la
théorie fe reuniffent à faire regarder la fuperfétation comme
impoftible. X V . 661. a , b.
Superfétation. E.xemples qui détruifent l’affertion précédente.
Suppl. III. 270. b.
SUPERFETATION , ( Phyfiolog. ) les anciens admettoient
ces conceptions fuccellives & éloignées. Suppi. IV. 846. a.
Cas extraordinaires dans lefquels perfonne n’en nie la poffi-
bilicé, favoir, lorfque le premier foetus n’eft pas contenu
dans la matrice , 8c lorfqu’une femme fe trouve avoir deux
uterus, La queftion fe réduit à favoir, fi dans un utérus lîm-
ple 8c ordinaire, après une conception faite, il peut fe faire
une fécondé conception, fur-tout quand le premier foetus eft
déjà d'un certain volume. Divers faits qui mettent cette poffi-
hilité hors de doute. Ibid. b.
SUPÉRIEUR, la c , {Géogr.) IX. l y . b.
S upérieurs , ( Morale ) les fupérieurs doivent traiter
leurs inférieurs comme leur étant naturellement égaux. V .
413. a. L e s égards du fupérieur envers fon inférieur , confti-
tueni la véritable politefte des grands. 416. a.
Su p é r ie u r , {Jurifpr. ) juge fupérieur. IX. 16. b. Jurif-
diélion fupérieure. 8 1. b. Juftice fupérieure. 100. a. F ief fupérieur.
VI. 7 13. b.
Supérieurs de monajîeres, ( Jurifpr.) X IV . 42. b. Droit
de correftion qu’ils exercent fur les religieux. IV. 273. a.
SUPERLA1 IF , ( Gramm. ) étymoiügie de ce mot. Le
fuperlatif peut bien être employé dans une phrafe comparative
, mais il n’exprime pas plus la coraparaifon que ia forme
pofitive ne l'exprime elle-même : ce que l’on prouve, d’après
Sanéiius, 1°. p.irce qu’on trouve des phrafes comparatives où
l’adjeftif eft au pofitif; la comparailbn n’y eft donc pas exprimée
par radjeétif, c’eft uniquement par la prépofition :
on trouve d’autres phrafes où la même prépofition comparative
eft exprimée, ou clairement défignée par fon régime
néceffaire, quoique l’adjedif foit au comparatif ou au fuperlatif
j donc dans ces cas-là même , l’adjciftif n’a aucune figni-
ficatioa comparative. Examen des objeélions de Perizonius
contre cet argument. XV. 661. a ,b .L es Hébreux ne connoif-
fent que ta forme pofitive des adjeélifs 8c des adverbes. Ibid.
663. a. 2°. L ’on rencontre quantité de phrafes où le fuperlatif
eft employé de maniéré qu’il n’eft pas poflîble d’y attacher
la moindre idée de comparaiibn, ce qui feroit apparemment
impolfibie , s’il étoit naturellement deftiné au fens comparatif.
Véritable feus de la forme fuperlative : elle n’eft qu'une
Ample extenfion du fens primitif énoncé par la forme pofitive.
Preuves de cette explication, i ”. La langue hébraïque
& fes dialeftes n’ont point admis cette forme. Üii la rempla-
çoit par une répétition de l’adjeftif ou de l’adverbe, a”. Cette
répétition n’étoit pas inconnue aux Latins. Ibid. b. 3". Exemples
cités par Voifius. 4°. Cet ufage de répéter le mot pour
amplifier le feus, n’étoit pas ignoré des Grecs. 3 " .Lefuper-
latif des Italiens n’a que le fens ampliatif que nous reniions
par très. Obfervation fur le fuperlatif de la langue allemande.
Ibid. 664. a. 6". Obfervation fur la diftinélion que font
les grammairieas francois de fuperlatifs relatifs, 8c de fupeilatifs
S U P
latifs abfolus. Tout ce qui précédé démontre que le fyftême
des degrés n’a pas encore été fuffifimment approfondi. Pour
répandre ia hinuere fur ce fyftême , il faut d’abord diftin-
giier le fens graduel, de la forme particulière qui l’exprime,
On peut diftinguer deux efpeces générales de lens graduels ,
favo ir, le fens abfolu , Sc le feus comparatif. Il y a troh
efpeces de fens abfolus j le pofitif, Pampliatif, 8t le diminutif.
Ibid. è. Il y a aiiffi trois efpeces de fens comparatifs
fa v o ir, celui d’égalité , celui de fupériorité, 8c celui 4 ’infé
riorité. Ibid. 663. u. Syftéme figuré des fens graduels. Obfer-
vations fur la nouvelle nomenclature établie ici par l’auteur.
Ibid: b. Des formes reçues d.ins les différentes langues, pou
exprimer 8c diftinguer les fens graduels. Ibid. 666. a, b. Des efpc
ces de mots qui font fufceptibles des fens graduels. Non-feule
nient un grand nombre d’adjeiftifs 8c d’adverbes font dans ce
c a s , mais on peut l’affirmer de même d’un grand nombre
de verbc.s, favoir, de ceux dont la fignification individuelle
préfente à l’efpric l’idée d’une qualité fufceptible de plus &
de moins. De la polFibilité de caradérifer dans les verbes les
différens feus graduels. Exemples tirés des langues latine,
hébraïque, 8c laponne. Ibid. 667. b. Obfervation fur cette
regie de Vaugclas : Tout adjeSlif mis après le fubjlantif, avec
ce mot plus entre-deux, veut toujours avoir fort article, 6>
article Je met immédiatement devant plus, S’ toujours au nominatif,
quoique l ’article du fiihfîamif qui va dev.int, foit
autre ca s, quelque cas que ce fait. Exemple ; cejï U coutume
des peuples les plus barbares. Ibid. 668. a. Redirication de cette
regie : fi un adjeEüf Juperlatif, ou précédé d'un adverbe fuperla
tif qui le modifie , ne vient qu après le nom auquel il Je rapporte
; quoique le nom foie accompagné de fon article, il j'aut
pourtant répéter l ’article fimpLe avant le mot qui exprime le rap
port de fupériorité J mais Jans répéter la prépofition dont le nor,
peut être le complément grammatical. Obfervation de M de
W a illy fur une remarque grammaticale de M. de Marfais,
C e dernier a prétendu que dans cette phrafe ; Dconim ami
qttijfimus habebatur calum ; il falloit fuppléer avant deorum
les mots è numéro. M. de 'W ailly prétend que c’eft deus qui
doit être fous-entendii en cette forte. Coelum habebatur ami-
xjuiffimus deus deorum. Ibid. b. Défenfe du fentiment de M.
du Marfais. Ibid. 669. a.
SuperlatiJ. Des comparatifs 8c fuperlatifs en latin , en an-
g lo is , 8c en italien. I ll, 349. b. 330. a. Superlatif abfolu &
relatif. Superlatifs françois imités du latin. 349. a. Des fuperlatifs
en françois. Suppl. 11,1. 1 28. a.
SUPER PO SITION, ( Géométr. ) milité du principe de
fuperpofition , pour démontrer phifieurs propoficioiis de géométrie
élémentaire. III. 612. a. VII. 634. a.
SUPERPü R G A T IO N , ( AJAfec. ) Remede par lequel un
homme'fut guéri d’une purgation excefttve ou fuperpurga-
•lion. X V . 669. b.
Superpurgaiion : As l’ufage des narcotiques, à l’égard des
■ fuperpurgations. XI. 23. u. Remedes à employer contre les
.purgations exceflives. X llI . 379. a.
SU PER ST IT IEU X, {Philojhphie) celui qui fe fait une
idée plus ou moins effrayante de la divinité 8c de fon culte.
Trifte fituation d’un tel homme. Quelles font les perfonnes
qui deviennent plus aifémenr fiiperftitieufes. X V . 669. b.
SUPER ST IT ION , {Mctapkyfiq.S Philofoph.) tout excès
•de la religion en général. X V . 669. b. Triftes effets de cette
forte de démence. Son origine. Ibid. 670. a.
Superjlition : différence entre la fuperftition Sc l’idolàtric.
XVII. 801. a, b. Origine de la fuperftition. IV. 1071. 4 , Sc.
Principe 8c progrès de la fuperftition Sc do l’erreur chez un
peuple. II. 394. a. Origine des cérémonies fiiperftitieufes.
039. a. Origine des pratiques fuperftitieiifes relatives à la
lune. IX. 742. Le fol de l’Egypte favorable à l.a fuperftition.
V . 436. b. Premiers effets de la fuperftition fur les anciens
Grecs. VIL 903. a. Elle éroufte en certains cas les fen-
îimens les plus naturels. III. 236. a. La fuperftition mife en
afHon par le fanatifme. V I . 393. a , b , Sc. Paillon des
Etrufques pourTa fuperftition. b'tfpp/. II. 901. b. Polybe regarde
les luperftitious des Romains comme avantageufes à
leur gouvernement. V. 672. a. Rien de fi puiftaiit que la
JùperlUtion pour tenir en bride une populace. X llI . 462. a.
Régné de )a fupcrflicioii fur les tribunaux. Son influence dans
les anciennes procédures judiciaires. Suppl. III. 888. b. 889.
et, b. A6Ies de barbarie qu’elle a fait commettre à l’égard des
êtres mal conformés, appelles monftres. 953. d. Si l’irréligion
eft pire que la fuperftition. I. 801.4. SagclTe avec laquelle
un légiftateur doit combattre celle-ci. IX. 339. b. 360. a.
Pourquoi les légiflateurs 8c les plnlofophcs lailibiem les peuples
dans la fuperftition. XII. 963. a. Danger i^ue court le
philofophe qui entreprend d'inftrüirc un peuple luperftitieux. 1. 196. a , b. Danger que court le prince qui attaque imprudemment
la fuperftition de fes fujets. Suppl. II, 2. a. S’il eft
licite de parler contre une fuperftition ccnfacrée par les ioix.
5 5Sr Soins à prendre pour prévenir toute opinion
.fuperftirieufe dans l’cfprk d’un enfant V 200. j
SUPER VILLE, [ D in id ) théolojlcn. 7 1 8 , *
Tome J f
S U P 7 2 Ï
SUP IN , ( Gramrn. ,) le mot latin fupinus , fignlfie proprement
couché fur le dos. Pourquoi on a donné ce nom à certaines
formes des verbes Latins. X V . 670. a. Quand une
.piiilTance agit, il faut diftinguer l’aftion , i’aéle 8c la paffion.
O r voilà qui diftingue le fupin des verbes ; amare, aimer
exprime laé lien; a^ian , être aimé, exprime la palTion •
amatum , aimc , exprime l’afte. De-là v ient, 1°. que le fupin
peut etre mis à la place du prétérit de l’infinitif i 2'' que le
prétérit du partic'ipe pafiîf en francois , en italien , en cfpa-
gn o l, 8c en allemand, ne dlffcre du fupin, que parce que le
participe eft déclinable, & que le fupin ne l’e ftp as ; 3". que
le HJOin a nil A>l"uir Pn l-irin à ,1^_____ ». -CÏ-
Ibid. b. 3°. il n’eft proprement, ni de la voix aélive , ni de la
voix paflive ; 4°. il doit être placé dans l’infinitif, dont il eft
employé comme le prétérit ; 3“. obfei varions fur le fupin en
U, Sc fur fon origine. Ibid. 671. a.
Supin. D ’où vient que- pliifieiirs prétérits Sc fupins des Latins
paroiffeiir n’avoir point confervé l’analogie , coinin'- ou
^ remarque, par exemple, dans le verbe Jero. III. 881. a
Obfervations fur un ufage du fupin aétif. VIH, 59(3. 4.
tl-ïs verbes françois 8c le participe paf-
lif. XII. 94. 4. 93. a , 4. Le fens naturel d’im fupin eft d’être
un prétérit. 93. a , b. Des occafions où l’on doit employer eu
françois le lupin ou le participe partif dans la conjiigailon des
verbes. 96. 4. — 98. 4. ^
SU P IN AT EU R , ( Anat. ) defeription de deux mufcles du
bras , appelles long Japinateur 6c coun Jiipinateur. XV. 6-7? ..
SUPINATION^, {Anat. ) mouvement de fupinacion du
radins. XIII. 449. a , 4. X IV . 379. a.
SUPPILO TE S, {H if i nat.) oiksiUx du Mexique Deux
efpeces de ce nom. Il eft défendu de les tuer. XV. 671. 4
^ SU P P L AN T E R , ( Gramm.) fignification propre de ce mot.
SUPPLÉMENT , ( Gramm. ) on appelle fupplément, les
mots que la conftniélion analytique ajoute, pour la plénitude
du fens, à ceux qui compofent ia phrafe ufuelle. X V . 6'’ i. 4.
Origine des ellipfes, fi fréquentes dans toutes les langues. Il
faut obfervcr, qu’une certaine ellipfe ufitée ne peut pas fonder
une analogie générale ^ 6c que pareillement, de l’analogie
générale, on ne peut pus conclure contre la réalité de
.’ellipfe p.wiculiere. Ibid. 672. a. Il faut obfcrvc-r encore,
que fi l'ufage autorife un tour elliptique pour donner à U
plirafe le mérite de la brièveté Sc de l’énergie, il a foin d’y
conferver quelque mot qui indique par quelque endroit la
fiippreflion 8c l’efpcce des mots fiipprimés. Deux regies générales
fur l’art de fuppléer ; la premiere , de ne fuppléer que
Japrès les anciens./4iù. 4. La fécondé, de n’employer que
les fupplémcns qui font indiques par la logique granimlti-
caJe. Objeiftions contre la liberté que fe donnent les grammairiens
, de faire des additions au texte par forme de
fiipplénient. Réponfes à ces objeélions. Ibid. 673. a.
Supplément d’un arc, ( Géoméi. ) X V . 673. a. '
Sup p lément , { Liicé.-at. ) Supplément de Frenshemius
X V . 673. 4.
Supplément de finances , ( Jurifpr. ) XV. 673. b.
Supplément , de {Horlog.) différence entre les v a riations
de l’arc de levée , 8c celles de l’arc de fuppJé-
ment. XV. 673. 4. Voye:^ A r c .
SUPPLIANT , ( Amiq. grec. S rom. ) ceux qui vouloieiit
obtenir quelque grace, avoient coutume de s’approclier du
foyer confacré aux dieux Lares, fous la proteélion dcfquels
étoit la maifon de celui dont ils imploroient la faveur. Exem-
les. X V . 673. 4.
SU P P L IC AT IO N , ( Antiq. rom. ) En quoi confiftolent les
fupplications publiques & particulières, comment 8c dans
quelles circonftances elles fe pratiquoient. XV. 673. 4. Formule
de fiipplication que Camilla Amata fait à la fievre pour
fou fils malade. Efpece de fiipplication appellee leüifiernc.
yoye[ ce mot, Les voeux peuvent être regardés comme des
fupplications particulières. Foye:^ l’article V ceu. Rapport qu’a-
voiemà nos proceffions, les fiipplications publiques qu’on
faifoit dans les fériés impératives des Romains. Defeription
de ces cérémonies. Pour quelles raifons elles s’ordonnoienr.
Exemples de quelques-unes qui furent ordonnées par le fé-
nar en différences circonftances. Ibid. 674. a.
SUPPLICE , {Gouvernement) gouverner par la force des
fijppiices, c’eft vouloir faire faire aux fupplices ce qui n’eft
en leur pouvoir, je veux dire, de donner des moeurs.
: Perfes s’appliquoienc plutôt à prévenir les fautes qu’à les
punir. XV. 674. 4.
Su pplice de U cendre , ( Litt. facr. S prof. ) fiippHce particulier
à la Perfe. Defeription. Ufage qu’en fit Darius No-
thus. XV. 674. 4.
Supplices des Hébreux , énumération de ces fiipplices. X V .
674. 4. Singulière circonfpeélion avec laquelle les juges pro-
ccdoient lorfqu’il s’agiffoit de la vie ou de la mort d’un hom-
Y iu uiixûcané qu’on donnoit aux fuppliciés pour en-
y V V V v v v Y