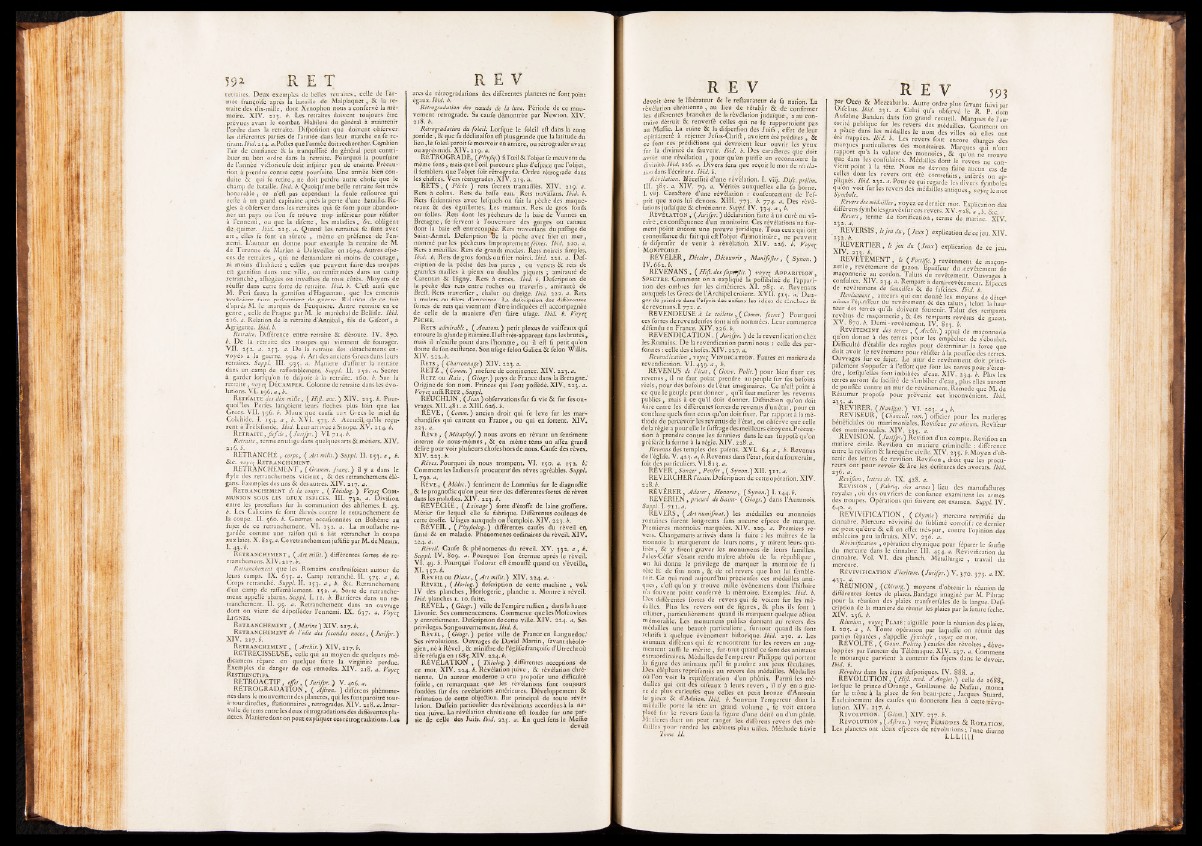
t: **
ri ij il., j
■ 5 !,
, 'U
, r . 1 ’;
?9^ R E T
réunîtes. Deux exemples de belles rciiaùcs, celle de U r inée
françoife après la bataille de Malplatjiiet , Se la retraite
des dix-mille, dont Xenophon nous a confervé la mémoire.
X IV. 213. b. Les retraites doivent toujours être
prévues avant le combat. Habileté du général à. maintenir
l’ordre d.nis la retraite. Difpofirion que doivent oblérvcr
les tiifl'érentcs parties de l’armée dans leur marche en fe retirant.
Ibid. 1 14, U. Polies que l’armée doit rechercher. Co^nbien
l'air de confiance & la tranquillité du général peut contribuer
au bon ordre dans la retraite. Pourquoi la pourfuite
de l’armée viélorieufe doit infpirer peu de crainte. Précaution
à prendre contre cette poursuite. Une armée bien conduite
& qui fe retire, ne doit perdre autre cliofe que le
champ de bataille. Ibid. b. Quoiqu’une belle retraite foit très-
Iionorable , ce n’eft pas cependant la feule refTource qui
relie à im grand capitaine après la perte d’une bataille. Réglés
à obferver dans les retraites qui fe font pour abandonner
un pays où l’on fe trouve trop inférieur pour réfifter
à rennemi, ou que la difette , les maladies, &c. obligent
de quitter. Ibid. 215. a. Quand les retraites fe font avec
a r t , elles fe font en sûreté , même en prcfence de l’ennemi.
L’auteur en donne pour exemple la retraite de M.
de Turenne de Murlen à Dcltveillcr en 1674. Autres cfpe-
ces de retraites , qui ne demandent ni moins de courage,
ni moins d'habileté ; celles que peuvent faire des troupes
en garnifon dans une v ille , ou renfermées dans iin camp
retranché, alTiégées ou invefties de tous côtés. Moyens de
réuflîr dans cette forte de retraite. Ibid. b. C'eli ainfi que
M. Perl fauva la garnifon d'Hagucnaii, que les ennemis
vouloienc faire prilonnierc de guerre. Relation de ce fait
d’après M. le marquis de Feuquiere. Autre retraite en ce
genre , celle de Prague par M. le maréchal de Bellifle. Ibid.
a i6 . ü. Relation de la retraite d’Annibal, fils de Gifeon', à
Agrigcnte. Ibid. b.
Rctraici. Dift'érencc entre retraite & déroute. IV . 870.
h. De la retraite des troupes qui viennent de fourager.
V i l . 252. 253. a. De la retraite des dètachemens envoyés
à la guerre. 994. é. A n des anciens Grecs dans leurs
retraites. Suppl. III. 935. ,1. Maniéré d’alTuier la retraite
dans uii camp de rafTemblemenr. Suppl. II. 132. a. Secret
à garder lorfqu’on fe difpofe à la retraite. 160. b. Sur la
retraite , voye[ DiCAMPEK. Colonne de retraite dans les évolutions.
V I . KjC.Uyb.
R e traite des dix mille, ( Hifl. une. ) X IV . 113. b. Pour-
qiioi les Perfes lançoient leurs fléchés plus loin que les
Grecs. VII. 396. b. Maux que caufa aiit Giecs le miel de
Colehidc. I. 154. a , b. X V I . 373. ù. Accue il qu’ils reçurent
à Trébifonde. Ibid. Leur a.-iivéc à Smope. X V . 214. b.
Retraite, {Junjpr.) V I .714./'.
Recruice, ic'nneenuf.ige dans quelques arcs & métiers. X IV .
216. b.
RETRANCHÉ , corps, A n milic.') Suppl. II. 1 3 3 .»i, b. 6lc. vuyci R e tranchement.
r e t r a n c h e m e n t , (Gramm. franc.') il y a dans le
ftyie des retranchemens vicieux , & des retranchcmcns élé-
gans. Exemples des uns Sc des autres. X IV . 217. a.
R e tranchement de la coupe , ( Théolo^. ) Koyeç C ommunion
so u s LES DEUX ESPECES. III. 732. a. Divifion
entre les proteflans fur la communion des abPemes. 1. 43.
b. Les Calixcins le font éLves (.outre le retranchement de
la coupe. II. 360. b. Guerres occafioniiées en Bohême au
fiijec de ce retranchement. V I . 132. a. La mouüache regardée
comme une raifon qui a fait retrancher la coupe
aux laïcs. X . 823. a. Ce retranchement juftifié par M. de Meaux.
I. 43. b.
R e tr an ch em en t , (^Anmilic.') différentes fortes de re-
ti anchuncns. X IV . 217. é.
Retranchement que les Romains conftruifoient autour de
leurs camps. IX. 633. a. Camp retranché. II. 373. a , b.
(iorps retranché. Suppl. II. 133. a , b. Sec. Rctrandicmem
d’un camp de raffcmblcment. 152. a. Sorte de retranchement
appelle abattis. Suppl. I. i i . b. Barrières dans un retranchement.
II. 93. a. Retranchement dans un ouvrage
dont on vient de dépoffedor l’ennemi. IX. 637. a. b'oycz
Lignes. ^ ^
Retranchement , {Marine ) X IV . 217.^.
R e tranchement ùc- l ’édit des fécondés noces, (Jurlfpr.)
X IV . 217. b. jy )
R e tr a n ch em en t , {Archit.) X IV . 217./-.
RÉTRECISSEUSE, celle qui au moyen de quelques mé-
dicamens répare en quelque forte la virginité perdue.
Exemples du danger de ces remedes. X IV . 218. a. Voyez
Restrinctifs.
R E T R O A C T IF , e fe t , ( Jurifpr. ) V . 406.
r é t r o g r a d a t i o n , ( AJlron. ) différens phénomènes
dans le mouvement des plnnetes, qui les font paroitre toiir-
u-tourdireéles, ffationnaires, rétrogrades. X IV . 218. <r. Intervalle
de teins entre les deux rétrogradations des différentes planètes.
Maniéré dont on p eut expliquer ces rétrogradations. Les
R E V
arcs de rétrogradations des differentes planètes ne font point
égaux./üi/. b.
Rétrogradation des nesuds de la lune. Période de ce mouvement
retrograde. Sa caufe démontrée par Newton. XIV.
218. b.
Rétrogradation du foleil. Lorfque le foleîl eft dans la zone
torride , & que fa décliiiaifon eft plus grande que la latitude du
lieu, le foleil paroitfe mouvoir en arriéré, ou rétrograder avant
ou après midi. X IV . 219. a.
r é t r o g r a d e , (Phyftj.) fl roe il& l’objet fe meuvent du
même fens, mais que l’oeil parcoure plus d’efpace que l’objet,
Üfcmblera que l’objet foit rétrograde. Ordre rétrograde dans
leschifi'res. Vers rétrogrades. X fV . 219. a.
RET S , ( Péc/ie ) rets fecrecs tramaillés. X IV . 219. a.
Rets à colins. Rets de baffe eau. Rets traviffans. Ibid. b.
Rets fédemaires avec lefquels on fait la pêche des maquereaux
6c des cguillettcs. Les tramaux. Rets de gros fonds
ou folles. Rets dont les pêcheurs de la baie de Vannes en
Bretagne, fe fervent à l’ouverture des gorges ou canaux
dont la baie eft entrecoupée. Rets traverfans du paffage de
Saint-Armel. Defeription la pèche avec filet en me r ,
nommé parles pécheurs improprcmentyl'ï/zfj. Ibid. iz o . a.
Rets à meiiilles. Rets de grands mnclcs. Rets noircis fimples.
Ibid. b. Rets de gros fondsou filet noirci. 7iiù. 221. a. D e feription
de la pêche des bas parcs , on vencts 6c rets de
grandes mailles à pieux ou doubles piquets ; amirauté de
Carenran & Ifigny. Rets à crocs. IbiJ. b. Defeription de
la pèche des rets entre roches ou traverfis , amirauté de
Brefl. Rets traverffer , chalut ou clreige. Ibid. 222. a. Rets
à mulets ou filets d’enceinte. La defeription des dift'érentes
fortes de rets qui viennent d’être indiquées eft accompagnée
de celle de la maniéré d’en faire ulagc. Ibid. b. Voye^
Pèche.
R ets admirable, {Anatom.) petit plexus de vaiffeaux qui
entoure la glande pitiiitaire.il eft très-apparent dans les brutes,
mais il n’exifte point dans l ’homme, ou il eft ff petit qu’on
doute de fou exiftence. Son ufage felon Galien & félon Willis.
X IV . 222. E
Rets , ( Charronnage') XIV. 223..7.
R ET Z , ( Comrn. ) mefure de continence. X IV . 223. a.
Retz ou R.iis , ( Geogr.) pays de France dans la Bretagne.'
Origine de fon nom. Princes qui l’ont poffédé. X IV . 2 iy .a .
Voye^ auffi RetZ , Suppl.
R EüCH LIN , ( Jean ) obfervations fur fa vie & fur fes ouvrages.
X II. 481. a. XIII. 626. b.
R Ê V E , {Comrn.) ancien droit qui fe leve fur les mar-
chandifes qui entrent en France, ou qui en forcent. X IV .
223. a.
Rêve , ( Métaphyf. ) nous avons en rêvant un fentiment
interne de nous-mêmes , 8c en même tems un affez grand
délire pour voir plufteurs chofeshors de nous. Caufe des rêves.
X IV . 223. é.
Pourquoi ils nous trompent. V I . 130. a. 152. bé
Comment les Indiens fe procurent'des rêves agréables. Suppl.
I- 79?- “ ■
Reve, {Médec.) fentiment de Lommius fur le diagnoftie
& le prognoftic qu’on peut tirer des différentes fortes de rêves
dans les maladies. X IV . 223. b.
R E V Ê CH E , {Lainage) forte d’étoffe de laine groftîere.
Métier fur lequel elle fe fabrique. Différentes couleurs de
cette étoffe. Ufages auxquels on l’emploie. X IV . 223. b.
R É V E IL , {Phyfwlog.) différentes caufes du réveil eft
famé 6c en maladie. Phénomènes ordinaires du réveil. X IV .
224. a.
Réveil. Caufe 8c phénomènes du r éreil. X V . „ a . J.
Suppl. IV. 809. <j. Pourquoi l’on eternue après le réveil.
VI. 49. b. Pourquoi l’odorat eft émouffe quand on s’éveille,
X L 337. b.
Réveil ou Diane, ( Art milit.) X IV . 224. a.
Réveil, {Horlog.) defeription de cette machine , voW
IV des planches , Horlogerie, planche 1. Montre à réveil.
Ibid, planches i. lo . fuite.
R E V E L , {Géogr.) ville de l’empire mffien, dans la haute
Livonie. Ses commencemens. Commerce que les Mofeovites
y entretiennent. Defeription de cette ville. X IV . 224. a. Ses
privileges. Son gouvernement. Ibid. b.
Rével, {Géogr.) petite ville de France en Languedoc.'
Scs révolutions. Ouvrages de David Martin, favantthéologien,
né à R é v e l, 6c ininiftre de l’églifefrançoife d'U trechtoii
R E V
il fe réfugia en 1683. XIV. 224. b.
~ 1V E L A T IO N , ( Théolog. ) différentes acceptions de
RÉ V É LA ION .,
I ju iv e ,
ce mot. X IV . 224. b. Révélation juive 6c révélation chré-
tienne. Un auteur moderne a cru jiropofer une difficulté
folid e , en remarquant que les révélations font toujours
fondées fur des révélations antérieures. Développement Sc
réfutation de cette objeftion. But principal de toute révé-
l.ation. Deffein particulier des révélations accordées à la nation
juive. La révélation chrétienne eft fondée fur une partie
de celle des Juifs, iéït/. 223. a. En quel fens le Meffie
devoi»
devoit être le libérateur & le reftaurareur de fa nation. La
révélation chrétienne , au lieu de rétablir & de confirmer
les différentes branches de la révélation judaïque, a au contraire
détruit Sc renverfé celles qui ne fe rapportoient pas
au »Meffic. La ruine 8c la difterfion des Juifs , effet de leur
opiniâtreté à rejetter Jefus-CJirift , avoient été prédites , ôc
ce font ces prédiélions qui devroienc leur ouvrir les yeux
fur la divinité du fauveiir. Ibid. b. De.s caraéleres que doit
.avoir une révélation , pour qu'on puiffe en reconnoitre ia
divinité./éiil. 226. a. Divers fens que reçoit le mot de révéla-
lion dans l’écriture. Ibid. b.
Révélation. Nécefficé d’une révélation. I. viij. Difc. prélim,
III- 383. a. X IV . 79. a. Vérités auxquelles elle fe borne.
I, viij. Caraâere d’une révélation : confentement de l’ef-
prii que nous lui devons. XIII. 773. b. 774. a. Des révélations
judaïque 8c chrétienne. Suppl. IV. 334, « ,
R é vé la tio n , {Jurifpr.) déclaration faite à un curé ou v icaire
, enconféquence d’un monitoire. Ces révélations ne forment
point encore une preuve juridique. Tous ceux qui ont
connoiffance du fait qui eft l’objet dit monitoire, ne peuvent
fe difpenfer de venir à révélation. X IV . 226. b. Voyez
M o n ito ir e .
RÉV É LE R , Déceler, Découvrir , Manifejler, ( Synon. )
IV. 662. b.
KE'Vf.'ÜAÜS , {H ifl.d e s fu p e^ ii.) voyc^ A p p a r i t io n ,
Spectre. Comment on a expliqué ia poflîbilité de l’apparition
des ombres fur les cimetières. X I. 783. a. Revennns
auxquels les G recs de l’Archipel croient. XVII . 313. a. Danger
de joindre dans l’efprit des enfans les idées de ténèbres 6c
derevennns.I.772. a.
R E V EN D EU SE S la toilette ,{Comm. fecret) Pourquoi
ces fortes derevendeufes fomainfi nommées. Leur commerce
défendu en France. X IV . 226. b.
R E V EN D IC A T IO N , ( Jurifpr. ) de la revendication chez
les Romains. D e la revendication parmi nous : celle des per-
foiines : celle des chofes. X IV . 227. a.
Revendication , voyei^ VINDICATION. Fautes en matière de
revendication, V I . 439. b.
REVENUS de l'état, ( Gouv. Polit.) pour bien fixer ces
revenus , il ne faut point prendre au peuple fur fes befoins
réels, pour des befoins de l’état imaginaires. C e n’cft point à
ce que le peuple peut donner , qu’il faut ntefurer les revenus
publics, mais à ce qu’il doit donner. Diftinélion qu’on doit
faire entre les différentes fortes de revenus d’un état, pour en
conclure quels font ceux qu’on doit fixer. Par r.ipporc à la m éthode
de percevoir les revenus de l ’état, on obfcrve que celle
delà régie a pour elle le fuffrngedes meilleurs citoyens. Précaution
à prendre contre les fermiers dans le cas fuppofé qu’on
préférât la fei me à la régie. X IV . 228. a.
Revenus des temples des païens. X V I. 64, a , h. Revenus
de l’églife. V . 423. a, b. Revenus dans l’état, foie du fouverain,
foit des particuliers. V I .813. ij.
RÊ V ER , Songer , Pen fer , ( Synon. ) XII. 31 1 .
R E V E llCH E R / ’ètuï«. Defeription de cette opération. X IV
2l8.i.
R É V ÉR ER , Adorer, Honorer, (S’y/ton.) I. 144. é.
RÉVÉRIEN , de Saint- {Géogr.) dans rAiltunois.
Suppl. I. 7 1 1. a.
R EV ERS , { Art nurniftnat.) les médailles ou monnoles
romaines furent long-cems fans aucune efpece de marque.
Premieres monnoics marquées. X IV . 229. a. Premiers revers.
Cliangemens arrivés dans la fuite ; les maîtres de la
monnoic la marquèrent de leurs noms, y mirent leurs qualités
, Sc y firent graver les monumens «le leurs familles.
Jiiles-Ccfar s’étant rendu maître abfolu de la république ,
«Il lui donna le privilege de marquer la monnoie de fa
tctc Si de fon nom , & de tel revers que bon lui femble-
roit. Ce qui rend aujourd’hui précieiifcs ces médailles antiques
, c’eit qu’on y trouve mille événemens dont l’Iuftoirc
11'a fouvent point confervé la mémoire. Exemples. Ibid. b.
Des differentes fortes de revers qui fe voient fur les mé-
tlaillcs. Plus les revers ont de figures, & plus ils font à
cffinier, particuliérement quand ils marquent quelque aélion
mémoialile. Les mominiciis publics donnent au revers des
iiicdailles une beauté particulière, fur-tout quand ils font
lelatifs quelque événement liifforiqne. Ibid. 230. a. Les
animaux différens qui fe rencontrent fur les revers en augmentent
auffi le mérite, fur-tout quand ce font des animaux
extraordinaires. Médailles de l’empereur Philippe qui portent
la figure des animaux qu’il fit paroitre aux jeux fcciilaircs.
Des^ éléphans rcpréfcniés au revers des médailles. Médailles
oil 1 on voit la rcprcfcniation d'uu phénix. Parmi les médailles
qui ont des oifeaux â leurs rev ers , il n’y en a guère
de plus curieufes que celles en petit bronze d’Aiuoiiin
le pieux & dAdrieu. Ibid. b. Souvent l’empereur dont la
médaille porte la tète en grand volume , fe voit encore
placé lut le revers fous la figure d’une deite ou d'un génie.
Manicrcs dont on peut ranger les différons revers des médaillcs
r venclrc les cabinets plus miles. Méthode fuivic
R E V 593 par O cco & Mezzabarba. Autre ordre plus favant fuiv
Uifehus. Ibtd. 231. m Celui qu’a obfervé le R. P. dbm
Anielme Bandun dans fon grand recueil. Marques de l’au-
toriie publique lur les revers des médailles. Comment on
a putee dans les médailles le nont des villes où elles ont
été frappées. Ibtd. b. Les revers font encore chargés des
marques pamenheres des monétaires. Marques qui n’ont
rapport qua la valeur des monnoics, & qu’on ne trouve
que dans les confiilaires. Médailles dont le revers ne convient
point à la tête. Nous ne devons faire aucun cas de
celles dont les revers ont été contrefaits, inférés ou appliques.
Ibtd. 232. m Pour ce qui regarde les divers fymboles
quoi! voit fur les revers des médailles antiques, vover iemor
Symbole. ’ a \
Rtvcrspsmidâ'dlts, voye z ce dernier mot. Explication des
üirtcrensfymbolesgravéslurces revers, X V . 728. a , h. Scc.
Revers, terme de fortification, terme de marine X IV
232. a.
du, ( Jeux ) explication de ce jeu. XIV.
REVERTIER , U jeu du {Jeux) explication de ce jeu.
A lV . 233. b. '
RE V E TEM EN T , U {Fortifie.) revêtement de maçonnerie
, revêtement de gazon. Epaiffeur du revêtement de
ma^nneric^ au cordon. Taluts du revêtement. Ouvrages à
confultcr. X IV . 234. a. Rempart à demi-revétcmeiit. Elpeces
de revêtemens de fauciffes & de fafeines. Ibid. b.
Revêtement , auteurs qui ont donné les moyens de déter*-
miner l’épaiffair du revêtement &. des taluts, felon la hauteur
des terres qu’ils doivent fomenir. Talut des remparts
revêtues de maçonnerie, 8c des remparts revêtus de gazon.
X V . 870. é. Demi-revêtement. IV. 813. b.
Revêtement des terres , {Archit.) appui de maçonnerie
quon donne à des terres pour les empêcher de s’ébouler.
Difficulté d établir des regies pour déterminer la force que
doit avoir le revêtement pour réfifter à la pouffée des terres.
Ouvrages fur ce fujet. Le mur de revêtement doit principalement
s’oppofer à l’effort que font les terres pour s’étend
re, lorfqti’elles fout imbibées d’eau. XIV, 234. b. Plus les
terres ainont de facilité de s’imbiber d'eau, plus elles auront
de pouffée contre un mur de revêtement. Remcde que M. de
Réaumiir propofe pour prévenir ccr inconvénient. Ibid,
REVIRER. {Navig.tt.) V I. 203. a , b.
rom.) officier pour les matières
béuèfieiales ou matrimoniales. Revifeur/icr Revifeur
des matrimoniales. XIV, 233. a.
REVISION. {Jurifpr.) Revilion d’iin compte. Revlfion en
matière civile. Revlfion en matière criminelle : différence
entre la rcvifion & la requête civile. X IV . 23 5. é. M oyen d’obtenir
des lettres de revifion. Revlfion , droit que les procureurs
ont pour revoir & lire les écritures des avocats. Ibid.
236. <7.
Revifon , lettres de. IX. 428. a.
Revision, {Fabriq. des armes) lieu des manufaélures
ro ya le s , où des ouvriers de confiance examinent les armes
des troupes. Opérations qui ffiivcm cec examen. Suppl. IV .
R E V IV IF IC A T IO N , {Chymic) mercure revivifié du
cimiabrc. Alercure révivifié du fublimé conofif; ce dernier
ne peut qu’être 6c eft en effet très-pur, coiure l'opinion des
médecins peu inftniiis. X IV . 236. a.
Révivific.ition , operation chymique pour féparer le foufre
dit mercure dans le ciimabre. III. 454. <7. Revivification du
cinnabre. Vol. VI. des planch. Métallurgie , travail du
mercure.
Revivification d'écriture. {Jurifpr.)\.'^7o. 3 7 3 . IX.
43T
R E U N IO N , {Chirurg.) moyens d’obtenir la réunion de
différentes fortes de plaies. Bandage imaginé p.ir M. Pibrac
pour la réunion des plaies tranfverfales de la langue. Defeription
de la maniéré de réunir les plaies par la future feche
X IV . 236. b.
Réunion, voye^ Plaie : aiguille pour la réunion des plaies.
I, 203. a , b. Toute opération par laquelle on réunit des
parties féparées, s’appelle fytuhcfe , voyez ce mot.
R É V O L T E , ( Gc>«v. Politiq. ) caufes des révoltes , dé ve loppées
par l’auteur du Télémaque. XIV. 237. a. Comment
le monarque parvient à contenir fes fujecs dans le devoir
Ibid. b.
Révoltes dans les états dcfpotiqucs. IV . 888. a.
R É V O L U T IO N , {Hiß. mod. d'Anglet.) celle de 1688,
lorfque le prince ci’Oninge , Guillaume de Naffaii, monta
fur le trône à la place de fou beau-pere , Jacques Suiard.
Enchiiinemciu des caufes qui donnèrent lieu à cette révolution.
X IV . 237. b.
Révolution. fGiw/t,) XIV. 237. b.
Révolution , Périodes Sc Rotation.
Les planètes ont deux efpcccs de révoUuions; l’uuc diurne
L L L l l I I