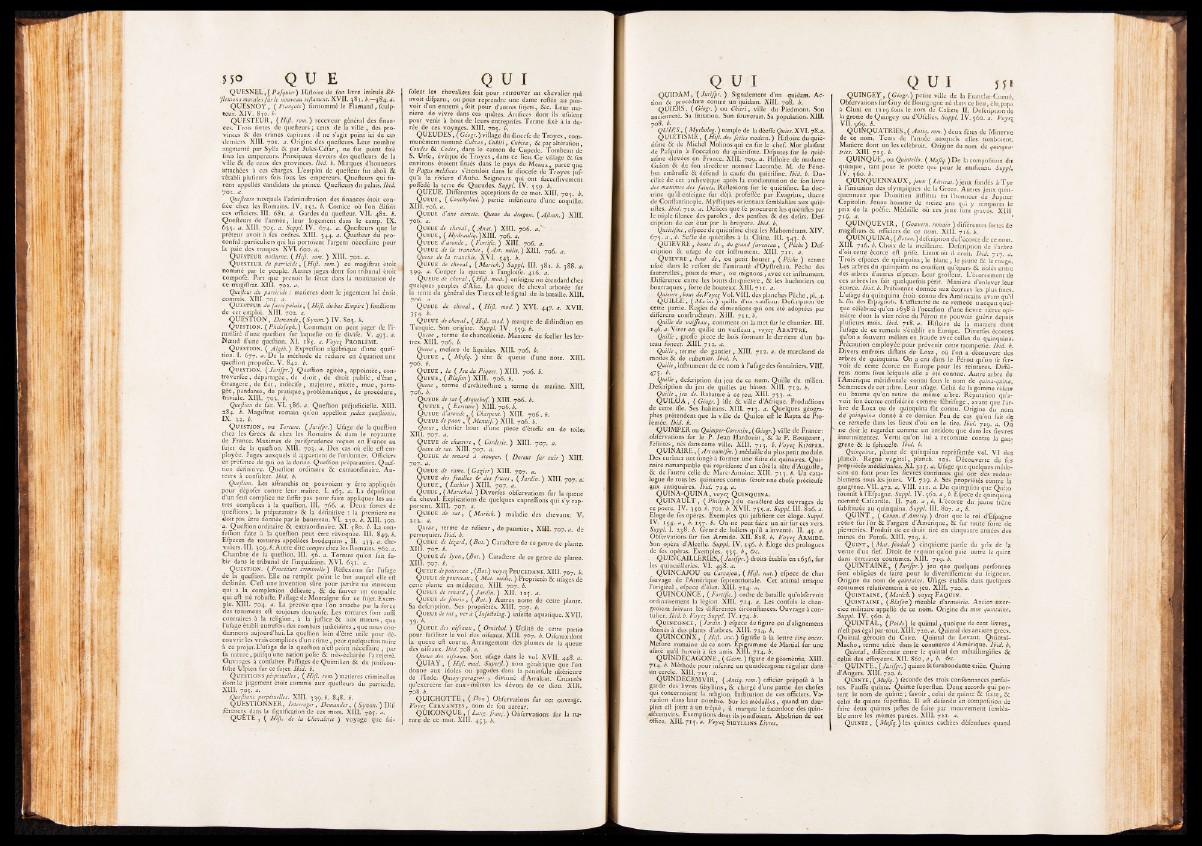
Ir i»
:1 m ? Q U E
r li l■ #s-ll ir ,irf;iii , Ï
H'i '■ i*'
5 50
Q U E SN E L , ( Pj/juitfr) Hifloirc de foil livre intitulé Äe-
'ßextuns moules furU nouvc.iu ieß.rncnt. X V II . ■ 581. b.— 384. a.
Q U E SN O Y j {F uiiçois) fiimommé le Flamand , fculp-
tciir. X IV . S30. b.
QUE.STEUR, {Hifl. rom.) receveur general des finances.
Trois /brtes de qiicfteurs ; ceux de la ville , des provinces
& des crimes capitaux ; il ne s’agit point ici de ces
•derniers. XIII. 701. a. Origine des quelleurs. Leur nombre
nugmenté par Sylla 5 c par Jules-Célar , ne fut point fixé
fous les empereurs. Principaux devoirs des quefieurs de la
v ille & de ceux des piovinces. Ibid. b. Marques d'honneurs
attachées à ces charges. L’emploi de quefieur fut aboli Sc
vétabli plufiems fois fous les empereurs. Quelleurs qui furent
appelles candidats du prince. Quelleurs du palais./itV.
702. -i.
Queßeurs auxquels radminlftratlon des finances étoit confiée
clioz les Romains. IV. i p . b. Comice où l'on clifoit
CCS ofiieiers. III. 681. a. Gardes du quefieur. V IL 482. b.
Quelleurs de l’armée, leur logement dans le camp. IX.
63^. a. X l l l . 705. J. Suppl. IV . 674. a. Quelleurs que le
préteur avoir à lés ordres. XIII. 344. j . Quefieur du pro-
conful : particuliers qui lui portoient l’argent nécelTaire pour
la paie des troupes. X V I. 600. a.
Q uesteur noclurrc. {FUß. rom\ ) XTIl. 702. a.
■ Questeur du pjrricidc, {Miß. rom.) ce magillrat étoit
nommé par le peuple. Autres juges dont fon tribunal étoit
compofé. Parc que prenoit le fénat dans la nomination de
ce magillrat. XIII, 702.
Queßeur du parricide : matières dont le jugement lui étoit,
commis. XIII. 705. a.
Q uesteur du Jàcrcpalais, ( Hiß, du bas Empire ) fonélions
de cet cnmloi. XIII. 702. a.
Q U E S T IO N , Demande,{Synon.) IV. 803. h.
Q uestion. {Philofoph.) Comment on peut juger de l’inutilité
d'une quefilon fur laqitelle ou fe divife. V. 493. a.
Noeud d’une quellion. XI. 185. Voye^ Problème.
Q uestion. ( Âl^éb.) Exprelfion algébrique d’une quef-
tion. I. 677. a. De la méthode de réduire en équation une
quellion propofée. V. 842. b.
Q uestion. {Jurifpr.) Quellion agitée, appointée, con-
troverlée , départagée, de d io it , de droit public, d’é ta t,
étrangère, de fuit, inclécife , majeure, mixte, mue , partag
é e , pendante, de pratique, problématique, de procédure,
triviale. XIU, 702. b.
Q_ucßion de fait. V I. 386. a. Quellion préjudicièlle. XIII.
284. b. Magillrat romain qu’on appelloit judex quczßionis.
Q uestion, ou Torture. {Jurifpr.) Ufage de la quellion
chez les Grecs & chez les Romains & dans le royaume
de France. Maximes de jurifprudence reçues en France au
fujet de la quellion. XIII. 703. a. Des cas où elle efi employée.
Juges auxquels il appartient de l’ordonner. Officiers
en préfence de qui on la donne. Qiiefiioii préparatoire. Quef-
tion définitive. Quellion ordinaire & extraordinaire. A u teurs
à confulter. Ibtd. b.
Queßiori. Les aftranchis ne pouvoient y être appliqués
pour dépofer contre leur maître. I. 163. a. La dépofition
d’un feul complice ne fuffit pas pour faire appliquer les autres
complices à la quellion. III. 766. a. Deux fortes de
quellions ; la préparatoire & la définitive : la premiere ne
doit pas être donnée parle bourreau. V I . 230. b. XIII. 300.
a. Quellion ordinaire & extraordinaire. XI. 380. b. La con-
felTion faite à la quellion peut être révoquée. III. 849. b.
Efpeces de tortures appellées brodequins , II. 433. a. chevalets.
III. 309. b. Autre dite campes chez les Romains. 762. a.
Cliainbre de la quellion. III. 56. a. Torture qu’on fait fu-
bir dans le tribunal de l’inquifition. X VI. 631. a.
Q uestion. {Procédure criminelle) Rcfiexions fur l'iifage
de la quellion. Elle ne remplit point le but auquel elle ell
defiinée. C e l l une invention sûre pour perdre un innocent
qui a la complexion délicate, & de fauver im coupable
qui efi né robufte. PalTage de Montaigne fur ce fujet. Exemple.
XIII. 704. a. La preuve que l’on arrache par la force
des tourniens efi toujours douteufe. Les tortures font auffi
contraires à la religion, à la jufiiee & aux moeurs, que
l’ufage établi autrefois des combats judiciaires , que nous condamnons
aujourd'hui. La quellion loin d’être utile pour découvrir
les vrais complices d’un crime , peut quelquefois nuire
à ce projet.L’ufage de la quellion n'efi point nécelTaire , p.ar
fa nature, puifqu’une nation polie Sc trés-éclairée l'a rejette.
Ouvrages à confulter. Pafiages de Quintilien & du jurifeon-
fulte Ulpien fur ce fujet. Ibid. b.
pérpetuelles, {H iß. row. ) matières Criminelles
dont le jugement étoit commis aux quelleurs du parricide
XIII. 703. a.
Qutßions perpétuelles. XIII. 339. 848. b.
Q UEST ION N ER , Interroger, Demander, ( 5 yn<?72. ) D ifférences
dans la fignification de ces mots. XIII. 703. a.
Q U Ê T E , ( Hiß. de la Chevalerie ) voyage que fai-
Q U I
foîent les chevaliers foit pour retrouver un chevalier qui
avoir difparu, ou pour reprendre une dame reliée au pouvoir
d'un ennemi , foit pour d’autres fujets, & c . Leur maniéré
de vivre dans ces quêtes. Artifices dont ils ufoient
pour venir à bout de leurs entreprifes. Terme fixé à la durée
de ces voyages. XIII. 70Ç. b.
Q U E U D E S , (Gc'ogr.) village du diocefe de Tro y es , communément
nommé Ciibtas, Cubiti, Cubita:, ÖC par altération,
Coudes 6c Codes, dans le canton de Cupede. Tombeau de
S. U rfe , évêque de Troyes , dans ce lieu. C e village & fes
environs étoient fitués dans le pays de Meaux, parce que
le Pagus mcldicus s’étendoit dans le diocefe de Troyes juf-
qu’à la riviere d'Aube. Seigneurs qui ont fucccflivcment
polTédé la terre de Queiides. Suppl. IV. ^^9. b.
QUEUE. Différentes açceptions de ce mot. XIII. 705. b.
Q ueu e, {Conchyliol.) partie inférieure d’une coauille.
XIII. 706. a.
Q ueue d'une comele. Queue du dragon. {Afiron.) XIII.
706. a.
Q ueue cheval, {A n a t.) XIII. 706.
Q ueue, { HydrauU(i.)H\\\. 706. a.
Q ueue d'aronde, {Fortifie.) XIII. 706. a.
Q ueue de la tranchée, {Art. milit.) XIII. 706. a.
Queue de la tranchée. X V I . ^43. b.
Q ueue de cheval, {Maréch.) Suppl, III. 381. b. 388. a,
399. a. Couper la queue à l'angloife. 416. a.
Q ueue de cheval, {Hiß. mod.) enfeigne ou étendard chez
quelques peuples d’Afic. La queue de cheval arborée fur
la tente du général des Turcs ell le fignal de la bataille. XIII.
706. J.
Q ueue de cheval, ( Hiß. mod. ) X V I . 447. a. X V I I .
354. b.
Q ueue de cheval, ( Hiß. mod. ) marque de difiinélion en
Turquie. Son origine. Suppl. IV . 559. b.
Queue , terme de chancellerie. Maniéré de fceller les lettres.
XIII. 706. b.
Queue, mefure de liquides. XIII. 706. b.
Q ueue , ( Mußq. ) tète & queue d’une note. XIII.
706. b.
Q ueue , la ( Jeu du Piquet. ) XIII. 706. b.
Q ueue, {Blafon) XIII. 706. b.
Queue , terme d’architeflure ; terme de marine. XIII.
706. b.
Q ueue de rat {Arquebuf. ) XIII. 706. b.
Q u e u e , ( £cmirrc) XIII. 706.
Q ueue d’aronde , ( Charpent. ) XIII. 706 . b.
Q ueue de paon , ( Mennif ) XIII. 706. b.
Queue , dernier bout d’une piece d’étoffe ou de toiles
XIII. 707. a.
Q ueue de chanvre, ( Corderie. ) XIII. 707 a
Queue de rat. XIII. 707. a.
Q ueue de renard à étouper. ( Doreur fur cuir ) XIII
70 ^ .2.
Q ueue de rame. {Gafier) XIII. 707. a.
Q ueue des feuilles & des fruits , ( Jardin. ) XIII. 707. a.
Q u e u e , {Luthier ) H \\1, 707. a.
Q u eu e , {Maréchal. ) Diverfes obfervations fur la queue
du cheval. Explications de quelques expreffions qui s’y rapportent.
XIII. 707. a.
Q ueue de rat, ( M.tréch. ) maladie des chevaux, V .
212. a.
Queue , terme de relieur , de paumier , XIII. 707. a. de
perruquier. Ibid. b.
_ Q ueue de léi^ard, {Bot. ) Caraélerc de ce genre de plante.
X l i l . 707. b.
Q ueue de lyon, {Bot.) Caraélere de ce genre de plante.
XIII. 707, b.
Q ueue de pourceau , {BotJ) voyc^ PeuCedane. XIII. 707. b.
Q ueue de pourceau, ( Mat. médic. ) Propriétés & ufages de
cette plante en médecine. XIII. 707, b.
Q ueue de renard, l Jardin.) XII. 125. a.
Q ueue de fouris, ( Bot. ) Autres noms de cette plante.
Sa defeription. Ses propriétés. X l l l . 707. b.
QuEUEùtrd/, verà {Infeélolog.) infcile aquatique. XVII.
Q ueue oifeaux, {O m ithol.) Utilité de cette partit»
pour faciliter le vol des oifeaux. XIII. 707. b. Oifeaux dont
la queue efi courte. Arrangement des plumes de la queue
des oifeaux. Ibid. 708. a.
Queue des oifeaux. Son ufage dans le vol, X V II . 448. a.
Q U IA Y , ( Hiß. mod. Superß.) nom générique que l’on
donne aux idoles ou pagodes dans la pénlnfule ultérieure
de Tlnde. Quiay-poragrai , divinité d’Arrakan. Cruautés
qu’exercent lùr eux-mêmes les dévots de ce dieu. X lll,
708. b.
Q U IC H O T T E , ( Don ) Obfervations fur cet ouvr.tgc.
Feveî; C ervante s , nom de l'on auteur.
Q U IC O N Q U E , { Lang, franc.) Obl'crvacions fur U na*
ture de ce mot. XIII. 453. b.
Q U I
q u i d a m , ( Jurifpr. ) Signalement d’nn miidam. A c tion
5 c procédure contre un quidam. XIII. 708. b.
Q U IER S, {Géogr.) ou Chieri, ville du Piedmont. Son
ancienneté. Sa fituation. Son fouverain. Sa population. X llL
708. b.
QDIES ,{Mytholog.)tQmp[c de la déeffe Q «i« .XV I. 78.Æ.
Q U IÉ T ISM E , {Hifl.des Jeàies modem.) Hilloirc du quié-
tifmc Sc de Michel Molinos qui en fut le chef. Mot plaifant
<le P.ifquin à Toccafion du quiécifme. Difputes fur le qtiié-
lifmc élevées en France. XIII. 709. Hifioire de madame
Guion 5 c de fon direéleur nommé Lacombe. M. de Fénelon
embraffe 5 c défend la caufe du quiétifmc. Ibid. b. D o cilité
de cet archevêque après la condamnation de fon livre
des maximes des faints. Reflexions fur le quiétifme. La doctrine
qu’il enfeigne fut déjà profeffee par Evagrius, diacre
de Confianrinople. Myfiiques orientaux Icmblables aux quié-
tifies. Ibid. 710. a. Délices que fe procurent les quiétifies par
le triple filence des paroles, des penfées & des defirs. Def-
eription de cet état par la bruyere. Ibid. b.
Quiétifmc, cfpece de quiétifme chez les Mahometans. X IV .
675. a , b. Scilc de quiétifies à la Chine. III. 343. b.
Q U IE V R E , bouts de, du grand faveneau, {Pèche) Dcf-
ciiptioii 8c ufage de cet inllnimcut. XIU. 7 1 1. a.
Q uie v r e , bout de, ou petit houtet , ( Pèche ) terme
iifité dans le relTort de l’amirauté d’Oyfirchnn. Pèche des
fautercllcs, poux de mer, ou mignons , avec cet infirument.
Différence entre les bouts du quievre, 5 c les buclioiiers ou
bourraques , forte de bouieux. XIII. 7 1 1 . a.
Quievre, bout Vol. V III. des planches Pèclie,pL 4.
Q U IL L E , {M.irine) quille d’im vaiffeau. Defeription de
cette partie. Regies de dimcnfions qui ont été adoptées par
différens conftriiéleiirs. XIII. 711. b.
Quille du vaijfeau, comment on U met fur le chantier. III.
146. <2. Virer ea quille un vaiffeau , roycç A b a t t r e .
Quille , groffe piece de bois formant le derrière d'un bateau
foncct. XIU. 712. a.
Quille, terme de- gantier , XIII. 712. a. de marchand de
modes Sc de rubanier. Ibid. h.
Quille, infirument de ce itom à l’ufage des fontainiers. VIII.
475. b.
Quille, defeription du jeu de ce nom. Quille du milieu.
Defeription du jeu de quilles au bâton. X l l l . 712 . b.
Quille , jeu de. Rabattre à ce jeu. XIII. 733. a.
Q U iL O A , {Géogr.) iûe S e ville d’Afrique. Produftlons
de cette ifle. Ses habitans. XIII. 713. a. Quelques géographes
prétendent que la ville de Quiloa efi le Rapia de Pio-
lémée. Ibid, b,
Q UIM PER ou Quimper-Corentin, {Géogr.) ville de France;
obfervations fur le P. Jean Hardouin , 5 c le P. Bçjugeant ,
Jéfiiites, nés dans cette ville. XIU. 713 . b. Foye^ K i.mper.
Q UIN AIR E , ( Art numifm. ) médaille du plus petit module.
Des curieux ont longé à former une fuite de quinaires. Q u inaire
remarquable qui repréfente d’un coté la tète d’Au gu lle ,
5 c de l’autre celle de Marc-Autolnc. XIII. 713 . b. Un catalogue
de tous les quinaires connus feroii une chofe précieufe
aux antiquaires. Ibid. 714. a.
Q U IN A -Q U IN A , voye^ Q u in q u in a .
Q U IN A U L T , { Philippe) ila caraélere des ouvrages de
ce poète. IV . 350. b. 702. b. XVII . 753.<2. Suppl. 1 1 1 . 826. a.
Eloge de fes opéras. Exemples qui jullifient cet éloge. Suppl.
IV . 134. a , b. 137. b. On ne peut faire un air fur ces vers.
Suppl. I. 238. b. Genre de ballets qu’il a inventé. II. 43. a.
Obfervations fur fon Armidc. XII. 828. b. Voye^ A rmide.
Son opéra d’A lccfie. Suppl. IV. 136. b. Eloge des prologues
de fes opéras. Exemples. 33^. b , (rc.
Q UIN CAILLERIES, ( Jurifpr.) droits établis en 1636, fur
les quincailleries. VI. 498. a.
Q U IN C A JO U ou Carcajou, {H ijl. nul.) efpece de chat
fauvage de l'Amérique feptemrionale. Cet animal attaque
l’original, efpece d’élan. XIII. 714. a.
Q u i n c o n c e , ( Fortifie. ) ordre de bataille qu’obfervoit
ordinairement la légion, X l l l . 714. a. Les confuls le chan-
geoient 1'nivant les differentes circonftances. Ouvrage à con-
fuller. Ibid. b. l'oye^ Suppl. IV. 1 74. h.
Q u in c o n c e , {Jardin.) efpece défiguré ou d'alignemens
donnés à des plants d'arbres. XIU. 714. h.
Q U IN C O N X , ( Hifl. une.) fignifie à la lettre cinq onces.
Melure romaine de ce nom. Épigramme de Martial fur une
afnté qu’il biivoit à fes amis. X l l l . 714. b.
Q U IN D E C A G O N E , ( Géom. ) figure de géométrie. XIII.
714. b. Méthode pour inferire un quindécagone régulier dans
un cercle. XIU. 71 ç../,
Q U IN D E C EM V IR , {Antiq. rom.) officier prépofé à la
garde des livres fibyllins, Sc chargé d’une partie des chofes
qui concernolent L religion. Inftitution de ces officiers. Va-
riation dans leur nombre. Sur les médaillts, quand un dauphin
efi joint à un trépié, il marque le facerdoce des quin-
•d^emvirs. Exemptions dont ils jouiffoient. Abolition de cet
office. XIII. 715.12. Sib yl lin s liv r f j .
Q U I 55*
Q U IN G F .Y , {Geogr.) petite ville de la Frandic-Comté.
Oblèrvaiions fur G u y defiourgogiic né dans ce lieu, élu, pape
à Cluni en 1 1 19 fous le nom de Cnlixte II. Defeription de
la grotte de Quiiigey ou d’Ofelies. Suppl. IV . 560. a. Foye^
VH. 969. b.
Q U IN Q U A T R IE S , ( Antiq. rom.) deux fêtes de Minerve
de ce nom. Tems de l’année aiix(|uds elles tombaient.
Manière dont 011 les cclébroit. Origine du nom de qutnquw
tries. XIU 715.
Q U IN Q U E , ou Qiiintello. ( Mufq. ) De la comjiofitian du
qtiinquc, tant pour le poète que pour le muficicn. Suppl.
IV . 560. b.
Q U IN Q U E N N A U X , yc/rar ( iù/eVar. ) jeux fondes à T y r
à l’imitation des olympiques de la Grcce. Auties jeux quinquennaux
que Doiiùtien inliitua eu l’honneur de Jupiter
Capitolin. Jeune iiomme de treize ans qui y remporta le
prix de la poéfic. Médaille où ces jeux font gravés. XIU
716. a.
Q Ü IN Q U E V IR , ( Gouvern. romain ) différentes forces de
magiftrats 5 c officiers de ce nom. XIU. yiù .b .
Q U IN Q U IN A , ) defeription de l’écorce do ce nom.
X l l l . 716. b. Choix de la meilleure. Defeription de l’arbre
d’où cette écorce cft prife. Lieux où il croit. Ibid. 7 17 . a.
Trois efpeces de quinquina ; le blanc, le jaune 6c le rouge.
Les arbres du quinquina ne croilTc-nt qu’épars 5 c ii'olés entre
des arbres d’autres efpeces. Leur groffeur. L ecorccmcnt de
ces arbres les fait quelquefois périr. Maniéré d’enlever leur
écorce. Ibid. b. Préférence donnée aux écorces les plus fines.
L’iifage du quinquina étoit connu des Américains avanr qu’il
le fût des Elpagnols. L’efficacité de ce remede n’acquit quelque
célébrité qu’cn 1638 à l’occafion d’une fievre tierce opiniâtre
dont la vice reine du Pérou ne pouvoir guérir depuis
pluficurs mois. Ibid. 718. a. Hifioire de la maniéré dont
i'ufage de c e remede s’établit en Europe. Diverfes écorces
ciu’on a fouvenc mêlées en fraude avec celles du quinquina.
Précaution employée pour prévenir cette tromperie. Ibid. b.
Divers endroits difians de L o x a , où l’on a découvert des
arbres de quinquina. On a cru dans le Pérou qu’on fe fer-
voit de cette écorce en Europe pour les teintures. Différens
noms fous lefqueis elle a été connue. Autre arbre de
l'Amérique méridionale connu fous le nom de quina-quina.
Semences de cet arbre. Leur ufage. Celui de la gomme réfute
ou baume qu’on retire du même arbre. Réputation qu’a-
voic fon écorce confidérée comme fébrifuge , avant que l’arbre
de Loxa ou de quinquina fût connu. Origine du nom
de quinquina donné à ce dernier. Peu de cas qu’on fait d®
ce remede dans les lieux d’où on te tire. Ibid. 719. a. On
ne doit le regarder comme un antidote que dans les fievres
intermittentes. Vertu qu’on lui a reconnue contre la gangrene
5 c le fphaceJe. Ibid. b.
Quinquina, plante de quinquina repréfentée vol. V I des
planch. Régné vég éta l, planch. 102. Découverte de fes
propriétés médicinales. XI. 31 J. <2. Ufige que quelques m édecins
en font pour les fievres continues qui ont des redou-
hlemens tous les jours. V I . 729. i. Ses propriétés contre la
gangrene. VU . 472. a. VIII. n i . <2. Du quinquina que Quito
fournit à l’Efpagne. Suppl. IV. 562. a , b. Efpece de quinquina
nommé Cafcarille. II. 740. a , b. L’écorce du jeune frêne
fubllituée au quinquina. Suppl. III. 807. a, b.
Q U IN T , { Comm. d'Amériq.) droit que le roi d’Efpagne
retire fur Tor 6c l’argent d’Amérique, 6c fur route forte de
pierreries. Produit de ce droit tiré en cinquante années des
mines du Potofi. XIU. 719. b.
Q y m r ,{M a t. feodale) cinquième partie du prix de la
vente d’un fief. Droit de reqnint qu'on paie outre le quitic
dans certaines coutumes. XIII. 719. b.
Q U IN T A IN E , {Jurifpr.) jeu que quelques perfonnes
font obligées de fame pour le divertiffement du feigneur.
Origine du nom de quintaine. Ufages établis dans quelques
coutumes relativement à ce jeu. XIII. 720. a.
Q u in t a in e , (MurècA.) voyc^Fa q u in .
Q u in t a in e , {Blafon) meuble d’armoiric. Ancien exercice
militaire appelle de ce nom. Origine du mot quintaine.
Suppl. IV . 560. b.
Q u i n t a l , ( Polds) Ic quintal, quoique de cent liv re s ,
n’efi pas égal par-tout. X III. 720. a. Quintal des anciens grecs.
Quintal gérouin du Caire. Quintal du Levant. Qnintal-
Macho , terme ufité dans le commerce d’Amérique. Ibid. b.
Quintal, différence entre le quintal des métallurgiftes 6c
celui des effayeurs. XII. 860,.2, b. &c.
Q U IN T E , ( Jurifpr.) quinte Sefurabondante criée. Quinte
d’Angers. XIII. 720. b.
Q u in t e , {Mufq. ) fécondé des trois confonnances parfaites.
Fauffe quinte. Quinte fuperflue. Deux accords qui portent
le nom de quinte ; fa v o ir , celui de quinte 6c fix te, 6c
celui de quinte fuperflue. Il efi défendu en compoficion de
faire deux quintes juftes de fuite par mouvement fembla-
ble entre les mêmes parties. XIII. 721. a.
Q u in t e , {Mufiq.)\t% quintes cachées défendues quand
- ?
â\