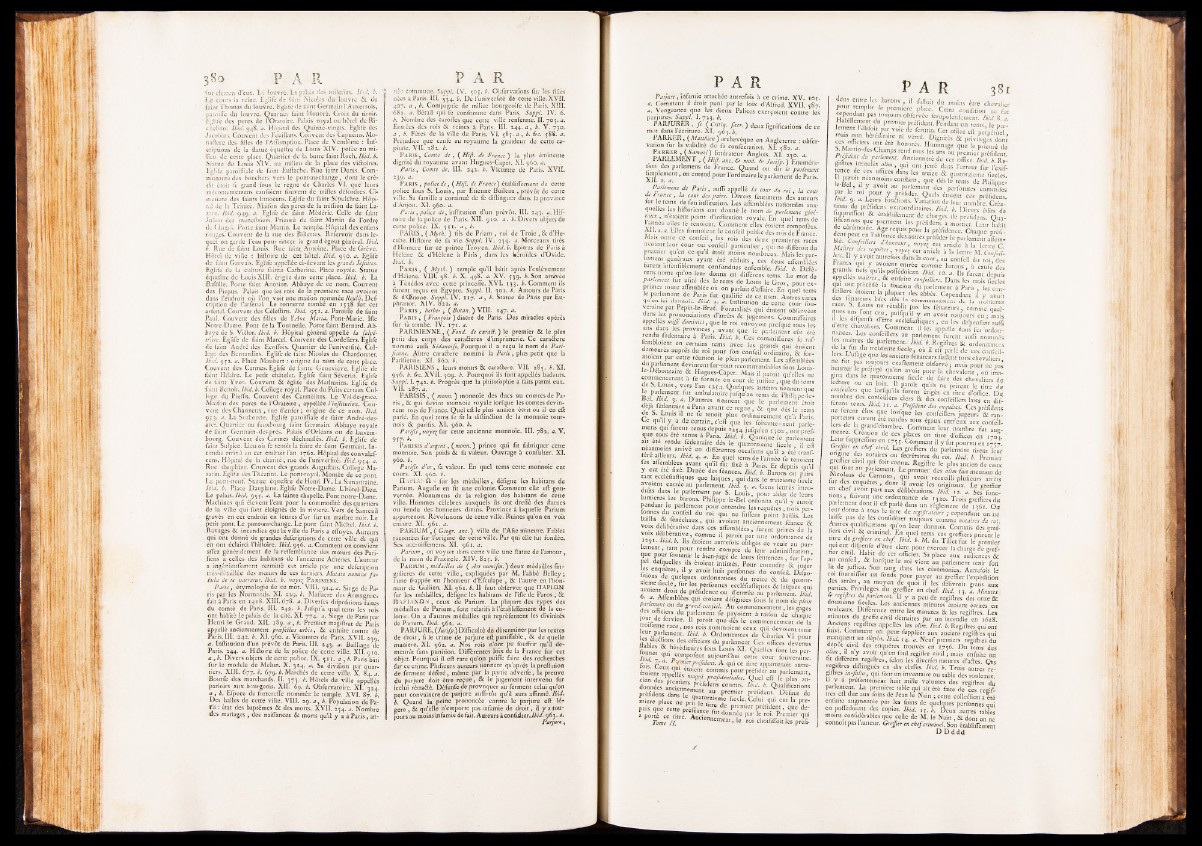
I l f t ;
i!r M.
i
3. So I V
ÙU chacim crc\is. 1 •; Univrc. Le priais tics tv-ilciles. 11:2. l\
Lo coi:;s la roiiic. L-llfc de 'aint Nicolas du louvre dc
i'.iint Tliomas dii louvre. Lglifc dc laint Germain I’An-Ktirois,
patoilTc du louvre. Quartier laint Honoré. Croi.\ du tiroir,
igln'e des pères de l’Oratuire. Palais royal ou hôtel dc Ri-
ei^clieii. UiJ. .1. Hôpital de> Quiuze-vingts. Eglife des
Jacobins. Couvent de.s l'cuillant. Couvciu des Capucnis. Mo-
nailcre des filic.s de [’.‘Mromption. Place de Vendôme : Iiil-
criptions dc la Ratuc cquellre de Louis X IV . poice au milieu
dc cette place. Quartier de la butte faim Roch./iii/. h.
^ratue de Loui,s X*IV. au milieu de la place des viéloircs.
L.s'lifé paroilli.de dc faim Luftadic. Rue faim DenR. Communauté
des bouchers vers le pont-au-diange, dont le crédit
croit fl grand fous le règne (le Cliarles VI. que leurs
inccontcinemeiis caufoient fouvent de trifles defordres. Cimetière
des faims Irmocens. Eglife du faim Siipulchre. Hôpi-
t.d (ie la Trinité. Maifon des peres de la niilîion de faine La-
7.n-e. Ib'ui. 949. a. Eglife de faint Métléric. Celle de faint
Julien (le; mencflt iers. Prieuré de faim Martin de l’ordrç
de Clugi-i. i’orte faim Martin. Le temple. Hôpital des enfans
r.Miges. Couvent de la rue des Billcttcs. Rélervoir dans lequel
on garde l'eau pour rincer le grand égout général. Ibid,
b. Rue de faim Louis. Rue faim. Antoine. Place de Grève.
Hôtel (le ville : hillolre de cet hôtel. Jbid. 9^0. j . Eglife
de faim Gervais. Eglife appellee ci-devant les gr,i;ids JéJ'uitcs.
Eglife de la culture f.iinte Catherine. Place royale. Statue
équellre dc Louis XIII. érigée dans cette place. Ibid. b. La
BafHlle. Porte faint Antoine. Abbaye de ce nom. Couvent
des Piepus. Palai.s que les rois de la premiere r.ace avoiem
dans l’emlroit où l’on voit une maifon nommée Dcf-
cription de rarfenal. Le tonnerre tombé en 1538 fur cet
arfenal. Couvent des Célellins. Ibid. 9 3 1. *î . Paroiffe de faim
Paul. Couvent des filles de \'Avc Maria. Pont-Marie, llle
Notre-Dame, Pont de la Tournelle. Porte faint Bernard. A b baye
dc S. Viélor. Ibid. b. Hôpital général appelle la falpé-
triae. Eglife (le faim Marcel. Couvent des Cordeliers. Eglife
de laint André des EcolTois. Quartier de l'imivetfité. C o llege
des Bernardins. Eglife de faim Nicolas du Chardonnet.
Ibid. 932. a. Place Maubert ; origine du nom de cette place.
Couvent des Carmes. Eglife de filme Geneviève. Eglife de
faim Hilaire. Le petit châtelet. Eglife faim Séverin. Eglife
dc f.iiiu Yve-. Couvent & eglife des Mathurins. Eglife de
film Benoît. Ibid. b. College royal. Place du Puits certain. Col-
l'.ge du Plellis. Couvent des Carmélites. Le Val-de-grace.
Maifon des peres de l’Oratoire , appellee l'inflitunon. Cou-
veiu des Chartreux , rue d’enfer ; origine de ce nom. Ibid.
933. J. La S(;rbonne. Eglife paroilîiale de faim André-des-
arcs. Quartier ou fau.xbuurg faim Germain. Abbaye royale
dc làint Germain-des-prés. Palais d'Orléans ou de Luxembourg.
Couvent dos Cannes déchauflés. Ibid, h. Eglife de
f.iiiit Siilpice. Lieu où fc tenoit la foire de faint Germain. Incendie
arrivé eu cet endroit l’an 1762. Hôrpiial des convalef-
cens. Hôpital de la charité, rue de runiverficé. ƒ/>/<ƒ. 934. a.
Rue dauphine. Couvent des grands Auguflins. College Ma-
aaiin. Eglife des Théatins. Le pont-royal. Montée de te pont.
Le pom-iieiif. Statue équellre de Henri IV . La S.i.mariraine.
Ibid, b. Place Dauphine. Eglife Notre-Dame. L’hôtel-Dieu.
Le p a l a i s . 933. a. La l^ainte chapelle. Pont notre-Dame.
Machines qui élèvent l’eau pour la commodité des quartiers
de la ville qui font éloignés de la riviere. Vers de Santeuil
gravés en cet endroit en lettres d’or fur un marbre noir. Le
petit pont. Le pom-au-change. Le pont faim Michel. Ibid. b.
Ravages & incendies que la ville de Paris a eiTuyés. Ameurs
qui ont donné de grandes defcripiions de cette ville & qui
en ont éclairci l’hiltoire. Ibid. 936. a. Comment on convient
afTcz généralement de la reiVemblance des moeurs des Pari-
ficns à celles des hafaitans de l’ancienne Athènes. L’auteur
a ingénieufemvm terminé cct article par une defeription
très-déiuillée des moeurs de ces derniers. Mutato nomim fa bula
de te narr.itur. Ibid. b. voye^ Pa RISIEN.S.
Paris, étymologie de ce mot. VIII. 914. rf. Siege de Paris
par les Normands. XI. 229. b. MalTacre des Armaenacr
fait à Paris en 1418. XIII. 678. Diveifes difpofiiions faites
du comté de Paris. III. 242. b. Jufqu’à quel tems les rois
ont habité le palais de la cité. XI. 774. a. Siege de Paris par
Henri le Grand. XII. 1S9. <i, b. Premier magiflrat de Paris
appelle anciennement pnzfeüus urbis, & enfuite comte de
Paris. III. 242, b. XL 960. 4. Vicomtes de Paris. XVII. 239.
a. Inftitution d’un prévôt de Paris. III. 243. a. Bailliage de
Paris. 244. a. HlRoire de la police de cette ville. XII. 910.
a , b. Divers objets de cette police. IX. 311. a , b. Paris bâti
fur le modèle dc Melun. X. 324. a. Sa divifion par quartiers.
XIII. 677. b. 679. b. Marchés dc cette ville. X.84, a.
Bourfe des marchands. IL 373. h. Hôtels de ville xf.appelles
parloirs aux bourgeois. X ll. 69. b. Obfervatoire. 324.
a y b. Efpece dc forterdTe nommée le temple. X VI. 87. b.
Des lialles dc cette ville. VIII. 29. a , b. Population de Pa-^
ris : état des baptêmes & des morts. XVII . 254, a. Nombre
des mariages , des nailTanccs & morts qu’il y a kP aris, anné:
cotitniunc. Suppl. IV. 503. ù. Obfervations fur les filies
liées à Paris. III. 334. b. Dc l’univerfité de cette v ille .X V I l.
407. a , h. Comp.ignic de milice botirgeoile de Paris. XIII.
681. a. Bétail qui fe confomme dans Paris. Suppl. IV . 6.
b. Nombre des carolfcs que cette ville renferme. II. 703. a.
Entrées dos rois reines à Paris. III. 244. a , b. 730.
a , b. Fêtes de la ville de Paris. VI. 383. a , b. &c. 38$. a.
Préjudice cpie caufe au royaume la grandeur de cette capitale.
11. 282. b.
Pa r i s , Comte de , {H iß . de Fr.-2nce) la plus éminente
dignité du royaume avant Hugucs-Caper. XL 960. a.
Paris, Comte de. 111. 24:. b. Vicomte de Paris. XVII.
259-
Parks , police de, {Hiß. de France') établilTemem de cette
police fous S. Louis, par Etienne Boileau , prévôt de cette
ville. Sa famille a continué de fe diflinguer clans la province
d’Anjou. XI. 960. a.
Paris, police infliliition d’un prévôt. III. 243. 4. Hif-
loire de la police de Paris. XII. 910. a. b. Divers objets de
cette police. IX. 31 1. a , b.
PARIS , ( Alyt/i. ) Ills de Priaiii , roi de Troie , Si d’He-
cube. Hifloire de lit v\c. Suppl. IV. 239. a. Morceaux tirés
crHoniti e fur ce prince Troyen. Ibid. b. Epitres de Paris à
Helone & d’Hclcne à Paris , dans k s kéroicles d’O vide.
IbtJ. b.
Pa r i s , ( Myth. ) temple qu’il bâtit âpres l’enlèvement
ci'Hélene. V llI . 98. b. X. 498. a. X V . 339. b. Son arrivée
à Ténédos avec cette princell'e. X V I . 133. b. Comment il»
furent reçus en Egypte. Suppl. II. 301. b. Amours de Paris
& d’OEiionc. Suppl. IV , 117. a , b. Statue de Paris par Eu-
phranor. X IV . 821. a.
Pa r i s , herbe-, ( ) VIII. 14 7.4 .
Pa r i s , ) diacre dc Paris. Des miracles opérés
fur fa tombe. IV . 17 1. 4.
P.VRISIENNE, {Fond, de carabl.) le premier & le plus
petit des corps des caraÛeres d’imprimerie. C e caraftere
nommé auffi Sédanoife. Pourquoi il a reçu le nom de Pari-
Jisnne. Autre caraélere nommé la Perle, plus petit que la
Parifienne. XI. 860. b.
PAR ISIENS, leurs moeurs & caraélcre. VII. 283. i .X I .
936. b. é-c. X V II . 309. b. Pourquoi ils font appelles bad.iuts.
Suppl. 1. 742. b. Progrès que la philofouhie a faits parmi eux.
VH. 287.4.
PARISIS , ( monn. ") raonnoie des ducs ou comtes de Pa*
ris , Sc qui (icviiu monnoie royale lorfque les comtes devinrent
rois (le France. Quel ell le plus ancien écrit où il en cft
parlé. En quel tems fc rit la diftinélion de la monnoie tournois
Sl pariris. XI. 960. b.
P.}rtßs,voye!(_(\is cette ancienne monnoie. III. 782. 4. V .
937. b.
Va k \s\s d'argent, {monn.') prince qui fit fabriquer cette
monnoie. Son poids & fa valeur. Ouvrage à conlulter. X L
960. b.
Parifts d'or, fa Valeur. En quel tems cette monnoie eut
cours. XL 960. h.
n m'L'«' Cl . fur les médailles, défigne les habitans de
Parium. Augiille en fit une colonie. Comment elle eft gouvernée.
Monumens de la religion des habitans de cette
ville. Hommes célébrés auxquels ils ont dreiTé des Hatties
ou rendu des honneurs divins. Province à laquelle Parium
appartenoit. Révolutions de cette ville. Ruines qu’on en voit
encore. XI. 961. a.
PARIUM , ( Géogr. anc.^ ville de l’Afie mineure. Fables
racontées fur l’origine de cette v ille. Par qui elle fut fondée.
Ses accroiffemens. XI. 961. 4.
Parium , on voyoit dans cette ville une fiatue de l’amour,
de la main dc Praxitèle. XIV. 823. b.
Par ium , médailles de ( A n numifm.') deux médailles fin-
gtilicrcs de cette v ille , expliquées par M. l’abbé B c lle y ;
l’une frappée en l’honneur d’Efculape , & l’autre en l’Iion-
neur de Gallien. XI. 961. b. Il faut obl'erver que ITAPIJIN
fur les médailles, défigne les habitans de l’iHe de Paros, &
n ’(PIANfi s ', ceux de Parium. La plupart des types des
médailles de Parium, font relatifs à rétabliflement de la colonie.
Ün a d’autres médailles qui repréfentent les divinités
de P.iriuin. Ibid. 962. a.
PARJURE,(/4ri/p.)Difficulcé de déterminer par les textes
de droit, fi le crime de parjure eft puniflable, & de quelle
maniéré. XI. 962. a. Nos rois n’ont pu fouffrir qu’il demeurât
fans punition. Différentes loix de la France fur cet
objet. Pourquoi il eff rare qu’on puiffe faire des recherches
fur ce crime. Phifieurs auteurs tiennent qu’après la preft.uion
de ferment déféré, même par la partie adverfe, la preuve
du parjure doit être reçue, & le jugement intervenu fur
icelui rétraélé. Défenfede provoquer au ferment celui qu’on
peut convaincre de parjure auflî-tôt qu’il aura affirmé. Ibid,
b. Quand la peine prononcée contre le parjure eft lé*
gere , Sc qu’elle n’emporte pas infamie de dro it, il y a toujours
au moins infamie défait. Auteurs kconfuiter./l>/J. 963. a.
Parjure ,
P A
Parjure, làl.vYixe attachée autrefois à ce crime. X V , lOi.
4. Comment il étoit puni par le loix d’Alfred. X V II . 5S7.
4. Vengeance que les dieux Paliccs exercoiciu contre les
parjures. Suppl. I. 723. b.
P.ARJURER, fe { Crnttj. fter. ) deux figiiifications d c c e
mot clans l écriture. XI. 963. é.
P A R K E R , {Matthieu ) arclievéque en Angleterre : obfcr-
V.ation fur la validité dc fa confccration. Xl. cSa. a.
Pa r k e r , {Samuel) littérateur Anglois. XI 220 4
PAR LEMENT . ( ™
tion des parlemens de France. Quand on dit le vademem
X lT I t’ntend pour l’ordinaire le parlement de Paris.
Parlemens de Paris, auffi appelle h cour du roi, la cour
rfc /-rance , la cour des pairs. Divers fentimeils des auteurs
lui etems (lefoninftitmion. Les affcrnhlées nationales auxquelles
les hiftonens ont donné le nom de parlemens eéné-
n’étoicnc point d’inftitution royale. lùi quel lenis de
lannee ehes ie tcnolent. Commenr elles étoient compofccs,
XJl. I.,;. Elles formoient IcConfeil public des rois de Fiance
A].us outre ce confcil , les rois des deux premieres races
avoicnt km- cour ou ccinfeil particulier , qui ne différoit du
J'rcmicr qu en ce qu'il étoit moins nombreux Mais les irtr
emen-s généraux ayant été réduits , ces deux affcmblks
luicnt ijilenfiblenient confondues enfcmble. Ibid. b. Diffé-
rens nnms qu’on leur tlonnn en dillércns tems. Le mot de
parltm.nt tut ufiie dés le tems de Louis le Gros, poure.x-
pruner toute a^mb lée oi, ou parloir d’affuiro. En qitel tems
le par emettt de Parts f.tt qualifié de ce „ou,. A,.très titres
quonlitt donnoit. i , u. Inditution de cette cour Ibii-
Y .a n iep a r Pepin-lc.Bref. Pormalités qui croient obfervées
auml “ P ™ “ " ' " " “ “ <''” ‘■ "5 & jugentens. Commiffaires
appel és mtp du,runta, que le roi envoyoit prefque tous les
ans dans les provinces , avant que le padement eût été
rendu fedentaire .à Paris. lb,d. t. Ces coniniilfaircs fc raf-
eutblo.eut eu certains tems avec les grandi qui étoient
demeures auprès du rot pour ion confeil ordinaire. & for-
motent par cette réuniott le plein parlement. Les affemblées
du parlement devnireM fiir^o.it recommandables fous Louis-
le-Debon„aire & Hugues-Capet. Mais il parott qu’elles ne
COTmienccront a fe tormer en cour de juliiee , q L dit tems
de S. Lou is , vêts 1 an t a ;,,. Quelques auteurs tiennent que
je p,iilement tut ambulatoire jufqu’aii tems de Philippc.le-
, 1 « fid ■ k “ “ " ’“ ‘ "■ '"'d't que le parlement étoit
d q a fedentatro a Pans avant ce régné , & que dés le tems
d^c S. Lotus il ne fe tcnoit plus ordinairement qu’i Paris
Ge qittl y a de certain, c’eft que les foîxante-,rà,f pade-
niens qm fiiratt tenus depuis ia ;4 jufqu’eu i-.oa , ont pref-
que tous été tenus à Pans. Itid. t. Quoique le patlemem
au etc rendu fedentaire dès le quatorzième ileele il cil
Iléanmoms a rm e en différentes occaCons qu'il a été rranf.
Gré adleius. Iktd. 4. u. En quel tems de l'aimée fe tenoiont
V eu ét" fi'r“ y eut ^ (ç fixe. Dn u’"r“e' e ’ dï e s feances. Ibid. b. Baro■n‘ >s =oPu'* n'iu"ir'sl
tant ecclefiaftiques que laïques, qui dans le treizième fLcle
avoient entree au parlement. I b i l 3. 4. Gens lettrés introduits
clans le parlement par S. Louis, pour aider de 'eurs
lumières les Kirons. Philippe-le-Bcl ordonna qu'il y auroit
pendant le parlement pour entendre lesreciuèces trois ner-
lonnes du confeil du roi qui ne fnffent Joint baillis. Les
^ 9“ * avoient anciennement féaiice &
voix deliberative dans ces affemblées , riireut privés de la
VOIX deliberative, comme il paroit par une ordonnance de
i z ÿ i . Ibid.b. Us etoietit .sutretois obliges de venir nu par-
n ü r n l ’ ' “. " ‘ P“ " ’ ,■ ■ “ * = . “ "'Plt: de leur ndminidration ,
oël d f ‘ S '" “ ,“' ! ' de leurs fcntenccs , fur l’apdefquelles
ils etoient intimés. Pour entendre & juger
fnions’ d ' “ ’ ’ 1' ^ “ ' ' ° a P " '» " " “ du confcil. Difpo-
mmns de qudques ordonnances du treize & du qitator-
lemcfieclo , f^ les perfonites ecclefiaftiques ik laïques qui
avoierii droit Y preftdence ou d’emrée au parlement. Ibid.
• 4. Aüenib ees qui croient dclignées fous le nom dc plein
par ou de grand-cotijeil. Au commencement les gages
d c 'Y ficters du patletueiti fc payoient à ra.fou de chaque
jour de fervice. Il paroit que dés le commencement <\t la
oiiiemc; race, nos rois nommoient ceux qui dévoient tenir
l ê r é K o . ’’ ' ' ; ; Otdomtances de Lltarles v i po:,;
fiables S f 'Ô du parlement C.es offices devenns
fonnls (»“ S. Uiitis XI. Quelles ft>„, les per-
Ibid l y “ '"poleut aiqourd’htii cette cour fouveraine.
fois' Ccu'x [‘y " ^ q>" « titre appartenoit autre-
éro;fnv n commis pour préfuler au parlemcrt
d e T d e sT r c “ '" fÿP™ /d™ -t .t/ r t. Qttel cil il: l,,:
données In d em r fttfidens connus. Ibid. b. Qualitications
préfidens dans l e ' " " " ' Pt>-’" ' ‘>--r préffdent. Défaut dc
L c r e pLce „ V ; r i T r S T P " '
puis que cette préféanco ï P ' '''•
a porté ce titre Pfcmier qm
Tome II. ' nement, le roi choififfoii les préfi-
P A R 381
Jdlls entre les harotis , il falloi, ,l„ moins être chevalier
pour remplir la prcimcro place. Cette condition ne fut
Ï S l 'Ô'” ' P"' ''>"l»''tsol>fo'vée fcnipuleufcncnt. dbid.i „
HabilluY-nt du li'Cimcr préhdcm. Pendant un tems lo p n -
lement I chfot, par voie de fcrtttin. Cet office eft ,ô pé, Ô
niais m.n hercd.tnre ni vénal. Dignités & privi eg s dont’
? m Î a T 'ô Ch' “ “ '"""■ ê" 1 “ fo P tt t tt 'téT
PrW : r " f ' ° ' “ pteitder préfident.
d t t “ Ancienneté de cet office. Ibid. b. Rcy
t e , „tunics efon. qu, je „ é dans l’erreur fur l’exif-
cnce de ces offices dans les treize & qu.atorzieme ffecles.
l'è P rottftant, que dès Je tems dc Pbilippem’
. y '‘ ' ' ° ' ' P'Iotncni des pcrfontles comnii'fes
pm le rot pour y prehder. Quels ét'oien, ces préfidens.
tinni d’ Ô p y fonsftions Variation de leur nombre. C r é a tions
de preMcils extraordinaires. Ibid. h. Divers édits do
ftq.preir,o„ 6c établiffeiitcnt dc charges de prefidenl Oua
hffcauonsqne ,u-enne„. les préfident à moi'tier. Leur U S t
< 0 ceremonie Age requis pour la préfidcnce. Cliaqiio preffJb5iiéc.
_ SLotr-.Jfat lLler ;s 4d 7ho' 'n' neur, rayerP '“cct‘' ".• m'=ic lpea ràl emla enLt- ra-rfefe mC -
Maures des requêtes ,_voyci Cct article à la lettre M. ConfeÜ-
Francs qu y avotent entrée comme barons, à cauf- d-s
appelles n ,„n r „ . & enfintc anjtilU,,. Dans les trois ffecles
qui ont precede la fixation du parlement à Paris , les con-
foillers cto,cm la plupart des abbés. Cependa.n il y avoF
t e (cmiteurs laies de ' le commencemeni dc la iimificme
race, 6. Louis no rétablit pas les fénateurs, comme ouel-
que; liiis lo in cru, [nufqu’il y en avoir toujours eu ; mais
d'etre d f r 'r " ' " r clifpciifamt auffi
il 1« appelle dans Tes ordon-
...ccs, iccs conlei lets ait parlement furent atillï nommés
i; i t ’ f i r ’; " P»'-''"’ ' " ' - / « i.Rcgtllres & ordonnances
de l.a fin du treizième ficelé, où il eft parlé dc ces confcil.
le r s Y iftage que les anciens fénateurs fidfcnt tous chevaliers
no .ut pas toujours exaftement obfervé j mais pour ne pas
heurter le préjugé qtt’on avoir pour la chcvaler.e , on iÔÔ
k â t i r T ô , 'l “ " “ '" ';" - - fi» Paire des cheval,ers de
k d u re ou en ioix. I! paron qu’ils ne prirent le titre de
ccnfeillers que loriqii ils furent érigés en titre d’office. Du
f W ! clers & des confeillcrs laïcs en dif-
- tems Ibtd. 1 1 4 . Préfidens des enquêtes. Ccs préfidens
m'.'.nT '-''’ “ “ 'f ’ “ ' “ "foiltes jugeiirs^&rappo
temrs curent ete rendus tous égaux omr’e'tix- aux confeil-
m. eenntteï. C(..rréc ati'oinn ce ccs places en titre d'offices enf“ ' t a- uog, I
T il y f o ' poufvu en ,75 7:
o r l/ l ■ I ' du parlement tirent leur
° " foarétaires du roi. Ibid. b. Premier
mil font'm, ‘‘ ‘"l P'uaanc.en de ceux
N iola, s P ^ ''" '" " " '- ^ Paumier des dm Éti, mention de
« cte tis de Carnom, qm avoir recueilli pluCcor, arrêts
y de.s enquetes , dont il avoir les originaux. Le greffier
en d .e f avoir part aux délibérations. Ibhl. ta. a Ses fo n d
ttoiis, fiiivimt une ordonnance tic ,310. Trois greffiers du
parlement dont d eft parlé dans un r é k in c n , de , , 6 , Ou
hiffe n i s k T " '% ' r ' ™Ç'A-U«rr ; cependant on ne
laiHe pas (^v. les confiderer toujours comme notaires du roi
Autres qualifications qu’on leur donnoic. Commis des s r d
fiers civil & -n n .n e l . En quel tems ces greffiers p n r cL le
tni e dc greffters en chef Ibid. b. M. du T llk t fut le premier
qui eut aifpenfe d etre clerc pour e.xercer h charge de greG
hcr civil Flabit de cct officier. Sa place aux audiences &
nu çonlcil , Ôc lorïque le roi vient au parlement tenir fon
ht de juftice. Son mng dans les cérémonies. Autrefois le
roi foin-mffüit iin fonds jwnr payer au greffier l’expédition
des arrets , au moyen de quoi il les délivroit gratis aux
parties^ Privileges du greffier en chef. Ibid. 13. 1 Minutes
J- regr/hes du parlement. 11 y a peu de regiftres des onze &
douzième fiedes. Les anciennes minutes étoient écrites en
rouleaux. Dilîerence entre les minutes & les regiftres. Les
minutes du greffe cm l détruites par un incendie en 1618
Anciens regiftres appelles les olim. Ibid. b. Regiftres qui ont
luivi. Comment on peut fuppléer aux anciens regiftres qui
manquent au dépôt. Ibid. 14. 4. Neuf premiers regiftres du
depot civil des enquêtes trouvés en 1736. Du tems des
“ Y regiilre civil ; mais enfuite on
ht differens regiftres, felon le.s diverfes natures d’aftes Cfes
regiftres diftingués en dix daffes. Ibid. b. Trois autres re-
gi/tres m-folio, qui font un inventaire on table des rouleaux
H y a prefentemeHt huit mille volumes des reoifires du
parlenicin, La premiere table qui ait été faite de ces regif-
très cil duc aux foms de Jean le Nain j cette colleftion a été
enltttte augmentée pm les foins de qnelmtes perfonnes q„i
en poffedotett, des coptes. Ib,d. b. d eu x outres tables
morns conbYrablcs que celle dc M. le Nain , & dont on ne
connoitpas 1 lutteur. Grejjierenchefcriminel. Son établiffenTeirt
D D d dd
t .