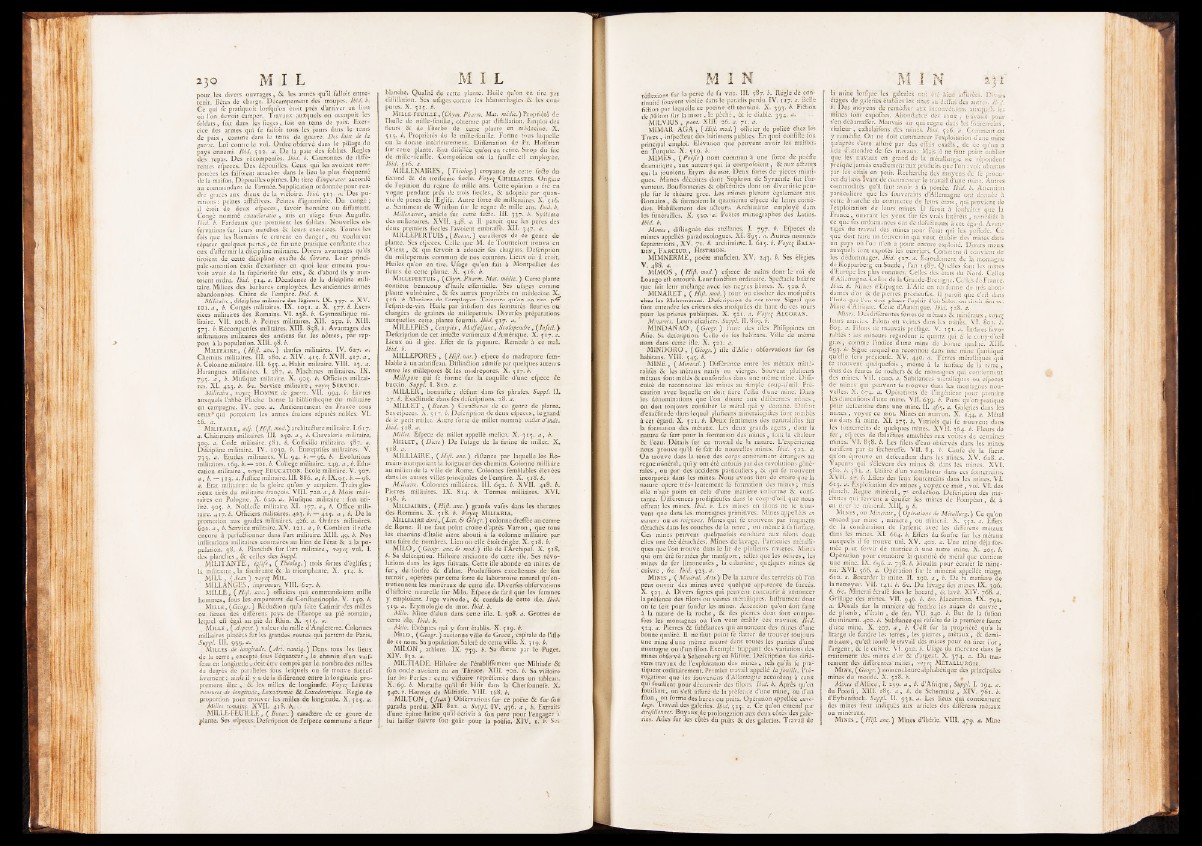
, , ; i ä
.i III
i'i i f
M I L
Nl ' , ]'
!, tf!l ii''lH ilj >
230
pour les divers ouvrages , & les armes qu'il t'alloit entretenir.
Bêtes de charge. Dêcampcment des croupes. IbiJ. b.
C e qui he pratiquoic lorfiqu’oii éu>it près d’arriver au lieu
oil l'on dévoie camper. Travau.x auxquels on occupoit les
loldais, foit dans les ficgc», l'oie en tenus de p.tix. Exercice
des armes qui Ce faifoic tous les jours dans le teins
de paix , comme dans le tems de guerre. Des Dix tie /.i
lierre. Loi contre le vol. Ordre oblervê dans le pillage du
pays ennemi. Jbi,I. ^12. a. Do l.i paie des loUlats. Regies
des repas. Des rccompenfes. Ibiii b. Couronnes de did'e-
lentes el'peccs. Des dépouilles. Ceux qui les avoient remportées
les faifoient attaclier dans le lieu le plus frequente
de la maifon. Dépouilles opimes. Du titre (.\'inipcr.:!or accordé
au commandant de raruiêc. Supplication ordonnée pour rendre
graces aux dieux de la viêhoire. Ibid. 513. e. Des punitions
; peines alHiélives. Peines d’ignominie. Du congé ;
il étoic de deux efpeccs, ù v o ir honnête ou diftamunc.
Congé nommé ix.!!iù!or.itio , mis en uliige fous Augure.
Ibi.I. b. Fardeaux que porcoient les foldats. Nouvelles ob-
fervations fur leurs marches & leurs exercices. Toutes les
fois que les Romains fe crurent eu danger , ou voulurent
réparer quelques pertes, ce fut une pratique conrtante chez
eux d'aftermir la difciplinc miliuùre. Divers avantages qu’ils
tiroieiu de cette dlfcipltne exaéle & févere. Leur principale
attention ètolt d’examiner en quoi leur ennemi pouvoir
avoir de la fupériorité fur eu x , & d’abord ils y met-
toient ordre. JbU. 514. j . Décadence de la difciplinc militaire.
Milices des barbares employées. Les anciennes armes
abandonnées. Chute de l’empire. Ibid. b.
AliUiaire , difeipline militaire des légions. IX. 3 57. a. X V.
l o i . J , b. Congés militaires. IX. 1031. a .X . 577. b. Exercices
militaires des Romains. V I . 238. b. Gymnadique militaire.
VU . io î8 . b. Peines militaires. XII. 230. b. XUI.
573. b. Rccompenfes militaires. XIII. 838. b. Avantages des
inftituiions militaires des anciens fur les nôtres, par rapport
à la population. XIII. 98.
M il it a ir e , {fJi/}. anc.) danfes militaires. IV . 627. a.
Chemins militaires. III. 280. X IV . 413. i . X VII . 4 1 7 . - i,
é. Colonne militaire. III. 6 3 5 .-i. Habit militaire. VIII. 13. j .
Harangues militaires. I. 287. a. Madvnes militaires. IX.
793. J , b. Mufiquc militaire. X. 903. b. Ofticicrs militaires.
X L 423. b. 6'c. Service m'ditaire , voye^ S er vice.
Miiitiiire y voyc:^ HOMME de Guerre. V i l . 994. b. Livres
auxquels l’abbé Pluche borne la bibliotlteque (lu militaire
en campagne. IV. 200. j . Anciennement en France tons
ceux* qui portoienc les armes étoiem réputés nobles. VI.
26. a.
M il it a ir e , aJj. (///y?./not/.) architedure militaire. 1.617.
J. Cliâtimens militaires. III. 230. ‘Z > />. Chevalerie militaire.
309. a. Code miliuiire. 381. b. Codicille militaire. 387. a.
Difeipline militaire. IV . 1030. b. Entreprifes militaires. V.
733. rf. Etudes militaires. V I. 94. b .— 96. b. Evolutions
militaires. 169. b.— 201. b. College militaire. 249. .-z, b. Education
militaire , voye^ EDUCATION. Ecole militaire. V. 307.
a , b. — 313. <z. Juilice militaire. III. 886. a, b. IX. 93. b.— 96.
a. Etat milit.a:re: de la gloire qu’on y acquiert. Traits glorieux
tirés du militaire irançois. VIII. 720 .0 , b. Mois militaires
en Pologne. X. 620. a. Muilque militaire : fon uti-
iiré. 903. b. NoLlcll’e militaire. XI. 1 -7 . u , h. Office militaire.
417. b. Officiers militaires. 423. b. — 423. a , b. De la
promotion aux grades militaires. 426. a. Ordres militaires.
602. a , b. Service militaire. X V. 121. t i , b. Combien il rede
encore à ptrfeélionner dans l’art militaire. XIII. 49. b. Nos
inditntions militaires comraircs au bien de l’état & à la population.
98. b. Plancluîs fur l’an militaire, roy«^; vol. 1.
des planches , 5c celles des Suppl.
M IL IT A N T E , {Thiolog.') trois fortes d’églifesj
la militante , la foulFrante & la triomphante. X. 314. b,
MILL , ( .han ) veye^ M il .
MIL LANG ES, imprimeur. VIII. 627. b.
M IL LE , a/ie.) officiers qui commandoient mille
hommes, fous les empereurs de Condantinople. V . 130. b.
M ille , ) Réduflion qu’a faite Cafimir des milles
ou lieues des ditTérens' pays de l’Europe au pié romain ,
lequel ed égal au pié du Rhin. X. 313. a.
Mille , ( Arpent.) valeur du mille d’Angleterre. Colonnes
milliaires placées fur les grandes routes qui parient de Paris.
Suppl. III. 939 --ZM
illes de longitude. {Art. naïuiq.) Dans tous les lieux
de la terre , excepté fous l’équateur , le chemin d’un vaif-
feaii en longitude , doit être compté par le nombre des milles
de degrés de parallèles fous lel'quels on fc trouve fuccef-
fivenienr : ainfi il y a de la différence entre la longitude proprement
dite , iSc les milles de longitude. A^oye^; L ieues
mineures de longitude, Loxodromie & Loxodromiqtie. Regie de
proportion pour trouver les milles de longitude. X. 313. a.
Alillcs romains. X V II . 418. b.
MILLE-FEUILLE, ( Boian. ) caraéiere de ce genre de
plante. Ses efpeccs. Deftripcion de l’efpece commune à fleur
M î L
blanche. Qualité de cctco plante. Huile qu’on en tire par
diilillaiion. Ses ufages conne les hémorrhagies Ôe les cou-
putes. X. Î1 5 . b.
M ille-feuille , (C'/iyz/j. Pharm. AUt. //j6/fc.) Propriété de
rimi’e de mille-feuille, obtenue par diflillation. Emploi dos
fleurs ik de l'herbe de cette plante en médecine. X.
313. h. Propriétés de la miUe-fcuiile. Forme fous laquelle
üii la donne intérieurement. Differtation de Fr, Holfmaii
lur cotte plante. Eau diflilloc qu’on eu retire. S!ro[) du fuc
de mille-feuille. Compofition ou la feiiille ell employée.
Ibid. 316. a.
MILLEN.^IRES, { Théolog.) croyance de cctie feéle du
fécond ik. du iroificmc fiecle. Voyc:^ C h il ia ste s . Origl.nc
do l'opinion du regne de mille ans. Cette opinion a été en
vogue pendant prés de trois liecles, & adoptée par quantité
de pores de l'Eglife. Autre forte de millénaires. X. 316.
J- Semiment de "Wliiflon fur le regne de mille ans. Ibid. b.
Millénaires, article fur cette feéto. III. 537. b. Syllome
des millénaires. XVII . 34S. a. Il paroic que les peres des
doux premiers hecles l'avoient embinlfé. XJI. 347. a.
MILLEPERTUIS , (éfo/.j/;.) caraélores de ce genre de
plante. Ses clj/eces. C,;lle que M. de Tournefort trouva eit
O rien t, ik qui fervoit à adoucir fes chagrins. Defeription
du millepemiis commun de nos contrées. Lieux où il croit.
Huiles qu’on en tire. Ufage qu’un fait à Montpellier des
fleurs de cotte plante. X. 316. b.
M illepertuis , {Chym. Pharm. Mat. médic. ) Cette planre
contient beaucoup d’huile elfeiiiielle. Ses ufages comme
plante vulnéraire , & fes autres propriétés en médecine. X.
316. b. Maniéré de l'employer. Teinture qifon en tire p.fT
refprit-de-vin, Huile par inùifion des fommités fleuries ou
chargées de graines de millepertuis. Diverfes préparations
auxquelles cette, plante fournit. îbid, 317. a,
MILLEPIÉS , Centpiès y ALilf.tifant, Scolopendre, {InfeLi.y
Defeription de cet inl'eéle venimeux d’Amérique. X. 317. a.
Lieux où il gîte. Effet de fa piquure. Reiucdc à ce mal.
Ibtd. h.
MILLEPORES , {Hiß-nat.) efjzece de madrepore fetU’
blable .à un arbrifl'eaii. Diflinélion admife par quelques auteius
entre les millepores & les madrepores. X. 317. b.
AUllcpore qui fe forme fur la coquille d’une efpece de
buccin. Suppl. I. 810. a.
M IL L E R , bocanifle ; défaut dans fes phrafes. Suppl. II.
27. b. Exaélitude dans fes deferiptions. 28. a.
M IL L E T , {B o u n .) Caiaélercs de ce genre de plante.
Ses efpeces. X. 3:7, b. Defeription de deux el'peccs, le grand
& ie petit miilct. Autre forte de millet nommé ntilui d'ïndc.
Ibid. 318. a.
Millet. Efpcce de millet appelle mclica. X. 313. a , b.
Mil le t , {D ie te) D e Pulége de la farine de millet. X.
î i S . J.
M IL LIA ÏRE, {H iß .a n c .) diflancc par laquelle les Romains
marquoient la longueur des chemins. Colonne milliaire
au milieu de la ville de llome . Colonnes femblubles élevées
dans les autres villes principales de l'empire. X. 318. b.
AliUiaire. Colonnes milliaires. III. 632. b. XV II . 418. b.
Pierres milliaires. IX. 814. b. Termes milliaires. X V I .
138. b.
M il l ia ir e s , {Hiß. anc.) grands vafes dans les ihcraics
des Romains. X. 318. b. Voyei(_ MiLiARlA.
M illi.\ire doré, {Litt. & Geogr.) colonne dreffiée au centre
de Rome. Il ne faut point croire d’après Varron , que tous
les chemins d'Italie aient abouti à la colonne milliaire par
une fuite de nombres. Lieu où elle étoit érigée. X. 318. b.
M IL O , {Géogr. ,inc.& mod.) ifle de l’Archipel. X. 318.
b. Sa defeription. Hifloire ancienne de cette ifle. Ses révolutions
dans les âges fuivans. Cette ifle abonde en mines de
f e r , de loufre & d’alun. Produéüons excellentes de fou
terroir, opérées par cette forte de laboratoire naturel qu’entretiennent
les minéraux de cette ifle. Diverfes obfervations
d’hilloire naturelle l'ur Milo. Efpcce de fard que les femmes
y emploient. Juge v aivode, 8c confuls de cette ifle. Ibid.
319. a. Etymologie du mot. Ibid. b.
AUlo. Mine d’alun dans cette ifle. I. 308. a. Grottes de
cette ifle. Ibid. h.
Milo. Evêques qui y font établis. X. 319. b.
Milo , ( Géogr. ) aiicionne ville de G r c c e , capitale de l’ifla
de ce nom. Sa population, Saleté de cette ville. X. 319. b.
MILON , acblere. IX. 7<o. b. Sa flatue par le Pucet.
XIV. 832.
MILTIA.d e . Hifloire de l’établiflement que Miltiade 8c
fon onde avoient eu en Thrace. XIII. 700. b. Sa viâo ire
fur les Perfes : cctic viftoire repréfentée dans un tableau.
X. 69. b. Muraille qu’il fit bâtir dans la Cheifonnefe. X.
340. h. Flermès de Miltiade. VIII. 168. b.
M IL TO N , {Jeun) Obfervations fur ce poète 8c fur fora
paradis perdu. XII. 822, a. Suppl. IV. 436. a , b. Extraits
d’une épître latine qu’il écrivit à fon pere pour l’engager à
lui laifTer fuivre fon goût pour la pocfie. X IV . i . b. Ses
M I N
rétl''xions fur la perte de f.i vue. III. 387. b. Regle de continuité
fouvent violée dans le paradis perdu. IV. 117. a. Belle
fidion par laquelle ce poème elf terminé. X. 393. b. Fiéhou
de Milton fur la mort , le péché, 8c ie diable. 394. u.
M iL V IU S , pont. X î l l . 26, a. 71. iz.
MIM All A G A , {Hiß. mod.) officier de police chez les
Turcs , infpeileur des bàtimeiis publics. En quoi confifle fou
principal emploi. Elévation que peuvent avoir les maifons
en Turquie. X. 319. b.
MIMES, {P o eße) nom commun à une forte de poéfie
dr.unatique , aux auteurs qifi la compofotenr, 8c aux ailcurs
qui la jouoient. Etym. du xnot. Deux fortes de pieces mimiques.
Mimes déceiites dont Sophron de Syraeufe fuc l'iu-
venteiir. Bouflbnnerles 8c obfcénités dont on divertie le peuple
fur le théâtre grec. Les mimes plurent également aux
•Romains , 8c formolent la qiutriema efpcce de leurs comédies.
Habillement des aéleurs. Archimime employé dans
les funérailles. X. 320.'d. Poètes inimographcs des Latins.
Ibid. h.
Alimes , diflingués des atcllancs. I. 797. b. Efpeccs de
mimes appelles paradoxologues. XL 893. a. Autres nommés
feptentrions, X V . 71. b. archimime. L 613. b. Voyc:^ Ba l a d
in , F a r c e u r , H is tr io n .
MIMNERME, poète muficien. X V . 243. b. Ses élégies.
V . 488. d,
MIMOS , {H iß . mod.) cfpece de nains dont la roi de
Loango eft entouré. Leur foiiélion ordinaire. SpcRacle bifarre
que fait leur mélange avec les nagres blancs. X. 320. b.
M IN AR E T , ( Hiß. mod. ) tour ou clocher des mofquéas
chez les Mahometans. Defeription de ces tours. Signal que
font entendre les crieurs des mofquées du haut de ces tours
pour les prières publiques. X. 321. f'uycç A l cü r a n .
Minarets. Leurs efeahers. Suppl. IL 809. b.
M IN D A N A O , (Géogr.) l'una des illcs Philippines en
Afic. Sa defeription. Celle de fes habitans. Ville de même
nom dans cette ifle. X. 321. a.
M IN D ORÜ , {Géogr.) ùle d’Afie : obfervations fur fes
habitans. VIII. 343-. b.
MINE , {Minéral.) Différence entre les meunux niiiil-
ralilés 8c les métaux natifs ou vierges. Souvent plalieurs
métaux font mêlés 8c confondus dans une même mine. Difficulté
de rcconnoiue les mines au fimple coup-cl'ceil. Précaution
avec laquelle on don faire l’cflai d’une mine. Dans
les déhominniions que l’on donne r.ux diùérentcs mines ,
on doit toujours confulter le métal qui y domine. Def.tit
d’exaftitude dans lequel plufieurs mineraiogifles font tombés
à cet égard. X. 321. b. Deux fentimens des nacuraliftes lur
la formation des métaux. Les deux grands agens , dont la
nature fe fert pour la formation des mines, lout la cli.ileur
8c l’eau. Détails fur ce travail de la nature. L’expérience
nous prouve qu'il fe fait de nouvelles mines. Ibid. 322. a.
On trouve dan-, la terre des corps entièrement étrangers au
regne minéral, qui y ont été enfouis par des revolutioui générales
, ou par (les accidens particuliers, 8c qui le trouvent
incorporés dans les mines. Nous avons Heu de croire qticla
nature opere très-lentement la formation des mines 3 mais
elle n’agit point en cela d’une maniéré unifonne 8c conf-
tante. Differences prodigieufes dans le coup-d’ccil que nous
offrent les mines. Ibid. b. Les mines en liions ne le trouvent
que dans les montagnes primitives. Mines appellees en
murons ou en roignons. Mines qui fe troiivciu par tragmens
détachés dans les couches de la terre , ou même ii la furface.
Ces mines peuvent quelquelbis conduire aux filons cioiu
elles ont été détachées. Mines de lavage. Particules métalliques
que l’on trouve dans le lit de phifieurs riv.eres. Mines
qui ont été formées [Far tranlporc, telles que les oci u c s , les
mines de fer liinoneufes , la calamine, quelques mines de
cuivre , &c. Ibid. 323. .z.
M ines , ( Aünèral. Arts ) De b nature des terreins où l’on
peut ouvrir des mines avec quelque apparence de fucccs.
X. 323, b. Divers Agnes qui peuveiu concourir à annoncer
lapréfence des filons ou veines mécalliqtics. lullrument dont
on fe fert pour fonder les mines. Aicciuion qu’on doit faire
à la nature de la roche, 8c des pierres donc font compo-
fées les montagnes où l'on veut établir ces travaux. Ibid.
324. a. Pierres 8c fubflances qui annonrent des mines d’une
bonne qualité. Il ne faut point le flatter de trouver toujours
une mine d'une même nauire d.ms toutes les parties d’une
montagne ou d’un filon. Exemple frappant dc> variations des
mines obfervè à Schenebergcn Mifnie. Del'cription des diffé-
rens travaux de l’exploitation dos mines , tels qu’ils fe pratiquent
ordinairement. Premier travail appelle la fouille. Pié-
rogatives que les fouvcraliis d’xAllemagne accordent â ceux
Sui fouillent pour découvrir des filons. Ibid. b. Après qu’en
ouill.mt, on s’eft affiiré de la prefence d’une mine, ou d'un
filon, on forme des bures ou puits. Opération appellee ciice-
lage. Travail des galeries. Ibtd. 323, a. Ce qu’on entend p.ar
étréfillonncr. Boyuux.de prolongation atix deux côtés des galeries.
Ailes fur les côtés du puits 8c des galeries. Travail de
M î i ' i
b mine lonqne les galeries ont été bien affinée-;. D ù.-jh
étages de galeries établies les unes au deffus des autr.-. U .!.
é. Des moyens de remédier aux inconvémens aiixqu-h. ior
mines Ion: expofées. Abondance dos eaux , travaux pour
s’en dcbarralTcr. Mauvais air qui régné dans les fouicrrcins,
chaleur, cxhalaifons des mines. îbid. 326. a. Comment on
y remédie. On ne doit commencer rcxploitailoii d'une mine
qu après s’etre alluré par des effais exaéls , de ce qu’on a
lieu J .utemire cie fes travaux. Mais il ne faut point oublier
que les travaux en grand de la métallmgic ne léponderit
prefqiie jamais exaéleincn: aux produits que l’on avoii obtenus
par les cüajs en [ictir. Rccli-erchc des moyens de fc procurer
du bois avant de commencer le travail d’une mine. A.iicrcs
coinmocliiés qu’il faut avoir à fa portée, Ibid. b. Atteiuhm
paniciillere que les iouverains d’Allemagne ont donnée à
cette branche (lu coniir.etce de leurs états, qui provient de
l’exploitation de leurs raines. Il fe.'-oit à fouhaiter que la
France, ouvnmr hes yeux fur fes vrais intérêts , remédiât à
ce que fes ordonii.mces ont de défcéliieiix à cct égaul. Avantages
du travail des mines pour l’éiat qui !e.s p’ofl'cde. Ce
que doit taire un feuver: in qui vent établir des mines dans
un pays oii l’o.; non a point encore cxjdolcé. Divers maux
auxquels lent expolés les ouvriers. Coraraciu U convient de
les dédommager. Ibid. 327. a. £..rO'jlement de la m-omagne
(le Kopparberg en Siiede , l’an 1387. Quelles font les mines-
(l'Europe les plus connues. Celles des ét.its du Nord. Celles
d Ali..m.agne. Cdh.', de h Gra..(ic-Brct gne. C^!Ls dc-France.
Uns. b. Mmes d’Eipagne. L A fie en rci firme de très alon-
(lamcs d'or 8c de pierres précieufi-s. il paroit que c’eil clans
riiule ([UC l’on aoii placer l’opliir d’oti Saloiuon tiioii fon or.
Mine d'Afrique. Ceiie d’Amérique. Jbia. 328. J.
Mine... D.,-. différentes fortes de métaux ik niinéraux , x oj q
leurs auiri.-., h,loti:, ou Veines dans fis raines. VI. 8oi. b.
803. Filons de mauvais prefage. V. 131 , Indices favoraineurs
regardent ie quartz qui a le ccup-d’cdl
g ia s , comma l’indice dune mine do bonne qual té. X ii l.
693. é. Signe auquel on reconnoit dans une mine (patl.iquc
quelle lcra precieiifc. X V . 440. a. Terres métalliques qui
le trouvent quelquefois , meme à la finfacc de la terre ,
dans des fentes de rochers 8c de montagnes qui contiennent
des mines. V i l . 1000. .2. Subitances luoculliques ou efpeccs
de min-;s qui peuvent le trouver dans les montagnes nouvelles.
X. 674. .1. Opéiacions 'de l'ingénieur pour prendre
les clancnfions d une mine. VII. 639. b. Puits qu'on pratique
pour üclLencIre dans une mine. II. 463. a. Galeries dans les
mmes, v o ye z ce mot. Mines en marron. X. i'44. a. Métal
mi dans fa mine. XI. 273. b. Vitriols qui fc trouvent dans
les loutcrreins de quelques mines. XVII . 3Ö4. b. Fleurs do
te r , ef]-cces de flalaéUtes attachées aux voûtes d-e certames
mines. VT. 838. b. Les filets d'eau obiervés dans les mines
tariircm par la féchereffe. V i l . 84. b. Caiife de la fuoiir
([u’on éjjrouve en defccndanc dans les mines. X V . 628. a.
VapciUb qui s’élèvent dos mines 8c dans les mines. X V I .
3S0. b. 381. ./. Utilité d’un ventilateur dans ces Ibiuerrelns.
XV II. 27. b. Efl'cts des feux fouterreins dans les mines. V I.
Ö13. O. Exploitation des mines , v o ye z ce m o t , vol. VI. des
planch. Regne minéral, colleétion. Defeription des machines
qui icrvcnt à épuiler les mines de Poiitpéan , 8c à
en tirer ic inufiral. Xil^, 9 b.
M in e s , ou Ali!içr.us, ( Operations de Alét.iUurg.) C e qu’on
entend par mine , miniere, ou minuxti. X. 332. Lflets
de la coiubiiiailon de l’arfenic avec les difi'érens métaux
dans les mines. XI. 664. b. Effets du foufre fur Ls métaux
auxquels il fe trouve uni. X V . 402. u. Une mine déjà formée
p, ut lervir de matrice à une autre mine. X. 203. b.
Opération pour connoitre la quantité de métal que contient
une mine. IX. 696. n. 738. b. Moulin pour écralér le mine-
r.ii. XVT. 366. a. Opération fur le minerai appellee triage.
6 to. a. Bocarderh mine. II. 290. a , b. D e la maniéré de
la nettoyer. V i l . 141. b. S>c. Du lavage des mines. IX. 306.
b. tUc. Minerai écrafé lotis le bocard, tk lavé. X IV . 768. a.
Grillage des mines. V IL 946. b. Macération. iX . 791.
a. Détails fur la manière cle fendre les mines de cu iv re ,
de plomb, d’etain , de 1er. VU. 240. b. But de la fufion
du minerai. 400. b. Snbflance qui réfultc de la premiere fonre
d’une mine. X. 207. a , b. C'èft fur la propriété qu’a la
litarge de fondre les terres , les pierres , métaux, 8c demi-
métaux , qu’eil ibndé le travail des mines pour en tirer i'or ,
l’argent, 8c le cuivre. VT. 920. b. Ulàge du mercure dans le
traitement des mines d’or 8c d’argent. X. 374. a. Du traitement
des différentes mines, '•cyc^ MÉTALLURGIE.
M ine, ( Géogr. ) nomenclature alplrabéîlque des principales
mines du monde. X. 328. b. ,
Mines d’Allr.ce, I. 299. a , b. d'Afrique, Suppl. I. 194. a.
du Potofi, X lI l. 183. .z, b. de Schemnitz , X IV . 761. b.
d’Eybenflode. Suppl. II. 931. a. Les lieux qui contiennent
des mines font iiuücjués aux articles des diff'érens métaux
ou minéraux.
M ines , ( Hiß. anc. ) Mines d’Ibérie, VIII. 479. a. Mine
IF
is';
f'i