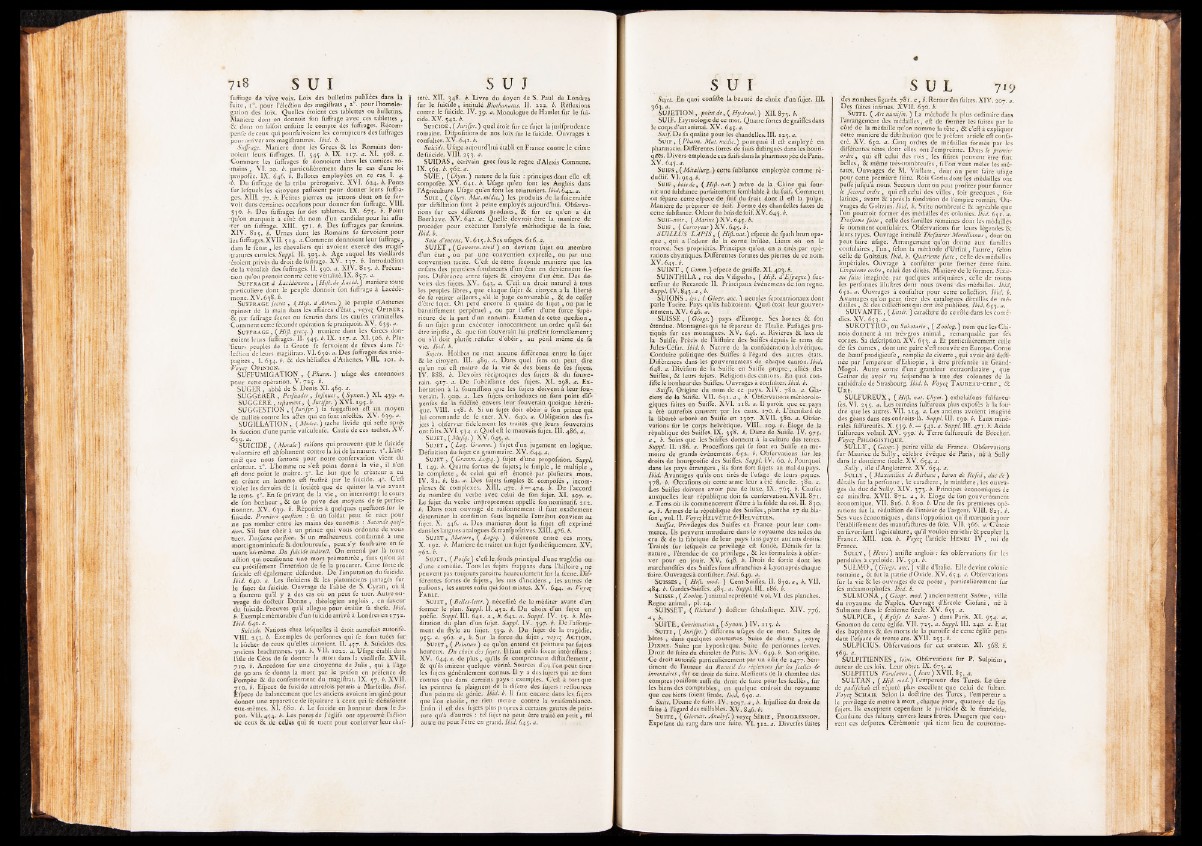
1«!
■' ]f 1’]:'
'n S:ii].
■ ' i
: ii:^
' 1 f
1 1 ]
1 !
h
7 i 8 S U I
fiifi'nigc de v iv e voix. Loix des bulletins publiées^ dans la
fu ite , i" . pour l’éleftion des magiftrats , 2''. pour rhomolo-
gntion des loix. Quelles croient ces tablettes ou bulletins.
Maniéré dont on doiinoit ion luffrage avec ces tablettes ,
& dont 011 taifoit enfuite le compte des fuffrages. Récom-
penfe (le ceux qui pourruivoiert les comipteun des lulTrages
pour arriver au.x inagillratiircs. Ibid. b.
S/tffr.igc. Maniéré dont les Grecs & les Romains don-
noient leurs (iift'ragcs. H. 5.^^
Comment les fuffrages fe tlonnoicnt dans les comices romains
, VI. ao. b. particuliérement dans le cas d’une loi
propofée. IX, 646. b. Ballotes employées en ce cas. I. 4.
b. Du fuffrage de la tribu prérogative. X V I . 624. b. Ponts
fur lefqucls Us citoy^ens pauoient pour donner leurs fiiffra-
gcs. XIII. 77. b. Petites pierres ou jettons dont on fe for-
voit dans certaines occafions pour donner fou fuffrage. V'III.
530. b. Des fuffrages fur des tablettes. IX. 675. b. Point
qu’on marquoit à côté du nom d’un candidat pour lui affu-
rcr un fuffrage. X l l l . 571. b. Des fuffrages par ferutins.
X IV . 813. b. Urnes dont les Romains fe fervoient pour
lesfuffrages.XVII. 514. u.Comment donnoient leur fuffrage,
dans le fénat , les clievaliers qui avoient exercé des_ magif-
tratuies curulcs. 5upp/. II. 303. b. Age auquel les vieillards
■ ctoicm privés du droit de fuffrage. X V . 137. b. IntroduéKon
de la vénalité des fuffrages. II. 390. a. X IV . 813. b. Précaution
qu’on prenoit contre cette vénalité. IX. 837. u.
Suf fr a g e *i Ld.:cd(mon£, {^Hijî.dc maniéré toute
particulière dont le peuple donnait fon fufi’-age à Lacédémone.
X V . 638. b.
Su f fr a ge iccra , {Hi^l. i'Aihcn.') \& peuple d’Atbenes
opiiioit de la main dans les affaires d’é ta t , voyc^ OPI^ER;
& par fuflVage fecret ou ferutin dans les caufes criminelles.
Comment cette fcconde opération fe pratiquoit. XV. 639. a.
Su f fr .aGE , ) maniéré dont les Grecs donnoient
leurs fuffrages. II. 343. f. IX. l l j . a . XL 306. b. Plu-
■ fieur-^ peuples de la Grece fe fervoient de fèves dans l’é-
Icéiion de leurs inagiffrats. VI, 630. a. Des fuffrages des aréo-
pagites, 1. 634. b!6c des héliaftes d’Atlienes. V i lL l o i . b.
V'oyei O p in io n .
SU F FUM IG A T IO N , ( Phixrm. ) ufage des entonnoirs
pour cette opération. VL 723. b.
SUGER , abbé de S. Denis. XI. 469. a.
SU G G É R ER , Perfuader , Irifinuer, {Synor..) XI. 439. u.
SUGGÉRÉ , uftarneyit, ( Junfpr. ) X V I. 193./>
SUGGESTIOiSl , {Jurifpr.) la fuggeftion eft un moyen
de nullité contre les aftes qui en font inledés. X V , 639. a.
SU G IL LA T IO N , ( AUdcc. ) taclie livide qui reffe après
la fuccion d’une partie vafculeufe. Caufe de ces taches. XV.
Su i c i d e , (MoraU) raifons qui prouvent que le filicide
volontaire eft abfolument contre U loi de la nature, i". L’mf-
tinff que nous fentons pour notre confervacion vient du
créateur. 2". L'homme ne s’eft point donné la v ie , il n’en
eft donc point le maitre. 3''. Le but que le créateur a eu
en créant un homme eft fruftrè par le filicide. 4". C e ft
violer les devoirs de la fociété que de quitter la vie avant
le teins. 3^. En fe privant de la vie , on interrompt le cours
de fon bo.nheur , & on fe prive des moyens de ie perfectionner.
X V . 639. b. Réponfes à quelques queftions lur le
filicide, Premiire quejUon : fi un foldat peut fe tuer pour
ne pas tomber encre les mains des ennemis : Seconde qiuf-
tion. S’il faut obéir à un prince qui vous ordonne de vous
îiier. Troifieme quefUon. Si un malheureux condamné à une
mort ignominteufe Si douloureufe , peut s’y fouftraire en fc
tuant lui-même. Du Juicide indireB. On entend par là^ toute
aftion qui occafionne une mort prématurée, fans qu’on ait
eu précifément l’intention de fe la procurer. Cette forte tie
l'uicide eft également défendue. De l'imputation du fuicide.
Jbid. 640. a. Les ftoïciens & les platoniciens partagés fur
le fujec du fuicide. Ouvrage de l'abbé de S. Cy ran, où il
a foutenu qu’il y a des cas où on peut fe tuer. Autre o uvrage
du doéleur Donne , théologien anglois , c-n faveur
du fuicide. Preuves qu’il allégué pour établir fa thefe. Ibid,
b. Exemple mémorable d’un fuicide arrivé à Londres en 1732.
Ibid.
Suicide. Nations chez lefqiielles il étoit autrefois autorlfc.
V l l I . 232. b. Exemples de perfonnes qui fe font ruées fur
le bûcher de ceux qu’elles aimoient. II. 437. b. Suicides des
anciens brachmanes. 391. b. VII. 1022. a. Ufage établi dans
l’iüe de Céos de fe donner la mort dans la vieilleffe. XVII.
710. b. Anecdote fur une citoyenne de Jiilis, qui à l'âge
de 90 ans fe donna la mort par le poifon en préfence de
Pompée 8c du confentement du magiftrat. IX. 37. X V II .
10. b. Efpece de fuicide autrefois permis à Marfeille. Ibid.
fpece de balancement que les anciens avoient imaginé pour
donner une apparence defépuiture à ceux qui fe défaifoient
eux-mèmes. X l. 680. b. Le fuicide en honneur dans le Japon.
V IL 434. b. Les peresde l’églifc ont approuvé l’aiffion
ceux Ôt de celles qui fe tuent pour conferver leurchaf-
U
S U J
teté. XII. 348. h. Livre du doyen de S. Paul de Londres
fur le fuicide, intitulé Bioihaïuius. IL 222. b. Réflexions
contre le fuicide. IV. 39. a. Monologue de Hamlet fur le fui-
c id c .X V .3 4 2 .É
Suicid e , ( Jurifpr. ) quel étoit fur ce fujet la jurifprudence
romaine. Dlipofitions de nos loix l'ur le fuicide. Ouvrages à
confulter. X V . 641. b.
Suicide. Ufage aujourd'hui établi en France contre le crime
defuicicle. V l l l . 233. û.
SUIDAS , écrivain grec fous le regue d’A lexis Comnene.
IX. 361. b. 362. a.
SU IE , (C/iym.) nature delà fuie : principes dont elle eft
compofée. X V . 641. h. Ufage qu’en font les Anglois dans
l’Agriculture. Ufage qifen font les teinturiers. Ibid. 642. a.
Suie , ( Chym. j\Ui. medic.) les produits de la fuie traitée
par diftillatlon font à peine employés aujourd’hui. Obferva-
tions fur ces différées produits, & fur ce qu’en a dit
Boerhave. X V . 642. j . Quelle devroit être la maniéré de
procéder pour exécuter l’analyfe méthodique de la fuie.
Jbid. b.
Suie d'encens. V . 613. i.S e s ufages. 616. a.
SUJET , {Gouvern. civil ) on devient fujet ou membre
d’un état , ou par une convention exprelTe, ou par ime
convention tacite. C ’eft de cette fécondé maniéré que les
enfans des premiers fondateurs d'un état en deviennent fu-
jets. Dift'ércnce entre fujets & citoyens d’un état. Des devoirs
des fujets. X V . 643. u. C e l l un droit naturel à tous
les peuples libres, que chaque fujec &c citoyen a la liberté
de fe retirer ailleurs, s’il le juge convenable , 8c de ceffer
d’être fujet. On perd encore La qualité de fujet , ou par le
banniffement perpétuel , ou par l’effet d’une force fiipé-
rieure de la part d’un ennemi. Examen de cette queftion ,
fl un fujet peut exécuter innocemment un ordre qu’il fait
être injulle , 8c que fon fouverain lui preferit formellement ;
ou s’il doit jffutüt refufer d’ob é ir, au péril meme de fa
vie. Jbid. h.
Sujets. Hobbes ne met aucune dift'ércnce entre le fujet
Sc le citoyen. IlL 489. Dans quel fens on peut dire
qu'un roi eft maiire de la vie 8c des biens de fes fujets.
IV . 888. b. Devoirs réciproques des fujets 8c du fouverain.
917. U. D e l'uhéillance des lujets. XL 298. a. E x hortation
à la foiimlfTion que les fujets doivent à leur fouverain.
1. 900. *1. Les fujets orthodoxes ne font point dif-
penfés de la fidélité envers leur fouverain quoique hérétique.
V l l l . 138. b. Si un fujet doit obéir à fon prince qui
lui commande de fe tuer. X V . 640. a. Obligation des fu-
jecs à obferver fidèlement les traités que lents fouverains
ont faits.XVI, 534- Q uel eft le mauvais fujet. III. 486. a.
Sujet , (M i r / f ) X V . 643.^.
Su j e t , {Log. Gramm.) iujetd’un jugement en logique.
Définition <lu fujet en grammaire. X V . 644. a.
S u j e t , {Gramm. Logiq.) fujet d’une propofition. Suppl.
I. 149. b. Quatre fortes de fujets j le fimple , le multiple ,
le complexe , 8c celui qui eft énoncé par plufieurs mots.
IV . 81. b. 82. a. Des fujets firaples 8c compofés , incomplexes
8c complexes. XIII. 472, i — 474. b. D e l’accord
du nombre du verbe avec celui de fon fujet. XL 207. a.
Le fujet du verbe improprement appelle fon nominatif. 212.
b. Dans tout ouvrage de raifonnement il faut exaélement
déterminer la condition fous laquelle l’attribut convient au
fujet. X. 446. a. Des maniérés dont le fujet eft exprimé
dans les langues analogues 8c tranfpofitives. XIII. 476. b.
Su j e t , Mauere, ( Lagiq. ) différence entre ces mots.
X. 192. b. Maniéré (le traiter un fujet fynthétiquement. X V .
762. b.
Sujet , {Poéjîe) c’eft le fonds principal d'une tragédie ou
d'une comédie. Tons les fujets frappans dans l’iiiftoire , ne
])euvcnc pas toujours paroitre heureiifement fur la feeue. I)if-
férentes fortes de fujets, les uns d’incidens , les autres de
palTions, les autres enfin qui font mixtes. X V . 644. a. Voye<^
F a b le ,
S u jet , {Bdles-letir.) néccftîcé de le méditer avant d’en
former le plan. Suppl. IL 432. b. Du choix d’un fujet en
poéfie. Suppl. III. 641. a , b. 642. u. Suppl. IV. 13. b. Méditation
du plan d’un fujet. Suppl. IV. 397. b. De l'all’orti-
ment du ftyle au fujet. 339. b. Du fujet de la tragédie,
933. a. 96a. a , b. Sur la force du fujec , ACTION.
Sujet , ( Peinture) ce qu’on entend en peinture par fujets
heureux. Du choix des fujets. Il faut qu’ils fuient intérelTans :
X V . 644. a. de plus, qu’ils fe comprennent diftinftement,
8c qu’ils imitent quelque vérité. Sources d’où l’on peut tirer
les fujets généralement connus. Il y a des fujets qui ns font
connus que dans certains pays : exemples, ( . ’eft à torique
les peintres fe plaignent de la ciiletre des fujets : rellburces
d'un peintre de génie. Ibid. b. Il faut encore dans les fujets
{|ue l’on d io ifit, ne rien mettre contre la vraifciiiblancc.
Enfin il eft des fujets plus propres à certains genres de peinture
qu’à d’autres : tel fujec ne peut être traité en petit , tel
aua e ne peut l’être en grand. Ibid. 643. a.
S U I
Sujet. En quoi confifte la beauté de choix d’un fujet. III.
363 .(X.
SU JE T IO N , p o intât,{Hy Jraul.) XII. 873.
SUIF. Etymologie de ce mot. Quatre fortes de graiffes dans
le corps d’un animal. X V . 643. u.
Sutf.JDc fa qualité pour les chandelles. IIL 123.U.
S u i f , {Pharm. Mat. médic.) pourquoi il ell employé en
pharmacie. Différentes fortes de l'uifs diftingiiés dans les botiti-
qirés. Divers emplois de ces fiiifs dans la pharmacopée de Paris.
X V . 643 .U.
Suif s , (MiÙ4//«rg. ) cette lubftance employée comme ré-
diiélif. VI. 914. b.
S v iv , bois de, {H iß . nas.) arbre de la Chine qui fournit
une fubftance purfaitemem femblable à du fuif. Comment
on l'épare cette efpece de fuif du fruit dont il eft la pulpe.
Maniéré de préparer ce luif. Forme des chandelles faites de
cette fubftance. Odeur du bois de fuif. X V . 645. é.
SuiF-«o?r, ( Murz/te) X V . 643. i .
S u i f , {Corroyeur)\V .O4'). b.
SUILLU S L A P I S , { Hiß.nat.) efpece de fpath brun opaque
, qui a l’odeiir de la corne brûlée. Lieux où on le
trouve. Ses propriétés. Principes qu’on en a tirés par opérations
chymiques. Différentes formes des pierres de ce nom.
XV .6 4 3 . b.
SUINT , ( Comm. ) efpece de graiffe. X L 403. L
SUINTH ILA , roi des Vifigoths, ( Hiß. d'Efpagnc) ftic-
ceftenr de Recaredo IL Principaux événemens de fon regne.
Suppl. IV. 843. U , b.
SUIONS , les, ( Giogr. anc. ) peuples fepcenrrlonaux dont
parle Tacite. Pays qu’ils habitoicnr. Quel croie leur gouvernement.
X V . 646. a.
SUISSE , (Gc'egr.) pays d’Europe. Ses bornes 8c fon
étendue. Montagnes qui le fépareut de ricalie. Paff'agcs pra-
liqués fur ces montagnes. X V . 646. a. Rivieres 8c lacs de
la Suiffe. Précis de l’hiftoire des Suiffes depuis le teins de
Jules-Céfar. Ibid. b. Nature de la confédération helvétique.
Conduite politique des Suift'es à l’égard des autres états.
Différences dans les gouvernemens de chaque canton./iiù.
648. a.. Divifion de la Suiffe en SiiilTc propre , alliés des
Suiffes, 6c leurs fujets. Religions des cantons. En quoi con-
ftfte le bonheur des Suiffes. Ouvrages à confulter. Ibid, b.
Suiffe. Origine du nom de ce pays. X IV . 780. a. Glaciers
de ia Suiffe. V IL 691. a , b. Obfervations météorologiques
faites en Suiffe. X V I. 118. a. Il paroit que ce pays
a été autrefois couvert par les eaux, i jo .b . L’étendard de
la liberté arboré en Suiffe en 1307. XV II . 380. a. Oofer-
vations fur le corps helvétique. VIII. 109. b. Eloge de la
république des Suiffes. IX. 338. b. Dicte de Suiffe. IV. 973.
a , b. Soins que les Suiffes donnent à la culture des terres.
Suppl. IL 186. a. Proceflions qui fe font en Suiffe en mémoire
de grands événemens. 632. b. Obfervations fur les
droits de bourgeoifte des Suiffes. Suppl. IV. Co. b. Pourquoi
dans les pays étrangers , ils font fort fujets au mal du pays.
Ibid. Avantages qu’ils ont tirés de l’iifage de leurs piques.
378. b. Occafions où cette arme leur a été funefte. 380. a.
Les Suiffes doivent avoir peu de luxe. IX. 763. b. Caufes
auxquelles leur république doit fa confervatioii. X VII . 871.
a. Tems où ils commencèrent d’être à la folde du roi. II. 830.
a , b. Armes de ia république des Suiffes, planche 17 du bia-
fon , vol. U. royqHELVÉTlEé'HELVÉTIEN.
Suiffes. Privileges des Suiffes en France pour leur commerce.
Ils peuvent introduire dans le royaume des toiles du
cm 8c de la fabrique de leur pays fans payer aucuns droits.
Traités fur lefquds ce privilege eft fondé. Détails fur la
nature , l’étendue de ce privilege, 8c les formalités à obferver
pour en jouir. X V . 648. b. Droit de lortie dont les
marclinndifes des Suiffes font affranchies à Lyon après chaque
foire. Ouvrages à confulter./éiûf. 649. a.
Suisses , ( Hiß. mod. ) Cent-Suiffes. II. 830. a , b. VIL
484. b. Gardcs-Sniffes. 483. a. Suppl. III. i86. b.
Suisse , ( Z(Jo/(?g. ) animal repréienté vol. V I des planclics.
Regne animal, pl- 14.
SUISSET, {R ich ard ) dofteur fcholaftique. X IV . 776.
a , b.
S U IT E , Continuation , ( Synm. ) IV. 1 1 5. é.
S u it e , {Jurifpr.) difl'éiens iff'ages de ce mot. Suites de
tè te s , dans quelques coutumes. Suite de dixine , voyrç.
D ixme. Suite par iiypotheqtie. Suite de perlbnnes ferves.
Droit de fuite du châtelet de P.nris. X V . 649. b. Son origine.
C e droit autorifé particuliérement par un édit de 1477. Sentiment
de l’aiiteur du Recueil des régUmens fur les J'celUs 6*
inventaires , lur ce droit de luire. Melfieurs de la chambre des
comptes jouiffciu auffi du droit de fuite pour les fccllés, fur
les biens des comptables, en quelque endroit du royaume
que CCS biens foienr fmiés. Ibid. 630. u.
Suite. Dixme (le fuite. IV. 1097. a , b. Injuflice du droit de
fuite à l’egard des taillables. X V . 846. b.
Su it e , ( Geométr. Ana ly f ) voyer SÉRIE , PROGRESSION.
Expofant du rang dans une fuite. 'V l.3 i2 .a . Diverfes fuites
S U L 719 <ïe.s nombres figurés. ySi. a ,b . Retour des fuites. X IV . 207. a.
Des fuites infimes. X V IL <$30. b.
Su ite . ( A n numifm. ) La méthode la plus ordinaire dans
l’arrangement des médailles, efl de former les fuites par le
côte (le la médaille qu’on nomme ta tète , 8c c ’eft à expHqitet-
cette maniéré de dlftrlbution que le prefent article eft confa-
cré. X V . 630. a. Cinq ordres de médailles formés par les
différentes têtes dont elles ont l’empreinte. Dans le premie:
ordre, qui eft celui des ro is , les fuites peuvent être fort
belles , Sc même trés-noinbrciifes, fi l’on veut mêler les métaux.
Ouvrages de M. V.-iillant, d(^iu on peut faire ufage
pour cette premiere fuite. Rois Goths dont les médailles ont
paffé jufqu’à nous. Secours dont on peut profiter pour former
le fécond ordre , qui eft celui des v ille s , foit grecques , foie
latines, avant 6c apres la fond.aiion de l’empire romain. Ouvrages
de Goltziiis. Ibid. b. Suite nomhreufe 8c agréable que
l’on pourroir former des médailles des colonies. Ibid. 631. æ.
Troifieme fuite , celle des f.imilles romaines dont les médailles
fe nomment confulaires. Obfervations fur leurs légendes 8c
leurs types. Ouvrage intitulé Thefaurus Moreliutnus , dont ou
peut faire ufage. Arrangement qu’on donne aux familles
confulaires, i’im, félon la méthode d’Urfini, l’autre, félon
celle de Goltzius. Ibid. b. Qu.i:rieme fuite, celle des médailles
impériales. Ouvrage à confulter pour former cette fuite.
Cinquième ordre, celui des déi'tcs. M.uiierc de le former. Sixième
fuite imaginée par quelques antiquaires, celle de toutes
les perfonnes illuftres dont nous avons des médailles. Ibid.
Ö32. a. Ouvrages à confulter pour cette collcdion. Ibid. h.
Avantages qu’on peut tirer des catalogues détaillés de mé-
d.iilles , 8c (les colleélions qui ont été publiées. Ibid. <333. a.
SUIVANTE , ( Littér. ) caraéfere de ce rôle dans les comédies.
XV. 633. a.
S U K O T Y R O , ou Sukotario , ( Zoolog. ) nom que les C h inois
donnent à un très-gros animal, remarquable par fes
cornes. Sa defeription. X V . 633. a. Et particuliérement celle
de fes cornes, dont une paire s’eft trouvée en Europe. Corne
de boeuf prodigieufe, remplie de civette , qui avoir été defti-
née par l’empereur d’Ethiopie, à être prèfeniée au Grand-
Mûgol. Autre corne d’une grandeur extraordinaire , que
Gefner dit avoir vu fufpendue à une des colonnes de la
cathédrale de Strasbourg. Ibid. b. Voyc^^ T a u r e au -CERF , 8c
U re.
SU L FUREUX, {H iß . nat. Chym.) exhala'ifons fulfureu-
fes. V L 235. a. Les terreins fulfureux plus expofés à la foudre
que les autres. V IL 114. a. Les anciens avoient imaginé
des gèans dans ces endroits-là. Suppl. III. 190. b. Eaux minérales
fulfureufcs. X. 5 39. />. — 541. Suppl. IlL gy i.h. Acide
fulfureux volatil. X V . 930. b. Terre fuîfureufc cie Beccher.
P'oyei Ph l o Gis t iq u e .
Su l l y , {Geogr.) pente ville de France. Obfervations
fur Maurice de S u lly , célébré évêque de Paris, né à Sully
dans le douzième fiecle. X V . 634. a.
Sully , ifle d’Angleterre. X V . 634. a.
Su l l y , ( Maximilien Je Béthune , baron de Rofni , duc de )
détails fur la perfonne , le caraftere, le mùiiftere, les ouvrages
du duc de Sully. X IV . 373. b. Principes économiques de
ce miniftre. X V II . 872. a , b. Eloge de fon gouvernement
économique. V IL 816. b. 820. b. Une de fes premieres opérations
fut la rédiiiftion de l’intérêt de l’argent. VHL 823. b.
Ses vue.s économiques , datis roppoiitioii qii’ii marquoit pour
l’établiffeTiiem des manufaélurcs de foie. V IL 366. a. C'étoic
en favorifiint l’agriculuire, qu’il vouloit enrichir 8c peupler la
France. XIII. 100. b. Poye:^ l’article Henri I V , toi de
France.
Su l l y , {Henri) artifte anglois; fes obfervations fur les
pendules à cycloïde. IV. 391. b.
Sü LM O , {Géogr. anc.) ville d'Italie. Elle devint colonie
romaine , & fut la patrie d’Ovide, X V . 654. a. Oblérvations
fur la vie Si les ouvrages de ce poète , particuliérement fur
fes métamorphofes. Ibid. b.
SULMON A , ( Géogr. mod. ) anciennement Sulmo , ville
du royaume de Naples. Ouvrage d’Ercole Ciofani, né à
Sulmone clans le fcizicme fiecle. XV. 633. a.
SUL PICE, {Eglifc de Saint- ) dans Paris. X L 934. a.
Gnomon de cette églife. V IL 725. Suppl. IIL 240. a. Etat
des baptêmes 8c des morts de la paroiffe de cette églife pendant
l’efpace de trente ans. XVII, 233. b.
SULPICIUS. Obfervations fur cet orateur. XL 568. b.
369. a.
SULPITIENNES , loix. Obfervations fur P. Sulpitiiis,
auteur de ces loix. Leur objet. IX. 673. a.
SULPITTUS Verulamis, (/ r.m ) X V IL 83. a.
SU L T A N , {H ill mod.) l'emperctir des Turcs. Le titre
de padijéhji eft réputé plus excellent que celui de fultan.
S c h a h . Selon la doélrine des T u rc s, l’empereur a
le privilege de mettre à mo rt, chaque jo u r, quatorze de fes
fujets. Ils exceptent cependant le p.irricide 8c le fratricide.
Conduite des fultans envers leurs freres. Dangers que coti-
rent ces defpotes. Cérémonie cpii tient lieu de couronne