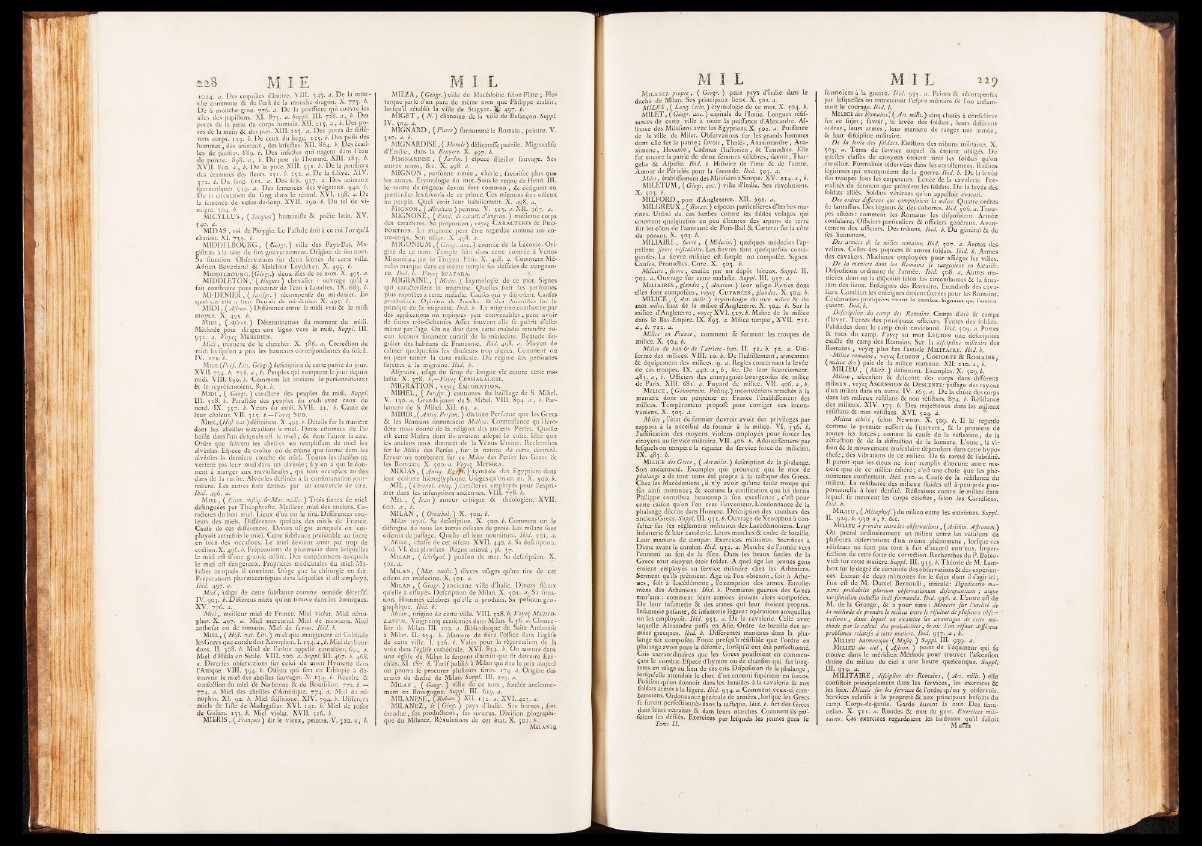
M I E M
Ü. T^ts coquilles d'liultre. \ l l ï . 34)- mouille
conimtine &. de l’oeil de la inoiiche-diagon. X. 775. i>.
D e la niouclie-griie. 776. a. D e la poiilTierc qui couvre les
a ilo des papillons. X L 873. •i.Suyf'L l l l . 728. ‘t , L Des
porcs de la peau du corps tumiaii). XII. 213. ‘i , Des pores
de la main & des pies. X lll. 125. a. Des pores de didé-
rciis corps. 113. b. D e ceux du liege. 123. h- Des poils des
lionimes , do.s animaux, des infefles. XII. 864. k. Des écailles
do poifron. S8y. h. Des infeéles qui nagent dans 1 eau
de poivre. S98. b. D u pou de llioiiinie. XIII. 1S5. b.
X V I I . 810. a , b. De la puce.XIII. 531. b. De la poulLiere
ik s ét.imiuos des fleurs. 231. b. 232. .i. De la falive. X IV.
372. b. Du Cang. 612. .1. Des icls. 927. a. Des aiuniaux
Ipcinntiqucs. 939. a. Des fcmences des végétaux. 940. b.
D e la cireutation du i'ang dans le têtard. X V l. 198. .1. De
ia lémence de vel’cc-de-loup. XVII. 190. b. Du Ici de vin.
iigre. 304. k.
M ICYLLU8 , (Jjcquc s) humanise & poete latin. X V .
540. <1.
MID.AS , roi de Phiygic. Le Paélole doit à ce roi l'or qu’il
charioit. XL 739. b.
M ID D K LBÜ U R G , ( Gedgr. ) ville des Pays-Ba.s. M.a-
eillrats à la tète de ion gouvernement. Origine de ibn nom.
Sa fituation. Oblervatlons i'iir deux lettrés de cette ville.
Adrien Bcverland 6c Melchior Leydeker. X. 493. b.
MiDDELBOURG. {Géogr.) deu.x ilîes de ce nom. X. 493. <1.
M ID D L L T O N , ( ) chevalier : ouvrage qu’il a
fait conllruire pour procurer tle l’eau à Londres. IX. 683. b.
MÏ-DENIER , ( /wWypr. ) récompcnle du mklenicr. En
quel cas elle a lieu. Retrait de mi-denier. X. 493. b.
M ID I , ( Jßron. ) Différence entre le midi vrai 6c le midi
mo)’en. X. 493. k.
Mid i , {Ajhon.') Détermination du moment du midi.
Méthode pour diriger une ligne vers le midi. Suppl. III.
931. a. l'oyci Méridien.
M'uli , maniéré de le chercher. X. 386. a. Correélion du
n;idi loil'qu’oii a pris les hauteurs correlpondaïues du foleil.
IV. 272. k.
Midi {Pcef. Lin. Géogr.') del'criptionde cette partie du jour.
X V ll. 734. k. 736. *7,/-. Peuples qui comptent le jour depuis
midi. V l l l . 890. b. Comment les anciens le perfonnirioient
ic. le rcpielcnioient. 891. k.
Midi , ( Geogr. ) caraRcre des peuples du midi. Suppl.
III. 318. k. Parallele des peuples du midi avec ceux du
nord. IX. 357. b. Vents du midi. X VII . 21. b. Caute de
leur clialeur. VII, 313. b.— l'ovni Suo.
M iel, [Hiß.nui.) définition. X. 4 9 3 . Détails fur la maniéré
dont les abeilles travaillent le miel. Deux ePomacs de l’abeille
dans l’un deli]uels eit le mie l, & dans rautre la cire.
Ordre que fiiivcnt les abeilles i#n remplillant de miel les
alvéoles. Efpecc de croûte ou de crème que forme dans les
alvéoles la dernière coudie de miel. Toutes les abeilles ne
verfem pas leur miel dans un alvéole; il y en a qui le donnent
à manger aux travailleufes , qui font occtipécs au-de-
dans de la ruche. Alvéoles ddlinés à la confoir.mation journalière.
Les autres font fermés par un couvercle de cire.
ibiJ. 496. ‘1.
Miel , ( Econ. nßiq. 6- M.u. méJic. ) Trois fortes de miel
diftinguées par Théophraflc. Meilleur miel des anciens. Ca-
raéleres du bon miel. Lieux d’où on le tire. Différences couleurs
des miels. Différentes qualités des miels de France.
Caufe de ces différences. Divers ufages auxquels on eni-
ployoit autrefois le miel. Cette fubffance préférable au fucre
en bien des occafions. Le miel devient amer par trop de
coélion.X. 496./>. Préparations de plurmacie dans lefquelles
le miel eff d'une giandc utilité. Des temperamens auxquels
le miel eff dangereux. Propriétés médicinales du miel. Maladies
auxquels il convient. Ufage que la chirurgie en fait.
Préparations pharmaceutiques dans lefquelles il eff employé.
Ibid. 497. U.
A l i d ufage de cette fubffance comme remède déterfif.
IV , 903. b. JDifférens miels qu'on tiouve dans les bouriqwes.
X V . 776. U.
A iie l, meilleur miel de France. Miel violât. Miel nénuphar.
X. 497. a. Miel mercurial. Miel de nicotiane. Miel
anthofat ou do romarin, Miel de favon. Ibid. b.
Miel, [H iß . um. L in .) miel que mangèrent en Colchidc
les Grecs que coiiduifoit Xeiiophon. 1.134.U , i . Miel des bourdons.
IL 368. b. Miel de l’arbre appelle caroubier. 694. a.
Miel d'Hibla en Sicile. VIII. 200. a. Suppl. III. 467. b. 46S.
a. Diverfes obfervatioiis fur celui du mont Hymetre dans
l'A ttique. VIII. 394. b. Oifeau qui fort en Ethiopie à découvrir
le miel des abeilles fauvages. X. 134. b. Récolte &
confeélion du miel de Narbonne 6c dû RouiHllon. 772. b.—
774. a. Miel des abeilles d’Amérique. 774. a. Miel de né--
nuphar. XI. 92. b. Miel fcilliciqiie. X IV . 794. b. Différens
■ miels de l’iHe de Madagafcar. X V I . 141. b. Miel de rofée
de Galien. 133. k. Miel violât. XVII. 316. b.
AIIERIS , ( Erançgis ) dit le v ieux, peintre. V . 320. a, b.
M IE Z A , (G co|t. ) ville de Macédoine felon Pline ; Phi'
tarque parle d'un parc de même nom que Pliilij>pe établit,
lorlqu’il rétablit la ville de Stagyre. 497. b.
A lIG E T , (A a ) chanoine d e là ville de Befançon.
IV . 304. a.
M IGN ARD , ( Pierre) furnommcle Romain , peintre. V .
3 20. .7. b.
M IG N A R D IS E ,( Morale) délicateffe puérile. Mignurdife
d’F.milic, daas la Ihuyere. X. 497. b.
Mignardise, (Jardin.) efjjece d’oeillet fauvage. Ses
autres noms, &c. X. 498. a.
MIGN ON , perfonne aimée , chérie, favorifée plus qu*
les autres. Etymologie du mot. Sous le regne de Henri ÜL
le terme de mignon devint fort commun , 6c défignoit en
particulier les favoris de ce prince. Ces mignons fott odieux
au peuple. Quel étoit leur habillement. A. 498,
Mignon, ) peintre. V . 313. a. XII. 267. a.
M IG N O N E , ( Eund, de caraB. d'imprim. ) trolfieme corps
clos Carafferes. Sa proportion, CARACTERES 6c PROPORTION.
La mignone peut être regardée comme un entre
corps. Son ufage. X. 498. a.
M iGÜ N IUM , ( Geoe,r. .un. ) contrée de la Laconie. O rigine
de ce uüiii. 'i'emple bâti dims cette contrée à Venus
Minonitis, par le Troyen Pàrib. X. 498. a. Comment Mé-
nclas marqua dans ce meme temple fes deffeius de vengeance.
Ibid. b. Voyci SpATARA.
M IG R A IN E , (Midec.) Etymologie de ce mot. Signes
qui caraélérifent la migraine. Quelles font les perfonne*
plus expofées à cette maladie. Caufes qui y difpofent. Caufe*
prochaines. Opinion de Jimcker- 6c des Animihes fur le
principe de la migraine. Ibid. b. La migraine combattue par
des applications ou topiques peu convenables , peut avoir
de fuites très-fâcheufes. Allez fouvent elle fe guérit d’clle-
mème parl’àge. On ne doit dans cette maladie attendre aucun
lecours luremcnt curatif de la médecine. Rcmede fin-
giilier des habitans de Francoiiie. Ibid. 498. a. Moyen de
calmer quelquefois les douleurs trop aigues. Conunvnt 011
en peut tenter la cure radicale. Du régime des perfoanes
fujettes à la migraine. Ibid. b.
Migraine., ufage du firop de longue vie contre cette maladie.
X. 378. b,— Foye:^ CÉPHALALGIE.
M IG R A T IO N , Émigration.
MIH EL, ( Jurifpr.) coutumes du bailliage de S. Mihel.
V . 130. a. Grands jours de S. Mihel VIII. 894. a , k. Parlement
de S. Mihel. XII. 63. a.
MIHIR,(yd/iriq.PcrJan.) divinité Perfanne que les Grecs
6c les Romains nommoient Mithra. Connoillance qu'Héro-
dote nous donne de la religion des anciens Perfes. Quelle
eff cette Mithra dont ils avoienr adopté le culte. Idée que
les anciens nous donnent de la Vénus Uranie. Rcciierches
fur le Milüo des Perfes , fur la nature de cette divinité.
Erreur où tombèrent fur ce Mihio des Perfes les Grecs cc
les Romains. X. 500. a. Voyc:^ MiTHRA.
M IK IA S , (Antiq. E c y f t.) fymbole des Egyptiens dans
leur écriture hiéroglyphique. Ui’agcs qu’on en tit. X. 300. i>.
MIL , ( Chronol. antiq. ) car.aéieres employés pour l’exprimer
dans les inferiptions anciennes. V l l l . 778. b.
M il , ( Jean ) auteur critique & théologien. X V II .
600. a , k.
MILAN , ( Ornithol. ) X. 300. b.
Milan royal. Sa defeription. X. 300. b. Comment on le
diffinguc de tous les autres oifeaux de proie. Les milans font
oifeaux de paffage. Quelle eff leur nourriture. Ibid. 301. a.
jMi/aa, chalTe de cet oifeau. X V II . 440. b. Sa deferiptiotu
Vol. VI, des planches. Régne animal , ‘pi. 37.
Milan, (Ichthyol.) poiffon de mer. Sa defeription. X.
301. a.
Milan, (Mat. medic.) divers nfages qu’on tire de cet
oifeau en médecine. X. 301. a.
Milan , ( Geogr. ) ancienne ville d'Italie. Divers fléau.x
qu’elle a clfuyés. Defeription de Milan. X. 301. a. Sa firua-
tion. Hommes célèbres qu’cHc a produits. Sa pofition géographique.
Ibid. b.
Milan , origine de cette ville. YII I. 328. b. Foyc^ M e d io -
Lyt.'fir.M. Vingt-cinq académies dans Milan. I. 36. a. Chancelier
de Milan. III. 102. a. Bibliothèque de Saint Ambroife
à Milan. II. 234. b. Maniéré de faire l’ofRcc dans l'églife
de cette ville. I. 326. b. "Vafes pour la répercuffioii de In
voix dans l’églife cathédrale. X V I. 834. h. On ruontre dans
une églife de Milan le ferpent d’airain que fit détruire Ezé-
chlas. XL 187. b. T a r if publié .à Milan qui fixe le prix auquel
on pourra fe procurer pluficiirs titres. 174. a. Origine des
armes du duché de Milan. Suppl. III. 279. a.
Milan , ( Gèogr. ) ville de ce nom , fondée ancieunc-
ment en Bourgogne. Suppl. III. 619. a.
MILANESE, (Ruban.) XII. 132. u. X V L 423. a.
M IL AN E Z , U ( Geog. ) pays d’Italie. Scs bornes , fon
étendue , fes produélions , fes rivières. Divifion géographique
du Milanez. Réyoliuions de cet eut. X. 501. b.
Milane-2
M I L M I L 2 2 9
Milanez propre, ( Geogr, ) petit pays d’Italie dans le
duché de Milan. Ses principaux lieux. A. 302. a.
m i l e s , ( Lang, latin.) étymologie de ce mot. X. 304. b.
MILET , ( Gr'ügr. anc.) capitale de l’Ionie. Longues réfif-
tances de cette ville à toute la puiffance d’Alexandre. A lliance
des Miléfiens avec les Egyptiens. X. 302. a. Puiffance
de la ville de Milet. Obfervations fur les grands hommes
dont d ic fut la patrie ; favoir. Thaïes , Anaximandre , Ana-
ximene, Hecatée , Cadmus l’iiifforicn , 6c Timothée. Elle
fut encore la patrie de deux femnies célébrés, ('avoir, Thar-
gelie 6c Afpafîe. Ibid. b. Hiffoire de l’une 8c de l’autre.
Amour de Périclés pour la fécondé. Ibid. 303. a. -
Milet, établiiremcutdesMiléllensàSinope. X V . 2 1 4 . b.
M IL E TUM , (Géogr. anc.) ville d’IiaUe. Ses révolutions.
X. 303. b.
M IL F O R D , port d’Angleterre. X l î . 291. a.
MILGREUX , ( Boian. ) efpeccs particulières d’herbes marines.
Utilité de ces herbes contre les fables volages qui
couvrent quelquefois en peu d'heures des arpens de terre
fur les cotes de ramirauté de Port-Bail 8c Carteret fur lu côte
du ponant. X. 503. b.
M IL IA IR E , fievre , (Médecin.) quelques médecins l’appellent
fievre vcjiculaïre. Les ficvres font quelquefois conta-
gieufes. La fièvre miliaire cft fimple ou compofée. Signes.
Caufes. Pronoftics. Cure. X. 303. b.
Miliaire , fievre, caiifée par un dépôt laiteux. Suppl. II.
701. a. Ouvrage fur cette maladie. Suppl. III. 937. a.
Miliaires, glandes , ( Anatom.) leur ufage. Parties dont
elles font compofées, voyei( C utanées , glandes. X. 304. b.
MILICE , ( Art. milit. ) étymologie du mot milice 6c du
mot miles. Etat de la milice d’Angleterre. X, 304. k. Sur la
milice d'Angleterre , X V I . 327./>. Maître de la milice
dans le Bas-Empire. IX. 893. a. Milice turque, XVII . 7 1 1 .
a , h. 712. a.
Milice en France, comment fc forment les troupes de
milice. X. 304. b.
Milice du ban &• de Varriéré - ban. II. 31. b. 32. a. Uniforme
des milices. VII I. 10. b. D e rhabillement, armement
8c équipement des milices. 9. a. Regies concernant la levée
de ces troupes. IX. 440. a , b , &c. De leur licenciement.
483. a , b. Officiers des compagnies boiirgeoifes de milice
de Paris. XIII. 681. a. Fuyard de milice. VII . 406. a , b.
Milice, (Gouvernent. Politiq.) inconvénlens attachés à la
maniéré dont on perpétue en France rétabliffemem des
milices. Tempérament propofe pour corriger ces incon-
véniens. X. 303. a.
Milice , l’état de fermier devroit avoir des privileges par
rapport à la néceffité de fournir à la milice. V I . 336. b.
Juffification des moyens violens employés pour forcer les
citoyens au fervice militaire. V II . 406. b. Adouciffemens par
lefquels on tempere la rigueur du fcrvice forcé du milicien.
IX . 483. b.
Milice des Grecs, (Artm ilir.) defeription de la plialangc.
Son ancienneté. Exemples qui prouvent que le mot de
phalange a de tout tems été propre à la taéliqiie des Grecs.
Chez les Macédoniens , i l n’y avoir qu’une feule troupe qui
fût ainfi nommée; 8c comme ia conffitution que lui donna
Philippe contribua beaucoup à fon excellence , c’eft pour
cette raifoii qu'on l’en crut l’inventeur. L’ordonnance de la
phalange décrite dans Homere. Defeription des combats des
anciens Grecs. Suppl. III. 93 i.b. Ouvrage de Xenophon à cou-
fulter fur les réglemens militaires des Lacédémoniens. Leur
infanterie 8c leur cavalerie, Leurs marches 8c ordre de bataille.
Leur maniéré de camper. Exercices militaires. Sacritîces à
Diane avant le combat. Ibid. 932. a. Marche de l’armée vers
l ’ennemi au fon de la flûte. Dans les beaux ffecles de la
Grece tout citoyen étoit foldai. A quel âge les jeunes gens
étoient employés au fervice militaire chez les Athéniens.
Serment qu’ils prétoient. Age où l’on obtenoit, folt à Aihe-
a e s , foit à Lacédémone, l’exemption des armes. Enrolle-
mens des Athéniens. Ibid. b. Premieres guerres des Grecs
Cntr’eux : comment leurs aimées étoient alors compofées.
D e leur infanterie 8c des armes qui leur étoient propres.
Infanterie pefante, 8c infanterie légère : opérations auxquelles
on les employoit. Ibid. 933. a. D e la cavalerie. Celle avec
laquelle Alexandre pafl'a en Afie. Ordre de bataille des armées
grecques. Ibid. b. Différentes maniérés dont la phalange
fut compofée. Force prefqu’irréfiftible que l’ordre eu
phalange avoit pour la défenfe, lorsqu’il'eut été perfeélionnc.
Cris extraordinaires que les Grecs pouffoient en commençant
le combat. Efpece d’hymne ou de chanfon qui fut long-
tems eu ulage au lieu de ces cris. Difpofition de la phalange ,
lorfqu’elle attendoit le choc d’un ennemi fupérieur en forces.
Pofitiou qu’on donnoit dans les batailles à la cavalerie 8c aux
foldats armés à la légère. Ibid. 934. a. Comment ceux-ci com-
battoiciu. Ordonnance générale de armées ,lorfque les Grecs
fe furent perfcélionnés dans la taéliquc. Ibid. b. Art des Grecs
dans leurs retraites 6c dans leurs marches. Comment ils paf-
foiem les défilés. Exercices par lefquels les jeunes gens fe
Tome II,
fermoientà la guerre. Ibid. 933. Peines & lécompenfes
par lefquelles on entrecenoit refprit militaire 8c l’on cnfbm-
moit le courage. Ikid. b.
Milice des Romains', ( Art. miJU.) cinq chofes à confidérer
fur ce lujet ; favoir, la levée des foldats , leurs différens
ordres, leurs armes, leur manière de ranger une armée,
8c leur difciplitie militaire.
De la levée des fioldats. Eleélion des tribuns militaires. X.
503. a. Tems de fcrvice auquel ils croient obligés. De
quelles claffes de citoyens etoient tirés les loldats qu’on
enrolloit. Formalités obfervées dans les enrollcmens. Raifons
légitimes qui excmptolcnt de la guerre. Ibid. b. De la levée
des troupes fous les empereurs. Levée de la cavalerie, fo r malités
du ferment que prétoient les foldats. D e la levée des
foldats alliés. Soldats vétérans qu’on appclloit evocaii.
Des ordres diféiens qui compofioient la milice. Quatre ordres
de fantaffins. Des légions 6c des cohortes. Ibid. 306. a. T rou pes
alliées : comment les Romains les difjjofoient. Armée
confulaire. Officiers particuliers 8c officiers généraux. Avancement
des officiers. Des tribuns. Ikid. b. Du général 8c de
fes lieutenans.
Des années de la milice romaine. Ibid. 307. a. Armes (les
velites. Celles des piquiers 8c autres foldats. Ibid. b. Armes
des cavaliers. Machines- employées pour alïïcger les villes.
De la maniéré dont les Romains je rangeaient en b.jlailtc,
Difpofition ordinaire de rarmée. Ibid. 308, a. Autres maniérés
dont on ia difpüfoic félon tes circonffances 6c la fmia-
tion des lieux. Enfcigiies des Romains. Etendards des cava-
^ Deficripiion du camp des Romains. Camps d’été 8c camps
d’hiver. Tentes des principaux officiers. Tentes des foldat*.
Palifiades dont le camp étoit environné. Ibid. 309. a. Portes
8c rues du camp. Foye^ au mot Légion une defeription
exaéle du camp des Romains. Sur la dificipline miliuite des
Romains , voye^ plus bas l’article Militaire. Ibid. b.
■ Milice romaine , voye^ LÉGION , COHORTE 8c ROMAINS ,
(milice des) paie de la milice romaine. XII. 210. a , b.
M IL IEU , (M é ch .) définition. Exemples. X. 309.^.
Milieu, afcenfion éc. dofeente des corps dans différens
milieux , A scension 6c Descente: paffage des rayons
d’un milieu dans un autre. IV. 163. .2. D e la chute des corps
dans les milieux réfiffans 8c non réfiffans, 874. b. Réfiffance
des milieux. X IV . 173. b. Des trajeftoires dans les milieux
réfiffans 8c non réfiffans. X V I . 524, a. *
Milieu éthéré, felon Newton. X. 309. b. Il le regarde
comme le premier reffort de l’univers , 8c la premiere de
toutes les forces; comme la caufe de la réflexion, de la
refraétion 8c de la diffraélion de la lumière. L’ouïe , la v i-
fion 8c le mouvement mufciilaire dépendent dans cette hypo-
thefe, des vibrations de ce milieu. De fa rareté 8c fubtilité.
Il paroit que les cieux ne font remplis d’aucune autre matière
que de ce milieu éthéré ; c’eff une chofe que les phénomènes
confirment. Ibid. 310. a. Caufe de la réfiffance du
milieu. La refiftance des milieux fluides eff à-peu-près pro-
portionelle à leur denfité. Réflexions contre Je milieu clans
lequel fe meuvent les corps céleffes, felon les Cartéfiens
Ibid. b.
Milieu , ( Métapkyfi. ) du milieu entre les extrêmes. Suppl.
II. 929. b. 930 a , b. 8cc.
Milieu à prendre entre les obfiervaùons, (Arithni. Ajlronom.)
On prend ordinairement un milieu entre les réfultats de
pluficurs obfervations d’un même phénomène , lorfqiie ces
léiultats ne font pas tout à fait d’accord entr’eux. Imper-
ledion de cette forte de correélion. Recherches du P. Bofeo-
vich fur cette matière. Suppl. III, 93 3. b. Théorie de M. Lambert
lui- le degré de certitude des obfervations 6c des expériences.
Extrait de deux mémoires fur le fujet dont il s’agit ic i;
l’iin eff de M. Daniel Bernoulli , intitulé: Dijudicario maxime
probabilis plurium obficrvationum dificrepaniium ; atque
verifitmilLim induhio inde fiormanda, Ibid. 936. a. L ’autre eff de
M. de la Grang e, 6c a pour titre : Mémoire fiur l ’utilité de
la méthode de prendre le milieu entre le réfiultat de plufiieurs obfiei-
vations , dans lequel on examine Us avantages de cette méthode
par U calcul des probabilités, 8» où l ’on réfiout différens
problèmes rclaiifis à cette matière. Ibid. 937. a , h.
M ilieu harmonique-(Mufiq.) Suppl. III. 939. a.
Milieu du c ie l, ( Afiron. ) point de l’équateur qui fe
trouve dans le méridien. Méthode pour trouver l’afcenfion
droite du milieu du ciel à une heure quelconque. Suppl.
À^LiT A IR E , dificipline des Romains, (A r t. milit.) elle
confiftoit principalement dans les fervices, les exercices Sc
les loix. Détails fiur les fierviccs 8c l’ordre qu’on y obfervoit.
Services relatifs à ia propreté 8c aux principaux befoins du
camp. Corps-de-garde. Garde durant la nuit. Des fenti-
nellos. X. 3 1 t. a. Rondes 8c mot du guet. Exercices militaires.
Ces exercices regardûient les fardeaux qu’il falioit
■ M u-fai
:-i|!