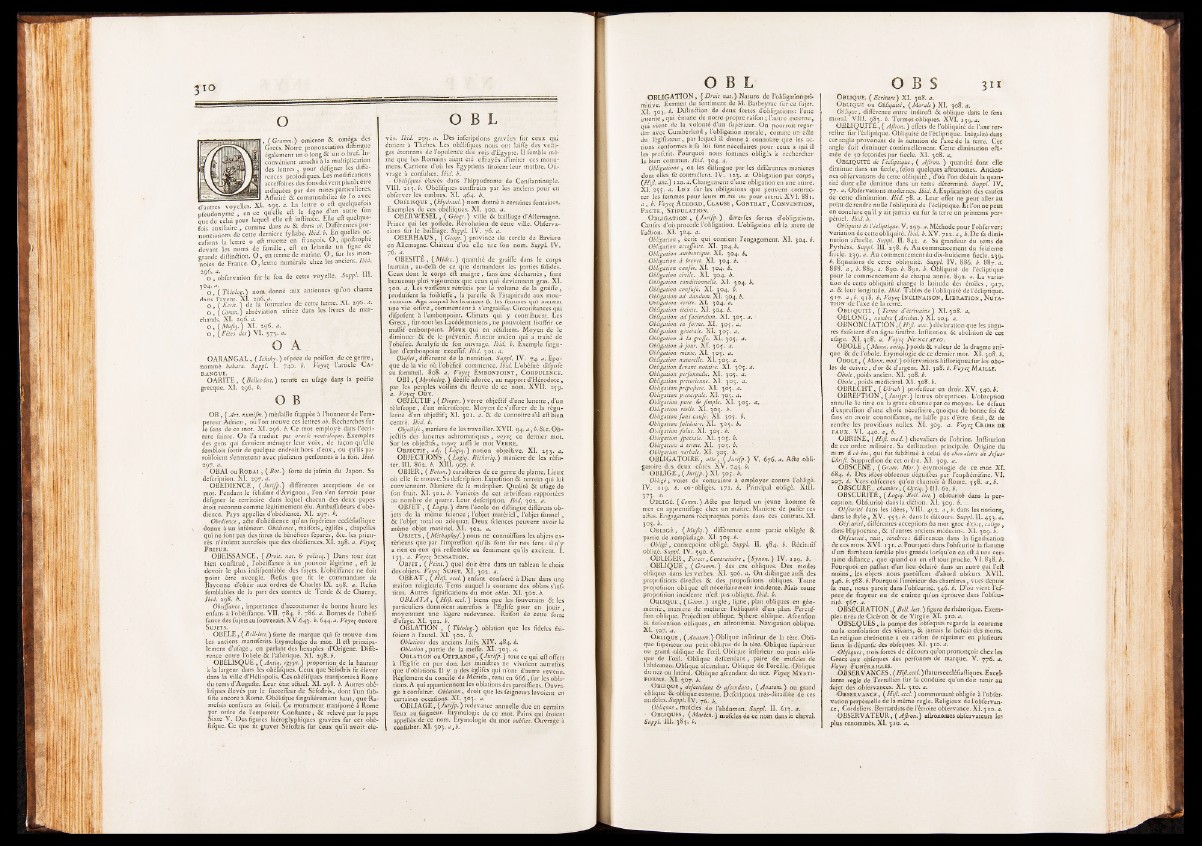
n:
•N
.,k: '1 \\i\ I 1 1 1
n!t . 1 1 '
I)
I 1. ( .
: i o
O
, {Gr<7mm.) omicron & omega des
Grecs. Notre proiionciaiioii clilVmguc
egalement tm o long 6c nn o bref. Inconvénient
attaché à !a multiplication
des lettres , pour déllgner les dide-
rcnces prolodiques. Les modifications
accelToires des fons doivent plutôt être
indiquées par des notes particulières.
Affinité 6c comniutabilité de l’o avec
d-amres voyelles. XI. e<;,. e. La lettre o cil tntelq.tefols
pfeutlonynte , en ce qu'elle eft le f.gne d ut, autre fon
que de celui pour lequel elle eft tnllituee. Ede elt quelquefois
auxiliaire , coiutne dans eu & daus ot.pdïcrentes pro-
nouciatlons de cotte derutere lyllabe. Ihd. b. En quelles oc-
caftoiis la lettre o eft muette en françois. O , apoftroplie
devant les noms de famille , eft en Irlande un ligne de
crande dillinaion. O , en terme de manne. O , lut les mon-
noies de France. O , lettre numérale chez les anciens. Ibid.
/obfervation fur le fon de cette voyelle. Supp!. IIL
^ °o 'r '( r/teo/og.) nom donné aux antiennes qu’on chante
dans l’avem. XI. 296. j .
o , ( Ecrit. ) de la formation de cette lettre. XI. 296. <?.
o , {Conm.) abréviation iifitée dans les livres de mar-
diands. XI. 296. .t.
O , {Muftq.) XI. 296. a.
O , (^Fetes des) V I . 573. <ï . O A O AU AN G A L , ( khihy. ) efpece de poiffion de ce genre ,
nommé Suppl. 1 . b, Voye^ 1 article C a -
RANGUE.
O A R I T E , {Bdies-Utt.) terme en ufage dans la poéfie
grecque. XI. 296. b. O B
O B , {A rt. num'ifm.) médaille frappée à l’honneur de l'empereur
Adrien , où l’on trouve ces lettres ob. Recherches fur
le fens de ce mot. XI. 296. b. Ce mot employé dans l’écrt-
inre fainre. On l’a traduit par oracle ventriloque. Exemples
des sens qui favoient ménager leur v o ix , de façon qu’elle
fembloit fortir de quelque endroit hors d’eu x , oit qu’ils pa-
roiiToient s’entretenir avec plufieurs perfonnes à la fois. Ibid.
297. a.
O B A l o uRo e a i , {B ot.) forte de jafmin du Japon. Sa
defeription. XI. 297. a.
O B ED IEN C E , {Jurifp.) différentes acceptions de ce
mot. Pendant le fchifme d’Avignon, l’on s’en fervoit pour
défigner le territoire dans lequel chacun des deux papes
étoit reconnu comme légitimement élu. Ambaffadeurs d’obédience.
P.ays appelles d’obédience. X L 297. b.
Obedience, a£ie d’obédience qu’un fupérieur eccléfiaflique
donne à un inférieur. Obédience, maifons, églifes , chapelles
qui ne font pas des titres de bénéfices féparés, & c. les prieurés
n’étoient autrefois que des obédiences. XI. 298. a. Eoyej^
P r ieur .
O BEISSANCE , {Droit, nat. 6* poliliq.) Dans tout état
bien conllitué , l’obéiffiince à un pouvoir légitime , eff le
devoir le plus indifpenfable des fujets. L’obéiffance ne doit
point être aveugle. Refus que fit le commandant de
Bayonne d’obéir aux ordres de Charles IX. 298. a. Refus
femblables de la part des comtes de Tende & de Charny,
Ibid. 298. b.
Obeijfancc, importance d’accoutumer de bonne heure les
enfaiis à l’obéiffance. VII. 784. b. 786. a. Bornes de l’obéif-
fancc des fujets au fouverain. X V .643. b. 644. a. Voyet^ encore
Sujets.
O B E L E , forte de marque qui fe trouve dans
les anciens manuferits. Etymologie du mot. Il efl principalement
d’ufage, en parlant des hexaples d’Origene. Différence
entre l’obele & l’allérique. XI. 298. b.
OBÉLISQUE , ( égypt.) proportion de la hauteui
à la largeur dans les obélifques. Ceux que Séfoffris fit élever
dans la ville d'Héliopolis. Ces obélifques tranfportés à Rome
du tems d’AugulIe. Leur état aftuel. XI. 298. b. Autres obé-
lifques élevés par le fiicceifeur de Séfoffris, dont l’un fub-
fiffe encore à Rome. Obélifque finguliéremcnt haut, que Ra-
mefsès confacra au loleil. C e monument tranfporté à Rome
par ordre de l’empereur Confiance , & relevé par le pape
Sixte V. Des figures hiéroglyphiques gravées fur cet obélifque.
C e que fit graver Séfoftris fur ceux qu’il avoit élc-
O B L
vés. Ibid. 299. a. Des infcriptîons gravées fur ceux qui
étoient à Thebes. Les obélifques nous ojtt laiffé des velii-
ges éionnans de l’opulence des rois d’Egypte. Il fenible même
que les Romains aient été effrayés d’imiter ces moiui-
meiis. Carrière d’où les Egyptiens tiroient leur marbre, ü ù -
,ige à confulter. Ibid. b.
Obélifques élevés dans l’iiippodrome de Confiantinoplc.
VIII. lie,, b. Obélifques conftruits par les anciens pour en
obferver les ombres. XI. 464. b..
O bélisque , {Hydraul.) nom donne à certaines fontaines.
Exemples de ces obélifques. XI. 300. a.
OBERWESEL , {Géogr.) ville 6c bailliage d’Allemagne.
Prince qui les poffede. Révolution de cette ville. Obferva-
tions fur le bailliage. Suppl. IV . 76. a.
O B ERH A U S, {Géogr.) province du cercle de Bavière
en Allemagne. Oiâteau d’où elle tire fon nom. Suppl. IV.
76. a. ^
OBESITE , ( Médec. ) quantité de graifie dans le corps
humain , au-delà de ce que demandent les parties folides.
Ceux dont le corps efi maigre , fans être décharnés , font
beaucoup plus vigoureux que ceux qui deviennent gras. XI.
300. a. Les vaiffeaux rétrécis par le volume de la graille,
produifent la foiblefle, la parefie 8c l’inapiitude aux mon-
vemens. Age auquel les hommes 6c les femmes qui mènent
une vie o ifiv e , commencent à s’engraifier. Circonfiances qui
difpofent à l’embonpoint. Climats qui y contribuent. Les
Grecs , fur-tout les Lacédémoniens, ne ponvoient Ibu.ffrir ce
inaffif embonpoint. Maux qui en réfulient. Moyen de le
diminuer 6c de le prévenir. Auteur ancien qui a traité de
l’obéfité. Analyfe de fon ouvrage. Ibid. b. Exemple fingii-
lier d’embonpoint exceffif. Ibid. 301. a.
Oieyîte, différente de la nutrition. Suppl. IV. 74. Epoque
de la vie où l’obéfité commence. Ibid. L ’obéfité difpofe
au fommeil. 808. a. Voye^ E.MBONPOINT, CoRPULENCEO
B l , {Mytholog. ) déeffe adorée, au rapport d’Hérodote ,
par les peuples voifins du fleuve de ce nom. X V II . 259.
a. Voye^ O b Y.
O BJE CTIF , ( Dioptr. ) verre objeflif d’une lunette, d’un
té'.efcope , d'un microfeope. Moyen de s’affurer de la régularité
d’un objeéHf; X L 301. a. 6c de connoître s’il efi bien
centré. Ibid. b.
Objeélifs, maniéré de les travailler. X V II . 94. a , b. 6cc. Ob-
jeélifs des lunettes achromatiques , voye^ ce dernier mot.
Sur les objeftifs, voye:^ aiiffi le mot V erre.
O b j e c t if , {Logiq.) notion objeélive. XI. 233. a.
O B JE C T IO N S , {Logiq. Réthoriq.) manierede les réfuter.
III. 862. b. X IlI. 907. b.
O B IE R , ( Bûtan.) caraéleres de ce genre de plante. Lieux
où elle fe trouve. Sa defeription. Expofition 6c terrein qui lui
conviennent. Maniéré de le multiplier. Qualité 8c ufage de
fon fruit. XL 301. b. Variétés de cet urbriffeau rapportées
au nombre de quatre. Leur defeription. Ibid. 302. a.
O B JE T , {Logiq.) dans l’école on difiingùe différens objets
de la même fcience ; l’objet matériel, l’objet formel ,
6c l’objet total ou adéquat. Deux fciences peuvent avoir le
même objet matériel. XI. 302. a.
O bjets , {Métbaphyf.) nous ne connoiffons les objets e.x-
térieurs que par l’impreffion qu’ils font fur nos fens: il n’y
a rien en eux qui reffemble au feniiment qu’ils excitent. I.
133. a. Voyei SENSATION.
O b je t , { Peint.) quel doit être dans un tableau le choix
des objets. Voyei Sujet. XI. 302. a.
O B E A T , {Hifl. (fcc/. ) enfant confacré à Dieu dans une
maifon religieufe. Tems auquel la coutume des oblats s’inf-
titua. Autres fignifications du mot oblat. XI. 302./».
O B L A T A , {Hiß. eccl. ) biens que les fouverains 6c les
particuliers donnoient autrefois à l’Eglife pour en jouir ,
moyennant une légère redevance. Raifon de cette forte
d’ufage. XL 302. b.
O B L A T IO N , ( Théolog.) oblation que les fidcles fai-
foient à l’autel. XL 302. b.
Oblations des anciens Juifs. X IV . 484. b.
Oblation , partie de la méfié. X L 303. a.
O bla t io n ou O f f r a n d e , tout ce qui efi offert
à l’Eglife en pur don. Les minifires ne vivoient autrefois
que d’oblations. Il y a des églifes qui n’ont d’autre revenu.
Réglement du concile de Mérida, tenu en 666, fur les oblations.
A qui appartiennent les oblations des paroiffiens. Ouvrage
à confulter. Oblation, droit que lesfeigneurs levoicnc en
certaines occafions. XL 303. a.
O B L IA G E , redevance annuelle duc en certains
lieux au feigneur. Etymologie de ce mot. Pains qui étoient
appelles de ce nom. Etymologie du mot oublies. Ouvrage à
i confulter. XL 303. <;,i.
O B L
O B L IG A T IO N , {Droit na;. )N am re de l’obligation primitive.
Examen du lenriment de M. Barbeyrac fur ce fujet.
XI. 303. b. Difilnfiion de deux fortes d’obligations: l’une
interne, qui émane de notre propre raifon ; ra'ucte externe,
qui vient <le la volonté d’un lupérieur. On pourroic regarder
avec Cumberland , l’obligation morale, comme un aéle
du légifi-iteur, par lequel il donne à connoiire que les actions
conformes à fa loi font nécelTaires pour ceux à qui il
les preferit. Pourquoi nous fommes obligés à rechercher
le bien commun. Ibid. 304. a.
Obligations , on les difiingùe par les différentes maniérés
dont elles fe coiuraélent. IV. 123. a. Obligation par corps,
{Hijl. anc.) 1 20. a. Changement d’une obligation en une autre.
X L 255. a. Lo'x l'ur les obligaùons que peuvent contracter
les femmes pour leurs m .ns ou pour autrui. XVI. 881.
a , b. A c c o r d , C l a u s e , C o n t r a t , C o n v en t io n ,
P a c t e , St ipu l a t io n .
O b l ig a t io n , {Jurifp.) diverfes fortes d’obligations.
Califes d’ûii procédé l’obligation. L’obligat.on ell la mere de
l’aéHon. XL 304. a.
Obligation, écrit qui contient l’engagement. XI. 304. i . Obligation accejfoirc. XL 304. i.
Obligation authentique. XI. 304. b.
Obligation à brevet. XI. 304. b.
Obligation caufée. XI. 304. b.
Obligation civile. XI. 304. b.
Obligation conditionnelle. XI. 304. b.
Obligation confufe. XI. 304, b.
Obligation ad dandurn.lL].. 304.
Obligation écrite. XI. 304. b.
Obligation éteinte. XI. 304. b.
Obligation ad faciendum. XI. 303. a.
Obligation en forme. XI. 303. a.
Obligation générale. XI. 305. a.
Obligation à la groffe. X l. 303. a.
Obligation à jour. XL 303. a.
Obligation mixte. XI. 303. a.
Obligation naturelle. XL 303. a.
Obligation devant notaue. XI. 3O3. a.
Obligation pcrjonnellc. XI. 303. a.
Obligation prétorienne. XL 303. a.
Obligation prêpojlere. XL 303. a.
Obligation p.incipale. XI. 303. .1.
Obligation pure & fimple. XI. 303. a.
Obhg.ition réelle. XI. 303. b.
Obligation fans c.iufe. XI. 303. b.
Obligation Jolid.we. XL 303. b.
Obiigation Jolue. XI. 303. b.
Obligation Jpeciale. Xl. 303. b.
Obligation à terme. XI, 303. b.
Obligation verbale. Xi. 303. b.
O B L IG A TO IR E , aüe, {Jurifp.) V . 676. a. Acle obligatoire
des deu.x cotés. X V . 743. b.
O BLIGÉ , ( Juri/p. ) X l. 30 3. b.
Obligé, voies de contrainte à employer contre l’obligé.
IV . 119. b. co-obligés. 171. b. Principal obligé. XlU.
373. a.
O b lig é . ( Com/H.) Aifie par lequel un jeune homme fe
met en apprentlfiage chez un m.ùtic. M.uiiere de palier ces
aéles. Engagemens réciproques portés dans ces contrats. XL
303. b.
O b l ig é , {Mujîq.) différence entre partie obligée Sc
partie de rempliiîage. X I.30 3 .X
Obligé, contrepoint obligé. Suppl. II. 384. b. Récitatif
obligé. Suppl. IV. 390. b.
O B L IG E R , Forcer, Contraindre , {Synon.) IV . 119. b.
. O b l i q u e , ( Gramm. ) des cas obliques. Des modes
obliques dans les verbes, XI. 306. a. On difiingùe auffi des
proptTitions direéles & des propofiiious obliques. Toute
propofition oblique efi néceffalreinent incidente. Mais toute
propolition incidente n’efi pas oblique./Wi/. b.
O b l iq u e , {Géom.) angle, ligne, plan obliques en géométrie
, nianicre de mefurcr l’obliquité d’un plan. Pereuf-
fion oblique. ProjeéUon oblique. Sphere oblique. Afcenfion
6t defcenfion obliques, en afironomie. Navigation oblique.
XL -i07. a.
O b l iq u e , Oblique inférieur de la tête. Oblique
fupérieur ou petit oblique de la tête. Oblique fupérieur
ou grand oblique de l’ccil. Oblique inférieur ou petit oblique
de l’oeil. Oblique defeendant, paire de mufcles de
l'abdomen. Oblique afeendam. Oblique de l’oreille. Oblique
du nez ou latéral. Oblique afcendanc du nez. Voyei^ My r t i -
FORME. XL 307. b.
O b l iq u e , defeendant €’ afeendant, {Anatom.) ou grand
oblique 6c oblique externe. Defeription très-détaillée de ces
mufcles. 5 «/’/)/. IV . 76. i.
, mufcles de l’abdomen. Suppl. II. 613. a,
O b l iq u e s , (M iwVcA. ^ aujfcjçj çg cheval. Suppl. 1 1 1 . 383. b.
O B S 3 1 Î
O b l iq u e . {Ecriture) XI. 308. a.
O b liq u e ou Obliquité, {Morale) XL 308. J.
Oblique, différence entre indireél Ôc oblique dans le fens
morrd. V î l l . 983. b. Termes obliques. X V I . 139. j .
O B L IQ U IT É , ( Aßron. ) effets de l’obliquité de l’axe ter-
refire fur I’cclipriquc. Obliquité de l’écliptique. Inégalité dans
cet angle provenant de la nutation de l’axe de la terre. Ce t
angle doit diminuer continuellement. Cette diminution efii-
niée de 30 fécondés par fiecle. X L 308. a.
O b l iq u it é de l'écliptique, ( Aßron. ) quantité donc elle
diminue dans un fiecle, felon quelques aftronomes. Anciennes
obfervations de cette obliquité, d’où l’on déduit la quantité
dont elle diminue dans un tems déterminé. Suppl. IV .
77. a. Obfervations modernes. Ibid. i . Explication des caufes
de cette diminution. Ibid. 78. a. Leur efi'ec ne peut aller au
point de rendre nulle l’obliquité de l’écliptiquc. Et l’on ne peut
en conclure qu’il y ait jamais eu fur la terre un printems perpétuel.
Ibid. b.
Obliquité de L’écliptique. V . 299. a. Méthode pour l’obferver:
variation de cette obliquité. Ibid. b. X V . 711. a , b.De fa diminution
aéiuelle. Suppl. IL 842. a. Sa grandeur du tems de
Pythéas. Suppl. III. 238. b. A u commencement du feizieme
fiecle. 239. a. Au commenccmentdu dix-huitieme fiecle. 239. b. Equations de cette obliquité. Suppl. IV . 886. b. 887. a.
888. a , b. 889. a. 890. b. 891. b. Obliquité de l’écliptique
pour le commencement de chaque annee. 89a. a. La variation
de cette obliquité cltange la latitude des étoiles , 917.
a. & leur longitude. Ibid. Tables de l’obliquité de l’écliptique.
917. a ,b . 918. b. In c l in a iso n , L ib r a t io n , Nu t a t
io n de l’axe de la terre.
O b l iq u it é , ( d'écrivains) XI. 308. a.
O B LO N G , nombre {Arithrn.) Xl. 204. a.
O B N O N C IA T IO N , ( Hiß. a n c . ) déclaration que les augures
faifoieiit d’un figue finifire. Inflitiuion 6c abolition de cec
ufage. XI. 308. a . V o y c:^ N u s c i a t i o .
ÔBOLE , {Monn. aniiq.) poids 6c valeur de la dragme atti-
que & de l ’obole. Etymologie de ce dernier mot. X L 308, i .
O bole , ( Monn. mod. ) obfervations hifioriqueifur les oboles
de cuivre , d’or 6c d'argent. XI. 308. b. Poye^^ Ma i l l i .
Obole, poids ancien. XI. 308. b.
Obole, poids médicinal. XI, 308. b.
OB R E C H T , ( É/Zac/i ) profelfeur en droit. X V . 340.
OBREPT ION , ( 7 Kt//pr.) lettres obreprrlces. L’obreptioo
aniuille le tit ie o u la grace obtenue par ce moyen. Le défaut
d’exprdfion d’une chofe nécefiàire, quoique de bonne foi 6c
fans en avoir connoiffance, ne laific pas d’être fatal, 6c de
rendre les provifions nulles. XI, 309. a. C rime DE
FAUX. V I. 440. a, b.
O BR IN E , {H iß. mod.) chevaliers de i’obrine. Infiltution
de cet ordre militaire. S.i defiination principale. Origine du
nem d ob ine, qui fut fubfiitué à celui de chevaliers de Jefus‘
Chriß. Supijrcfilon de cet ordre. Xl. 309. a.
O B SCEN E , {Gram. Mor.) étymologie de ce mor. XL
684. b. Des idées obicenes déguilees par reuphémifine. VI.
207. b. Vers obfcenes qu’on chantoit à Rome. 538. a, b.
O B S CU R E , chambre, ( Optiq. ) III. 62. b.
O B SCU R ITÉ , {Logiq. Bell. Icit.) obi'curité dans la perception.
Obfcuriié dans la diélion. X l. 309. b. .
OLfeurité dans les idées, VIH. 492. a , b. dans les notions,
dans le ftyle , X V . 33 3. è. dans le dilcours. Suppl. IL 433. a.
O lf.untc, différentes acceptions du mot grec kXX-î , caligo ,
dans Hippocrate, 6c d’autres anciens médecins. X l. 309. b.
Obfcurité, nuit, ténèbres: différences dans la figniricatioci
de CCS mots. X V I . 131.0 . Pourquoi dans l’obfcurité la flanune
d'un flambeau fenible plus grande lorfqu’on en tft à une certaine
diftnnce, q^ue quand on en efi tout proche. VI, 83 8. i .
Pourquoi en paffanr d’un lieu éclairé dans un autre qui l’eft
moins, les objets nous paroiffeni d’abord obf'curs. X V I I .
346. b. 368. b. Pourquoi l’iiitérieur des chambres, vue.s depuis
la rue, nous paroit dans l’obfcurité. 346. b. D ’où vient l’eC
pece de frayeur ou de crainte qu’on éprouve dans l’obfcu-
rité. 367. a.
OBSÉCR A T IO N , (Rc//. /e«.)figure de rhétorique. Exemples
tirés de Cicéron & de Virgile. XL 310. a.
O BSEQUES , la pompe des obfeques regarde la coutume
ou la confolation des vivans, Si jamais le befoin des morts.
La religion chrétienne a eu raifon de réprimer en plufieurs
lieux la dépenfe des obfeques. XI. 310. a.
ObJ'cques, trois fortes de difcoiirs qu’on prononçoit chez les
Grecs aux obfeques des perfonnes de marque. V. 776. a.
Voye{ F unérailles.
•OBSERVANCES, (fff/j^.«cc/.)fiatutsecdefiafiiques.Excellente
regle de Tcrtullien fur la conduite qu’on doit tenir au
fujet des obfèrvances. XI. 310.^1.
O b servance , ( Hiß. eccl. ) communauté obligée a l’obfer-
vation perpétuelle de ta même regle. Religieux de l'obfervan-
c c , Cordeliers. Bernardins de l’étroite obÄrvance. XL 310. a.
O B SER V A T EU R , (Ayiron.) agronomesofafervateurs les
plus renommés. X l. 310. a.