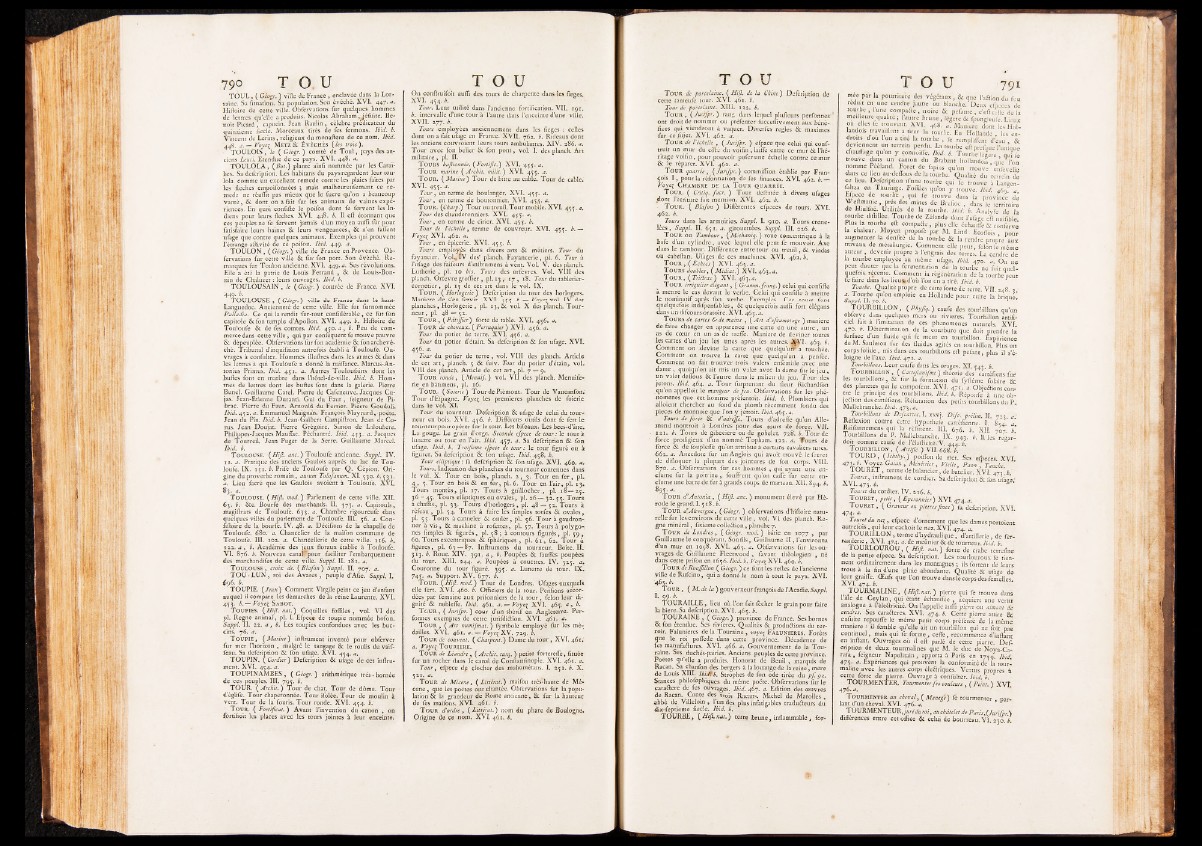
I
f : i ! î
i
790 T O U
T O U L , ( Gèogr. ) ville Je France , enclavée dans la Lorraine.
Sa fituation. Sa population. Son évéclié. X VI. 447. a.
Hifloirc de cette ville, ôblérvarions fur quelques hommes
de lettres qu’elle a produits. Nicolas Abraliaiii, jéfuite. Benoit
Picard, capucin. Jean Raulin , célébré prédicateur du
quinzième fiecle. Morceaux tirés de fes fermons. h.
Vincent Je Lerins, religieux du monartere de ce nom. Ihid.
448. Vùyci Metz S: Évêchés (/« trois).
T O U LO IS , U ( Geogr.) comté de T o u ! , pays des anciens
Lcuà. Etendue de ce pays. X V I. 448. a.
T O U L O L A , {Bot.) plante ainfi nommée par les Caraïbes.
Sa defeription. Les habitans du pays regardent leurtou-
lola comme un c.xcellent remede contre les plaies faites par
les ficelles empoifonnées ; mais malheuretifemcnt ce re-
niede ne réuRit pas mieux que le fucre qu’on a beaucoup
v anté, & dont on a fait fur Us animaux de vaines expériences.
En quoi confdlc le poifoii donc fe fervent les Indiens
pour leurs fléchés. X V I . 448. b. Il eft étonnant que
ces peuples ne fe fervent jamais d’un moyen aiiifi lur pour
faiisfaire leurs haines & leurs vengeances, & n'en falTetu
ufage que contre quelques animau.x. Exemples qui prouvent
l ’étrange aélivité de ce poifon. Ibid. 449. a.
T O U L O N , {Gèogr.) ville de France en Provence. Ob-
fervations fur cette ville & fur fon port. Son évêché. Remarques
fur Toulon ancienne. XVI. 449. Ses révolutions.
Eüe a été la patrie de Louis Ferrand , & de Louis-Bon-
nin de Clialucec : leurs ouvrages. Ibid. b.
T O U L O U S A IN , le (Gfugr. ) contrée de France. XVI.
449. b.
TO U LO U SE , {Géogr.) ville de France dans le haut-
Languedoc. Ancienneté do cette ville. Elle fut furnommée
Pulljdi.s. Ce qui la rendit fur-tour confidérable , ce fut fon
Capitole & fo n temple d'Apollon. X V I. 449. b. Hiftoire de
Touloufe & de fes comtes. Ibid. 450. a , b. Peu de commerce
dans cette ville , qui par conféquent fe trouve pauvre
&. dépeuplée. Obfervations fur fon académie &. fon archevêché.
Tribunal d’inquifuion autrefois établi à Touloufe. Ouvrages
à confulter. Hommes illuBres dans les armes & dans
les lettres à qui Touloufe a donné la naüTance. Marcus-An-
tonius Primus. Ibid. 451. a. Autres Touloufains dont les
bulles font en marbre dans l’hôtel-de-ville. Ibid. b. Hommes
de lettres dont les buftes font dans la galerie. Pierre
Bunel. Guillaume Catel. Pierre de Cafeneuve. Jacques Cujas.
Jean-Etienne Duranti. Gui du Faur , feigneur de Pi-
brac. Pierre du Faur. Arnould du Ferrier. Pierre Gouduli.
Ibid. a. Emmanuel Maignan. François Maynard, poëte.
Jean du Pin. Ibid. b. Jean-Galbert Campiftron. Jean de C o rns.
Jean Doujat. Pierre Grégoire. Simon de Laloubere.
Philippes-Jacques Mauifac. Péchanrré. Ibid. 453, a. Jacques
de Tourreil. Jean Pugec de la Serre. Guillaume Marcel.
Ibid. b.
T oulouse. {Hiß. anc.) Touloufe ancienne. Suppl. IV.
12. a. Pratique des anciens Gaulois auprès du lac de To u loufe.
IX. 15 1.^. Prife de Touloufe par Q . Cépion. Origine
du proverbe romain , auruin ToloJjnum. XI. 330. b. 331.
a. Lieu facro que les Gaulois avoient à Touloufe. X ’C''!.
83.
T oulouse. {H iß . mod. ) Parlement de cette ville. XII.
63. h. Sic. Bonrfe des marchands. II. 373. a. Capitoiils,
magiUrats de Touloufe. 633. a. Chambre rigoureufe dans
quelques villes du parlement de Touloufe. 111. 36. a. Con-
filloire de la bourfe. IV, 48. a. DécHîons de la chapelle de
Touloufe. 680. a. Chancelier de la maifon commune de
Touloufe. III. 102. a. Chancellerie de cette ville. 116. b.
î i i . a , b. Académie des jeux floraux établie à Touloufe.
V I . 876. b. Nouveau canal“ pour faciliter l’embarquement
des inarchandifes de cette ville. Suppl. II. 181. a.
T oulouse, croix de. {B b fo n ) Suppl. II. 707. a.
T O U - LUN , roi des Avares , peuple d’Afie. Suppl I.
^96. b.
TOUPIE. {Jcii.x) Comment Virgile peint ce jeu d’enfant
auquel il compare les démarches de la reine Laurence. X V I .
453. b.— SaBOT.
T oupies. {H ß . nat.) Coquilles foflîles , vol. V I des
pl. Regne animal, pl. I. Efpece de toupie nommée bofon.
Suppl. II. 22. a , b. Les toupies confondues avec les buccins.
76. a.
T oupie, {A h r ine ) infiniment inventé pour obferver
fur mer l’horizon , malgré le tangage & le roulis duvalf-
feau. Sa defeription & fon ufage. X V I . 434. a.
TOUPIN . {Cordier) Defeription & ufage de cet infiniment.
X V I . 434. a.
TOU PIN AMBES , {Géogr.) arithmétique très-bornée
de ces peuples. III. 793. b.
TO U R . {A rchil.) Tour de chat. Tour de dôme. Tour
d'èglife. Tour chaperonnée. Tour ifolée. Tour de moulin à
vent. Tour de la fouris. Tour ronde. X V I. 434. b.
T our, ( Fortificat. ) Avant l’invention dn canon , on
fortifioit les places avec les tours jointes à leur enceinte.
T O U
On confli ulfoit aufll des tours de cliarpcntc dans les ficges.
X V I . 434, é.
Tour. Leur utilité dans l’ancienne fortification. VII. 191.
b. intervalle d’une tour à rature dans l'enceinte d’une ville.
X V I I . 277. b.
Tours employées anciennement dans les ficges ; celles
dont on a fait ufage en France. XV II . 762. b. Ruleaux dont
les anciens couvroiem leurs tours ambulantes. X IV . 286. a.
Tour avec fon belier £c fon pont, vol. I. des pianch. Art
militaire, pl. H.
T ours baflionnèc. {Fortifie.) X V I . 433. a.
T our murine {Archit. mUit.) XVI. 433. a.
T o u r . {Murine) Tour de bitte au cable. Tour de cable.
X V I . 455-
Tour , en terme de boulanger. X V I . . .
Tour, en terme de bouionnier. X V I . 43.3. a.
T our. {Churp.) ToHroutreuil. T our mobile. X V I . 433. a.
rewr des chiiuderonniers. X V I . 433.
Tour, en terme de drier. XVI. 455. b.
Tour de Iéchelle, terme de couvreur. XVI. 433. F .—
Voye:^ XVI. 462. a.
Tour, en épicerie. X V I . 433. b.
Tours employés dans divers arts 8c métiers. Tour du
fayander. V o L lV des’ planch. Fayancerie, pi. 6. Tour à
l’iifage des faifeurs d’inilnimens à vent. Vol. V . des planch.
Lutherie , pl. 10 bis. Tours des orfèvres. Vol. VII I des
plunch. Orlevre g rolfier, pl. 13 , 1 7 , 18. Te;//-du tableiicr-
corneticr, pl. 13 de cet art dans le vol. IX.
T our. {Horlogerie) Defeription du tour des horlogers.
Maniéré de s’en fervir. X V I . 433. b. — Voyez yo\. IV des
planches , Horlogerie , pl. 13, 8c vol. X des planch. Tourneur,
pl. 48 — 32,
T o u r , {Pânjfier) forte de table. X V I . 436. u.
T our de cheveux, {Perruquier) X V I . 436. a.
Tour du potier de terre. X V I. 436. <2.
Tour du potier d’étain. Sa defeription & fon ufage. X V I.
436. a.
Tour du potier de ter re , vol. VII I des planch. Article
de cet a r t , planch. 3 8c fuiv. Tour du potier d’étain, vol.
VII I des piancti. A i tide de cet a rt, pl- 7 — 9.
T our ronde, {Menuij.) vol. VII des planch. Menulfe-
rie en bànmens, pl. 16.
T our. {Soierie) Tour de Piémont. Tour de Vaucanfon.
Tour d’Elpagne. Voyei^ les premieres planches de foierie
dans le vol. XI.
Tour du tourneur. Defeription &. iifijgc de celui du tourneur
en bois. X V I. 436. b. Différons outils dont fe fert le
tourneur poiiropérer fur le tour. Les bifeatix. Les becs-d’âne.
La gouge. Le grain d’orge. Seconde efpece de cour: le tour à
lunette ou tour en l’aii'. Ibid. 437. u. Sa defeription 8c fon
ufage. Ibid. b. Troificme efpece de tour: le tour figuré ou à
figurer. Sa defeription & fon ufage. Ibid. 438. b.
Tour elliptique : fa defeription 8c fon ufage. X V I . 460. a.
Tours. Indication des planches du tourneur contenues dans
le vol. X. Tour en bois, planch, a , 3. Tour en fe r , pl.
4 , 3. Tour en bois 8c en fe r, pl. 6. Tour en l’air, pl. 1 3.
Tours montés, pl, 17. Tours à guillocher , pl. 18— 23.
3 6 -4 3 . Tours elliptiques ou ovales, pl. 26 — 32. 33. Tours
à chaflis, pl. 33. Tours d’horlogers, pl. 48 — 32. Tours à
réfeau , pl. 34. Tours à faire les fimples rorfes 8c ovales,
pl. 35. Tours à canueler 8c oiuler, pl. 56. Tour à gaiidron-
iier à v is , 8c machine à rofettes, pl. 57. Tours à polygones
fimples 6c figurés, pl. 38 ; à contours figurés, pl. 3 9 ,
60. Tours excentriques & fphériqiies , pl. 6 1 , 62. Tour à
figures, pl. 6 3— 87. Infirumens du tourneur. Boîte. II.
313. b. Roue. X IV . 391. a , b. Poupées & faufies poupées
du tour. XIII. 244. a. Poupées à couettes. IV . 323. a.
Couronne du tour figuré. 393. a. Lunette de tour. IX.
743. a. Support. XV. 677. b.
T our. {Hifl. mod.) Tour de Londres. Ufages îuixquels
elle fert. X V f . 460. b. Officiers de la tour. Penfions accordées
par femaine aux prifonniers de la to u r , felon leur dignité
8c nobleffe. Ibid. 461. u.^Voy e^ X V I . 463. a , b.
T o ur , {Jurifpr.) cour d’un shérif en Angleterre. Per-
fonnes exemptes de cette junfdiélion. X V I . 461. u.
T o u r , { A n numijmat.) fymbole employé fur les médailles.
X V l, 46t. <J. — X V . 729. b.
T our de couvent. ( Charpent.) Dame du tour , XVI. 461,
a. Voyei T ouriere.
T our de Léandre , { Archit. turq. ) petite fortereffe, fituée
fur un rocher dans le canal de Confiantinople. X V l. 461. a.
Tour, efpece dp clocher des inahoniéians. 1. 251. b. X.
521. a.
T our de Mécene, {Littérat.) maifon très-haute de Mécène
, que les poètes ont chantée. Ob/ervations fur la population
6c la grandeur de Rome ancienne, 6c fur la hauteuc
de fes maifons. X V L 461. b.
T our d'ordre, {Littérat.) jtom du phare de Boulogne,
Origine de çe nom. XVI, 461. b.
T O U
T o u r de porcelaine. { Hifi. de lu Chine) Defeription dc
cette tameiife tour. X V l. 461. b.
Tour de porcelaine. XIII. 122. b.
T o u r , {Jn nfp '-) rang dans lequel pluficurs perfonnes
ont droit de nommer ou préfenter (ucceiîivemem aux bénéfices
qui viendront à vaquer. Diverlès règles 8c inaxhncs
fur ce fujet. X V I. 462. a.
T our de TéchelU , ( Jurifpr. ) efpace que celui qui conf-
truit un mur du col-- (lu voifin , lailTe entre ce mur 6c l’héritage
voifin , pour pouvoir poferime échelle contre ce mur
6c le réparer. X V I . 462. a.
T our quarree, {Jurifpr.) conimiffion établie par François
I , pour la reformation de fes finances. X V I. 462. b._
Voye^ Chambre de la T our quarrée.
T our. ( Cmiq. fier. ) Tour ciellinéc à divers ufages
^lont l’écriture fait mention. X V l. 462. b.
T our. ( Blafon ) Dift'érentes cfpeces de tours. X V L
462. b.
Tours dans les armoiries. Suppl. I. 910. a. Tours crénelé
es , Suppl. II. 631. u. giroueitées. Suppl. III. 226. b.
T our ou Tambour, {Méchaniq. ) roue concentrique à la
bafe d'tm cylindre, avec lequel elle peut fe mouvoir. Axe
d.ins le tambour. Différence entre tour ou treuil, 6c vindas
ou cabedan. Ufages dc ces machines. X V L 46a. b.
T o u r , {Echecs) X V l. 463. a.
T ours doubles, {Médiat.) XVI. 463.
T our , {Triärac) X V I. 463..2.
T our irrégulier élégant, { Gramm, fr.mç.) celui qui confide
H mettre le cas devant le verbe. Celui qui confifte à mettre
le nominatif après fon verbe. Exemples. Ces tours font
quelquefois indifpenfiibles, 6c quelquefois aulli fort élégans
dans un difeours oratoire. X V I. 463../.
T ours de canes & de mains , { A n d’efcamoiage ) maniéré
de faire changer en apparence une carte en une autre, un
as de cceur en un as de treffe. Manière de deviner toutes
les cartes d’un jeu les unes après les autres. .J^VI. 463. b.
Comment ou devine la carte que quelqu’un a touchée.
Comment 011 trouve I.1 carte que quelqu’un a penlée.
Comment on fait trouver trois valets enlêmble avec une
dame, quoiqu’on ait mis un valet avec In dame f ii r le j c u ,
un valet deffoiis 6c l’autre dans le milieu du jeu. Tour des
jetons. Ibid. 464. a. T o u r furprenant du ficur Richardfoii
qu on appelloit le mangeur de feu. Obfcrvations fur les phénomènes
que cet homme préfentoit. Ibid. b. Plombiers qui
alloient chercher au fond du plomb récemment fondu des
pieces de monnoie que l’on y jeiioit. Ibid. 463. a.
Tours de force 8c d’adrejfe. Tours d'adiclTe qu’un A lle mand
montroit à Londres pour des tours de force. VII.
. 121. b. Tours de gibecière ou de gobelet. 728. i. Tour de
force prodigieux d'un nommé Topham. 122. a. Tours de
force 6c de fouplelTe qu’on attribue à certains cavaliers turcs.
662. a. Anecdote fur un Anglois qui avoir trouvé le fecret
de dilloqiier la plupart des jointures de fon corps. VIII.
870. a. Obfervations fur ces hommes , qui ayant une enclume
fur la poitrine , fouiTrem qu’on cafle fur cette enclume
une barre de fer à grands coups de marteau. XII. 894. b.
S 9L .
T o u r d'Antonia , ( Hifi. anc. ) monument élevé par Hé-
rode le grand. I. 318, b.
T our d'Auvergne, {Géogr.) obfervations d'hifioire naturelle
fur les environs de cette ville , vol. V I des pl.mch. Regne
minéral, fixieme colleélion , planche 7.
T our de Londres, {Géogr. moJ.) bâtie en 1 0 7 7 , par
Guillaume le conquérant. Son fils, Guillaume I I , l’environna
d’un mur en 1098. XVI. 463. a. Obfervations fur les o u vrages
de Guillaume Fleenvood , favant théologien , né
dans cette prifon en 1636. Ibid. b. Voye:^ XVI. 460. b.
T our deRouffillon ( Géogr. ) ce font les refies de l ’ancienne
ville de Rufeint), qui a donné le nom à tout le pays. X V I .
463. b.
T our , { M.de U ) gonverneur François de l ’.A.cadie.
I. 99. L
TO U RAILLE , lien où l’on fait fccher le grain pour faire
la blerc. Sa defeription. X V I. 463. b.
T O U R A IN E , {Géogr.) province de France. Ses bornes
6c fon étendue. Ses rivieres. Qualités Sc prodiiélions dn terroir.
Falunieres de la Touraine , voyf^; Falunieres. Forêts
que le roi poffedo dans cette province. Décadence de
fes mamifaélures. XVI. 466. a. Gouvernement de la T o u raine.
Ses duchés-pairies. Anciens peuples de cette prcrvince.
Poètes qu’elle a produits. Honorât de Beuil , marquis de
Racan. Sa chanfon des bergers à la louange de la reine, mere
de Louis XIII. Ibid* b. Strophes de fon ode tirée du pj-ya.
Stances philofophiques du même poète. Obfervations fur le
caraftere de fes ouvrages. Ibid. 467. a. Edition des oeuvres
de Racan. Conte des trois Racnns. Michel de Marolles ,
abbé de Villeloin , Tun des plus infatigables tradmficurs du
«lix-feptieme fiecle. Ibid, b.
TO U R B E , {H ifi.n u i.) terre brune, inflaaunable, for-
T O U 791
mée par la poiirriime des v égétaux, 8c que fiaaiondu f u
rédim en »me cendre jaune on blanche. Deux efpuce» de
tourbe , l’une compafte , noire & pefantc , c'eflcJ I- de l i
meilleure qualité; l’autre brune , légère 6c fpong'eufe’ Li ux
ou elles fe trouvent. XVI. 468. u. Maniéré dont ic^ Hol-
landois trav.uli.nt à tirer la tourbe. En Hollande , les endroits
dou Ion a tire la tourbe , fe rempl.ffem d’eau , &
deviennent un terrem perdu. La lourbe efi prefinie rmuuue
chaufiage quon y connodre. Ib,d. b. Tourbe lege^c qui fe
trouve dans un canton chi Brabant hollandoit ' i’on
nomme Pééland. Foret dc fapins qu’on trouve ’ e'„ibvcIio
dans ce lieu au-deffous de la tourbe. Qualité du tei rc-in de
ce lieu. Defeription d’une tourbe qui fe trouve â Lanaen-
G tza en Tluirmge. Follile. qu’on y trouve. IbiJ.
Efpece de tourbe , qui le tioiive dans la province de
We fimame , près des mines de BrUioc , dans le territoire
de Hmlloc. Utilités de la tourbe. ibiJ. h. A!ia!y'‘o de Li
tourbe diftilléc. Tourbe de Zélande dont l’ufage ell miifible.
Plus la tourbe efi compare, plus elle échauffe Sc conferve
la chaleur. Moyen propofé p;.r M. Lind Ecoflois pour
augmenter la denfité de la tourbe 8c la rendre propre aux
travaux de métallurgie. Comment elle peut, félon Je même
auteur devenir propre .à l’engrais des terres. La cendre de
la tourbe employée au même ufage. Ibid. 470. a. Ou uc
peut douter que la fermentatiim de la tourbe ne fi,it quelquefois
récence. Comment ia régenératien dc la tourbe peut
le faire dans les lieux, d’où l’on en a tiré. Ibid. b.
Tourbe. Qualité propre de cette forte de terre. VII ■’ 48
a. Tourbe qu’on emploie en Hollande pour cuire la brique!
Suppl. TI. 70. b. a '
TO U R B IL LO N , {P h y fq .) caufe des toiirliillons qn’on
oblcrve d.mj. quelques mers ou rivières. Tourbillon artificiel
fait a l im.ration dc ces pheno.menes naturels. X V I.
470. b. Détermination de la courbure que doit prendre la
lurfacc d’un fluide qui fe meut en tourbillon. Expérience
d eM. Saulmon fur des fluides agités en touibillon. Plus un
corpsfolide, mis dans ces tourbillons efi pelant, plus il s’éloigne
de l’axe. Ihia. 471. a.
Tourbillons. Leur caufe dans les omges. XL 343. b.
T o u r b il l o n , { tjn,/,J,,,/;,,,) iiiéorie des cané'dens fur
les touroiltons, 8c lur la form..tion du fvfiéme folaire 6c
des planètes qui le conipofenr. XVI. 4 7 i .'u Obieaioiiscontre
le principe des tourbillons. l i i j . i. Réponfe à une ob-
jedion des cartcfiens. Retutalloii des petits tourbillons dn P.
Mallebranche. Jbid. 473, a.
Tourbillons de Dejcar:es.\. xxvj. Dlfc. prcllm. II. .2
Reflexion contre cette hyputhele canéficnne 1 é e l a
Raifonnemens qui h réfutent. III. 676. b. XII. 707. b.
Tourbillons du P. Mallebranche. IX. 943. b. Il les rei’ ar-
doit comme cmife de réliilliciié. V aa. b °
T oubbillon , ( A n ifc ) VU. bdS. b,
T Ü U R D , {Ichthy.) polifoiKle mer. Scs efpeces. X V I
r '-o n , Tancb,,.
IO U R jlT , rermedebalancier,de batelier. X V I 473 b
Tourei, inflrument de cordicr. Sa defcripiion 6clbn ufaee'
X V l. 473. E &
Touut du cordier. IV . 216. b.
T oURET , petit, ( Eperonnier) XVI. 474, a.
T ourE T , ( Graveur en pierres fines) fa defeription. X V I .
474. a. ‘
Touret du ne:’ , efpece d’ornement que les dames nortoient
autrefois , qui leur cachoit le nez. XVI. 474.
TO U R IL LO N , terme d’h^^drauliqiie, d’artillerie , de ferraïUerie
, X V l. 474. a. de meunier 8c de tourneur. Ibid. b.
TO U R LO U R O U , ( Hlfi. nat.) forte de crabe terrefire
de la pente efpece. Sa defeription. Les tourlouroux fe tiennent
ordinairement dans les montagnes ; ils fortent de leurs
trous à la fin d’une pluie abondante. Qualité & ufage de
leur grailTe. OEufs que l’on trouve dans le corps des femelles.
X V I . 474. b.
TO U RM A L IN E , {Hifi.nat.) pierre qui fe trouve dans
lifîe de C e y lan , qui étant échaufiec , acquiert une vertu
analogue à l’éleélricitc. On l’appelle aufll pierre ou .lim.int de
cendres. Ses caraèfcres. X V l. 474. b. Cette pierre attire 6c
enfuite repouffe le même petit corps préfenté dc la meme
maniéré ; il femble qu’elle ait un tourbillon qui ne l’oit pas
continuel, mais qui fe forme, celle, recommence d’infiant
en infiant. Ouvrages où il efi parlé de cette pierre. D e feription
de deux tourmalines que M. le duc de Noya-Ca-
r a fa , feigneur Napolitain, .apporta à Paris en 1739. Ibid. 473- Expériences qui prouvent la conformité de la tourmaline
avec les autres corps éleftriqucs. Vertus propres à
cette forte de pierre. Ouvrage à confulter. Ibid. b.
TOU RMENTER. Tourmenter fes couleurs , ( Peint. ) X V Î
476- a.
T ourmenter un cheval, ( Manege) fe tourmenter parlant
d’im cheval. XVI. 476. a. ’ ^
TOURMENTEUR,yürèu'üro/,Æ«cA<2tf/ct de Paris,{.furif'pr.y
différences entre cet office 6c celui de bourreau. V I. 230. k